Alexandre Journo
Traversées antisionistes
À propos d’Antisionisme, une histoire juive (Syllepse, 2023)
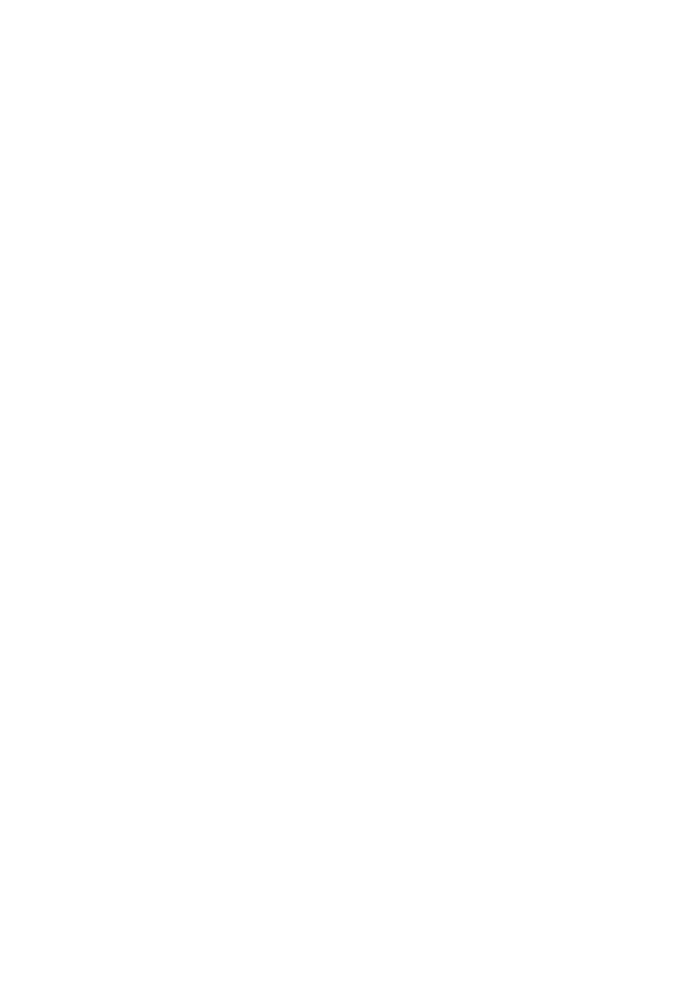
Paul Klee, Fantôme d'un génie, 1922
Michèle Sibony, Béatrice Orès et Sonia Fayman ont mis à la disposition du public un recueil de textes antisionistes, voulant ainsi démontrer que par-delà les différences d’approches, entre assimilationnistes, libéraux, ultra-orthodoxes, toutes sortes de Juifs convergent pour condamner l’existence d’Israël. L’anthologie composée par ces trois auteures est donc résolument polyphonique, ses textes sont souvent contradictoires et excessifs — on y reviendra —, mais ils touchent certaines des limites et contradictions internes du sionisme. Aussi cette publication a-t-elle un mérite fondamental. À l’heure où l’antisionisme gagne une position centrale dans le débat public sans qu’il n’y soit pourtant tout à fait défini, y compris et surtout par ceux et celles qui s’en réclament, ce livre permet d’en dessiner les contours. Certains textes procèdent pourtant d’autres perspectives que l’antisionisme. C’est le cas d’un texte de Martin Buber appelant à un sionisme de régénération nationale ou un autre de Daniel Boyarin démontrant l’inanité de la pensée antisioniste quand elle aborde la définition nationale ou non du fait juif. Mais c’est également le mérite de l’ouvrage que de laisser ainsi place à de telles voix dissonantes.
Il en va de la sorte des textes ultra-orthodoxes rassemblés ici. Ces ultra-orthodoxes tiennent pour hérétiques ces antisionistes sécularisés et ces antisionistes sécularisés n’ont d’estime pour la pensée ultra-orthodoxe que dans son aspect antisioniste. Deux nœuds de la pensée antisioniste se jouent là : la notion de nation et celle d’élection du peuple juif. La pensée antisioniste achoppe sur ces deux notions quand elle condamne le sionisme, mais il y a là une ruse de l’histoire. Ces notions, elle les adopte de fait, c’est l’objet de cette note.
Histoire juive de l’antisionisme… et du sionisme
Avant d’entrer dans le vif, un bref rappel historique. Le sionisme politique naît à la fin du XIXème siècle en Europe, en réaction à la persistance de l’antisémitisme après l’Émancipation (les pogromes de 1881-1882 en Russie tsariste, puis l’Affaire Dreyfus), mais aussi à la menace existentielle d’assimilation qui est consubstantielle de l’Émancipation (ce que Baruch Hagani expose dans L'émancipation des Juifs, 1928, Rieder). À peu près en même temps, d’autres réponses à la question juive sont formulées, l’assimilation, le revivalisme religieux ou le bundisme, c’est-à-dire l’émancipation des travailleurs juifs ici et maintenant, le doikayt. Ces réponses à la question juive s’opposent au sionisme, parce qu’elles concurrencent cette voie, et l’estiment délétère pour le fait juif en Europe, soit qu’il fragilise l’intégration nationale obtenue après l'Émancipation, soit qu’il a un effet dilatoire vis-à-vis de la question sociale. Mais il serait malhonnête de définir ces réponses à la question juive comme antisionistes. Ou bien cela reviendrait à dire que tout ce qui n’est pas ceci est anti-ceci plutôt que d’être cela, et à leur retirer tout contenu positif pour que ne subsiste qu’une définition en creux, vis-à-vis du sionisme, lequel n’avait pourtant pas encore la centralité qu’il a acquise plus tard au sein des communités juives.
Dans la première moitié du XXème siècle, le sionisme est en effet minoritaire chez les Juifs, qui expriment surtout de la perplexité devant ce projet d’apparence utopique — ce qui conduit les auteures à la conclusion que la plupart des antisionistes étant hier juifs, tandis que la plupart des sionistes étant aujourd’hui non-juifs, l’antisionisme est un plus authentique héritier du judaïsme que le sionisme. Progressivement cependant, puis par à-coups, le sionisme n’en gagne pas moins en popularité au sein des institutions juives les plus centrales. Dans l’entre-deux-guerres, dans les grandes villes d’Europe, la plupart des mouvements de jeunesse et des étudiants juifs se structurent progressivement autour du sionisme — ainsi à Vienne, Franz Kafka et Max Brod étaient sionistes lors de leurs études, Joseph Roth et Soma Morgenstern, le fils de Sigmund Freud, etc. et de la même manière à Paris, si l’on songe aux publicistes juifs des années 20. Souvent, par transgression vis-à-vis de la voie tout ou partie assimilationniste élue par leurs parents et comme moyen d’exprimer une fierté juive à l’heure antisémite. Mais très tôt, des premières critiques poignent, parmi lesquelles celles du Brith Shalom dans le Yishouv qui regrette la conflictualité avec les Arabes que le sionisme n’a de cesse d’induire.
La deuxième mue n’est pas générationnelle, c’est la Shoah. Six millions de Juifs sont exterminés, parmi eux, un grand nombre des militants du Bund. Il est souvent reproché au sionisme sa philosophie de l’histoire pessimiste, sa manière de concevoir l’antisémitisme comme immuable, comme une psychose des nations contre laquelle on ne peut rien si ce n’est la fuite. Or, la Shoah a largement accrédité par le pire la vision sioniste de l’histoire universelle.
À partir de là, de l’après-guerre et de 1948 en particulier, le sionisme triomphe dans le monde juif, dans ce qu’il reste du monde juif, soit une large communauté américaine, des diasporas en Europe occidentale, des « personnes déplacées » rescapées de la Shoah, la diaspora soviétique et celles du monde arabo-iranien, en sus des quelques 600 000 Juifs du Yichouv. Israël structure l’identité juive, compensant affectivement en partie l’extrême violence de la destruction des Juifs d’Europe, en particulier pour les laïcs pour lesquels la pratique religieuse n’est d’aucun secours moral. Cet état de fait gagne encore en acuité avec la Guerre des Six Jours, où le triomphe éclair et inattendu d’Israël supplante l’angoisse existentielle du printemps 1967[1]. Étonnamment, la menace suivie de la victoire conduisent beaucoup de Juifs européens – souvent situés à l’extrême-gauche – à revenir à la pratique du judaïsme[2]. C’est encore plus criant en 1973, à l'occasion du choc représenté par l’attaque-surprise syro-égyptienne lors de la guerre du Kippour.
C’est aussi à ce moment que l’antisionisme se reforme. Israël occupe la Cisjordanie, Gaza, le Golan et le Sinaï. Dans les pays occidentaux apparaît une certaine nostalgie du Bund. Un échec majeur du sionisme parait : l’État juif n’est nullement normalisé et peine à assurer la sécurité des Juifs. Le prix d’Israël, selon l’expression de Gershom Scholem, est de surcroît exorbitant, il fait porter aux Palestiniens le prix de l’auto-émancipation des Juifs, estiment certains. Le sionisme inverse en outre l’agentivité morale des Juifs : de victimes, ils deviennent responsables, et il s’en faut peu pour que ce renversement, effectivement vertigineux, soit perçu comme un passage de victime à bourreau. Au moins, en diaspora, à tout le moins dans les pays occidentaux où l’existence juive est assurée, les Juifs ne sont pas soumis à de tels choix moraux et c’est au fond plus confortable. En outre, l’ethos sioniste, s’il permet effectivement une certaine fierté juive, est mâtiné d’un rejet de la condition galuthique. En diaspora, cela peut être perçu comme un outrage appelant une mise en cohérence : puisque nous vivons en diaspora, alors nous devons cesser de nous réclamer d’un sionisme qui nous nie et de revendiquer cette existence diasporique. L’un des plus beaux plaidoyers littéraires pour le diasporisme se trouve sous la plume ironique de Philip Roth, qui pousse cette le trait jusqu’au bout à la radio polonaise dans Opération Shylock. Formulé plus placidement, on retrouve ces arguments en français chez Richard Marienstras, dans Être un peuple en diaspora ?.
Paradoxes de l’élection
Comment se formule alors depuis cette trame historique l’antisionisme juif ? Par-delà la malignité que postule auteures du sionisme – lequel transpire chaque paragraphe du recueil, qui peut ainsi être hélas lu comme un amoncellement d’indices concordants sur le caractère diabolique du mouvement sioniste[3] –, quelles sont les déterminations idéologiques de l’antisionisme juif ?
A mesure que le statu quo s’enlise, après deux Intifadas, l’échec des processus de paix, l’occupation, les opérations militaires israéliennes du Liban, de Gaza, et bien entendu de la guerre en cours, les arguments soulignant l’échec du sionisme ont gagné en résonnance, trouvant un large public non-juif flattant les Juifs qui les formulaient, ces Juifs courageux qui savent penser contre eux-mêmes, ces Juifs qui permettent de distinguer le sionisme du judaïsme. Un suicide ne vaut pas un meurtre, et si des Juifs réfutent aux autres Juifs le droit à une existence nationale, cela ne peut être assimilé à une injonction hétéronome ou persécutrice. Précisons : il y a un diasporisme qui acte l'existence d'Israël et qui réclame pour soi une existence disjointe. Ce n’est pas de ça dont il s’agit dans l’antisionisme : c’est réclamer la fin d’Israël, demander à Israël un suicide.
Les auteures estiment ainsi que l’antisionisme, c’est renoncer à ce que l’on sait perdu depuis l’échec de Bar Kohba, soit l’existence nationale, pour sauver l’essence éthique du judaïsme, à la manière de R. Yohanan ben Zaccaï fondant l’académie de Yabne. Cet argument doit-il être immédiatement adossé à la recherche absolue de fragilité, de prise sur soi de toutes les responsabilités ? « Un geste d’auto-agression qui est dans le même temps un geste d’autocélébration satisfaite » écrit Noémie Issan-Benchimol dans Tenoua. Que penser de cet antisionisme lorsqu’il semble lui-même instrumental, puisqu’opposé par les auteures à la « communauté juive organisée » (le syntagme communauté juive étant toujours suivi dans le recueil de l’adjectif organisée), afin de mieux se tenir aux côtés des racisés de France et de leur condition postcoloniale ?
Cette visée est fondée sur une revendication d’authenticité. Le sionisme prétend émaner du judaïsme, or, le judaïsme a longtemps été antisioniste, affirment les auteures du recueil. C’est bien entendu vrai. Mais il manque l’essentiel : qu’est-ce qui explique que le judaïsme, ses institutions, ses synagogues, est aujourd’hui, dans l’ensemble, sioniste ? C’est là un angle mort de l’ouvrage. L’existence de textes antisionistes juifs, peu importe qu’ils soient datés et qu’ils aient été révoqués plus tard par leurs auteurs, par exemple après la démonstration par le pire qu’a constituée la Shoah, qu’ils émanent des courants ultra-orthodoxes de Satmar et des Neturei Karta, ne sont là que pour démontrer avec autorité que le judaïsme a été antisioniste, donc doit le rester. Mais admettons, le judaïsme est par nature antisioniste. Le retour à Sion oublie un élément essentiel du messianisme, c’est-à-dire que Dieu est seul décisionnaire. C’est en effet une constante des textes fondateurs du sionisme – tout du moins dans sa version laïque –, l’auto-émancipation nationale est ainsi explicitement opposée à l’attente messianique.
Cette transgression du sionisme laïc inspire plusieurs textes d’inspiration religieuse compilés dans l’ouvrage. Des réformés, le CCAR, refusent à la fin du XIXème siècle (1885) l’identification du peuple juif à une nation moderne, c’est-à-dire à une société politique susceptible d’action historique. Un autre rabbin réformé, Isaac Mayer Wise (1897) craint que la mission universaliste des Juifs soit corrompue par la menée sioniste. Chez ces rabbins libéraux ou conservateurs (massorti), la conjonction universalisme-particularisme, tension permanente du judaïsme, mérite pourtant d’être interrogée. Il ne me semble pas qu’elle soit davantage résolue – donc abolie – dans l’antisionisme et dans le judaïsme communautaire de diaspora. Le cinquième rabbi de Loubavitch (1903) rejette ainsi le sionisme au titre de la possibilité qu’il offre aux Juifs d’être Juifs sans être religieux, à demeurer fidèles aux leurs tout en rejetant la Torah et les mitzvot, autant de critiques qui s’ajoutent à l’effacement de l’attente messianique opérée par le mouvement sioniste. Un argument similaire est donné par les Neturei Karta (1958), mais les Neturei Karta sont peut-être plus précis sur un point d’achoppement de l’antisionisme. Les Juifs sont un peuple élu, ‘am segoula, le sionisme veut normaliser les Juifs, les mettre au même rang que les autres nations, c’est là sa faute. Un rabbin réformé, Elmer Berger, écrit en 1981, en poursuivant cette logique, que les Juifs ne méritent pas Sion, entendre ne méritent pas aujourd’hui, et de citer les prophètes de l’exil. Dans la relation d’élection entre Dieu et son peuple, Dieu a infligé la galouth à son peuple, et Dieu seul le rédimera par son retour à Sion.
Ce point d’achoppement autour de l’élection est pleinement manifesté par la forme prise par l’antisionisme juif laïc, lequel reproche à Israël son particularisme ethnocentriste et sa conception nationale du judaïsme. Or, dans la pensée antisioniste laïque, la notion d’élection est aussi essentielle, mais elle n’est pas assumée comme telle. Les Juifs ne peuvent se normaliser dans un État, puisqu’ils ont une mission plus importante à remplir, être en exil une lumière parmi les nations, or lagoyim. Cet argument contredit l’argument juif traditionnel invoqué concernant les temps messianiques : les Juifs sont un peuple élu et le retour à Sion est repoussé tant que les Juifs ne le méritent pas. Les antisionistes laïques comprennent cela différemment : l’élection juive consiste précisément en cette dispersion parmi les nations. Les Juifs y gagnent une supériorité morale, inaccessible aux nations puisqu’elle vient avec l’extraction juive. En fait, du triangle monothéisme-messianisme-élection, qui est le cœur de la théologie juive, cet antisionisme laïc ne retient que l’élection et omet la rédemption messianique qui rassemblerait les exilés de la nation juive. L’élection n’est plus un expédient qui permet d’endurer l’attente, une béquille pour supporter la condition juive ; puisqu’il n’y a rien à attendre et que la fragilité existentielle n’est nullement difficile à vivre, elle est en elle-même un titre de noblesse. Le sionisme laïc, lui, est plus affirmé, puisqu’il rejette l’attente en hâtant le retour des exilés, et par suite rejette l’anormalité dans laquelle maintient l’élection. Aussi n’est-il pas anodin que dans cette présentation des auteures, ainsi que dans le choix des textes, il soit si peu question des Palestiniens. Le sionisme n’est pas condamné pour ce qu’il fait aux Palestiniens, mais pour ce qu’il fait des Juifs, des pantins de l’impérialisme, des colons, tout cela déchoit les Juifs de leur surplomb moral.
Peu importe dès lors si cette élection – défaite par le sionisme – vient avec la condition de paria. Au contraire, être paria, appartenir à un peuple paria, surtout en Occident où la condition juive est, quoique l’on en dise, plus convenable qu’ailleurs, offre des certitudes morales appréciables. Ainsi Ilan Pappé (2010) de regretter que les Juifs d’Israël soient des Fichte, des Herder, des Gobineau (les pères du nationalisme allemand et le théoricien du racisme scientifique), tandis que les Juifs en diaspora sont des ponts pour la réconciliation avec la lutte des minorités persécutées, singulièrement aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Ainsi Amnon Raz-Krakotzkin (2007) de regretter que le sionisme soit une négation de l’exil, un retour intolérable des Juifs à l’Histoire, faisant virtuellement siens les mots de Léon Bloy : « L'histoire des Juifs barre l'histoire du genre humain, comme une digue barre un fleuve, pour en élever le niveau. » (Le Salut par les Juifs). En un mot, les Juifs devraient se satisfaire d’être une indispensable vigie morale parmi les nations.
Un paradoxe cruel apparait néanmoins : l’antisionisme laïc est le fait d’individus résolument opposés à toute construction communautaire en diaspora, à toute action réelle pour la perpétuation du fait juif. En un mot, ils sont assimilés. Leur judaïsme est alors cette expérience qui consiste à être né juif, haute stature morale que leur réserve l'héritage individuel, lequel risque toutefois à chaque génération de s’estomper, clôturant de la sorte l’élection elle-même.
Les Juifs, une nation ?
Aussi la problématique élective est-elle directement en lien avec l’interrogation du type de collectif que forment les Juifs, ce qui donne lieu dans le recueil à une section portant sur la question nationale. Celle-ci s’ouvre par un texte sur le Bund (textes de 1901 à 1905), lequel faisait sienne une idéologie qui, si elle était non-étatique, n’en était pas moins tout aussi nationale que le sionisme, tout aussi réactionnaire dira Lénine. Que dit le Bund dans ces textes ? Que le sionisme est bourgeois, qu’il est une manœuvre dilatoire contre les travailleurs, qu’il produit un effacement de la cause des travailleurs au nom de la cause nationale, prématurée. Ça n’est là pas une négation de la conception nationale de la judéité que l’on retrouve dans le sionisme. Cette dimension est largement oubliée par ceux qui se réclament les héritiers du Bund, lesquels rejettent le sionisme précisément parce qu’il les assigne à une définition nationale du judaïsme. Ils ne retiennent donc pas l’idée d’autonomie nationale ici et maintenant, en rupture avec les citoyennetés française, britannique ou américaine, mais uniquement le rejet du sionisme.
Parmi les autres textes, des textes de Montagu (1917), ministre juif du Royaume-Uni au moment de la déclaration Balfour, de Julius Kahn (1919) ou de l’American Council for Judaism (1943) , affirmant de concert que le sionisme fragilise les citoyennetés durement acquises en Occident, et que si le futur Israël doit être un refuge pour les Juifs opprimés de l’Est et du monde arabe, il ne doit pas concerner ceux d’Occident, au risque de mettre en péril leur citoyenneté. Ils ajoutent en outre avec justesse qu’au sionisme s’agrège un pessimisme historique profond, qu’il est préférable de lutter contre l’antisémitisme que de l’estimer éternel et de se dérober à cette lutte en fondant un État juif. Ces perspectives sont ainsi développées dans les textes de Karl Kraus (1898) et Henryk Erlich (1938). Le sionisme se fait l’allié objectif de l’antisémitisme en ne luttant pas contre. En 1938, il est absurde que les Juifs se résignent et quittent l’Europe, dit Erlich.
S’agissant néanmoins du pessimisme sioniste, par-delà à nouveau la démonstration par le pire de sa justesse, ces textes disent aussi à leur corps défendant le besoin de ré-affirmation de loyauté (américaine, britannique, française, allemande), démontrant précisément la précarité de cette appartenance nationale, ce qui est un constat fondamental de l’idéologie sioniste. D’autre part, de nombreux théoriciens sionistes parèrent à cet argument, en démontrant la compatibilité, et même la synergie, entre sionisme et appartenance à la République française, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis d’Amérique. La précarité de l’appartenance nationale précède le sionisme, et le sionisme ne l’accroit qu’à la marge. Certains le démontrèrent par leur propre parcours, ainsi les juges à la Cour suprême Louis Brandeis ou Arthur Goldberg, qui ont atteint les plus hauts postes fédéraux et à la fois professaient un franc sionisme, notamment à l’American Jewish Committee (AJC, à ne pas confondre avec l’ACJ cité plus haut), ou bien André Spire, l’un des chefs de file du mouvement sioniste en France et Conseiller d’État. Y’a-t-il là une contradiction impensée chez ces sionistes ? Sans doute. C’est ce que pointe une tribune parue dans le Jewish Chronicle (1902), rangée dans la section Sionisme et antisémitisme, qui déplore que la schizophrénie du sionisme de diaspora, qui réclame tout à la fois la citoyenneté occidentale et une séparation à l’égard des non-juifs par l’établissement en Palestine mandataire. A-t-on pourtant résolu cette contradiction toujours aussi actuelle en postulant la nécessité stricte de l’assimilation aux sociétés européennes ? À l’heure d’une impressionnante montée du racisme et de l’antisémitisme, l’idéal de fusion nationale – c’est-à-dire d’assimilation parachevée – est-il la voie d’émancipation postulée par l’antisionisme laïc contemporain ? À l’évidence, cette position est de nouveau tributaire d’une forme poussée d’individualisation, la judéité étant un héritage, mais un héritage qui n’est accessible qu’au travers d’une identité vécue sur un mode strictement individuel.
S’agissant de l’antisémitisme, dont les flux et reflux sont incessants, est-ce aux Juifs de le combattre ? Comment échapper au pessimisme historique quand l’antisémitisme – même au lendemain de la Shoah[4] - parait aussi structurant des sociétés modernes ? Des textes d’Hannah Arendt (1945) et d’Isaac Deutscher (1968) n’en condamnent pas moins le sionisme l’une parce que « le soutien impérialiste à Israël est comme la corde qui soutient le pendu », l’autre parce que la structure que représente l’État-nation est déjà obsolète en 1948. Un texte des Independant Jewish Voices (l’équivalent canadien de l’UJFP) de 2005 qui estime que le sionisme est un échec puisque les Juifs n’y sont pas en sécurité et n’ont de surcroît pas atteint la normalité recherchée. Ce que dit également Michel Warschawski (1994), qui ajoute que le sionisme sonne la fin des Juifs, devenus Israéliens (on pense au titre provocateur de Georges Friedmann, Fin du peuple juif ?), et surtout que le sionisme implique une dévalorisation de l’histoire juive, dans laquelle les Juifs furent des victimes résignées pendant près de 2000 ans, jusqu’à ce qu’ils raidissent leur nuque avec le sionisme. La question de la sécurité juive dévaluée par Israël n’est pourtant paradoxale qu’en apparence : Israël suscite des alyoth quand il est en danger, en insécurité, parce que ce que les Juifs recherchent en Israël, ça n’est pas exactement la sécurité individuelle, ou pas la sécurité tout court, mais l’alignement des intérêts de l’État et de la sécurité des Juifs, la sortie de la solitude et de l’état de minorité.
Daniel Boyarin (2020), quant à lui, expose les contradictions propres à l’antisionisme juif. Le sionisme estime que la solution au problème national est l’État-nation, l’antisionisme répond qu'il n'y a pas de nation juive. Or, le judaïsme constitue bien une nation renanienne, concède Boyarin à Michael Walzer, mais cette existence nationale ne doit pas conduire à un État. Boyarin ajoute que réduire le judaïsme à une religion est impropre et dangereux, et que la pensée antisioniste est dans un cul-de-sac quand elle réclame la pleine justice pour les Palestiniens, c’est-à-dire un État, tandis que la poursuite d'une culture nationale juive vivante qu’elle appelle de ses vœux passe de facto par Israël. L’extrait choisi par les auteures ici consiste en la mise au jour de ces contradictions de l’antisionisme, contradictions que Daniel Boyarin tente de dépasser dans The No State Solution.
Sionisme, anti-sionisme et post-sionisme, vus d’Israël
Le sionisme, disent les auteures, est un colonialisme, d’après l’argumentaire connu et pas dénué de pertinence de Maxime Rodinson.Elles ajoutent à raison que ce caractère colonial était reconnu de manière assumée par l’appareil sioniste, avant d’être supplanté au profit de la seule grille de lecture ‘auto-émancipation nationale’. Ilan Pappé (2010) explique ainsi que qualifier Israël de fait colonial est un truisme vu de l’extérieur, mais que cela est impensable en Israël et ce pour une raison précise : le fait colonial est encore actif, dit Pappé. Reconnaître le passé demanderait de porter un regard sur le présent, et de voir que ce qui est intolérable dans le présent (l’occupation et la colonisation) n’est que la continuation de la forme prise par l’État d’Israël. En outre, le sionisme a impliqué et implique toujours une dépendance aux empires, à l’empire britannique hier, à la puissance américaine aujourd’hui, et est donc lui-même impérial, disent les auteures. Dans ce spectre d’analyse, celui de l’anti-impérialisme géopolitique, tout État est impérial puisqu’aucun ne peut échapper aux interdépendances et aux logiques de blocs et d’influences. Sont ainsi proposés deux textes du Brith Shalom, d’Hans Kohn (1929) et de Gershom Scholem (1931), où sont démontrés l’indifférence du mouvement sioniste à la question arabe, l’épuisement de l’utopie sioniste une quinzaine d’années après Balfour et la dépendance du sionisme aux empires vainqueurs de la Première guerre mondiale. Suit un entretien de Léon Trotsky (1934) qui, ne se prononçant pas la question sur le sionisme, n’en donne pas moins ce diagnostic lucide et nuancé sur les émeutes de Hébron, qui peut éclairer nos débats sur la nature du 7 octobre :
« [Avec une meilleure connaissance des faits] il me sera plus facile de juger dans quelle mesure se trouvaient en présence des éléments tels que les forces de libération nationales anti-impérialistes, les mahométans réactionnaires et les antisémites fauteurs de pogromes. À première vue, il me semble que tous ces éléments étaient réunis. »
Juif et démocratique sont deux exigences incompatibles pour l’État d’Israël disent les auteures, et pour dépasser cette contradiction, il faut faire advenir un État binational (donc acter la fin de l’État juif). Pour appuyer ce diagnostic, sont ainsi proposés des textes en lien avec le post-sionisme ou le bi-nationalisme. Le premier est un texte de Martin Buber (1948), qui voit deux pôles contraires au sionisme, les idées de renaissance nationale et de normalisation parmi les nations. Buber prônant la renaissance nationale et spirituelle du peuple juif affirme doctement que la conquête de Canaan était justifiée parce que les Cananéens étaient idolâtres, ce qui ne peut être dit des Palestiniens, et nous condamne donc à vivre en bonne intelligence avec eux. Mais la véritable raison n’est pas le monothéisme des Palestiniens : déclarer un État en 1948, c’est renoncer à la Judée-Samarie et donc trahir la terre d’Israël, ce qu’il ne se résout pas à faire. Un texte du Matzpen (1975) déplore le prix du sionisme : l’écrasement des Palestiniens. C’est peut-être le seul texte qui expose aussi nettement le prix payé par les Palestiniens pour l’établissement d’Israël, quand tous les autres sont essentiellement judéo-centrés. Ilan Halevi (1988), citoyen palestinien — fait suffisamment rare pour être signalé — estime qu’au sionisme hypocrite (travailliste) s’est substitué un sionisme cruel (likudnik). Ces mots disent également quelque chose de la logique de révélation sans cesse à l’œuvre dans la pensée antisioniste, où il s’agit de dévoiler la réalité des acteurs et de leurs idées par-delà leurs – superficiels – atours. C’est le cas en particulier du texte d’Ariella Azoulay et Adi Ophir (1998), anaphore mythes à déboulonner (« on nous dit que… »). Ils affirment en outre, à raison, que les Juifs en Israël ont conservé l’ethos minoritaire élaboré en diaspora où ils sont des victimes, une citadelle assiégée, et le monde non-juif une menace. Un similaire constat conduit Maxime Rodinson (1972) à explorer les raisons de l’échec du bi-nationalisme, notant que la lutte contre le sionisme est à la fin des années 60 le faux nez de la lutte contre les Juifs, que le sionisme redonne de la fierté aux Juifs. Il ajoute qu’avec le sionisme, Israël devient central pour l’identité juive et oblige les Juifs, partout où ils sont, à se positionner sur la question israélienne, ce qui a eu des conséquences considérables sur les Juifs du monde arabe et du bloc soviétique.
Faut-il s’en étonner ? Les contradictions de l’antisionisme laïc – élection morale contre individualisme résolu –sont figurées en pratique par les textes finaux de l’ouvrage. Judith Butler (2004) rejette l’appellation d’État binational puisqu’elle suppose encore binarité et conceptions nationales (et où les cas limites sont les Palestiniens israéliens et… les « Juifs arabes »), et quatre textes – « l’appel d’Olga » (2004), un texte d’Eyal Sivan (2012), Future Scenarios For Israel-Palestine (2018) et un éditorial de Gideon Levy (2019) – concordent à se défaire des illusions de la solution à deux États et à se rallier à la « One State reality ». En effet, disent-ils, si le sionisme implique la séparation des Palestiniens, alors il est profondément malfaisant. Dans le dernier de ces quatre textes, on peut y lire cette sidérante perspective politique : « Il faut renoncer à ses privilèges de colon, renoncer au sionisme et se mettre sous la direction des colonisés.»
Un texte profondément pessimiste de Moshé Behar (2020) clôt l’ouvrage. Moshé Behar nous dit ainsi que les colonies sont trop profondément ancrées dans la réalité pour permettre l’établissement d’un État palestinien, sans parler des impératifs sécuritaires que se fixe Israël dans la vallée du Jourdain. Mais il ajoute qu’il n’y a également rien à espérer du bi-nationalisme. Ce pays, Israël et la Palestine, est trop éloigné du libéralisme civique, les identités collectives nouées par des liens religieux, ethniques et nationaux ne peuvent disparaître d’un revers de main. Or, les partisans du bi-nationalisme esquivent cette difficulté, dit-il. Prôner un État binational pour sortir du statu quo, c’est prôner ou bien la poursuite de l’apartheid sans qu’il ne soit jamais de jure ou bien l’expulsion des Palestiniens à mesure qu’Israël annexe la Cisjordanie, pour permettre ainsi une annexion sans apartheid. Une telle conclusion donnée à un recueil résolument antisioniste ne peut qu’étonner. Peut-être est-elle lucide, même s’il faut espérer que non, qu’un sursaut diplomatique international permettra la mise en place de la solution à deux États sitôt la guerre à Gaza terminée. Ce pessimisme final ne figure pas moins le paradoxe intenable de l’antisionisme juif, sommé d’être aussi exemplaire et intransigeant moralement qu’antinational en pratique, de sorte que la seule voie de conciliation paraît être paradoxalement la continuation de l’État israélien tel qu’il est jusqu’à son effondrement – peut-être le messianisme est-il finalement ici logé ?
[1] Danny Trom, La France sans les juifs, PUF, 2019, pp. 93-118.
[2] Benny Lévy, Être juif : étude lévinassienne, Verdier, 2003.
[3] Ainsi, les auteures pourront traiter d’un seul tenant des arguments de nature foncièrement différente, mais en les évoquant tous ensemble comme un même geste politique. Rabbi Yohanan ben Zaccaï dit que.. d'ailleurs, beaucoup savaient que la déclaration Balfour allait produire un conflit insurmontable... le troisième rabbi de Gur prévenait qu'un État juif était une profanation du nom du dieu. Les auteures veulent nous dessiller les yeux et ont ce même rapport à l’histoire, chaque évènement — 1967 en particulier — révèle les intentions profondes du passé — 1948, voire 1898, le premier congrès sioniste.
[4] De nombreuses violences antisémites — jusque l'acmé du pogrom de Kielce en 1946 — ont suivi la Libération.
Il en va de la sorte des textes ultra-orthodoxes rassemblés ici. Ces ultra-orthodoxes tiennent pour hérétiques ces antisionistes sécularisés et ces antisionistes sécularisés n’ont d’estime pour la pensée ultra-orthodoxe que dans son aspect antisioniste. Deux nœuds de la pensée antisioniste se jouent là : la notion de nation et celle d’élection du peuple juif. La pensée antisioniste achoppe sur ces deux notions quand elle condamne le sionisme, mais il y a là une ruse de l’histoire. Ces notions, elle les adopte de fait, c’est l’objet de cette note.
Histoire juive de l’antisionisme… et du sionisme
Avant d’entrer dans le vif, un bref rappel historique. Le sionisme politique naît à la fin du XIXème siècle en Europe, en réaction à la persistance de l’antisémitisme après l’Émancipation (les pogromes de 1881-1882 en Russie tsariste, puis l’Affaire Dreyfus), mais aussi à la menace existentielle d’assimilation qui est consubstantielle de l’Émancipation (ce que Baruch Hagani expose dans L'émancipation des Juifs, 1928, Rieder). À peu près en même temps, d’autres réponses à la question juive sont formulées, l’assimilation, le revivalisme religieux ou le bundisme, c’est-à-dire l’émancipation des travailleurs juifs ici et maintenant, le doikayt. Ces réponses à la question juive s’opposent au sionisme, parce qu’elles concurrencent cette voie, et l’estiment délétère pour le fait juif en Europe, soit qu’il fragilise l’intégration nationale obtenue après l'Émancipation, soit qu’il a un effet dilatoire vis-à-vis de la question sociale. Mais il serait malhonnête de définir ces réponses à la question juive comme antisionistes. Ou bien cela reviendrait à dire que tout ce qui n’est pas ceci est anti-ceci plutôt que d’être cela, et à leur retirer tout contenu positif pour que ne subsiste qu’une définition en creux, vis-à-vis du sionisme, lequel n’avait pourtant pas encore la centralité qu’il a acquise plus tard au sein des communités juives.
Dans la première moitié du XXème siècle, le sionisme est en effet minoritaire chez les Juifs, qui expriment surtout de la perplexité devant ce projet d’apparence utopique — ce qui conduit les auteures à la conclusion que la plupart des antisionistes étant hier juifs, tandis que la plupart des sionistes étant aujourd’hui non-juifs, l’antisionisme est un plus authentique héritier du judaïsme que le sionisme. Progressivement cependant, puis par à-coups, le sionisme n’en gagne pas moins en popularité au sein des institutions juives les plus centrales. Dans l’entre-deux-guerres, dans les grandes villes d’Europe, la plupart des mouvements de jeunesse et des étudiants juifs se structurent progressivement autour du sionisme — ainsi à Vienne, Franz Kafka et Max Brod étaient sionistes lors de leurs études, Joseph Roth et Soma Morgenstern, le fils de Sigmund Freud, etc. et de la même manière à Paris, si l’on songe aux publicistes juifs des années 20. Souvent, par transgression vis-à-vis de la voie tout ou partie assimilationniste élue par leurs parents et comme moyen d’exprimer une fierté juive à l’heure antisémite. Mais très tôt, des premières critiques poignent, parmi lesquelles celles du Brith Shalom dans le Yishouv qui regrette la conflictualité avec les Arabes que le sionisme n’a de cesse d’induire.
La deuxième mue n’est pas générationnelle, c’est la Shoah. Six millions de Juifs sont exterminés, parmi eux, un grand nombre des militants du Bund. Il est souvent reproché au sionisme sa philosophie de l’histoire pessimiste, sa manière de concevoir l’antisémitisme comme immuable, comme une psychose des nations contre laquelle on ne peut rien si ce n’est la fuite. Or, la Shoah a largement accrédité par le pire la vision sioniste de l’histoire universelle.
À partir de là, de l’après-guerre et de 1948 en particulier, le sionisme triomphe dans le monde juif, dans ce qu’il reste du monde juif, soit une large communauté américaine, des diasporas en Europe occidentale, des « personnes déplacées » rescapées de la Shoah, la diaspora soviétique et celles du monde arabo-iranien, en sus des quelques 600 000 Juifs du Yichouv. Israël structure l’identité juive, compensant affectivement en partie l’extrême violence de la destruction des Juifs d’Europe, en particulier pour les laïcs pour lesquels la pratique religieuse n’est d’aucun secours moral. Cet état de fait gagne encore en acuité avec la Guerre des Six Jours, où le triomphe éclair et inattendu d’Israël supplante l’angoisse existentielle du printemps 1967[1]. Étonnamment, la menace suivie de la victoire conduisent beaucoup de Juifs européens – souvent situés à l’extrême-gauche – à revenir à la pratique du judaïsme[2]. C’est encore plus criant en 1973, à l'occasion du choc représenté par l’attaque-surprise syro-égyptienne lors de la guerre du Kippour.
C’est aussi à ce moment que l’antisionisme se reforme. Israël occupe la Cisjordanie, Gaza, le Golan et le Sinaï. Dans les pays occidentaux apparaît une certaine nostalgie du Bund. Un échec majeur du sionisme parait : l’État juif n’est nullement normalisé et peine à assurer la sécurité des Juifs. Le prix d’Israël, selon l’expression de Gershom Scholem, est de surcroît exorbitant, il fait porter aux Palestiniens le prix de l’auto-émancipation des Juifs, estiment certains. Le sionisme inverse en outre l’agentivité morale des Juifs : de victimes, ils deviennent responsables, et il s’en faut peu pour que ce renversement, effectivement vertigineux, soit perçu comme un passage de victime à bourreau. Au moins, en diaspora, à tout le moins dans les pays occidentaux où l’existence juive est assurée, les Juifs ne sont pas soumis à de tels choix moraux et c’est au fond plus confortable. En outre, l’ethos sioniste, s’il permet effectivement une certaine fierté juive, est mâtiné d’un rejet de la condition galuthique. En diaspora, cela peut être perçu comme un outrage appelant une mise en cohérence : puisque nous vivons en diaspora, alors nous devons cesser de nous réclamer d’un sionisme qui nous nie et de revendiquer cette existence diasporique. L’un des plus beaux plaidoyers littéraires pour le diasporisme se trouve sous la plume ironique de Philip Roth, qui pousse cette le trait jusqu’au bout à la radio polonaise dans Opération Shylock. Formulé plus placidement, on retrouve ces arguments en français chez Richard Marienstras, dans Être un peuple en diaspora ?.
Paradoxes de l’élection
Comment se formule alors depuis cette trame historique l’antisionisme juif ? Par-delà la malignité que postule auteures du sionisme – lequel transpire chaque paragraphe du recueil, qui peut ainsi être hélas lu comme un amoncellement d’indices concordants sur le caractère diabolique du mouvement sioniste[3] –, quelles sont les déterminations idéologiques de l’antisionisme juif ?
A mesure que le statu quo s’enlise, après deux Intifadas, l’échec des processus de paix, l’occupation, les opérations militaires israéliennes du Liban, de Gaza, et bien entendu de la guerre en cours, les arguments soulignant l’échec du sionisme ont gagné en résonnance, trouvant un large public non-juif flattant les Juifs qui les formulaient, ces Juifs courageux qui savent penser contre eux-mêmes, ces Juifs qui permettent de distinguer le sionisme du judaïsme. Un suicide ne vaut pas un meurtre, et si des Juifs réfutent aux autres Juifs le droit à une existence nationale, cela ne peut être assimilé à une injonction hétéronome ou persécutrice. Précisons : il y a un diasporisme qui acte l'existence d'Israël et qui réclame pour soi une existence disjointe. Ce n’est pas de ça dont il s’agit dans l’antisionisme : c’est réclamer la fin d’Israël, demander à Israël un suicide.
Les auteures estiment ainsi que l’antisionisme, c’est renoncer à ce que l’on sait perdu depuis l’échec de Bar Kohba, soit l’existence nationale, pour sauver l’essence éthique du judaïsme, à la manière de R. Yohanan ben Zaccaï fondant l’académie de Yabne. Cet argument doit-il être immédiatement adossé à la recherche absolue de fragilité, de prise sur soi de toutes les responsabilités ? « Un geste d’auto-agression qui est dans le même temps un geste d’autocélébration satisfaite » écrit Noémie Issan-Benchimol dans Tenoua. Que penser de cet antisionisme lorsqu’il semble lui-même instrumental, puisqu’opposé par les auteures à la « communauté juive organisée » (le syntagme communauté juive étant toujours suivi dans le recueil de l’adjectif organisée), afin de mieux se tenir aux côtés des racisés de France et de leur condition postcoloniale ?
Cette visée est fondée sur une revendication d’authenticité. Le sionisme prétend émaner du judaïsme, or, le judaïsme a longtemps été antisioniste, affirment les auteures du recueil. C’est bien entendu vrai. Mais il manque l’essentiel : qu’est-ce qui explique que le judaïsme, ses institutions, ses synagogues, est aujourd’hui, dans l’ensemble, sioniste ? C’est là un angle mort de l’ouvrage. L’existence de textes antisionistes juifs, peu importe qu’ils soient datés et qu’ils aient été révoqués plus tard par leurs auteurs, par exemple après la démonstration par le pire qu’a constituée la Shoah, qu’ils émanent des courants ultra-orthodoxes de Satmar et des Neturei Karta, ne sont là que pour démontrer avec autorité que le judaïsme a été antisioniste, donc doit le rester. Mais admettons, le judaïsme est par nature antisioniste. Le retour à Sion oublie un élément essentiel du messianisme, c’est-à-dire que Dieu est seul décisionnaire. C’est en effet une constante des textes fondateurs du sionisme – tout du moins dans sa version laïque –, l’auto-émancipation nationale est ainsi explicitement opposée à l’attente messianique.
Cette transgression du sionisme laïc inspire plusieurs textes d’inspiration religieuse compilés dans l’ouvrage. Des réformés, le CCAR, refusent à la fin du XIXème siècle (1885) l’identification du peuple juif à une nation moderne, c’est-à-dire à une société politique susceptible d’action historique. Un autre rabbin réformé, Isaac Mayer Wise (1897) craint que la mission universaliste des Juifs soit corrompue par la menée sioniste. Chez ces rabbins libéraux ou conservateurs (massorti), la conjonction universalisme-particularisme, tension permanente du judaïsme, mérite pourtant d’être interrogée. Il ne me semble pas qu’elle soit davantage résolue – donc abolie – dans l’antisionisme et dans le judaïsme communautaire de diaspora. Le cinquième rabbi de Loubavitch (1903) rejette ainsi le sionisme au titre de la possibilité qu’il offre aux Juifs d’être Juifs sans être religieux, à demeurer fidèles aux leurs tout en rejetant la Torah et les mitzvot, autant de critiques qui s’ajoutent à l’effacement de l’attente messianique opérée par le mouvement sioniste. Un argument similaire est donné par les Neturei Karta (1958), mais les Neturei Karta sont peut-être plus précis sur un point d’achoppement de l’antisionisme. Les Juifs sont un peuple élu, ‘am segoula, le sionisme veut normaliser les Juifs, les mettre au même rang que les autres nations, c’est là sa faute. Un rabbin réformé, Elmer Berger, écrit en 1981, en poursuivant cette logique, que les Juifs ne méritent pas Sion, entendre ne méritent pas aujourd’hui, et de citer les prophètes de l’exil. Dans la relation d’élection entre Dieu et son peuple, Dieu a infligé la galouth à son peuple, et Dieu seul le rédimera par son retour à Sion.
Ce point d’achoppement autour de l’élection est pleinement manifesté par la forme prise par l’antisionisme juif laïc, lequel reproche à Israël son particularisme ethnocentriste et sa conception nationale du judaïsme. Or, dans la pensée antisioniste laïque, la notion d’élection est aussi essentielle, mais elle n’est pas assumée comme telle. Les Juifs ne peuvent se normaliser dans un État, puisqu’ils ont une mission plus importante à remplir, être en exil une lumière parmi les nations, or lagoyim. Cet argument contredit l’argument juif traditionnel invoqué concernant les temps messianiques : les Juifs sont un peuple élu et le retour à Sion est repoussé tant que les Juifs ne le méritent pas. Les antisionistes laïques comprennent cela différemment : l’élection juive consiste précisément en cette dispersion parmi les nations. Les Juifs y gagnent une supériorité morale, inaccessible aux nations puisqu’elle vient avec l’extraction juive. En fait, du triangle monothéisme-messianisme-élection, qui est le cœur de la théologie juive, cet antisionisme laïc ne retient que l’élection et omet la rédemption messianique qui rassemblerait les exilés de la nation juive. L’élection n’est plus un expédient qui permet d’endurer l’attente, une béquille pour supporter la condition juive ; puisqu’il n’y a rien à attendre et que la fragilité existentielle n’est nullement difficile à vivre, elle est en elle-même un titre de noblesse. Le sionisme laïc, lui, est plus affirmé, puisqu’il rejette l’attente en hâtant le retour des exilés, et par suite rejette l’anormalité dans laquelle maintient l’élection. Aussi n’est-il pas anodin que dans cette présentation des auteures, ainsi que dans le choix des textes, il soit si peu question des Palestiniens. Le sionisme n’est pas condamné pour ce qu’il fait aux Palestiniens, mais pour ce qu’il fait des Juifs, des pantins de l’impérialisme, des colons, tout cela déchoit les Juifs de leur surplomb moral.
Peu importe dès lors si cette élection – défaite par le sionisme – vient avec la condition de paria. Au contraire, être paria, appartenir à un peuple paria, surtout en Occident où la condition juive est, quoique l’on en dise, plus convenable qu’ailleurs, offre des certitudes morales appréciables. Ainsi Ilan Pappé (2010) de regretter que les Juifs d’Israël soient des Fichte, des Herder, des Gobineau (les pères du nationalisme allemand et le théoricien du racisme scientifique), tandis que les Juifs en diaspora sont des ponts pour la réconciliation avec la lutte des minorités persécutées, singulièrement aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Ainsi Amnon Raz-Krakotzkin (2007) de regretter que le sionisme soit une négation de l’exil, un retour intolérable des Juifs à l’Histoire, faisant virtuellement siens les mots de Léon Bloy : « L'histoire des Juifs barre l'histoire du genre humain, comme une digue barre un fleuve, pour en élever le niveau. » (Le Salut par les Juifs). En un mot, les Juifs devraient se satisfaire d’être une indispensable vigie morale parmi les nations.
Un paradoxe cruel apparait néanmoins : l’antisionisme laïc est le fait d’individus résolument opposés à toute construction communautaire en diaspora, à toute action réelle pour la perpétuation du fait juif. En un mot, ils sont assimilés. Leur judaïsme est alors cette expérience qui consiste à être né juif, haute stature morale que leur réserve l'héritage individuel, lequel risque toutefois à chaque génération de s’estomper, clôturant de la sorte l’élection elle-même.
Les Juifs, une nation ?
Aussi la problématique élective est-elle directement en lien avec l’interrogation du type de collectif que forment les Juifs, ce qui donne lieu dans le recueil à une section portant sur la question nationale. Celle-ci s’ouvre par un texte sur le Bund (textes de 1901 à 1905), lequel faisait sienne une idéologie qui, si elle était non-étatique, n’en était pas moins tout aussi nationale que le sionisme, tout aussi réactionnaire dira Lénine. Que dit le Bund dans ces textes ? Que le sionisme est bourgeois, qu’il est une manœuvre dilatoire contre les travailleurs, qu’il produit un effacement de la cause des travailleurs au nom de la cause nationale, prématurée. Ça n’est là pas une négation de la conception nationale de la judéité que l’on retrouve dans le sionisme. Cette dimension est largement oubliée par ceux qui se réclament les héritiers du Bund, lesquels rejettent le sionisme précisément parce qu’il les assigne à une définition nationale du judaïsme. Ils ne retiennent donc pas l’idée d’autonomie nationale ici et maintenant, en rupture avec les citoyennetés française, britannique ou américaine, mais uniquement le rejet du sionisme.
Parmi les autres textes, des textes de Montagu (1917), ministre juif du Royaume-Uni au moment de la déclaration Balfour, de Julius Kahn (1919) ou de l’American Council for Judaism (1943) , affirmant de concert que le sionisme fragilise les citoyennetés durement acquises en Occident, et que si le futur Israël doit être un refuge pour les Juifs opprimés de l’Est et du monde arabe, il ne doit pas concerner ceux d’Occident, au risque de mettre en péril leur citoyenneté. Ils ajoutent en outre avec justesse qu’au sionisme s’agrège un pessimisme historique profond, qu’il est préférable de lutter contre l’antisémitisme que de l’estimer éternel et de se dérober à cette lutte en fondant un État juif. Ces perspectives sont ainsi développées dans les textes de Karl Kraus (1898) et Henryk Erlich (1938). Le sionisme se fait l’allié objectif de l’antisémitisme en ne luttant pas contre. En 1938, il est absurde que les Juifs se résignent et quittent l’Europe, dit Erlich.
S’agissant néanmoins du pessimisme sioniste, par-delà à nouveau la démonstration par le pire de sa justesse, ces textes disent aussi à leur corps défendant le besoin de ré-affirmation de loyauté (américaine, britannique, française, allemande), démontrant précisément la précarité de cette appartenance nationale, ce qui est un constat fondamental de l’idéologie sioniste. D’autre part, de nombreux théoriciens sionistes parèrent à cet argument, en démontrant la compatibilité, et même la synergie, entre sionisme et appartenance à la République française, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis d’Amérique. La précarité de l’appartenance nationale précède le sionisme, et le sionisme ne l’accroit qu’à la marge. Certains le démontrèrent par leur propre parcours, ainsi les juges à la Cour suprême Louis Brandeis ou Arthur Goldberg, qui ont atteint les plus hauts postes fédéraux et à la fois professaient un franc sionisme, notamment à l’American Jewish Committee (AJC, à ne pas confondre avec l’ACJ cité plus haut), ou bien André Spire, l’un des chefs de file du mouvement sioniste en France et Conseiller d’État. Y’a-t-il là une contradiction impensée chez ces sionistes ? Sans doute. C’est ce que pointe une tribune parue dans le Jewish Chronicle (1902), rangée dans la section Sionisme et antisémitisme, qui déplore que la schizophrénie du sionisme de diaspora, qui réclame tout à la fois la citoyenneté occidentale et une séparation à l’égard des non-juifs par l’établissement en Palestine mandataire. A-t-on pourtant résolu cette contradiction toujours aussi actuelle en postulant la nécessité stricte de l’assimilation aux sociétés européennes ? À l’heure d’une impressionnante montée du racisme et de l’antisémitisme, l’idéal de fusion nationale – c’est-à-dire d’assimilation parachevée – est-il la voie d’émancipation postulée par l’antisionisme laïc contemporain ? À l’évidence, cette position est de nouveau tributaire d’une forme poussée d’individualisation, la judéité étant un héritage, mais un héritage qui n’est accessible qu’au travers d’une identité vécue sur un mode strictement individuel.
S’agissant de l’antisémitisme, dont les flux et reflux sont incessants, est-ce aux Juifs de le combattre ? Comment échapper au pessimisme historique quand l’antisémitisme – même au lendemain de la Shoah[4] - parait aussi structurant des sociétés modernes ? Des textes d’Hannah Arendt (1945) et d’Isaac Deutscher (1968) n’en condamnent pas moins le sionisme l’une parce que « le soutien impérialiste à Israël est comme la corde qui soutient le pendu », l’autre parce que la structure que représente l’État-nation est déjà obsolète en 1948. Un texte des Independant Jewish Voices (l’équivalent canadien de l’UJFP) de 2005 qui estime que le sionisme est un échec puisque les Juifs n’y sont pas en sécurité et n’ont de surcroît pas atteint la normalité recherchée. Ce que dit également Michel Warschawski (1994), qui ajoute que le sionisme sonne la fin des Juifs, devenus Israéliens (on pense au titre provocateur de Georges Friedmann, Fin du peuple juif ?), et surtout que le sionisme implique une dévalorisation de l’histoire juive, dans laquelle les Juifs furent des victimes résignées pendant près de 2000 ans, jusqu’à ce qu’ils raidissent leur nuque avec le sionisme. La question de la sécurité juive dévaluée par Israël n’est pourtant paradoxale qu’en apparence : Israël suscite des alyoth quand il est en danger, en insécurité, parce que ce que les Juifs recherchent en Israël, ça n’est pas exactement la sécurité individuelle, ou pas la sécurité tout court, mais l’alignement des intérêts de l’État et de la sécurité des Juifs, la sortie de la solitude et de l’état de minorité.
Daniel Boyarin (2020), quant à lui, expose les contradictions propres à l’antisionisme juif. Le sionisme estime que la solution au problème national est l’État-nation, l’antisionisme répond qu'il n'y a pas de nation juive. Or, le judaïsme constitue bien une nation renanienne, concède Boyarin à Michael Walzer, mais cette existence nationale ne doit pas conduire à un État. Boyarin ajoute que réduire le judaïsme à une religion est impropre et dangereux, et que la pensée antisioniste est dans un cul-de-sac quand elle réclame la pleine justice pour les Palestiniens, c’est-à-dire un État, tandis que la poursuite d'une culture nationale juive vivante qu’elle appelle de ses vœux passe de facto par Israël. L’extrait choisi par les auteures ici consiste en la mise au jour de ces contradictions de l’antisionisme, contradictions que Daniel Boyarin tente de dépasser dans The No State Solution.
Sionisme, anti-sionisme et post-sionisme, vus d’Israël
Le sionisme, disent les auteures, est un colonialisme, d’après l’argumentaire connu et pas dénué de pertinence de Maxime Rodinson.Elles ajoutent à raison que ce caractère colonial était reconnu de manière assumée par l’appareil sioniste, avant d’être supplanté au profit de la seule grille de lecture ‘auto-émancipation nationale’. Ilan Pappé (2010) explique ainsi que qualifier Israël de fait colonial est un truisme vu de l’extérieur, mais que cela est impensable en Israël et ce pour une raison précise : le fait colonial est encore actif, dit Pappé. Reconnaître le passé demanderait de porter un regard sur le présent, et de voir que ce qui est intolérable dans le présent (l’occupation et la colonisation) n’est que la continuation de la forme prise par l’État d’Israël. En outre, le sionisme a impliqué et implique toujours une dépendance aux empires, à l’empire britannique hier, à la puissance américaine aujourd’hui, et est donc lui-même impérial, disent les auteures. Dans ce spectre d’analyse, celui de l’anti-impérialisme géopolitique, tout État est impérial puisqu’aucun ne peut échapper aux interdépendances et aux logiques de blocs et d’influences. Sont ainsi proposés deux textes du Brith Shalom, d’Hans Kohn (1929) et de Gershom Scholem (1931), où sont démontrés l’indifférence du mouvement sioniste à la question arabe, l’épuisement de l’utopie sioniste une quinzaine d’années après Balfour et la dépendance du sionisme aux empires vainqueurs de la Première guerre mondiale. Suit un entretien de Léon Trotsky (1934) qui, ne se prononçant pas la question sur le sionisme, n’en donne pas moins ce diagnostic lucide et nuancé sur les émeutes de Hébron, qui peut éclairer nos débats sur la nature du 7 octobre :
« [Avec une meilleure connaissance des faits] il me sera plus facile de juger dans quelle mesure se trouvaient en présence des éléments tels que les forces de libération nationales anti-impérialistes, les mahométans réactionnaires et les antisémites fauteurs de pogromes. À première vue, il me semble que tous ces éléments étaient réunis. »
Juif et démocratique sont deux exigences incompatibles pour l’État d’Israël disent les auteures, et pour dépasser cette contradiction, il faut faire advenir un État binational (donc acter la fin de l’État juif). Pour appuyer ce diagnostic, sont ainsi proposés des textes en lien avec le post-sionisme ou le bi-nationalisme. Le premier est un texte de Martin Buber (1948), qui voit deux pôles contraires au sionisme, les idées de renaissance nationale et de normalisation parmi les nations. Buber prônant la renaissance nationale et spirituelle du peuple juif affirme doctement que la conquête de Canaan était justifiée parce que les Cananéens étaient idolâtres, ce qui ne peut être dit des Palestiniens, et nous condamne donc à vivre en bonne intelligence avec eux. Mais la véritable raison n’est pas le monothéisme des Palestiniens : déclarer un État en 1948, c’est renoncer à la Judée-Samarie et donc trahir la terre d’Israël, ce qu’il ne se résout pas à faire. Un texte du Matzpen (1975) déplore le prix du sionisme : l’écrasement des Palestiniens. C’est peut-être le seul texte qui expose aussi nettement le prix payé par les Palestiniens pour l’établissement d’Israël, quand tous les autres sont essentiellement judéo-centrés. Ilan Halevi (1988), citoyen palestinien — fait suffisamment rare pour être signalé — estime qu’au sionisme hypocrite (travailliste) s’est substitué un sionisme cruel (likudnik). Ces mots disent également quelque chose de la logique de révélation sans cesse à l’œuvre dans la pensée antisioniste, où il s’agit de dévoiler la réalité des acteurs et de leurs idées par-delà leurs – superficiels – atours. C’est le cas en particulier du texte d’Ariella Azoulay et Adi Ophir (1998), anaphore mythes à déboulonner (« on nous dit que… »). Ils affirment en outre, à raison, que les Juifs en Israël ont conservé l’ethos minoritaire élaboré en diaspora où ils sont des victimes, une citadelle assiégée, et le monde non-juif une menace. Un similaire constat conduit Maxime Rodinson (1972) à explorer les raisons de l’échec du bi-nationalisme, notant que la lutte contre le sionisme est à la fin des années 60 le faux nez de la lutte contre les Juifs, que le sionisme redonne de la fierté aux Juifs. Il ajoute qu’avec le sionisme, Israël devient central pour l’identité juive et oblige les Juifs, partout où ils sont, à se positionner sur la question israélienne, ce qui a eu des conséquences considérables sur les Juifs du monde arabe et du bloc soviétique.
Faut-il s’en étonner ? Les contradictions de l’antisionisme laïc – élection morale contre individualisme résolu –sont figurées en pratique par les textes finaux de l’ouvrage. Judith Butler (2004) rejette l’appellation d’État binational puisqu’elle suppose encore binarité et conceptions nationales (et où les cas limites sont les Palestiniens israéliens et… les « Juifs arabes »), et quatre textes – « l’appel d’Olga » (2004), un texte d’Eyal Sivan (2012), Future Scenarios For Israel-Palestine (2018) et un éditorial de Gideon Levy (2019) – concordent à se défaire des illusions de la solution à deux États et à se rallier à la « One State reality ». En effet, disent-ils, si le sionisme implique la séparation des Palestiniens, alors il est profondément malfaisant. Dans le dernier de ces quatre textes, on peut y lire cette sidérante perspective politique : « Il faut renoncer à ses privilèges de colon, renoncer au sionisme et se mettre sous la direction des colonisés.»
Un texte profondément pessimiste de Moshé Behar (2020) clôt l’ouvrage. Moshé Behar nous dit ainsi que les colonies sont trop profondément ancrées dans la réalité pour permettre l’établissement d’un État palestinien, sans parler des impératifs sécuritaires que se fixe Israël dans la vallée du Jourdain. Mais il ajoute qu’il n’y a également rien à espérer du bi-nationalisme. Ce pays, Israël et la Palestine, est trop éloigné du libéralisme civique, les identités collectives nouées par des liens religieux, ethniques et nationaux ne peuvent disparaître d’un revers de main. Or, les partisans du bi-nationalisme esquivent cette difficulté, dit-il. Prôner un État binational pour sortir du statu quo, c’est prôner ou bien la poursuite de l’apartheid sans qu’il ne soit jamais de jure ou bien l’expulsion des Palestiniens à mesure qu’Israël annexe la Cisjordanie, pour permettre ainsi une annexion sans apartheid. Une telle conclusion donnée à un recueil résolument antisioniste ne peut qu’étonner. Peut-être est-elle lucide, même s’il faut espérer que non, qu’un sursaut diplomatique international permettra la mise en place de la solution à deux États sitôt la guerre à Gaza terminée. Ce pessimisme final ne figure pas moins le paradoxe intenable de l’antisionisme juif, sommé d’être aussi exemplaire et intransigeant moralement qu’antinational en pratique, de sorte que la seule voie de conciliation paraît être paradoxalement la continuation de l’État israélien tel qu’il est jusqu’à son effondrement – peut-être le messianisme est-il finalement ici logé ?
[1] Danny Trom, La France sans les juifs, PUF, 2019, pp. 93-118.
[2] Benny Lévy, Être juif : étude lévinassienne, Verdier, 2003.
[3] Ainsi, les auteures pourront traiter d’un seul tenant des arguments de nature foncièrement différente, mais en les évoquant tous ensemble comme un même geste politique. Rabbi Yohanan ben Zaccaï dit que.. d'ailleurs, beaucoup savaient que la déclaration Balfour allait produire un conflit insurmontable... le troisième rabbi de Gur prévenait qu'un État juif était une profanation du nom du dieu. Les auteures veulent nous dessiller les yeux et ont ce même rapport à l’histoire, chaque évènement — 1967 en particulier — révèle les intentions profondes du passé — 1948, voire 1898, le premier congrès sioniste.
[4] De nombreuses violences antisémites — jusque l'acmé du pogrom de Kielce en 1946 — ont suivi la Libération.

