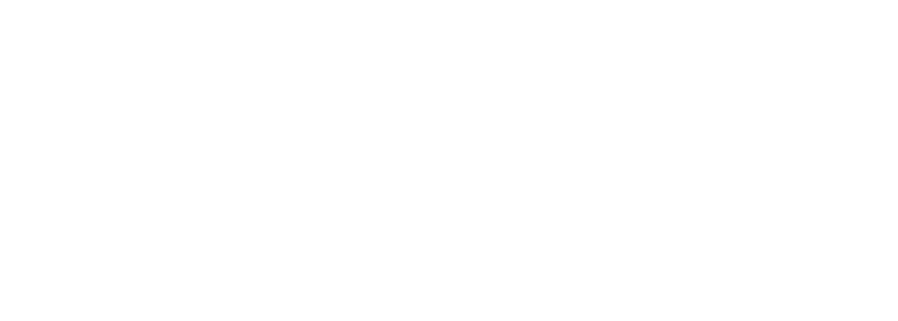
11 février 2025.
Mais seule l’humanité rachetée a le droit à la totalité de son passé. Rachetée, c’est-à-dire libérée[1].
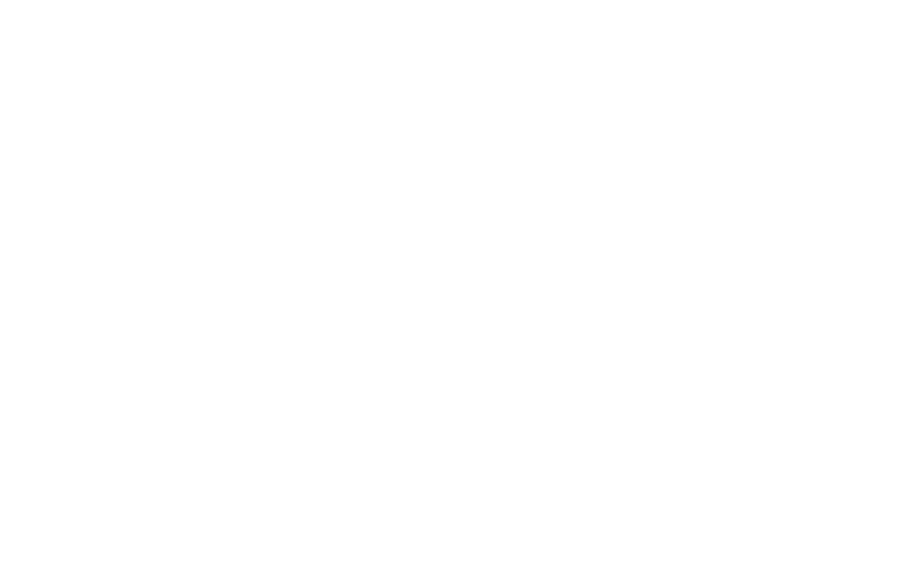
Caravansérail d'Alep, 23 janvier 2025
Six semaines après la chute du tyran qui avait juré de régner ilā al-abad, les amis du sang s’interrogent : que faire face à l’ampleur du désastre ? Que faire pour les morts et les disparus, mais aussi pour les dizaines de milliers d’enfants affamés – orphelins ou non – qui errent sans fin dans les rues d’Alep, Homs ou Damas ? À l’heure de sa libération, l’exorbitante tragédie du pays brûlé convoque tant le jugement sur le passé terrible que la perspective d’un avenir meilleur, tant la mise en mémoire de la folie assadienne que la responsabilité à l’égard des vivants. S’agit-il d’une contradiction ? Déjà, on prioritise : la crise économique est telle que tout doit être subordonné à sa résolution ; les crimes commis sont si lourds qu’il convient de ne pas risquer la fragile concorde nationale en désignant trop vite ceux qui y ont si goulument pris part, par-delà le nizām dont tous s’entendent désormais à dire qu’il fut en effet malfaisant. Se pourrait-il pourtant que le dilemme entre le solde de tout compte et l’urgence du présent soit moins insoluble qu’il n’y a d’abord paru ?
Ces dernières semaines, parmi les fractions de la société syrienne demeurées jusqu’au bout loyales au régime, la critique des décennies d’abus et d’exploitation économique éclate enfin au grand jour. La pauvreté inouïe des partisans – mou’ayidīn – et de leurs familles, le système de prédation du parti-État et en particulier de sa redoutée garde prétorienne – la fameuse division 4 – et finalement la fuite désordonnée et crapuleuse du tyran ont fini de lui aliéner ses derniers soutiens. À Douma, ville-martyre de l’immédiate banlieue de Damas, un officier sunnite de la défunte Armée arabe syrienne me dit toute sa détestation du régime : « Les salaires étaient bas, il nous était impossible de vivre ». Un autre officier, alaouite de Homs, concourt : « À part Bashar et son clan familial, nous avions tous des difficultés ».
La souffrance serait-elle le facteur unificateur de la société syrienne hébétée de tant de violence ? La thèse se répand parmi les amis du sang faisant montre d’une incontestable grandeur morale. « Tout le monde en Syrie a perdu à cause du régime », disent certains d’entre eux lors des innombrables conférences-débats qui agitent le pays brûlé assoiffé de politique. Malgré son indéniable générosité, l’élan échoue à convaincre ceux auxquels il est destiné. Les anciens partisans du régime, ceux qui se rangent désormais au triomphe de la révolution, ont enduré la mainmise ba'thiste sur le pays, mais ils n’ont eu à souffrir ni les bombardements au baril et les disparitions forcées, ni le dangereux exil et la vie dans les camps de fortune d’Idlib, du Liban, de la Jordanie ou de l’Iraq. Quel aurait été leur point de vue sur le régime assadien si celui-ci avait su assurer leur prospérité ?
Certains, heureusement minoritaires, regrettent déjà la tyrannie du Ba’th. Ces derniers jours en Syrie, un étrange phénomène a ainsi eu lieu : la rumeur du retour de Maher al-Assad – frère du président déchu, représentant de l’aile la plus cruelle d’un État dont la norme était la brutalité – a enflé au sein des villes du littoral qui ont longtemps formé le cœur battant du régime assadien. Certains ont repris les armes, espérant inverser la défaite eschatologique du Ba’th ; leur tentative a rapidement été mise en échec par l’action conjuguée des nouvelles autorités et de la réaction populaire majoritaire. On a dit de certains amis du sang empreints d’esprit de concorde nationale qu’ils étaient prêts à passer outre l’écart béant qui sépare les partisans insuffisamment récompensés d'un côté des victimes de l’État de barbarie de l'autre. Mon interlocuteur de Douma se charge de dissiper la méprise d’une réconciliation trop facilement décrétée : « les récits d’attaque à l’arme chimique de la Ghouta orientale sont du tahwīl ». Tahwīl : l’exagération destinée à effrayer, dans le but d’attirer une sympathie indue.
Le pays bruisse pourtant de violences trop longtemps tues. Malgré d’éparses velléités de révolte, le littoral alaouite est ainsi dûment protégé, sans doute plus que d’autres régions du pays, en particulier celles rurales où des forcenés réunis en Brigades des partisans de la Sunna ont récemment donné libre cours à un sanglant esprit de revanche. Dans la région de Homs, capitale de l’élan révolutionnaire, ville-monde d’Abdelbassit Sarout reprise et détruite par le régime en 2014, des villages alaouites ont fait face ces derniers jours au déchainement de la vindicte vengeresse. On tue d’abord des officiers ba'thistes de haut rang, avant que la colère n’emporte également leurs voisins. En comparaison de situations historiques de pareille nature, les représailles sont néanmoins rares, tant bien que mal contenues par la Hay’at Tahrīr ash-Shām – le Comité de libération du Levant[4] – qui a défait Assad.
On aurait tort – comme s’y pressent déjà les sempiternels spécialistes ès sectarisme moyen-oriental – de ne voir dans les épisodes de vengeance qui suivent la libération du pays brûlé que l’expression de différends théologiques perpétuellement ressassés. La crainte des minorités religieuses à l’encontre de la majorité sunnite trouvait dans le ba’thisme une expression renouvelée par le procès de modernisation-nationalisation du pays[5]. La majorité était tenue pour trop conservatrice, trop sous-développée, trop nombreuse – racisme social authentiquement moderne qui aboutissait logiquement à l’impératif de l’endiguement. Cette politique minoritaire trouvait sa vérité en un lieu déterminé à défaut d’être exclusif : Saednaya.
Le nom terrible a fait le tour du monde, à mesure que nous parvenaient les images miraculeuses de rescapés stupéfaits d’être soudain libres. Au lendemain de la libération, des Syriens venus de toutes les régions du pays avaient afflué à Saednaya et aux nombreux autres satellites de l’univers concentrationnaire assadien[6]. Les amis du sang ne pouvaient se laisser aller à la liesse populaire sans s’élancer fébrilement à la recherche des leurs. Hélas, quelques centaines seulement parmi eux avaient été sauvés ; le reste – plus de 130 000 disparus – n’a pas été retrouvé. À Saednaya, aux premiers jours de la libération, une sorte d’hallucination collective a eu lieu, illusion de lieux de détentions secrets sous la prison officielle désespérément vide[7], d’où l’on a cru entendre les appels au secours des disparus. En Syrie, les premiers instants de la libération ont été consacrés au forage frénétique des sols.
Ma visite à la prison a eu lieu quelques semaines après que l’afflux des familles et des journalistes a cessé. Depuis la place des Abbassides, un mini-bus de service a pour destination le village araméen de Saednaya – dont le nom vénérable avait été ainsi volé par le régime assadien. L’arrêt devant la prison n’est pas prévu, il me faut demander brusquement au chauffeur de s’arrêter devant ses murs nouvellement peints du drapeau révolutionnaire et de slogans sans équivoque : « nous n’oublierons par l’abattoir humain, nous ne pardonnerons pas », « nos disparus sont une douleur pour l’âme, une épine dans la victoire ».
La découverte quotidienne de fosses communes insoupçonnées avait pourtant remplacé la recherche fiévreuse des disparus. La prison n’était plus gardée que par quelques jeunes soldats de la libération : « tu peux visiter, mais il te faudra une voiture, la prison est loin derrière le mur d'enceinte ». En désespoir de cause, j’ai d’abord rebroussé chemin pour Damas, peut-être secrètement soulagé. Un chauffeur de taxi rencontré à quelques dizaines de mètres de la prison me propose néanmoins de la visiter ensemble ; lui aussi veut contempler l’horreur de ses yeux. Issu du cru, mon acolyte inattendu se nomme Abou Hadi. Il a vécu plusieurs années à Idlib, la poche révolutionnaire du nord-ouest d'où se sont élancés les soldats de la libération, avant de revenir dans sa région à la faveur de la chute du régime assadien. Les jeunes hommes qui gardent la prison ne lui sont pas étrangers, Abou Hadi les a connus lorsqu’ils n’étaient que des enfants survivants tant bien que mal à la faim et au froid des camps de fortune d’Idlib, où se massaient ainsi toujours plus de déplacés à mesure que l’État de barbarie paraissait remporter la guerre contre sa société. Malgré l'interconnaissance, les soldats qui nous accompagnent cette fois jusqu’à la porte de la prison refusent d’y entrer. « Je l’ai vu trop de fois, je n’en peux plus », me dit l’un d’entre eux, bien que précocement aguerri au combat militaire.
La prison comptait perpétuellement plusieurs dizaines de milliers de détenus, opposants chevronnés, entourages suspectés par association ou gens du commun arrêtés pour un mot ou un regard. Quoique Saednaya ait été un haut lieu de la torture dont le régime assadien avait fait sa règle, la prison ne servait guère à extorquer les aveux de ceux que l’on y avait enterrés vivants ; ces confessions avaient été déjà arrachées ailleurs, au sein de la constellation de services de renseignements – on en comptait plusieurs dizaines dans le régime d’Assad – qui étranglaient le pays brûlé. La torture à Saednaya n’avait nulle visée autre que la terreur généralisée ; les prisonniers étaient ainsi les infortunés messagers portant dans leurs corps la nouvelle d’une barbarie innommable. Il fallait pourtant bien que la rotation se fasse, que les morts-vivants – ad-dākhil mafqōd wa al-khārij mawlōd[8] – cèdent leurs cellules bondées à d’autres guère mieux lotis, que la terreur continue son œuvre. La « solution » assadienne – en écho à une autre « solution[9] » – était ainsi bien moins nuancée que les contorsions discursives de ses soutiens occidentaux anti-impérialistes : une presse de cinquante tonnes pour broyer les corps, un crématorium pour disposer des restes. Tout au long de notre visite, Abou Hadi n’aura de cesse de psalmodier la supplique que l’on entonne en terre musulmane lorsque règne la nuit la plus sombre. « Ya latīf » : ô Bienveillant.
Le traumatisme d’une cruauté si exorbitante peut-il finir par s’estomper ? J’ai écrit plus tôt que les amis du sang oscillaient entre la performance de l’oubli et l’esprit de vertueuse vengeance. Il me faut corriger le propos ; l’espoir né d’une victoire miraculeuse trace une sinueuse mais bien réelle voie de réparation collective.
Une chorale de femmes dans la caravansérail brisé d’Alep chante la fierté d’une libération eschatologique. Un soldat de la libération est présent, il se filme fredonnant lui aussi les refrains révolutionnaires. Le spectacle finit, l’assistance ne peut pourtant s’empêcher de poursuivre : « un, un, un, le peuple syrien est un », « porte ta tête haute, tu es un Syrien libre », etc. Le vendredi après-midi, après la prière, au pied de la citadelle détruite, des familles sont en promenade, scènes populaires reconnaissables entre toutes, dans le monde arabe et au-delà. En Syrie, néanmoins, les marchands de sucreries et de ballons gonflables ont ajouté à leurs activités lucratives la vente de drapeaux aux couleurs de la révolution, ainsi que celle des portraits de Sarout. Des jeunes adolescents donnent quelques billets à un groupe de percussionnistes afin qu’ils puissent danser la dabké ; ils sont rapidement entourés de badauds admiratifs. Les soldats sont pourtant la principale attraction de l’après-midi, destinataires souriants d’infinies demandes de selfies, se prenant parfois en photo en compagnie des passants avec leurs propres téléphones, étrange inversion propre au temps de retrouvailles nationales inespérées. Quelques jours plus tard, à Bab Touma, quartier chrétien de la vieille ville de Damas, l’annonce par les nouvelles autorités de la dissolution du Ba’th et de l’Armée arabe syrienne suscite de nouvelles explosions de joie, en l’espèce les sempiternels coups de feu en l’air, comme une réminiscence de ce matin de décembre où la nouvelle de la fuite d’Assad a embrasé les consciences. Le lendemain, je suis témoin d’une scène tant fugace qu'attendrissante. Des enfants jouent au loup dans le parc sur fond sonore de Janna ya watanna. L’un parmi eux a pour animal domestique une sorte de perruche ayant élu domicile dans son cou. Trois soldats passent ; ils demandent au jeune ami des oiseaux s’ils peuvent lui racheter son compagnon. « Même pas pour un million de dollars », répond l’enfant à l’espièglerie des hommes en armes – scène impensable à l’heure de l’État de barbarie.
À Idlib, avant la libération, l’autorité qui régnait sur la dernière région révolutionnaire s’était proclamée Gouvernement du salut. Le terme est sans doute aussi intrigant que juste. Qu’on n'en doute pas : la joie, qui est volonté de vivre, est par elle-même salvatrice. La tâche qui attend le pays brûlé n'en est pas moins vertigineuse. La victoire révolutionnaire n’était qu’un commencement. À l'heure qui lui fait suite, le salut ne viendra que de courage moral à hauteur des horreurs surmontées. À Saednaya libérée, les murs repeints l’avaient déjà proclamé : la libération comporte une épine.
[1] Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers, Paris : Flammarion, 1980, p. 21.
[2] On reconnaitra l’expression du regretté Michel Seurat, près de quarante ans après son enlèvement et son assassinat par le Hezbollah agissant sur commande assadienne.
[3] Coquio, Catherine, Joël Hubrecht, Farouk Mardam-Bey, et Naïla Mansour, éds. Syrie, le pays brûlé (1970-2021): Le livre noir des Assad. Paris: Seuil, 2022.
[4] Le terme as-Shām signifiant le Levant désigne également Damas.
[5] Cet aspect du problème fera l’objet d’un autre texte.
[6] Le terme est de Catherine Coquio.
[7] À la veille de la libération, les autorités pénitentiaires ont assassiné de nombreux détenus, parmi lesquels Mazen al-Hamada, témoin essentiel de la torture dans les geôles assadiennes. Voir le livre de Garance Le Caisne, Oublie ton nom. Mazen al-Hamada, mémoires d'un disparu (Stock, 2022).
[8] « Celui qui entre est perdu, celui qui sort renait ». Cette formule servait à décrire les prisons syriennes dans leur ensemble.
[9] À la différence de toute métaphore agambienne, la filiation qui lie le régime assadien au nazisme est circonstanciée. Aloïs Brunner, second d’Eichmann, ancien commandant du camp de Drancy, est devenu après-guerre le conseiller de Hafez al-Assad, pour lequel il a conceptualisé l’appareil sécuritaire ba'thiste. Plusieurs méthodes de torture usitées au sein des prisons syriennes venaient ainsi du nazisme (le Boger Swing, la chaise allemande etc.).

