Simon pierre
Positionnalités et structures.
Les islamisants et islamité
Les islamisants et islamité
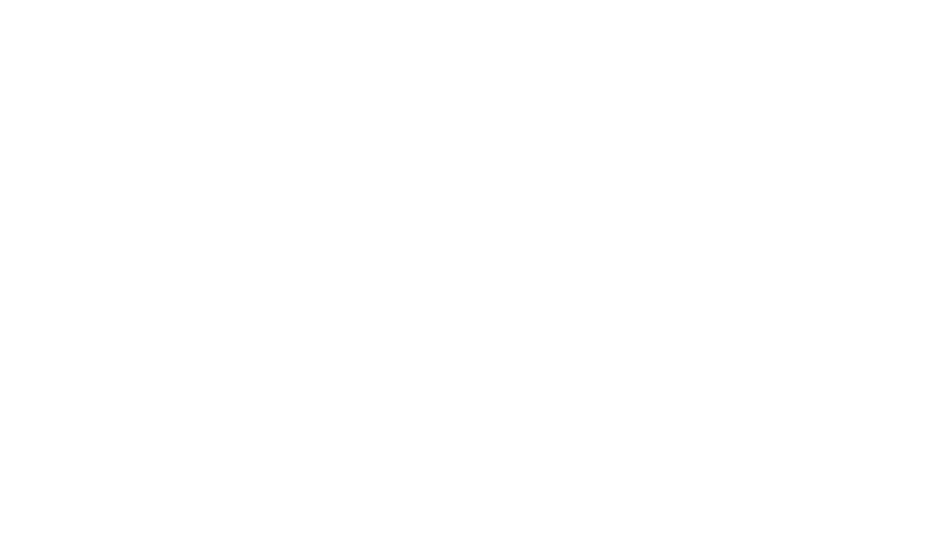
Le monde scientifique a tendance à sous-estimer l’influence de nos biais socio-culturels sur les paradigmes de nos disciplines, surtout lorsqu’elles sont éloignées du monde social européen et contemporain. Interroger notre position propre de chercheur.se devrait être nécessaire à l’appréhension de logiques sociales et humaines qui, bien qu’anciennes ou lointaines, sont souvent parallèles voire interconnectées. Pourtant, l’abstraction intellectuelle, la focalisation sur un domaine concentré et précis, la décortication d’échantillons tout aussi désincarnés qu’ils peuvent être réanimés à volonté, forment autant de filtres au cocon qui protège notre personne de la réalité humaine de notre sujet, et en retour sépare notre terrain de notre champ social. Malgré tout, la réalité surgit parfois brutalement et nous contraint à nous identifier comme act·eur·ice·s, et non plus comme observat·eur·ice·s.
1. « Connais-toi toi-même ! »
En temps normal toutefois, cette mise à distance permet aux chercheur·se·s de ne point trop s’inquiéter des conditionnements que leurs environnements induisent pour leurs hypothèses, approches, choix de sélection, analyses et interprétations des données. Et cet isolement est démultiplié par la grande rareté des échanges et communications entre des spécialités, domaines et époques trop cloisonnées. Ainsi, l’hyperspécialisation induit deux phénomènes qui se conjuguent de manière circulaire : hors de leur champ disciplinaire précis, les savant·e·s sont trop souvent contraints de se fonder sur l’image vague et simpliste que produit la narration médiatique, laquelle les tient justement à l’écart lorsqu’il est question de vulgariser leur propre sujet. En l’absence de prise en compte de l’état de la science des autres disciplines, cela introduit mécaniquement des prémisses non-questionnées. Ainsi, dans sa tentative même de neutralité, chacun·e entretient, à propos de savoirs que ne traitent que les autres disciplines, un grand nombre de prénotions hégémoniques, issues d’une perception superficielle des faits qui les soutiennent, et confortées par ses présupposés socio-culturels.
Du côté des spécialistes des mondes contemporains, un exemple serait la définition de « l’islam » comme « religion » et le problème de l’articulation de ce « religieux » avec la forme du gouvernement et l’ordre législatif des mondes précoloniaux. Or, ces deux notions sont le produit d’un univers colonial puis mondialisé, aux normes occidentalisées et où le champ du religieux a été délimité, et l’islamité réduite à l’identification de l’indigène, exclue de toutes les autres dimensions sociales et politiques : celles qui sont l’objet des études contemporaines de la recherche occidentale. Cela implique qu’un avant obscur et sans aspérité se voit assigné au règne du « religieux », congelé dans la permanence d’un ordre canonique fondateur.
Cet avant est bien plus imaginé qu’analysé, en fonction de la place que lui laisse ‒ ou que reconvoque ‒ une modernité sécularisée. Il est fréquent que le processus de ces catégorisations coloniales et réappropriations postérieures soit appréhendé, évoqué voire déconstruit en introduction. En revanche, il est presque systématiquement impossible que l’arrière-plan médiéval et moderne des institutions, sociabilités et modes de fonctionnements éthiques, idéologiques, légaux et politiques, profanes comme sacrés puisse être saisi. Autrement dit, le passé précolonial apparaît alternativement soit comme une idylle romantique, voire romanesque et libertaire, soit comme un régime totalement régi par des considérations irraisonnées, théologiques et eschatologiques. Par conséquent s’impose alors inconsciemment aux non-médiévistes la transposition de leur propre imaginaire occidental sur la religion d’une part, et sur l’islam d’autre part, et ce même lorsqu’il·elle·s s’évertuent courageusement à prendre le contre-pied des attendus de leur milieu. Tout cela est très handicapant lorsqu’il faudrait pouvoir discuter, expertiser et vulgariser des notions comme les « signes religieux par destination », dont se saisit le débat juridique et politique de notre univers social du XXIe siècle occidental.
En revanche, il est beaucoup moins facile d’appréhender l’ampleur des mécanismes et réflexions beaucoup plus séculières et pragmatiques, mondaines et libérales, capitalistes et redistributives, qui charpentent l’objet principal de la littérature savante comme de son application de tous les jours en Islam : un fiqh qui n’a pas grand-chose de « religieux » au sens post-colonial. Concrètement, l’absence d’influx de connaissances et de concepts depuis les études médiévales et modernes vers les sciences humaines du contemporain empêche souvent de saisir l’Islam – majuscule – comme le système de civilisation de l’œkoumène médiéval, lui-même en grande partie non-clérical et donc laïc, et concentré sur le règlement légal de causes profanes. En son sein ou en marge de celui-ci, des « communautés » « religieuses » et « ethniques » se sont quant à elle effectivement constituées de manière sectaire autour de leur clergé et/ou de leur noblesse militaire, afin de survivre face à cette autre première hégémonie impériale, séculière et assimilatrice. Un bon exemple est le mariage de droit musulman qui apparaissait aux institutions non-musulmanes médiévales comme un « mariage séculier (ʿalmānāyā) » [Synodicon in the West, II, p. 30-31], une « union » « fornicatrice » voire « adultérine », en raison de son caractère purement contractuel et civil. Or, celui-là même se retrouve aujourd’hui affublé de la notion de « mariage religieux » et reporte le même jugement contre les unions civiles en droit occidental [Koné, Calvès 2021]. Si de telles perspectives gagnaient en visibilité, cela pourrait permettre de faire émerger des critères d’analyse, des paradigmes et des théories de mécanismes humains, non pas au sein de l’objet moyen-oriental circonscrit, mais bien à partir de lui vers l’universalité.
Réciproquement, et pour des raisons identiques, les spécialistes des périodes anciennes et médiévales sont conduits à se représenter de manière superficielle ou confuse les dynamiques des mondes musulmans contemporains, et leurs évolutions. Cela concerne l’hétérogénéité et les articulations complexes des formes et des réalités sociales, géopolitiques et idéologiques, et a fortiori lorsqu’il est question du rapport au religieux, de l’islam politique. On a alors soi-même tendance à projeter sur la chrétienté antique ou l’islamité médiévale les attitudes conditionnées par le monde moderne traversé sans être étudié, à peine observé, et toujours non-partagé. On se forge ainsi une idée anhistorique de l’islamité à partir de laquelle on travaille et, au bout du cycle, ce qui en est finalement vulgarisé hors des milieux académiques finit par former la prénotion des recherches portant sur « l’islamisation » au XXe siècle. Ce mécanisme explique sans doute l’incapacité à appréhender, saisir et exposer le phénomène pourtant massif, hors des bureaux et des laboratoires, de la lame de fond du sécularisme, de l’irreligion et de l’athéisme que connait aujourd’hui le Moyen-Orient et la Méditerranée (infra). Un autre bon exemple pour l’illustrer est le paradigme implicite mais omniprésent, que l’état de corruption endémique des sociétés post-ottomanes serait le reflet d’habitus médiévaux. Or, dès que l’on se propose de confronter cette projection hypothétique avec les sources, il semble bien que les fonctionnaires et les juges, à tout le moins ceux des premiers siècles de l’Islam, étaient rarement soupçonnés de ce type de malversations si malheureusement coutumières aujourd’hui.
2. Double position et détection des asymétries ?
telle préoccupation personnelle et méthodologique est davantage susceptible d’émerger lorsque le·a chercheur.se est confronté·e à une dissonance propre à son assignation sociale. En effet, il·elle peut être à la fois correctement identifié·e à la catégorie sociale et ethnoculturelle dominante, mais, en raison d’aléas propres et particuliers à son parcours ou héritage familial, ou à ses démarches, affects et attirances personnelles, avoir assimilé une part significative de culture subalterne et de codes sociaux dominés. Dans ces conditions, il·elle sera plus à même d’être admis dans les échanges privés de la sociabilité dominante, et d’en reconnaître les implicites pour ce qu’ils sont : des marques de renforcement de l’entre-soi et des présupposés socio-culturels. La violence symbolique en sera d’autant plus explicitement perçue que, du même coup, le choc de ce discours ou dispositif fera ressentir à l’autre part de son individualité qu’il consiste en une réaffirmation de sa propre subordination.
Lorsque, par exemple en contexte para-académique, il·elle se situe sans l’avoir même planifié à la table des dominants hiérarchiques, entouré·e de semblables socio-culturels, tandis que ses autres semblables sont ségrégués, et relégués au regard de cette hiérarchie, à un autre entre-soi subi, il·elle lui sera difficile de l’ignorer, de prendre cet état de fait comme une norme implicite et non-questionnée, contrairement à ses voisins. Il·elle s’apercevra que l’un·e se moque, plus ou moins gentiment, de l’une ou l’autre des expressions culturelles extra-européennes, ou que l’autre rapporte de son « terrain » en contexte islamique des souvenirs de brousse impliquant, pour des raisons alimentaires évidentes, une ségrégation de facto. Un.e troisième semble partager une crainte incontrôlable de la banlieue, même la plus voisine de sa métropole tandis que l’autre nie l’influence structurelle et fondatrice de l’ordre social et administratif français sur ses anciennes colonies. Un·e quatrième se montre incapable de comprendre la légitimité de certains mécanismes ‒ certes désagréables ‒ de rejet de la part des collègues de l’ancienne colonie. Un·e dernier·e déplorera la passivité des co-aut.eu.rices académiques du « terrain » ultra-marin, et cela en dépit du fait qu’il est implicitement entendu qu’il·elle·s n’ont d’autre rôle que de justification nominale pour valider une coopération post-coloniale asymétrique (infra). Une autre autorité trouvera naturel de juger implicitement inacceptable toute expression et même manifestation d’attachement à une quelconque islamité ; et un·e autre collègue se pensera par ailleurs très tolérant·e de juger que ce n’est « pas grave » qu’un étudiant soit islamophile « au niveau Master », impliquant donc que cela le deviendrait pour un doctorant. Et finalement, on jugera un postulant « apologétique avec l’islam » lorsque, d’origine extra-européenne, il aura eu le malheur de paraître croyant, ou de paraître aux côtés de croyants. Il est bien entendu que personne ne jugera jamais de la sorte quelque impétrant et candidat que ce soit dont la foi et la pratique catholique serait non seulement manifeste ; mais assumée, reconnue comme telle et donc légitimée au sein des catégories estudiantines du quartier latin.
Face à cette avalanche de marques de reconnaissances de l’ordre dominant auquel il·elle est convié·e pour la part de soi qui est visible, il·elle reçoit alors aussi clairement le message lié à sa connivence de classe et d’ethnie, qu’il·elle peut le penser et l’interpréter, et donc l’expliciter, parce que l’autre partie de « soi » en est la cible implicite. Il.elle pourra parfois tenter la pirouette du raisonnement par l’absurde ou de l’humour pour manifester poliment son rejet d’une telle connivence de dominants, et éventuellement tenter de faire saisir à son interlocut·eur·ice la teneur oppressante de cet implicite de domination. Cependant, cela ne change rien aux dynamiques et rapports structurels, aux phénomènes de masse qui conditionnent tous les arrière-plans paradigmatiques de son véritable terrain : le champ académique. Ce système valide un grand nombre de prénotions admises parce que non-questionnées, et accroit la béance des fossés entre réalité contemporaine superficiellement externalisée, et systèmes anciens analysés en contexte mental et social rassurant et confortable.
Cette expérience de la double position questionne donc la cécité du monde académique face à des attitudes qui devraient précisément être débusquées et analysées avec la méthodologie des sciences humaines et sociales. Comment une même sélection des plus aptes à les traiter dans les sources ou les terrains peut-elle complètement ignorer d’appliquer cette méthode dans leur environnement réel ? Comment passer outre le temps et l’énergie dépensés à l’office de nouer des relations et de s’attacher des patrons ? En premier lieu, nous proposons l’hypothèse que la dissociation mentale entre les stratégies pratiques et implicites et les phénomènes étudiés et explicités est liée au fait que d’énoncer les premières en détruit l’efficacité, et que le refus d’en personnaliser les secondes, sert à préserve l’implicite des premières : que le processus de recrutement de l’université médiévale n’a jamais été rationalisé à l’instar du reste de la fonction publique. Et cela rend d’autant plus pertinent les similarités anthropologiques entre l’objet virtuel de son étude médiévale, et sa position dans son terrain réel. Pour autant, cette dissociation permet de se penser tout à la fois en surplomb, supérieur à son objet d’étude, et aussi, et conséquemment, pur esprit en dehors de tout conditionnement social.
3.Clientélisme et réseau, médiévaux et actuelsLe problème qui articule et unit ces isolats disciplinaires en interaction non contrôlées consiste au peu d’incitation à s’inspirer des mécanismes sociaux auxquels nous participons pour comprendre l’objet de nos études. Notre monde d’acteur social est jugé normal et universel, et donc implicite et non-questionné. Dès lors, les jeux de position en son sein, qui pourtant, occupent pour des raisons matérielles une grande partie de notre temps de cerveau disponible, ne sert que trop rarement à proposer et transposer des modèles explicatifs vers les phénomènes parallèles que nos sources suggèrent. À cela s’ajoute bien entendu le fait que la nature élitiste de la sélection et de la sociabilité académique tend à délégitimer toute démarche comparatiste au prétexte du risque d’approximation même de la discipline empruntée en parallèle de la sienne propre. Mais, ne se pourrait-il pas que cette méconnaissance de nos structures et de nos positions individuelles, au sein de cet espace social tangible, puisse être bien davantage susceptible de déformer l’interprétation des phénomènes anciens étudiés ? Le « terrain » des médiévistes s’étend-il davantage à la bibliothèque dont il dépouille les manuscrits qu’à ce cadre géographique et humain actuel de l’espace de recherche ? Les mécanismes sociaux et politiques qu’il·elle cherche à reconstituer, sous l’amas des discours, récits et notes des scribes et savants de son cadre d’étude ne seraient-ils pas plus facilement déduits de la somme de ses observations particulières des interactions, rapports de forces et attractivités qui le pressent et le traversent au quotidien, dans son propre monde académique de scribes et de savants ?
Nous souhaiterions profiter de cet espace d’expression pour réhabiliter ici la nécessité scientifique d’une telle démarche introspective. Nous donnerons brièvement deux exemples d’identification et d’explication plausible tirées de la comparaison des informations de nos sources sur la période des débuts de l’Islam, au regard des mécanismes vécus et subis dans le terrain dont notre personne est acteur et sujet, le clientélisme et les réseaux :
1)À travers notamment l’introduction de conceptions tardo-antiques comme la familia élargie et la notion d’amicus, nous proposons de réévaluer le processus socio-politique du patronage de walāʾ chez les premiers Arabo-musulmans[1]. L’idée théorique d’un mawlā ethnicisé, statutairement inférieur à l’Arabe, voire assimilé à la condition captive et servile, est en fait le produit d’une époque de fixation et de stratification d’un ordre social (fin VIIIe siècle) qui fut aussi celui de l’époque de rédaction de nos sources. Ce faisant, ce système clôt ne permettant que le « changement social » efface toutes les dynamiques de « mobilité sociale » antérieures [Tajfel, Billig, Bundy et Flament 1971] d’individus qui adhèrent à des groupes élitaires spécifiques en mettant à leur service loyauté et compétence : une forme d’adoption à la familia, indépendant d’une quelconque infériorité servile ou non-arabe préalable. Or, pour détecter et interpréter les processus d’affiliation, de loyauté, de fidélité, et inversement d’élection, de propulsion et de paternalisme dont les acteurs et auteurs tardo-antiques témoignent, il nous a été nécessaire de les observer au sein des relations interpersonnelles présentes dans le monde académique qui concerne notre position sociale.
2) Nous avons également proposé, dans une publication récente, plusieurs comparaisons entre les stratégies de réseaux multiples et croisées des moines syro-mésopotamiens et celles des universitaires modernes. En effet, en contexte miaphysite « jacobite », comme académique aujourd’hui, les nominations étaient alors fonction de solidarités provinciales (Syrie du Nord/Qinnasrīn, Jazīra et Irak/Mossoul), déterminées par l’organisation administrative et politique. À plus grande échelle et par croisement, elles étaient aussi produites par l’attache à des centres de formation communs (monastères de Tell ʾAddē, Kayshūm, Gūbbā, Qen-Neshrē, Qarṭmīn, Mār Mattay, Knūshyō, Ḥaṣṣīṣōyō). Enfin, des mécanismes compatibles autant que contradictoires émergeaient du fait de succéder à un métropolite, voire à un patriarche, sur son premier poste d’évêché (Ḥarrān, Amid, Takrīt, Mossoul, Raqqa). L’intersection de ces logiques produit non seulement des rivalités de monastères au sein d’un même bloc régional, mais aussi des hostilités interpersonnelles nées au sein d’un même centre de formation, ou entre le monastère de tête et les branches subordonnées mais rivales, et enfin la cristallisation de camps opposés dans une même cité épiscopale [XXXXX, 2023].
4.L’héritage franc comme normeSi ce type de méthodologie parait si inhabituel, et si les mécanismes de subordination socio-ethniques restent à ce point impensés ‒ alors même que l’on traite en tant qu’Occidental du Dār al-Islām, c’est sans doute en partie parce que la fiction de cette dissociation entre monde académique et terrain d’étude permet de maintenir incritiqué le poids de l’héritage social et culturel des agents universitaires.
En effet, celui-là est occidental par définition, et donc tributaire d’une matrice idéologique qui ne cesse de se renouveler, en marge de l’oikoumène islamisé, dans les mêmes limites aux périodes « franque » (VIIe-XIe), puis « catholique romaine » (XIe-XIVe), et enfin impériale « européenne » (XVe-XIXe). En outre, si l’on admet l’axiome matérialiste que les idées, idéaux, prérequis et notions sont déterminées par le statut social, alors, au terme de la constitution des hiérarchies impériales sur fondements ethniques, physiques et confessionnels (infra), elles le sont aussi par le statut racial qui est tout à la fois le produit et le critère de cette histoire occidentale.
En l’espèce, la position des chercheur·se·s résulte mécaniquement d’un parcours scolaire déterminé par les capitaux économiques, ethniques et culturels objectifs. Le recrutement dépend donc par définition de préférences socio-culturelles implicites et donc d’autant plus puissantes : « les savoir-être ». Or, la force du caractère interpersonnel ‒ pré-révolutionnaire pour dire le moins ‒ de la sélection universitaire en France (et d’autres pays européens sans doute ?) implique que les choix de patronage des directeur·ice·s, puis les critères d’appréciation pour les postulant.e.s aux réseaux, sont d’autant plus dépendant de ces critères subjectifs et irréfutables.
Répétons que ce cloisonnement mental est d’autant plus prégnant qu’il concerne un milieu académique particulier : celui-là même qui se consacre non pas à l’un ou l’autre aspect du monde occidental, mais aux champs d’espaces anciens et modernes extra-occidentaux. Le non-dit y est donc, en l’occurrence, d’autant plus manifeste qu’innocemment ignoré. En outre, le domaine du Moyen-Orient et de la Méditerranée, le Dār al-Islām médiéval, constitue la partie la plus voisine du monde franc : son altérité est donc d’autant plus radicalement perçue et catégorisée qu’elle se renforce du voisinage, des échanges, et donc des conquêtes et des migrations. Cet espace est ainsi, de tous les dominions de l’impérialisme occidental des deux derniers siècles, celui qui fut le plus conceptualisé comme adversaire, puis comme sujet, et enfin comme antagoniste. Il pâtit donc logiquement de la plus radicale des constructions produites par la république chrétienne des lettres et de l’eurocentrisme aryanisant, dont hérite le monde universitaire occidental. En contexte sud-européen en particulier, il est impossible d’éluder un passif de proximité, et donc d’exacerbation, de 13 siècles d’opposition en Méditerranée occidentale entre, d’une part, les « Francs » « catholiques romains » « européens » (de l’Ebre à l’Elbe), et, d’autre part, les « Maures » « musulmans » et « Africains ». En outre, ce rapport conflictuel, caractérisé par les croisades (XIe-XIIIe) puis les guerres de courses (XIVe-XIXe), fut longtemps asymétrique en défaveur des « Francs », et à l’avantage des « Maures ».
Ce déséquilibre, qui ne se retourne guère qu’au milieu de l’époque moderne, a nourri d’autant plus d’angoisses culturelles, religieuses et existentielles qu’elles sont ensuite reprojetées sur le nouveau vaincu et dominé. Les acteurs et penseurs de ces différentes couches n’ont eu de cesse de puiser dans les plus anciennes pour renouveler, reformuler et restructurer à chaque époque un même contingent de peurs et de mépris. Il serait donc beaucoup plus surprenant que cette intraitable altérité n’ait pas induit l’hostilité dont témoigne l’université latine à l’égard de la religion des « mahométans », avant qu’elle se double, à la fin du XVIIe siècle, du complexe de supériorité d’une civilisation marchande et militarisée de l’Europe industrielle moderne, et de son cortège de savants orientalistes.
5.La première objectivation de « l’Oriental »Par hypothèse, l’altérisation du non-Européen, autant que sa disqualification dans l’expression de soi-même, du reste du monde et surtout de l’Europe, remonte aux balbutiements de l’orientalisme. Il faut peut-être revenir à l’aube du complexe de supériorité, lors de la venue de Ḥannā Diab à la cour de Louis XIV en 1708.
Bien qu’ayant tout pour y être admis, étant chrétien et même catholique romain (maronite), citadin et lettré, polyglotte et intelligent, il ne fut pour les nobles français rien d’autre qu’une rareté exotique pour un cabinet de curiosité, que son employeur Lucas exhiba en costume folklorique avec à la main un oiseau des îles. Or, nous ne connaissons même son existence que parce que ses mémoires ont été exhumées récemment [Dyâb, D’Alep à Paris], et cela nous permet de savoir que son employeur s’était joué de lui, en lui faisant miroiter une charge officielle de traducteur d’arabe, dont il n’avait jamais été question entre Français. Mieux ‒ ou pire ‒ les traducteurs de l’ouvrage suggèrent que son passage à Paris, et notamment sa rencontre avec Antoine Galland, explique l’apparition fortuite des deux fables les plus connues de la version française des Mille et une Nuit, Aladin et Ali Baba, qui ne figurent dans aucun manuscrit arabe de la somme. Or, ces deux contes sont devenus tellement efficaces dans l’imaginaire occidental pour que l’on réduise tout l’œuvre à ces deux seuls récits. Il est donc plausible qu’ils furent en fait rédigés à partir d’une histoire racontée à/pour des oreilles occidentales. De fait, tandis que Galland devait encore expurger tous les passages à connotation sexuelle pour passer la censure de l’ordre catholique romain, bien avant donc le retournement du stigmate du fanatisme et de la pudibonderie sur les musulmans, il avait pu tout consigner de celles-ci.
Et pourtant, une figure comme Diyab n’appartenaient déjà plus au même niveau socio-ethnique que Galland : il n’était déjà plus qu’un indigène extérieur à la sociabilité occidentale. Ainsi, non content d’avoir été trompé et exhibé comme une curiosité, Diyab n’a simplement jamais été crédité par Galland parce qu’il n’existait pas dans le monde social élitaire francophone. Il n’existe toujours pas pour « nous », le sujet orientaliste, et « lui »-même, l’objet d’étude orientaliste, il n’a même jamais su la postérité universelle et grandiose des deux histoires enfantines qu’il aurait, dans cette hypothèse, offert à l’humanité.
Ne serait-il pas temps, au bout de trois siècles, d’identifier le Franc, catholique, latin comme le « nous » qui « objectivons », un objet aliène, subalterne et subordonné ? En effet, il est rare et difficile de percevoir les cadres communs aux mondes étudiés et au monde étudiant, puisque les premiers sont obligés « d’être » sans « parler », objets de la projection intellectuelle du second qui, quant à lui, « parle » sans avoir besoin d’« être ». Pourrions-nous enfin interroger le fait que « ses » réponses s’inscrivent dans « nos » normes universelles et implicites, qu’il s’agisse de l’existence consciente de participer à cet ordre autant que de l’expression de sa résistance à cette sujétion. En effet, l’étudié·e n’est guère autorisé à jamais rien « nous » dire au sujet de « sa » compréhension des enjeux universels auquel « nous » et « lui » appartenons, et « nous » ne nous autorisons pas non plus à rapporter la valeur généralisante de « son » analyse et de « sa » perception de ce même monde. Inversement, nous serons conduits à essentialiser sa subjectivité, pourtant elle-même partie prenante de la modernité post-coloniale. En d’autres termes, l’étudié·e n’est supposé servir à l’étudiant·e, ni pour comprendre le monde perçu du premier, ni le monde réel du second.
En fin de cycle, la toute puissance coloniale et mondialisée de l’Occident, à l’instar de celle de l’Islam médiéval avant elle, produit la norme sans l’énoncer, dès lors qu’elle cesse d’être décrite par le reste du monde. Ce dernier ne peut être que l’objet de la description de l’Occident, dont le ressortissant jouit de la certitude confortable d’être la norme. En l’espèce, non content de limiter drastiquement, et la conceptualisation et la diffusion, l’étude de l’Islam continue de le concevoir comme un objet d’étude confortable, mental, qui n’épouse ni son humanité réelle, ni son apport réel pour les humanités. Le monde islamique n’est pratiquement jamais convoqué pour son discours sur le monde, ou sur notre monde franc et catholique.
Ce faisant, alors même que le monde académique croit pouvoir ‒ ou devoir ‒ s’abstraire des structures générales de domination auxquelles il participe, il les amplifie pour les avoir méconnues. Dès lors, il serait étonnant que de telles constantes n’induisent pas des prérequis conceptuels refuges et prédominants, au détriment du fruit d’analyses objectives. Certain·e·s s’arriment cependant à la tâche de dénoncer ces rapports de domination, et bénéficient conséquemment de la confortable posture de l’ouverture. Or, il·elle·s sont souvent les plus actifs dans l’entretien et la reproduction ‒ peut-être inconsciente mais objective ‒ des règles socio-culturelles de sélection, des projections de la norme scientifique eurocentrée, et d’exclusion de toute montée en généralité qui émanerait des objets d’étude du « terrain ».
À l’inverse, il n’est pas si rare que certain·e·s autres, dénoncé·e·s par les premier·e·s pour des positionnements prétendument racistes ou réactionnaires
1)encadrent bien d’avantage d’étudiant·e·s non-européens, y compris à affects islamiques perceptibles, que ceux qui les accablent.
2)soient les seuls à proposer des pensées islamiques, médiévales ou modernes, au titre de références philosophiques et théoriques de portée universelles pour leur propre travaux.
Peut-être serait-il temps de proclamer qu’il y a peut-être moins de racisme d’être essentialiste avec Ibn Khaldoun, que d’être anti-raciste avec l’essentialisme de Montesquieu.
6.Histoire comparée des empires occidentaux et islamiques« Notre » rapport normatif aux objets d’étude extra-européens, « leur » impuissance à s’ériger sujets d’un discours sur « nous », et la sujétion des individus qui en ressortent à « nos » normes dominantes ne sont pas seulement l’héritage passif d’un millénaire de confrontation militaire, imaginaire et donc universitaire. Notre arrière-plan académique est surtout conditionné, bien après les balbutiements de l’orientalisme, par deux siècles de réactivation de cette dichotomie héritée des catégories médiévales du Franc et du Maure, du mahométan et du naṣrānī. Leur omniprésence et prééminence est le produit de leur reformulation et donc réaffirmation, bien après la fin de la guerre de course, à travers la structuration légale et institutionnelle de castes coloniales ethno-confessionnelles.
Ici encore, l’approche comparatiste pourrait ouvrir des perspectives éclairantes et dialectiques entre médiévistes et contemporanéistes. En effet, l’Europe est devenue un empire militaire globalisé, et a donc remplacé l’Islam comme puissance d’universalisation et de structuration juridique, cadre conceptuel et intellectuel indépassable de tous ses sujets. Cela étant posé, dans un sens, l’étude parallèle de ces deux processus historiques permettrait de transposer les observations objectives des rapports sociaux de l’Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge sur ceux que nous subissons sans les analyser. Réciproquement, la synthèse de l’histoire contemporaine de l’ordre colonial européen éclaire bien des étapes intermédiaires de mécanismes pour lesquels la littérature abbasside ne préserve qu’un état tardif et figé.
D’une part, le droit français, d’abord chrétien, franc et catholique romain, et seulement ensuite bourgeois et bonapartiste est resté de 1848 jusqu’à 1956 la condition sine qua non de la citoyenneté républicaine des « Européens ». D’autre part, au nom de la défensede l’exception « religieuse » du droit familial et patrimonial des « musulmans », ces « indigènes » puis français de « second collège » furent réunis en une caste inférieure de mineurs politiques, exclus des droits civiques et sociaux ‒ la séparation laïque de 1905 n’ayant à ce sujet, et pour cause, aucune incidence. Cela implique que « Français » et « Algériens » de la fin du XXe siècle se définissent en fonction de critères civiques, confessionnels et nationaux discordants mais complémentaires. Ils projettent aussi sur la période coloniale une dichotomie finalement simplifiée entre population « française », d’ascendance « européenne » jouissant seules de tous les droits politiques, sociaux et économiques, et un peuple indigène « algérien », conquis, essentiellement arabo-berbère et musulman, inversement démuni de tout. Cette dichotomie ressemble beaucoup à celle qui distingue les populations susceptibles d’être associées aux conquérants comme Arabes et musulmans et celle des ḏimmī chrétiens, supposés indigènes araméens ou coptes. Ce faisant, les débuts de l’Islam fournissent un parallèle intéressant dans la distinction des catégories confessionnelles, « gens de l’islam » et « gens de l’écriture », pour parler de groupes ethniques « arabes » et « non-arabes ».
Or, dans les deux cas, cette catégorisation hermétique et cette homologie dans les différentes dimensions (statutaire, confessionnelle, ethnique, etc.) est le produit figé et tardif d’une progression qui ne fut pas seulement la validation d’évidences héritées. Ainsi, ce schéma binaire n’est en Algérie valable que si l’on fige la situation des années 1920-1940, après un siècle d’histoire impériale et coloniale. À l’identique, les privilèges civiques de l’arabité et leur association à l’islam commencèrent possiblement à se poser au milieu de l’époque marwānide, un siècle après la conquête. Or, dans les deux cas, paradoxalement, ce fut seulement à ce moment tardif qu’émergea et s’imposa la question de l’égalité des droits, d’une part des « Français musulmans » [Mélia, 1928] et d’autre part des mawlā-s.
Ce double synchronisme suggère que l’on peut faire l’hypothèse d’une même structuration et consolidation de cette hiérarchie des normes en trois étapes clefs :
6.1)De 1830 jusqu’en 1893, une bonne part des immigrants d’Algérie étaient des étrangers, italiens et ibères, méprisés et indésirables [Temine, 1987 ; Bachoud, 1999 ; Jerfel, 2013]. À l’inverse, les indigènes musulmans étaient sujets français depuis Napoléon III, et leur élite avait pu tout d’abord être courtisée et choyée par le consulat général, et ponctuellement intégrée via des procédures d’octroi du droit de cité français. Ce n’est qu’avec la loi sur la naturalisation collective que les immigrants obtiennent l’égalité avec les citoyens de la métropole et que les musulmans sont tout entiers rejetés dans l’infra-citoyenneté[2]. Or, nous savons, en raison du débat qu’elle a suscité au Parlement, que la ligne de démarcation entre le sujet indigène et le citoyen français fut fixée entre le Maltais et le Tunisien, et pour la raison explicite que les premiers, bien qu’arabophones, étaient catholiques romains[3]. Il devient alors très clair, sous un gouvernement anticlérical à Paris, que le droit de cité français s’obtient en abjurant l’islam[4]. Cela implique un bouleversement de l’ordre social, et une systématisation administrative du privilège « européen », même du plus démuni des prolétaires, au détriment des « indigènes », même du plus puissant des aristocrates.
Ce modèle permet de mieux interpréter les sources éparses et inattendues que recèlent aussi bien les traditions islamiques que les mémoires chrétiennes orientales à propos de l’époque pré-marwānide, souvent triées et réarrangées un siècle plus tard. Une multitude d’indices pointent en effet vers des relations d’association et de protection des émirs « croyants » avec les notables issus du monde romano-sassanide conquis. À l’inverse, les ressortissants des multiples peuples et régions de la péninsule arabique, notamment ceux qui furent agglomérés dans la catégorie fourre-tout des « Yaman », semblent avoir été initialement peu favorisés[5]. Cette accointance aurait longtemps prédominé au développement d’un privilège de statut de tous les ahl al-islām sur tous les ahl al-dhimma, laquelle s’articula aussi, en dernier lieu, avec l’invention de la commune ethnicité « arabe », et de la commune infériorité des non Arabes mawālī ou dhimmī[6].
1. « Connais-toi toi-même ! »
En temps normal toutefois, cette mise à distance permet aux chercheur·se·s de ne point trop s’inquiéter des conditionnements que leurs environnements induisent pour leurs hypothèses, approches, choix de sélection, analyses et interprétations des données. Et cet isolement est démultiplié par la grande rareté des échanges et communications entre des spécialités, domaines et époques trop cloisonnées. Ainsi, l’hyperspécialisation induit deux phénomènes qui se conjuguent de manière circulaire : hors de leur champ disciplinaire précis, les savant·e·s sont trop souvent contraints de se fonder sur l’image vague et simpliste que produit la narration médiatique, laquelle les tient justement à l’écart lorsqu’il est question de vulgariser leur propre sujet. En l’absence de prise en compte de l’état de la science des autres disciplines, cela introduit mécaniquement des prémisses non-questionnées. Ainsi, dans sa tentative même de neutralité, chacun·e entretient, à propos de savoirs que ne traitent que les autres disciplines, un grand nombre de prénotions hégémoniques, issues d’une perception superficielle des faits qui les soutiennent, et confortées par ses présupposés socio-culturels.
Du côté des spécialistes des mondes contemporains, un exemple serait la définition de « l’islam » comme « religion » et le problème de l’articulation de ce « religieux » avec la forme du gouvernement et l’ordre législatif des mondes précoloniaux. Or, ces deux notions sont le produit d’un univers colonial puis mondialisé, aux normes occidentalisées et où le champ du religieux a été délimité, et l’islamité réduite à l’identification de l’indigène, exclue de toutes les autres dimensions sociales et politiques : celles qui sont l’objet des études contemporaines de la recherche occidentale. Cela implique qu’un avant obscur et sans aspérité se voit assigné au règne du « religieux », congelé dans la permanence d’un ordre canonique fondateur.
Cet avant est bien plus imaginé qu’analysé, en fonction de la place que lui laisse ‒ ou que reconvoque ‒ une modernité sécularisée. Il est fréquent que le processus de ces catégorisations coloniales et réappropriations postérieures soit appréhendé, évoqué voire déconstruit en introduction. En revanche, il est presque systématiquement impossible que l’arrière-plan médiéval et moderne des institutions, sociabilités et modes de fonctionnements éthiques, idéologiques, légaux et politiques, profanes comme sacrés puisse être saisi. Autrement dit, le passé précolonial apparaît alternativement soit comme une idylle romantique, voire romanesque et libertaire, soit comme un régime totalement régi par des considérations irraisonnées, théologiques et eschatologiques. Par conséquent s’impose alors inconsciemment aux non-médiévistes la transposition de leur propre imaginaire occidental sur la religion d’une part, et sur l’islam d’autre part, et ce même lorsqu’il·elle·s s’évertuent courageusement à prendre le contre-pied des attendus de leur milieu. Tout cela est très handicapant lorsqu’il faudrait pouvoir discuter, expertiser et vulgariser des notions comme les « signes religieux par destination », dont se saisit le débat juridique et politique de notre univers social du XXIe siècle occidental.
En revanche, il est beaucoup moins facile d’appréhender l’ampleur des mécanismes et réflexions beaucoup plus séculières et pragmatiques, mondaines et libérales, capitalistes et redistributives, qui charpentent l’objet principal de la littérature savante comme de son application de tous les jours en Islam : un fiqh qui n’a pas grand-chose de « religieux » au sens post-colonial. Concrètement, l’absence d’influx de connaissances et de concepts depuis les études médiévales et modernes vers les sciences humaines du contemporain empêche souvent de saisir l’Islam – majuscule – comme le système de civilisation de l’œkoumène médiéval, lui-même en grande partie non-clérical et donc laïc, et concentré sur le règlement légal de causes profanes. En son sein ou en marge de celui-ci, des « communautés » « religieuses » et « ethniques » se sont quant à elle effectivement constituées de manière sectaire autour de leur clergé et/ou de leur noblesse militaire, afin de survivre face à cette autre première hégémonie impériale, séculière et assimilatrice. Un bon exemple est le mariage de droit musulman qui apparaissait aux institutions non-musulmanes médiévales comme un « mariage séculier (ʿalmānāyā) » [Synodicon in the West, II, p. 30-31], une « union » « fornicatrice » voire « adultérine », en raison de son caractère purement contractuel et civil. Or, celui-là même se retrouve aujourd’hui affublé de la notion de « mariage religieux » et reporte le même jugement contre les unions civiles en droit occidental [Koné, Calvès 2021]. Si de telles perspectives gagnaient en visibilité, cela pourrait permettre de faire émerger des critères d’analyse, des paradigmes et des théories de mécanismes humains, non pas au sein de l’objet moyen-oriental circonscrit, mais bien à partir de lui vers l’universalité.
Réciproquement, et pour des raisons identiques, les spécialistes des périodes anciennes et médiévales sont conduits à se représenter de manière superficielle ou confuse les dynamiques des mondes musulmans contemporains, et leurs évolutions. Cela concerne l’hétérogénéité et les articulations complexes des formes et des réalités sociales, géopolitiques et idéologiques, et a fortiori lorsqu’il est question du rapport au religieux, de l’islam politique. On a alors soi-même tendance à projeter sur la chrétienté antique ou l’islamité médiévale les attitudes conditionnées par le monde moderne traversé sans être étudié, à peine observé, et toujours non-partagé. On se forge ainsi une idée anhistorique de l’islamité à partir de laquelle on travaille et, au bout du cycle, ce qui en est finalement vulgarisé hors des milieux académiques finit par former la prénotion des recherches portant sur « l’islamisation » au XXe siècle. Ce mécanisme explique sans doute l’incapacité à appréhender, saisir et exposer le phénomène pourtant massif, hors des bureaux et des laboratoires, de la lame de fond du sécularisme, de l’irreligion et de l’athéisme que connait aujourd’hui le Moyen-Orient et la Méditerranée (infra). Un autre bon exemple pour l’illustrer est le paradigme implicite mais omniprésent, que l’état de corruption endémique des sociétés post-ottomanes serait le reflet d’habitus médiévaux. Or, dès que l’on se propose de confronter cette projection hypothétique avec les sources, il semble bien que les fonctionnaires et les juges, à tout le moins ceux des premiers siècles de l’Islam, étaient rarement soupçonnés de ce type de malversations si malheureusement coutumières aujourd’hui.
2. Double position et détection des asymétries ?
telle préoccupation personnelle et méthodologique est davantage susceptible d’émerger lorsque le·a chercheur.se est confronté·e à une dissonance propre à son assignation sociale. En effet, il·elle peut être à la fois correctement identifié·e à la catégorie sociale et ethnoculturelle dominante, mais, en raison d’aléas propres et particuliers à son parcours ou héritage familial, ou à ses démarches, affects et attirances personnelles, avoir assimilé une part significative de culture subalterne et de codes sociaux dominés. Dans ces conditions, il·elle sera plus à même d’être admis dans les échanges privés de la sociabilité dominante, et d’en reconnaître les implicites pour ce qu’ils sont : des marques de renforcement de l’entre-soi et des présupposés socio-culturels. La violence symbolique en sera d’autant plus explicitement perçue que, du même coup, le choc de ce discours ou dispositif fera ressentir à l’autre part de son individualité qu’il consiste en une réaffirmation de sa propre subordination.
Lorsque, par exemple en contexte para-académique, il·elle se situe sans l’avoir même planifié à la table des dominants hiérarchiques, entouré·e de semblables socio-culturels, tandis que ses autres semblables sont ségrégués, et relégués au regard de cette hiérarchie, à un autre entre-soi subi, il·elle lui sera difficile de l’ignorer, de prendre cet état de fait comme une norme implicite et non-questionnée, contrairement à ses voisins. Il·elle s’apercevra que l’un·e se moque, plus ou moins gentiment, de l’une ou l’autre des expressions culturelles extra-européennes, ou que l’autre rapporte de son « terrain » en contexte islamique des souvenirs de brousse impliquant, pour des raisons alimentaires évidentes, une ségrégation de facto. Un.e troisième semble partager une crainte incontrôlable de la banlieue, même la plus voisine de sa métropole tandis que l’autre nie l’influence structurelle et fondatrice de l’ordre social et administratif français sur ses anciennes colonies. Un·e quatrième se montre incapable de comprendre la légitimité de certains mécanismes ‒ certes désagréables ‒ de rejet de la part des collègues de l’ancienne colonie. Un·e dernier·e déplorera la passivité des co-aut.eu.rices académiques du « terrain » ultra-marin, et cela en dépit du fait qu’il est implicitement entendu qu’il·elle·s n’ont d’autre rôle que de justification nominale pour valider une coopération post-coloniale asymétrique (infra). Une autre autorité trouvera naturel de juger implicitement inacceptable toute expression et même manifestation d’attachement à une quelconque islamité ; et un·e autre collègue se pensera par ailleurs très tolérant·e de juger que ce n’est « pas grave » qu’un étudiant soit islamophile « au niveau Master », impliquant donc que cela le deviendrait pour un doctorant. Et finalement, on jugera un postulant « apologétique avec l’islam » lorsque, d’origine extra-européenne, il aura eu le malheur de paraître croyant, ou de paraître aux côtés de croyants. Il est bien entendu que personne ne jugera jamais de la sorte quelque impétrant et candidat que ce soit dont la foi et la pratique catholique serait non seulement manifeste ; mais assumée, reconnue comme telle et donc légitimée au sein des catégories estudiantines du quartier latin.
Face à cette avalanche de marques de reconnaissances de l’ordre dominant auquel il·elle est convié·e pour la part de soi qui est visible, il·elle reçoit alors aussi clairement le message lié à sa connivence de classe et d’ethnie, qu’il·elle peut le penser et l’interpréter, et donc l’expliciter, parce que l’autre partie de « soi » en est la cible implicite. Il.elle pourra parfois tenter la pirouette du raisonnement par l’absurde ou de l’humour pour manifester poliment son rejet d’une telle connivence de dominants, et éventuellement tenter de faire saisir à son interlocut·eur·ice la teneur oppressante de cet implicite de domination. Cependant, cela ne change rien aux dynamiques et rapports structurels, aux phénomènes de masse qui conditionnent tous les arrière-plans paradigmatiques de son véritable terrain : le champ académique. Ce système valide un grand nombre de prénotions admises parce que non-questionnées, et accroit la béance des fossés entre réalité contemporaine superficiellement externalisée, et systèmes anciens analysés en contexte mental et social rassurant et confortable.
Cette expérience de la double position questionne donc la cécité du monde académique face à des attitudes qui devraient précisément être débusquées et analysées avec la méthodologie des sciences humaines et sociales. Comment une même sélection des plus aptes à les traiter dans les sources ou les terrains peut-elle complètement ignorer d’appliquer cette méthode dans leur environnement réel ? Comment passer outre le temps et l’énergie dépensés à l’office de nouer des relations et de s’attacher des patrons ? En premier lieu, nous proposons l’hypothèse que la dissociation mentale entre les stratégies pratiques et implicites et les phénomènes étudiés et explicités est liée au fait que d’énoncer les premières en détruit l’efficacité, et que le refus d’en personnaliser les secondes, sert à préserve l’implicite des premières : que le processus de recrutement de l’université médiévale n’a jamais été rationalisé à l’instar du reste de la fonction publique. Et cela rend d’autant plus pertinent les similarités anthropologiques entre l’objet virtuel de son étude médiévale, et sa position dans son terrain réel. Pour autant, cette dissociation permet de se penser tout à la fois en surplomb, supérieur à son objet d’étude, et aussi, et conséquemment, pur esprit en dehors de tout conditionnement social.
3.Clientélisme et réseau, médiévaux et actuelsLe problème qui articule et unit ces isolats disciplinaires en interaction non contrôlées consiste au peu d’incitation à s’inspirer des mécanismes sociaux auxquels nous participons pour comprendre l’objet de nos études. Notre monde d’acteur social est jugé normal et universel, et donc implicite et non-questionné. Dès lors, les jeux de position en son sein, qui pourtant, occupent pour des raisons matérielles une grande partie de notre temps de cerveau disponible, ne sert que trop rarement à proposer et transposer des modèles explicatifs vers les phénomènes parallèles que nos sources suggèrent. À cela s’ajoute bien entendu le fait que la nature élitiste de la sélection et de la sociabilité académique tend à délégitimer toute démarche comparatiste au prétexte du risque d’approximation même de la discipline empruntée en parallèle de la sienne propre. Mais, ne se pourrait-il pas que cette méconnaissance de nos structures et de nos positions individuelles, au sein de cet espace social tangible, puisse être bien davantage susceptible de déformer l’interprétation des phénomènes anciens étudiés ? Le « terrain » des médiévistes s’étend-il davantage à la bibliothèque dont il dépouille les manuscrits qu’à ce cadre géographique et humain actuel de l’espace de recherche ? Les mécanismes sociaux et politiques qu’il·elle cherche à reconstituer, sous l’amas des discours, récits et notes des scribes et savants de son cadre d’étude ne seraient-ils pas plus facilement déduits de la somme de ses observations particulières des interactions, rapports de forces et attractivités qui le pressent et le traversent au quotidien, dans son propre monde académique de scribes et de savants ?
Nous souhaiterions profiter de cet espace d’expression pour réhabiliter ici la nécessité scientifique d’une telle démarche introspective. Nous donnerons brièvement deux exemples d’identification et d’explication plausible tirées de la comparaison des informations de nos sources sur la période des débuts de l’Islam, au regard des mécanismes vécus et subis dans le terrain dont notre personne est acteur et sujet, le clientélisme et les réseaux :
1)À travers notamment l’introduction de conceptions tardo-antiques comme la familia élargie et la notion d’amicus, nous proposons de réévaluer le processus socio-politique du patronage de walāʾ chez les premiers Arabo-musulmans[1]. L’idée théorique d’un mawlā ethnicisé, statutairement inférieur à l’Arabe, voire assimilé à la condition captive et servile, est en fait le produit d’une époque de fixation et de stratification d’un ordre social (fin VIIIe siècle) qui fut aussi celui de l’époque de rédaction de nos sources. Ce faisant, ce système clôt ne permettant que le « changement social » efface toutes les dynamiques de « mobilité sociale » antérieures [Tajfel, Billig, Bundy et Flament 1971] d’individus qui adhèrent à des groupes élitaires spécifiques en mettant à leur service loyauté et compétence : une forme d’adoption à la familia, indépendant d’une quelconque infériorité servile ou non-arabe préalable. Or, pour détecter et interpréter les processus d’affiliation, de loyauté, de fidélité, et inversement d’élection, de propulsion et de paternalisme dont les acteurs et auteurs tardo-antiques témoignent, il nous a été nécessaire de les observer au sein des relations interpersonnelles présentes dans le monde académique qui concerne notre position sociale.
2) Nous avons également proposé, dans une publication récente, plusieurs comparaisons entre les stratégies de réseaux multiples et croisées des moines syro-mésopotamiens et celles des universitaires modernes. En effet, en contexte miaphysite « jacobite », comme académique aujourd’hui, les nominations étaient alors fonction de solidarités provinciales (Syrie du Nord/Qinnasrīn, Jazīra et Irak/Mossoul), déterminées par l’organisation administrative et politique. À plus grande échelle et par croisement, elles étaient aussi produites par l’attache à des centres de formation communs (monastères de Tell ʾAddē, Kayshūm, Gūbbā, Qen-Neshrē, Qarṭmīn, Mār Mattay, Knūshyō, Ḥaṣṣīṣōyō). Enfin, des mécanismes compatibles autant que contradictoires émergeaient du fait de succéder à un métropolite, voire à un patriarche, sur son premier poste d’évêché (Ḥarrān, Amid, Takrīt, Mossoul, Raqqa). L’intersection de ces logiques produit non seulement des rivalités de monastères au sein d’un même bloc régional, mais aussi des hostilités interpersonnelles nées au sein d’un même centre de formation, ou entre le monastère de tête et les branches subordonnées mais rivales, et enfin la cristallisation de camps opposés dans une même cité épiscopale [XXXXX, 2023].
4.L’héritage franc comme normeSi ce type de méthodologie parait si inhabituel, et si les mécanismes de subordination socio-ethniques restent à ce point impensés ‒ alors même que l’on traite en tant qu’Occidental du Dār al-Islām, c’est sans doute en partie parce que la fiction de cette dissociation entre monde académique et terrain d’étude permet de maintenir incritiqué le poids de l’héritage social et culturel des agents universitaires.
En effet, celui-là est occidental par définition, et donc tributaire d’une matrice idéologique qui ne cesse de se renouveler, en marge de l’oikoumène islamisé, dans les mêmes limites aux périodes « franque » (VIIe-XIe), puis « catholique romaine » (XIe-XIVe), et enfin impériale « européenne » (XVe-XIXe). En outre, si l’on admet l’axiome matérialiste que les idées, idéaux, prérequis et notions sont déterminées par le statut social, alors, au terme de la constitution des hiérarchies impériales sur fondements ethniques, physiques et confessionnels (infra), elles le sont aussi par le statut racial qui est tout à la fois le produit et le critère de cette histoire occidentale.
En l’espèce, la position des chercheur·se·s résulte mécaniquement d’un parcours scolaire déterminé par les capitaux économiques, ethniques et culturels objectifs. Le recrutement dépend donc par définition de préférences socio-culturelles implicites et donc d’autant plus puissantes : « les savoir-être ». Or, la force du caractère interpersonnel ‒ pré-révolutionnaire pour dire le moins ‒ de la sélection universitaire en France (et d’autres pays européens sans doute ?) implique que les choix de patronage des directeur·ice·s, puis les critères d’appréciation pour les postulant.e.s aux réseaux, sont d’autant plus dépendant de ces critères subjectifs et irréfutables.
Répétons que ce cloisonnement mental est d’autant plus prégnant qu’il concerne un milieu académique particulier : celui-là même qui se consacre non pas à l’un ou l’autre aspect du monde occidental, mais aux champs d’espaces anciens et modernes extra-occidentaux. Le non-dit y est donc, en l’occurrence, d’autant plus manifeste qu’innocemment ignoré. En outre, le domaine du Moyen-Orient et de la Méditerranée, le Dār al-Islām médiéval, constitue la partie la plus voisine du monde franc : son altérité est donc d’autant plus radicalement perçue et catégorisée qu’elle se renforce du voisinage, des échanges, et donc des conquêtes et des migrations. Cet espace est ainsi, de tous les dominions de l’impérialisme occidental des deux derniers siècles, celui qui fut le plus conceptualisé comme adversaire, puis comme sujet, et enfin comme antagoniste. Il pâtit donc logiquement de la plus radicale des constructions produites par la république chrétienne des lettres et de l’eurocentrisme aryanisant, dont hérite le monde universitaire occidental. En contexte sud-européen en particulier, il est impossible d’éluder un passif de proximité, et donc d’exacerbation, de 13 siècles d’opposition en Méditerranée occidentale entre, d’une part, les « Francs » « catholiques romains » « européens » (de l’Ebre à l’Elbe), et, d’autre part, les « Maures » « musulmans » et « Africains ». En outre, ce rapport conflictuel, caractérisé par les croisades (XIe-XIIIe) puis les guerres de courses (XIVe-XIXe), fut longtemps asymétrique en défaveur des « Francs », et à l’avantage des « Maures ».
Ce déséquilibre, qui ne se retourne guère qu’au milieu de l’époque moderne, a nourri d’autant plus d’angoisses culturelles, religieuses et existentielles qu’elles sont ensuite reprojetées sur le nouveau vaincu et dominé. Les acteurs et penseurs de ces différentes couches n’ont eu de cesse de puiser dans les plus anciennes pour renouveler, reformuler et restructurer à chaque époque un même contingent de peurs et de mépris. Il serait donc beaucoup plus surprenant que cette intraitable altérité n’ait pas induit l’hostilité dont témoigne l’université latine à l’égard de la religion des « mahométans », avant qu’elle se double, à la fin du XVIIe siècle, du complexe de supériorité d’une civilisation marchande et militarisée de l’Europe industrielle moderne, et de son cortège de savants orientalistes.
5.La première objectivation de « l’Oriental »Par hypothèse, l’altérisation du non-Européen, autant que sa disqualification dans l’expression de soi-même, du reste du monde et surtout de l’Europe, remonte aux balbutiements de l’orientalisme. Il faut peut-être revenir à l’aube du complexe de supériorité, lors de la venue de Ḥannā Diab à la cour de Louis XIV en 1708.
Bien qu’ayant tout pour y être admis, étant chrétien et même catholique romain (maronite), citadin et lettré, polyglotte et intelligent, il ne fut pour les nobles français rien d’autre qu’une rareté exotique pour un cabinet de curiosité, que son employeur Lucas exhiba en costume folklorique avec à la main un oiseau des îles. Or, nous ne connaissons même son existence que parce que ses mémoires ont été exhumées récemment [Dyâb, D’Alep à Paris], et cela nous permet de savoir que son employeur s’était joué de lui, en lui faisant miroiter une charge officielle de traducteur d’arabe, dont il n’avait jamais été question entre Français. Mieux ‒ ou pire ‒ les traducteurs de l’ouvrage suggèrent que son passage à Paris, et notamment sa rencontre avec Antoine Galland, explique l’apparition fortuite des deux fables les plus connues de la version française des Mille et une Nuit, Aladin et Ali Baba, qui ne figurent dans aucun manuscrit arabe de la somme. Or, ces deux contes sont devenus tellement efficaces dans l’imaginaire occidental pour que l’on réduise tout l’œuvre à ces deux seuls récits. Il est donc plausible qu’ils furent en fait rédigés à partir d’une histoire racontée à/pour des oreilles occidentales. De fait, tandis que Galland devait encore expurger tous les passages à connotation sexuelle pour passer la censure de l’ordre catholique romain, bien avant donc le retournement du stigmate du fanatisme et de la pudibonderie sur les musulmans, il avait pu tout consigner de celles-ci.
Et pourtant, une figure comme Diyab n’appartenaient déjà plus au même niveau socio-ethnique que Galland : il n’était déjà plus qu’un indigène extérieur à la sociabilité occidentale. Ainsi, non content d’avoir été trompé et exhibé comme une curiosité, Diyab n’a simplement jamais été crédité par Galland parce qu’il n’existait pas dans le monde social élitaire francophone. Il n’existe toujours pas pour « nous », le sujet orientaliste, et « lui »-même, l’objet d’étude orientaliste, il n’a même jamais su la postérité universelle et grandiose des deux histoires enfantines qu’il aurait, dans cette hypothèse, offert à l’humanité.
Ne serait-il pas temps, au bout de trois siècles, d’identifier le Franc, catholique, latin comme le « nous » qui « objectivons », un objet aliène, subalterne et subordonné ? En effet, il est rare et difficile de percevoir les cadres communs aux mondes étudiés et au monde étudiant, puisque les premiers sont obligés « d’être » sans « parler », objets de la projection intellectuelle du second qui, quant à lui, « parle » sans avoir besoin d’« être ». Pourrions-nous enfin interroger le fait que « ses » réponses s’inscrivent dans « nos » normes universelles et implicites, qu’il s’agisse de l’existence consciente de participer à cet ordre autant que de l’expression de sa résistance à cette sujétion. En effet, l’étudié·e n’est guère autorisé à jamais rien « nous » dire au sujet de « sa » compréhension des enjeux universels auquel « nous » et « lui » appartenons, et « nous » ne nous autorisons pas non plus à rapporter la valeur généralisante de « son » analyse et de « sa » perception de ce même monde. Inversement, nous serons conduits à essentialiser sa subjectivité, pourtant elle-même partie prenante de la modernité post-coloniale. En d’autres termes, l’étudié·e n’est supposé servir à l’étudiant·e, ni pour comprendre le monde perçu du premier, ni le monde réel du second.
En fin de cycle, la toute puissance coloniale et mondialisée de l’Occident, à l’instar de celle de l’Islam médiéval avant elle, produit la norme sans l’énoncer, dès lors qu’elle cesse d’être décrite par le reste du monde. Ce dernier ne peut être que l’objet de la description de l’Occident, dont le ressortissant jouit de la certitude confortable d’être la norme. En l’espèce, non content de limiter drastiquement, et la conceptualisation et la diffusion, l’étude de l’Islam continue de le concevoir comme un objet d’étude confortable, mental, qui n’épouse ni son humanité réelle, ni son apport réel pour les humanités. Le monde islamique n’est pratiquement jamais convoqué pour son discours sur le monde, ou sur notre monde franc et catholique.
Ce faisant, alors même que le monde académique croit pouvoir ‒ ou devoir ‒ s’abstraire des structures générales de domination auxquelles il participe, il les amplifie pour les avoir méconnues. Dès lors, il serait étonnant que de telles constantes n’induisent pas des prérequis conceptuels refuges et prédominants, au détriment du fruit d’analyses objectives. Certain·e·s s’arriment cependant à la tâche de dénoncer ces rapports de domination, et bénéficient conséquemment de la confortable posture de l’ouverture. Or, il·elle·s sont souvent les plus actifs dans l’entretien et la reproduction ‒ peut-être inconsciente mais objective ‒ des règles socio-culturelles de sélection, des projections de la norme scientifique eurocentrée, et d’exclusion de toute montée en généralité qui émanerait des objets d’étude du « terrain ».
À l’inverse, il n’est pas si rare que certain·e·s autres, dénoncé·e·s par les premier·e·s pour des positionnements prétendument racistes ou réactionnaires
1)encadrent bien d’avantage d’étudiant·e·s non-européens, y compris à affects islamiques perceptibles, que ceux qui les accablent.
2)soient les seuls à proposer des pensées islamiques, médiévales ou modernes, au titre de références philosophiques et théoriques de portée universelles pour leur propre travaux.
Peut-être serait-il temps de proclamer qu’il y a peut-être moins de racisme d’être essentialiste avec Ibn Khaldoun, que d’être anti-raciste avec l’essentialisme de Montesquieu.
6.Histoire comparée des empires occidentaux et islamiques« Notre » rapport normatif aux objets d’étude extra-européens, « leur » impuissance à s’ériger sujets d’un discours sur « nous », et la sujétion des individus qui en ressortent à « nos » normes dominantes ne sont pas seulement l’héritage passif d’un millénaire de confrontation militaire, imaginaire et donc universitaire. Notre arrière-plan académique est surtout conditionné, bien après les balbutiements de l’orientalisme, par deux siècles de réactivation de cette dichotomie héritée des catégories médiévales du Franc et du Maure, du mahométan et du naṣrānī. Leur omniprésence et prééminence est le produit de leur reformulation et donc réaffirmation, bien après la fin de la guerre de course, à travers la structuration légale et institutionnelle de castes coloniales ethno-confessionnelles.
Ici encore, l’approche comparatiste pourrait ouvrir des perspectives éclairantes et dialectiques entre médiévistes et contemporanéistes. En effet, l’Europe est devenue un empire militaire globalisé, et a donc remplacé l’Islam comme puissance d’universalisation et de structuration juridique, cadre conceptuel et intellectuel indépassable de tous ses sujets. Cela étant posé, dans un sens, l’étude parallèle de ces deux processus historiques permettrait de transposer les observations objectives des rapports sociaux de l’Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge sur ceux que nous subissons sans les analyser. Réciproquement, la synthèse de l’histoire contemporaine de l’ordre colonial européen éclaire bien des étapes intermédiaires de mécanismes pour lesquels la littérature abbasside ne préserve qu’un état tardif et figé.
D’une part, le droit français, d’abord chrétien, franc et catholique romain, et seulement ensuite bourgeois et bonapartiste est resté de 1848 jusqu’à 1956 la condition sine qua non de la citoyenneté républicaine des « Européens ». D’autre part, au nom de la défensede l’exception « religieuse » du droit familial et patrimonial des « musulmans », ces « indigènes » puis français de « second collège » furent réunis en une caste inférieure de mineurs politiques, exclus des droits civiques et sociaux ‒ la séparation laïque de 1905 n’ayant à ce sujet, et pour cause, aucune incidence. Cela implique que « Français » et « Algériens » de la fin du XXe siècle se définissent en fonction de critères civiques, confessionnels et nationaux discordants mais complémentaires. Ils projettent aussi sur la période coloniale une dichotomie finalement simplifiée entre population « française », d’ascendance « européenne » jouissant seules de tous les droits politiques, sociaux et économiques, et un peuple indigène « algérien », conquis, essentiellement arabo-berbère et musulman, inversement démuni de tout. Cette dichotomie ressemble beaucoup à celle qui distingue les populations susceptibles d’être associées aux conquérants comme Arabes et musulmans et celle des ḏimmī chrétiens, supposés indigènes araméens ou coptes. Ce faisant, les débuts de l’Islam fournissent un parallèle intéressant dans la distinction des catégories confessionnelles, « gens de l’islam » et « gens de l’écriture », pour parler de groupes ethniques « arabes » et « non-arabes ».
Or, dans les deux cas, cette catégorisation hermétique et cette homologie dans les différentes dimensions (statutaire, confessionnelle, ethnique, etc.) est le produit figé et tardif d’une progression qui ne fut pas seulement la validation d’évidences héritées. Ainsi, ce schéma binaire n’est en Algérie valable que si l’on fige la situation des années 1920-1940, après un siècle d’histoire impériale et coloniale. À l’identique, les privilèges civiques de l’arabité et leur association à l’islam commencèrent possiblement à se poser au milieu de l’époque marwānide, un siècle après la conquête. Or, dans les deux cas, paradoxalement, ce fut seulement à ce moment tardif qu’émergea et s’imposa la question de l’égalité des droits, d’une part des « Français musulmans » [Mélia, 1928] et d’autre part des mawlā-s.
Ce double synchronisme suggère que l’on peut faire l’hypothèse d’une même structuration et consolidation de cette hiérarchie des normes en trois étapes clefs :
6.1)De 1830 jusqu’en 1893, une bonne part des immigrants d’Algérie étaient des étrangers, italiens et ibères, méprisés et indésirables [Temine, 1987 ; Bachoud, 1999 ; Jerfel, 2013]. À l’inverse, les indigènes musulmans étaient sujets français depuis Napoléon III, et leur élite avait pu tout d’abord être courtisée et choyée par le consulat général, et ponctuellement intégrée via des procédures d’octroi du droit de cité français. Ce n’est qu’avec la loi sur la naturalisation collective que les immigrants obtiennent l’égalité avec les citoyens de la métropole et que les musulmans sont tout entiers rejetés dans l’infra-citoyenneté[2]. Or, nous savons, en raison du débat qu’elle a suscité au Parlement, que la ligne de démarcation entre le sujet indigène et le citoyen français fut fixée entre le Maltais et le Tunisien, et pour la raison explicite que les premiers, bien qu’arabophones, étaient catholiques romains[3]. Il devient alors très clair, sous un gouvernement anticlérical à Paris, que le droit de cité français s’obtient en abjurant l’islam[4]. Cela implique un bouleversement de l’ordre social, et une systématisation administrative du privilège « européen », même du plus démuni des prolétaires, au détriment des « indigènes », même du plus puissant des aristocrates.
Ce modèle permet de mieux interpréter les sources éparses et inattendues que recèlent aussi bien les traditions islamiques que les mémoires chrétiennes orientales à propos de l’époque pré-marwānide, souvent triées et réarrangées un siècle plus tard. Une multitude d’indices pointent en effet vers des relations d’association et de protection des émirs « croyants » avec les notables issus du monde romano-sassanide conquis. À l’inverse, les ressortissants des multiples peuples et régions de la péninsule arabique, notamment ceux qui furent agglomérés dans la catégorie fourre-tout des « Yaman », semblent avoir été initialement peu favorisés[5]. Cette accointance aurait longtemps prédominé au développement d’un privilège de statut de tous les ahl al-islām sur tous les ahl al-dhimma, laquelle s’articula aussi, en dernier lieu, avec l’invention de la commune ethnicité « arabe », et de la commune infériorité des non Arabes mawālī ou dhimmī[6].
6.2)De 1893 jusqu’en 1944, et à travers 1905, l’exclusion des musulmans de tous droits civiques continue de préoccuper certains militants, notamment le député socialiste Blaise Diagne, à propos de ceux qui sont ses voisins et cousins dans les communes françaises du Sénégal. Il lui fallut attendre 1916 pour que l’État major s’aperçoive du gain en termes de conscrits de l’extension de l’égalité civique à des non-chrétiens[7]. Mais si le précédent sera déterminant plus tard, il est à l’époque isolé, ce qui implique en réciprocité que l’indépendantisme, par exemple tunisien, se construit dans l’opposition aux naturalisés, jugés apostats[8]. Cela implique surtout que la laïcité ne fut jamais étendue aux indigènes de l’empire, ce qui explique le rapport asymétrique à ces derniers aujourd’hui, ainsi que la cristallisation de l’identité confessionnelle comme seul privilège retord. Le paradoxe est que l’établissement de ce faux dilemme, ce chantage des droits contre l’apostasie ‒ entretenu à Mayotte jusqu’aujourd’hui à propos des droits sociaux ‒ aboutit d’une part à renforcer le clergé musulman, et à enfermer leurs ouailles dans une catégorie confessionnelle, et dans la défense de son dogme, au détriment de l’accession aux droits et idéaux universels[9].
De même, les décennies marwānides, de 692 à 744 sont marquées par une intense politique de colonisation, incluant l’octroi de terres pour des implantations explicitement dévolues à des Arabes, souvent affiliés aux confédérations du nord (Qays/Muḍar)[10]. D’une part, cette phase correspond avec la structuration des organisations confessionnelles, communautaires et ecclésiastiques en Islam comme uniques interlocuteurs de l’État califal. D’autre part, cela répercute les tentatives, avortées ou invalidées en fonction des alternances de califes et de gouverneurs (al-Ḥajjāj, ʿUmar II et Hishām), de réconcilier les principes universels de l’égalité politique des « croyants » avec les privilèges des « Arabes ». Paradoxalement, tout en luttant pour cet avènement, ces catégories jusqu’alors vagues en deviennent plus officielles, plus déterminantes : être mawlā naturalisé ou dhimmī indigène devient synonyme de sujétion.
6.3)Enfin, après avoir proclamé une première fois en 1945 l’universalité française de tous les T.O.M., la IVe république renvoie immédiatement les « français musulmans » à la minorité politique du « second collège ». À peine la coalition sociale-démocrate de 1956 abolit-elle enfin les collèges et décrète-t-elle l’égalité politique par la Loi-cadre Defferre[11]… que son régime est renversé, l’union française dissoute et les « indépendances » gaulliennes les rejettent au statut d’étranger, synonyme d’indigène, une politique objectivement « ethno-différentialiste » que l’extrême droite du XXIe siècle reconnaît comme étant la sienne[12].
En Islam, une telle dénaturalisation aurait consisté en une abrogation des acquis de ʿUmar II (r. 717-720) validés par la révolution abbasside (v. 747-754) ‒ ou dans un autre contexte impérial, de l’édit de Caracalla (r. 211-217) confirmé par la succession d’empereurs non-italiques au IIIe siècle. L’empire occidental semble donc le seul et le premier à ainsi céder aux sirènes du repli ethno-confessionnel autour de la caste franque, chrétienne, européenne. Contrairement à ses prédécesseurs italiques et arabes, cela indique de sa part un refus très net de dissoudre ses privilèges d’ethnie dans le creuset de l’universalité culturelle, politique et idéologique qu’elle a suscitée par ses conquêtes, sa colonisation et son uniformisation.
Il se pourra être opposé que l’égalité politique en Islam était, par principe, relative au statut confessionnel musulman, à l’identique de ce qui était appliqué de facto par le régime français avant le bref intermède 1956-1959 (1958-1962 en Algérie). De même, il faudra remarquer que le statut de dhimma est comparable à l’indigénat, et que le walāʾ équivaut à la naturalisation individuelle sur dossier et implique une même abjuration de son droit confessionnel antérieur. Il y a néanmoins une distinction importante entre ces deux constructions légales des castes ethno-confessionnelles, c’est que : a) le droit français était théoriquement non confessionnel et national alors que son application statutaire était absolument conditionnée par l’origine confessionnelle (comme en atteste le cas maltais, supra) car l’État sécularisé et la république concordataire comme post-concordataire reposaient sans le dire sur une codification d’un droit exclusivement catholique. b) Inversement, le droit médinois était théoriquement confessionnel, puisqu’il était celui d’un État fondé au nom d’une parole transcendantale. Et pourtant, son application statutaire était presque seulement nationale puisqu’il distinguait de fait les Médinois et leurs affidés arabophones du reste des peuples conquis, indépendamment d’un dogme religieux qui n’avait encore guère d’armature légale et institutionnelle.
De là découle le biais susmentionné de réduire le non-Européen à sa « religion » et de l’enfermer dans cette identité : il revient depuis cette époque à l’emprisonner dans une posture bigote, qui préserve en fait son infantilisation. Comme le dit Ernest Renan dans une optique inverse ‒ puisque, comme souvent les dominants, il prend l’effet pour la cause ‒ le musulman est « heureux comme d’un privilège de ce qui fait son infériorité[13] ». Ce mécanisme entraîne la conséquence grave et délétère d’interdire de traiter le véritable racisme ainsi hérité, à l’encontre les Maures, des Indigènes, des seconds collèges, des Nord-Africains, des Maghrébins. Tous ce dispositif contraint, sous le nom « d’Islamophobie », à la défense stérile et archaïque du dogme islamique, et donc de tous ces « religieux », désireux de représenter ceux dont ils veulent faire leurs ouailles, mais jamais de l’oppression matérielle et structurelle héritée de ces siècles ; et dont tous les non-Européens tentent de se distinguer pour se valoriser. Ainsi un sociologue médiatique comme Farhad Khosrokavar peut-il énoncer sans contredite, à propos d’un terroriste qu’il est atypique car « il est Iranien, il n’est pas immigré… au sens de Maghrébin »[14].
En effet, l’héritage sans cesse renouvelé de cette hiérarchie coloniale c’est, par exemple dans une gare, qu’il est bien souvent assez aisé et instinctif de reconnaître les différents statuts, et donc fonctions, des employés d’une entreprise publique comme la SNCF, sur le fondement de leur phénotype. Moins trivialement, il se pourra constater la grande difficulté des spécialistes de faire comprendre, y compris en milieu académique non-spécialiste, à quelle point la propagande russe qui assimile tous les Occidentaux anti-Poutine à des « Nazis » est aussi grossière, ridicule et dangereuse que celle qui, pourtant de même origine et usant des mêmes relais, assimile tous les Arabes anti-Asad à des « jihadistes ».
Dans notre monde post-impérial, comme dans celui de l’Islam, pourtant, il est difficile de ne pas trouver quelques similitudes entre les réactions d’hostilité et de prohibition, contre le muezzin et la construction de mosquées dans l’Europe post-impériale et celles, identiques, concernant la simandre et les églises dans le Moyen-Orient post-omeyyade[15]. De même n’est-il pas si abscons de comparer le fantasme arabe, a priori infondé, de la shuʿūbiyya des non-Arabes au IXe siècle, à celui du « communautarisme » au XXIe, de même étymologie (shaʿb = commune[16]) et de même nature.
7.Dévalorisation des compétences non-européennesCe type d’approche comparative et théorique est souvent disqualifiée en contexte académique français, car on y valorise toujours la concentration sur un domaine très resserré, mais pas l’établissement de ponts avec les voisins. Pourtant, connexions larges et approximations mesurées sont toujours nécessaires à l’érection d’une théorie. Cela impacte également la fonction pourtant essentielle en société démocratique, de diffusion et surtout de la vulgarisation. Ce biais structurel hérite en partie du primat monastique du scriptorium silencieux. En fait, au-delà de l’enseignement, rarement évalué en tant que tel, c’est toute la vertu sociale et intellectuelle de l’échange oral illimité, qui se trouve reléguée au second plan, et dévalorisée par rapport au cadre lettré et littéraire. Or, celui-ci s’accorde bien avec un autre caractère issu de la chrétienté : la verticalité descendante de la dévolution ecclésiastique de l’autorité. Dès lors, disqualifier tout ce qui n’est pas hyperspécialisé et étroitement délimité, tout ce qui n’est pas formulé par un écrit standardisé, constitue autant de freins et de limites pour quiconque n’est pas issu de ce conditionnement socio-culturel. Allié au principe de l’incomparabilité de tous les domaines d’études, cela empêche complètement l’objet de « nos » recherches de proposer directement à l’objet d’étude ‒ ni même à travers « nous » ‒ sa propre lecture de « son » monde et du « nôtre » ; une montée en généralité pourtant nécessaire au progrès scientifique.
Au-delà de ces effets visibles, et des anecdotes évoquées plus haut, ces structures relèvent de dispositifs plus inconscients, à commencer par le fait que l’arabe puisse être qualifié comme une « langue rare »… alors qu’il est parlé couramment par des millions de Français, mais qui ne descende pas « d’Européens ». En outre, ce protocole implique aussi de magnifier la langue classique et de dévaloriser la langue parlée (lahja ou dārij(a)), a fortiori celle des « Maures » d’Afrique du Nord.Or, ce mécanisme coïncide d’une part avec le rapport pré-moderne et donc élitiste aux lettres en Dār al-Islām comme dans toutes les sociétés anciennes, et d’autre part avec sa systématisation par la fiction du standard nationaliste arabe. Ainsi, il passe inaperçu car ses victimes s’en font complice. Pourtant, une telle exclusion de la langue parlée est aussi une éviction de tout le champ imaginaire et de toute la grammaire inconsciente que charrie la culture orale et qui est nécessaire à la compréhension des tournures, des sous-textes et des suggérés. Ainsi, ce critère de sélection académique, la maîtrise de la langue classique et écrite, ne forme en réalité un élément de distinction que pour ceux qui ne la parlent pas.
En effet, il n’est jamais indépendant d’une batterie d’autres déterminants académiques prioritaires, absolument conditionnés par le capital social et culturel : cela exclut d’une part les prolétaires et les ruraux, et d’autre part les racisés et les extra-Européens. Plus avant, les obstacles les plus violents sont ceux qui sont institutionnels et induisent des mécanismes de domination, de hiérarchie et d’exclusion à la fois transversaux, intersectionnels et cumulatifs. Tout d’abord, les critères de sélection des concours reposent sur le capital culturel, et sur la valorisation d’attitudes sociales spécifiques jamais verbalisées. Ensuite, la relation de patronage qui continue à charpenter l’université depuis le Moyen-Âge ‒, a fortiori lorsqu’elle n’est jamais décrite par ceux dont ce devrait être le métier (supra) ‒ renforce encore ces logiques fondées sur le « savoir-être » implicite, tandis que, par tautologie, le parrainage consiste à reproduire des semblables. Enfin, ces verrous sont défendus avec le plus de véhémences, et cette reproduction est la plus systématique chez ceux là même qui s’installent dans des postures paradoxales d’inclusivité, enseignant parfois la violence symbolique en la faisant (supra). Ces mécanismes imposent des hiérarchies sociales variées et complexes, qui ne donnent guère de chance aux candidats d’origine arabo-musulmane, eux-mêmes placés, pour la portion congrue des postes, en concurrence avec les Européens de milieux sociaux subalternes.
Certaines fiches de poste, y compris dans des universités privées/expatriées du monde arabo-musulman, notifient que le doctorat du postulant doit impérativement avoir été obtenu « en Europe ou en Amérique du Nord ». Mieux, au delà des discussions informelles évoquées ci-dessus, l’expression de cette altérisation, disqualification et asymétrie en vient parfois à s’expliciter lorsque l’intitulé d’un poste inscrit la nécessité d’une « approche non confessante » de l’histoire islamique. Or, une telle exigence n’a strictement jamais besoin d’être consignée dans les fiches concernant l’étude du christianisme, a fortiori celui du Moyen-Orient médiéval, où une telle « non-confession » risque au contraire d’être excluante, au cas très improbable où un candidat oriental n’en serait pas.
Évoquons encore le problème des coopérations, surtout archéologiques mais aussi épigraphiques, entre équipes de recherche du Nord et équipes du pays où se trouve le « terrain ». Ces structures internationales académiques associent des groupes de chercheurs qui sont en fait en concurrence dans le monde scientifique international. Or, les règles de ce jeu, intellectuels et littéraires avant d’être culturels et oraux, ne défavorisent pas les Occidentaux lorsqu’ils sont isolés, voire méconnaissant, du contexte social et humain environnant leur « terrain », puisqu’ils n’ont jamais eu besoin de l’étudier, ni même de l’appréhender, de l’envisager. De même, cet avantage comparatif théorique des collaborateurs « locaux » ne leur sert à rien pour échapper à la subordination académique, en termes d’initiatives sur place, mais aussi et surtout lors de la phase des publications scientifiques. Dès lors, l’auteu·rice européen paraît subir le·a « co-auteu·rice » local.e, plus ou moins « imposé·e », et, en effet, cette minuscule concession à la souveraineté académique du pays d’accueil n’implique jamais une véritable autorité de la part de ce·tte dernier·e, de telle sorte que le·a premier·e est amené·e à s’en plaindre. Un tel mécanisme peut difficilement aboutir à autre chose qu’à renforcer la hiérarchie implicite entre les équipes du monde post-colonial, et du monde post-colonisé.
Ces verrous retords sont renforcés par les exigences d’adhérer à des réseaux et des clientèles subjectives, lesquelles reposent, on l’a dit, davantage sur les savoirs-êtres sociaux et les références culturelles communes que sur une évaluation objective des qualifications en enseignement et en recherche. Dès lors, la société académique attend parfois d’avantage des Arabo-musulmans qu’ils soient irréligieux, et que, de préférence, ils boivent du vin lors des dîners de colloques, que de leur connaissance privilégiée du contexte linguistique et culturel des sources. Inversement, on notera qu’il ne sera jamais disqualifiant pour un·e Occidental de refuser de se déchausser, de manger assis, proprement avec une main droite lavée, dans le même plat que ses camarades et collègues ; non seulement l’inaptitude sera admise, mais la compétence sera elle-même porteuse de potentielle disqualification. En effet, rappelons que jusqu’au XXe siècle, outre le christianisme et les vêtements de coupe européenne, ces mêmes critères de « civilisation » étaient sondés pour octroyer des droits civiques à certaines tribus amérindiennes des États-Unis. Il n’y a donc aucune raison pour que ces paradigmes, s’ils ne sont pas contestés, cessent de jouer dans la « communauté » académique. Dès lors, les stratégies de survie individuelles des personnes qui sont ainsi sommées de présenter outre ces critères implicites et subjectifs, une conscience compatible aux exigences socio-culturelles de la « communauté », induisent de puissantes dissonances. Elles sont mêmes contraintes de remiser leurs affects culturels dans les tréfonds de leur âme, et de parfois s’inscrire dans des réseaux aux méthodologies sceptiques dont l’arrière plan est souvent peu amène à l’égard de cette islamité (infra).
Ces mécanismes reviennent à perpétuer les stratégies de distinction de classe et d’ethnie, et souvent à reproduire les hiérarchies coloniales qui avaient consisté à promouvoir tous ceux qui pouvaient, d’une manière ou d’une autre, se distinguer des Arabes sunnites. Et cette habituation entraîne des conséquences. Ainsi, pour défendre « l’antisémitisme » de Renan, précurseur de cette pensée dès les années 1860[17], un chercheur contemporain peut tenter de le justifier en ce qu’il serait « plus » « un anti-islamisme ». Ainsi, dans cette société, il paraît acceptable de dédouaner ce racisme en expliquant qu’il ne visait pas prioritairement les Juifs et le judaïsme. Par contraste, ses assauts brutaux contre l’essence raciale des Arabes, dont l’islam serait le produit ontologiquement déterminé (sic), apparaissent implicitement comme l’opinion entendable d’un « intellectuel courageux »[18].
En revanche, comme tous les plafonds de verre de genre, de classe ou de race, l’exigence d’une telle dissonance pour ceux qui en sont cibles nuit à la nécessaire liberté académique, et entrave les élans de vertus éthiques. Pire, en évinçant les bons connaisseurs des langues d’étude, tout en instillant une compétition qui empêche le travail collectif, la qualité de la production scientifique générale est forcément impactée. En maintenant dans la sujétion les ressortissants réels ou imaginaires du monde colonisé, la recherche française perd d’un côté en influence, ce qu’elle ne gagne pas en insertion dans la sphère internationale : en désorbitant les autres, elle se désorbite elle-même.
8.« La vision des vaincus »[19]. Études franques, christianologie, et irreligion en IslamOn l’a dit, ces héritages, conditionnements et hiérarchies culturelles conduisent à projeter les définitions occidentales ou coloniales sur les réalités étudiées, présentes ou passées. Cependant, elles peuvent même entretenir des catégorisations chrétiennes médiévales comme des vérités conceptuelles irréfutables, alors qu’elles sont possiblement absentes des sources premières, chrétiennes comme musulmanes. Ainsi, le personnage principal de l’islam est-il toujours défini comme « le Prophète ». Pourtant, les documents du Ier siècle de l’hégire comme les titulatures islamiques traditionnelles, lui accordent d’abord et avant tout le titre « d’apôtre (ar. rasūl, gr. apostolos, pers. paygambar) » (à l’exception marquante de l’inscription du Dôme du rocher de 692). En outre, l’introduction du concept de nbyā (« prophète ») dans la littérature syriaque ne date guère que de la seconde moitié du VIIIe siècle, au moment exact où le ḥadīth muḥammadien commence à s’insinuer au cœur des autres modes de législation. Dès lors, il ne serait pas impossible que cette revendication prophétique ait constitué un point de consensus entre antagonistes. En effet, pour les chrétiens, conceptualiser un profètès à l’origine de « l’hérésie des Ismaélites » s’accordait alors avec la quête d’autorité incontestable que les musulmans espéraient susciter en empruntant à une catégorie biblique de référence. Dès lors, informée par les polémiques de ses coreligionnaires orientaux, l’université latine dont nous sommes le prolongement épistémique appréhende-elle le « mahométisme » autour de la figure de son « Pseudo-Prophète ». À partir de là l’orientalisme finit-il par imposer la notion de « Prophète », au point que les concernés se l’approprient au moment de traduire rasūl.
Ce mécanisme explique aussi comment d’une part l’apologétique cléricale peut être admise, à différents degrés de tempérance selon les spécialistes des études sur les chrétiens d’Orient, pour des raisons idéologiques assumées, inconscientes ou pratiques, alors que, d’autre part, la trace la plus ténue d’islamophilie sera rejetée sans justification comme incompatible avec la science. Or, cette même asymétrie entre les disciplines (christianisantes/islamisantes), fruit de notre université catholique européenne articulée à l’impensé de nos structures de domination, se démultiplie en raison des cloisonnements disciplinaires. Dès lors, les sources chrétiennes sur les débuts de l’islam tendent-elles à être sous-critiquées ‒ et inconsciemment magnifiées ‒ par les plus sceptiques des islamisants, tandis que les sources musulmanes sont hyper-critiquées ‒ et inconsciemment dévalorisées ‒ par les plus positivistes des islamologues. Cela implique que le courant révisionniste de ce début de XXIe siècle emprunte aux christianisants des textes peu critiqués, et donc présumés anciens et intactes, et il ignore les processus de leurs réécritures, de leurs réinventions, et surtout des circulations depuis leurs sources musulmanes. Autrement dit, le positionnement hypercritique ou sceptique sur les sources arabo-musulmanes est bien souvent associé à une approche benoitement positiviste des sources chrétiennes, pourtant elles aussi tardives, et souvent mal informées ou de seconde main. Cette asymétrie est le reflet le plus matériel de l’héritage du regard que porte depuis près de neuf siècles l’université postchrétienne sur l’altérité arabo-musulmane. Dès lors, lorsque des étudiant·e·s ou docteur·e·s, identifié·e·s comme arabo-musulmans, s’associent aux réseaux qui professent cette méthodologie, ils ne font pas seulement violence à leur propre régime d’autorité. En effet, ils peuvent aussi chercher dans cette idée d’un ancrage et décalque judéo-chrétien de l’islam, religion comme civilisation, un bon moyen de résoudre cette dissonance, une voie de légitimation qui épouse le langage dominant de de la science occidentale.
Si l’on acceptait de décentrer la focale, et de laisser parler les textes et les humains du Dār al-Islām à partir de leur point de vue, du centre de l’œkoumène sur la périphérie franque, peut-être s’apercevrait-t-on que tandis qu’il y a des études arabes, perses, turques, islamiques, il n’y a jamais d’étude « franques », pas même dans les pays musulmans. De même, alors qu’il y a une discipline de l’islamologie, il n’y a pas de « christianologie », ni ici ni ailleurs. Peut-être de nouvelles approches comme celle de la « géo-ecclésiologie » de Philippe Blaudeau[20] conduiront-elles à l’ouverture d’études non-chrétiennes et non-occidentale ‒ pourquoi pas par des musulmans ‒ de l’Église et des Églises.
À titre d’exemple, du point de vue du droit musulman, l’évolution du droit romain vers l’assujettissement juridique et économique des femmes, via la confiscation de leur douaire et dot, fruit de l’abolition du divorce, prend une autre coloration. De même la constitution de castes féodales de sang, autour de la noblesse militaire et de la servitude des vilains peut-elle être comparée à un système individualiste où ces processus anthropologiques sont limités par la Loi. Enfin, il serait plus aisé de comparer l’entreprise rapide d’élimination de toute hérésie non-chalcédonienne, puis des juifs, de presque tout le monde franc, uniformisation qui ne se produit dans le reste de l’œkoumène que de manière forcément modérée voire contrainte autant par l’abstraction islamique des « piliers de la foi » pour les non-sunnites, que par l’irrévocabilité des droits des dhimmī pour les non musulmans. Sur le plan des processus politico-militaires eux-mêmes, la confrontation des références au mercenariat franc chez les Byzantins et les Fatimides avec les récits d’aventure coloniale des ethnies normandes, bourguignonnes, lorraines ou provençales en Méditerranée pourrait être réévaluée. Elle serait très comparable avec les autres expansions parfaitement synchrones, et leurs vernis concomitamment réformateurs, par exemple, des Turcs en Orient et des Berbères en Occident, avant et pendant les régimes respectivement almoravides et seljoukides (XIe siècle).
Pour conclure, observons comment l’autorité politique assigne régulièrement à des islamisants, médiévistes ou non, la tâche de parler de « laïcité », un sujet qui relève normalement du droit public ou constitutionnel : celui-là n’a en effet rien à voir avec nos qualifications. Pour admettre cette assignation insensée, il faudra considérer un autre de ces paradigmes post-chrétiens et post-coloniaux implicites : que l’islam/les musulmans s’opposeraient à la laïcité, ce qui n’a aucune pertinence pour un juriste, et aucun fondement pour un historien ou un sociologue. Plus profondément, il y a la poursuite tacite de l’entreprise de gestion des indigènes à travers l’assignation essentialisante à leur religion, hors des droits que la laïcité devrait leur accorder. Le comble ne serait-il pas que cette injonction à l’analyse du « musulman » à travers « son » dogme alimente la création de chaires d’islamologie, lesquelles bénéficient encore aujourd’hui de la dîme d’État des départements concordataires ?
Finalement, pendant que le monde des islamisants est entraîné à l’étude d’un fait religieux qui serait l’alpha et l’oméga de l’islamité éternelle, le salafisme s’effrite, les partis islamo-conservateurs sont défaits, les légitimités conservatrices des autocrates sont dissoutes. Or, il n’y a aucun espace pour que le monde académique cesse de projeter ses impératifs sur « son » objet, sur « son » terrain, et qu’il parvienne enfin à saisir l’exponentielle lame de fond de sécularisation, et bien souvent d’irreligion voire d’athéisme, qui s’empare des sociétés arabo-musulmanes depuis l’échec des révolutions arabes, et de ceux qui ont voulu les manipuler[21]. Cependant, pour enfin la voir émerger, encore faudrait-il laisser la parole à l’objet et au terrain, cesser d’islamiser les musulmans, et leur donner la possibilité d’avoir sur « notre » monde le discours du progrès et de l’universalité qui nous fait de plus en plus défaut.
BibliographieAnonyme, « L'opinion des vrais Ulémas sur la naturalisation », L'Action tunisienne, 4 mai 1933.
Blaudeau Philippe (2017), “Qu’est-ce que la géo-ecclésiologie?: éléments de définition appliqués à la période tardo-antique (IVe-VIe s.)”, in Costellazioni geo-ecclesiali da Costantino a Giustiniano: dalle chiese ‘principali’ alle chiese patriarcali, XLIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, 2017, Rome, p. 39-56.
A. Bonnichon, « La conversion au christianisme de l’indigène musulman algérien et ses effets juridiques (un cas de conflit colonial) », Thèse de Doctorat, Paris, 1931.
H. Bouali, H. Hafsa et S. Pierre, “Friends of the Family. Patronage in the Government of the Islamic Empire During the First Century A.H.” Forum Insaniyyat, Tunis, 22/09/2022, https://insaniyyat.com/conference/111.
P. Bourdieu, « Espace social et genèse des ‘classes’ », ARSS 52-53, 1984, p. 3-14.
A. Calvès, O. Koné, « La mobilisation des organisations féminines en faveur du Code de la famille au Mali », Cahiers d’études africaines 242, 2021, p. 331-354.
A. Bachoud, « Les Espagnols en Algérie : questions sur l’identité et sur l’intégration », Exils et migrations ibériques au XXe siècle, 7, 1999, p. 205-18 ;
P. Crone, « Were the Qays and Yaman of the Umayyad period political parties ? », Der Islam 71, 1994, p. 1‑58.
M. Donato, L'émigration des Maltais en Algérie au XIXème siècle, Montpellier, 1985. et Smith, 2006.
B. Fuligni, « Le retour de Blaise Diagne », Humanisme 304-3, 2014, p. 80-85.
Ḥannā Dyāb, D’Alep à Paris: Les pérégrinations d’un jeune syrien au temps de Louis XIV, P. Fahmé-Thiéry, B. Heyberger et J. Lentin (éd.), Paris, 2015.
K. Jerfel, « Siciliens et Maltais en Tunisie aux XIXe et XX e siècles Le cas de la ville de Sousse ». MAWARID 18, 2013, p. 159-191.
Legendre, Marie, « Islamic conquest, territorial reorganization and empire formation: A study of 7th Century movements of population in the light of Egyptian papyri », dans éd. Gnasso, A. Intagliata, E. MacMaster, T. et Morris B., The Long Seventh Century: Continuity and Discontinuity in an Age of Transition, 2015, p. 235-50.
J. Mélia, Pour la représentation parlementaire des indigènes musulmans d'Algérie, Paris, 1927.
M. Messling, Gebeugter Geist. Rassismus und Erkenntnis in der modernen europنischen Philologie, Göttingen 2016.
S. Pierre, « Patriarcat, califat et réseaux. Le moment Ḥarrān au cœur de l’Empire (126/744-140/758) », Journal of Abbasid Studies10-2, 2023, p. 56-137.
S. Pierre, « La fuite des Iyād au ‘Pays des Romains’ : une théorie de migration transfrontalière aux débuts de l’Islam », Arabica 71-1, 2024, [p. 1-49]. (sous presses)
S. Pierre, M.-A. Utrero Agudo, From the Tigris to the Ebro. Church and Monastery Building under Early Islam, Madrid, 2024. (sous presses)
É. Pontanier, « Indifférence religieuse et athéisme, ou le choix d’une école laïque en Tunisie », dans P. Bréchon et A.-L. Zwilling (éd.), Indifférence religieuse ou athéisme militant ?Penser l'irréligion aujourd'hui, Grenoble, 2020, p. 148-162.
E. Renan, « L’islamisme et la science », Paris, 1883.
E. Renan, « De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation », Paris, 1862 (23 février 1862).
P. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State: The World of a Mid-Eighth-Century Egyptian Official, Oxford, 2013
G. Stroumsa, « Renan, le judaïsme et l’Islam. Orientalisme et monothéisme », Humanitas 76, 2021, p. 529-538.
H. Tajfel, B. Billig et C. Flament, « Social categorization and intergroup behaviour », European Journal of Social Psychology 1-2, 1971, p. 149-178.
É. Temine, « La migration européenne en Algérie au XIXe siècle : migration organisée ou migration tolérée », Revue d’étude de la méditerannée et du monde musulman, 43, 1987, p. 31-45 ;
A. Vööbus, The Synodicon in the West Syrian Tradition, 2 vol., éd. (et trad), Paris-Louvain, 1975-1976.
N. Wachtel, La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole 1530-1570. Paris, 1971.
P. Webb, Imagining the Arabs: The Construction of Arab Identity and the Rise of Islam, Édimbourg, 2016.
P. Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », Histoire de la justice, 16-1, 2005, p. 93-109.
[1] Travail présenté avec Hafsa et Bouali, 2022.
[2] Weil 2005.
[3] Donato 1985; Smith 2006.
[4] Bonnichon 1931.
[5] Crone 1994.
[6] Webb 2016.
[7] Fuligni 2014.
[8] Anonyme 1933.
[9] https://revue-conditions.com/empirecatholique
[10] Voir pour le cas du delta du Nil, Sijpesteijn 2013, p. 192 ; Legendre 2015, p. 245 ; pour la Syrie du Nord, Pierre, 2024.
[11] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000692222
[12] https://orientxxi.info/magazine/zemmour-de-gaulle-lyautey-l-enterrement-de-l-universalisme-republicain,5320
[13] Renan 1883.
[14] https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/attaque-a-paris-quelles-reponses-psychiatriques-pour-les-radicalises-5840142; à 16’30’’.
[15] Pierre, Utrero Agudo 2024.
[16] Il s’agit de la traduction que retient Christian Robin pour le terme sudarabique identique, dans toutes ses publications.
[17] Renan 1862.
[18] Stroumsa 2021, n. 17 : « J’accepte le jugement de Messling, selon lequel Renan fait preuve plus d’anti-Islamisme que de ce que nous nommons antisémitisme. » et p. 538, n. 35, citant Messling 2016, p. 401: « Renan’s Antisemitismus ist ein Antiislamismus ».
[19] Wachtel 1971.
[20] Blaudeau 2017.
[21] Saisi par ce phénomène, j’ai tenté d’apporter ce sujet dans la presse en octobre 2021, sans grand succès : ci-après la republication récente du manifeste https://blogs.mediapart.fr/simon-victor-pierre/blog/130124/pour-letude-de-l-irreligion-et-de-la-secularisation-dans-le-monde-arabo-musulman. L’irruption de l’athéisme en contexte arabo-musulman émerge désormais à la surface, comme en témoigne les pics de fréquentation, entre autres, de la chaine de « Mihoub Bouchama DZ » (https://www.youtube.com/@MihoubBouchamaDZ). On trouvera tout de même un article quelque peu prémonitoire chez Pontanier 2020.

