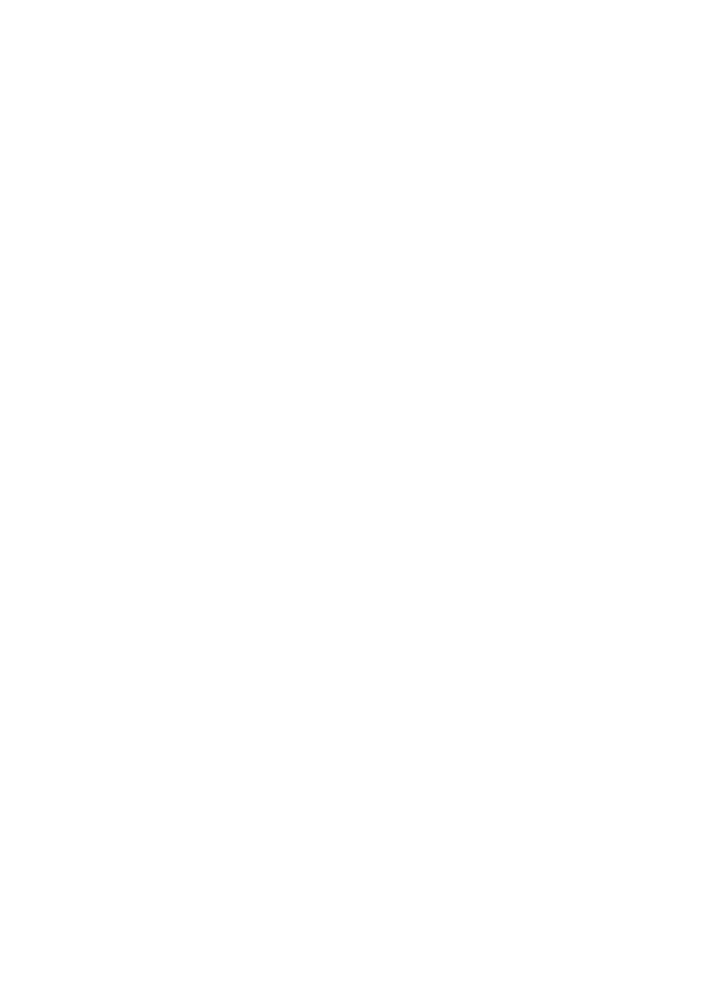
https://www.editions-ulb.be/fr/book/?GCOI=74530100983710#h2tabDetails
« Poètes noirs d’Arabie » est une anthologie reprenant les œuvres de quelques poètes et poétesses arabes, connus et moins connus, ayant vécu entre le 6e et le 12e siècle de notre ère, et qui partagent le point commun d’avoir la peau noire. Ce critère de sélection pour établir une anthologie peut paraître à première vue étonnant, voire incongru, il est pourtant judicieux puisque pour la plupart de ces poètes, la couleur de leur peau, souvent associée à une origine servile, a joué un rôle important – parfois primordial – dans l’élaboration de leurs œuvres: certains vantent leur noirceur et la revendiquent avec fierté, d’autres se plaignent des troubles qu’elle occasionne, d’autres encore la tournent en dérision, mais surtout chacun la mentionne. La plupart du temps, le teint noir de ces poètes est l’héritage d’une ascendance africaine, généralement abyssinienne (ḥabashī en arabe) durant la période préislamique – nous reviendrons plus loin sur les rapports étroits entre la péninsule Arabique et l’Abyssinie –, plus tard nubienne (nūbī), ou d’autres régions d’Afrique (zanjī). Cette ascendance, outre qu’elle est souvent abordée par les poètes eux-mêmes dans leur œuvre – comme lorsque ‘Antara se déclare descendant de Cham – ou revendiquée par leur nom – al-Najāshī par exemple signifie le Négus, c’est-à-dire le souverain d’Abyssinie –, est généralement signalée dans les notices biographiques des grands ouvrages médiévaux consacrés à la poésie, comme le Kitāb al-shi‘r wa-l-shu‘arā’ (« Le livre de la poésie et des poètes ») d’Ibn Qutayba (m. 276 AH/889 CE).
Historiquement, les échanges entre la péninsule Arabique et la côte nord-orientale de l’Afrique, séparées uniquement par l’étroite mer Rouge, sont très anciens, comme l’attestent l’archéologie et la linguistique. En effet, l’arabe et les autres langues sémitiques du Proche-Orient partagent une origine commune avec le guèze – la langue sacrée d’Éthiopie – et d’autres langues parlées aujourd’hui en Afrique orientale comme l’amharique, le tigréen et le tigrinya, ce qui implique très tôt dans l’Antiquité un déplacement de population d’un continent à l’autre.
Dans les siècles précédant l’avènement de l’islam, les Éthiopiens envahirent le Yémen à plusieurs reprises, ce qui marqua les esprits des Arabes de la péninsule : la sourate de l’Éléphant, dans le Coran, se rapporte à l’invasion du Yémen par le roi axoumite Abrāhā, dans le courant du vie siècle de notre ère. Ces événements sont attestés par l’archéologie, plusieurs inscriptions en guèze, par exemple, retrouvées dans la péninsule Arabique et en Éthiopie, faisant référence à la souveraineté axoumite sur le Yémen de l’époque. Ils sont relatés également par plusieurs chroniqueurs arabes – comme Ibn Iṣḥāq (704-767) ou encore al-Ṭabarī (839-923), ce dernier offrant notamment une description de la splendide église édifiée par Abrāhā à Sanaa, l’actuelle capitale yéménite –, mais aussi par des sources latines et grecques de l’époque2. Leur souvenir subsiste également dans la littérature populaire, notamment dans le mystérieux cycle épique de Sayf bin Dhī Yazan, une épopée fantastique se passant entre l’Arabie et l’Abyssinie et relatant la rivalité entre Arabes et Abyssins. Rappelons enfin que Yéménites et Éthiopiens se disputent jusqu’à nos jours la filiation de la reine de Saba.
Les rapports entre l’Afrique de l’Est et la péninsule Arabique ne cesseront pas avec l’islam, tant s’en faut. L’historiographie arabo-musulmane insiste sur le rôle positif de l’Éthiopie du vivant de Muḥammad (vers 570-632), le prophète de l’islam, lorsque le Négus accueillit les réfugiés musulmans venus d’Arabie. Avec la conquête fulgurante de l’Afrique du Nord, les populations arabes entrèrent progressivement en contact avec de nouvelles populations africaines, comme les Nubiens dès le viie siècle, puis dans les siècles suivants avec diverses populations de la ceinture saharienne et des portions importantes de l’Afrique de l’Ouest, donnant parfois naissance à de grands royaumes comme celui du Mali qui connut son apogée entre le xie et le xive siècle.
Ceci étant dit, ces poètes ne se bornent pas à aborder la couleur de leur peau : certains décrivent aussi leur amour pour leur bien-aimée, d’autres font l’éloge (madḥ) de certains de leurs contemporains ou au contraire s’essaient à la satire (hijā’), deux genres très prisés dans la tradition arabe. Par ailleurs, quelques-uns vantent les valeurs guerrières, avec souvent une certaine violence assumée, qu’il s’agisse de descriptions de batailles ou de combats singuliers. Ces scènes sont certes violentes, mais elles doivent être replacées dans le contexte du mode de vie bédouin dans un milieu hostile, où les valeurs guerrières sont indispensables pour la survie de l’individu et de sa tribu. En outre, ces scènes ne sont pas plus violentes que celles décrites par Homère dans L’Iliade – pensons entre autres à la célèbre scène du Chant XXII, lorsqu’Achille traîne le cadavre d’Hector autour des remparts de Troie après lui avoir percé les talons – ou celles qu’on retrouve, bien plus tard, dans la Chanson de Roland. Il faut mentionner aussi le cas particulier des poètes-brigands, qui se vantent de leurs razzias, larcins et autres enlèvements… Mais là encore, c’est une sorte de passage obligé pour des brigands, même poètes, rendus amers par l’action des membres de leur tribu qui les ont chassés, les privant ainsi de toute ressource. La religion est donc loin d’être le seul thème poétique abordé ou même le plus important. Néanmoins, nous avons sélectionnés pour Conditions trois poèmes, représentatifs de trois périodes différentes, mais aussi de trois attitudes par rapport à la religion.
Le premier poème, très court, est dû à ‘Antara bin Shaddād, qui aurait vécu avant l’avènement de l’islam. La période préislamique est généralement appelée al-Jāhiliyya en arabe, littéralement « la période d’ignorance », parce que les Arabes n’avaient pas encore eu connaissance de la parole divine, délivrée par la mission prophétique que les musulmans attribuent à Muḥammad, au début du 7e siècle de notre ère. Avant l’avènement de l’islam, communément daté de 622, l’année de l’Hégire, c’est-à-dire du départ de Muḥammad et ses compagnons de La Mecque à Médine, les Arabes qui peuplaient la péninsule Arabique mais aussi déjà certaines portions du Proche-Orient professaient plusieurs religions: polythéisme, judaïsme, christianisme. La péninsule Arabique, loin d’être isolée du reste du monde, entretenait des rapports commerciaux et politiques avec l’Empire byzantin et l’Empire perse, mais aussi avec l’Afrique orientale. Les Arabes importaient des objets de ces régions et le domaine des arts, en particulier dans les centres urbains, est marqué par ces influences comme en témoignent notamment les statues exhumées en divers endroits de la péninsule.
‘Antara ibn Shaddād aurait vécu au tournant du 6e et du 7e siècle, certaines sources plaçant sa mort vers 615. Son père était Shaddād, l’un des chefs d’une grande tribu arabe de l’époque, les Banū ‘Abs. Quant à sa mère, Zabība (ou Zubayba), c’était une esclave au teint noir, éthiopienne ou soudanaise selon les sources. Il combine donc deux origines différentes, deux couleurs différentes et surtout deux conditions sociales différentes. Sa poésie aborde trois grands thèmes : son amour pour ‘Abla, sa bravoure et la couleur de sa peau. ‘Abla, fille de Mālik, était la cousine de ‘Antara, et ce dernier lui vouait un amour devenu proverbial. ‘Abla et ‘Antara font partie des quelques couples emblématiques de la poésie amoureuse arabe, au même titre que ‘Urwa et Afra, Jamīl et Buthayna ou Qays et Lubnā. Comme souvent dans la littérature amoureuse orientale – et mondiale –, cet amour est difficile à concrétiser en raison de l’opposition du père de la jeune fille. Cela ne l’empêchera pas de composer de superbes vers en son honneur. Au contraire, comme souvent dans la littérature amoureuse, ce sont les obstacles à leur union qui deviennent la source d’inspiration de ‘Antara. Mais dans le cas de ce dernier, la trame du récit est plus originale. D’abord, la différence de classe est poussée à l’extrême, puisqu’un esclave aime une femme libre – même si, paradoxalement, elle fait partie de sa famille proche. Ensuite, leur histoire d’amour se termine par un mariage, contrairement à la plupart des autres grands couples de la poésie arabe. La tradition épique donnera à ‘Antara de nombreuses autres conquêtes féminines, en Arabie et ailleurs. Pourtant, sa poésie ne nomme qu’une seule femme, ‘Abla.
La bravoure de ‘Antara est un autre grand thème de sa poésie – son propre nom signifie d’ailleurs « brave, courageux », comme si sa mère avait voulu encourager son destin par le choix de ce nom. La tradition veut qu’encore enfant, ‘Antara ait appris les arts de la guerre en cachette, s’entraînant avec son frère Shaybūb à manier les armes et à monter à cheval. Il remporta plusieurs combats mortels durant son adolescence, mais toujours contre des esclaves… C’est grâce à cette bravoure qu’il put finalement gagner le statut d’homme libre. En effet, il participa à quelques batailles, mais lors du partage du butin, on lui rappelait toujours son statut. Un jour, le camp des Banū ‘Abs fut attaqué par une autre grande tribu de la péninsule, celle des Ṭayyi‘; son père lui demanda alors de les aider à combattre au lieu de s’occuper du bétail. ‘Antara répondit qu’on lui avait toujours affirmé que la place de l’esclave était auprès des chameaux, pas dans les rangs des combattants. Acculé par la tournure des événements, son père lui dit alors une phrase restée célèbre dans la tradition arabe : « Bats-toi, bats-toi et tu seras libre. » On devine la suite : ‘Antara prit les armes et mit l’ennemi en déroute, gagnant du même coup sa liberté. Dès lors, ‘Antara participa comme les autres aux razzias et aux ripostes contre l’ennemi, alimentant sa poésie grâce à ses faits d’armes.
La couleur de la peau de ‘Antara et, partant, ses origines serviles constituent le thème le plus intéressant de sa poésie, car c’est ce qui donne à l’œuvre son originalité. Tous les poètes de l’époque parlent d’amour et de leurs faits d’armes, mais lui fait plus, plus et mieux : il aborde deux thèmes de société, l’esclavage et le racisme. À cet égard, le racisme en tant que concept est bien sûr un terme récent, en français comme en arabe, néanmoins on sent bien à la lecture de nombreux poèmes de ‘Antara et d’autres poètes à la peau noire comme Abū Dulāma ou Suḥāym qu’il ne sont pas raillés uniquement pour leur origine servile, mais aussi pour la couleur de leur peau et toute une série de stéréotypes – la laideur ou l’immoralité, par exemple – qui lui sont associés.
Et la religion dans tout ça ? Certes, ‘Antara parle parfois de Dieu, de l’enfer, du paradis ou des djinns dans ses vers, sans que l’on sache s’il s’agit de poèmes ou de simples vers postérieurs, faussement attribués à ‘Antara, ou de véritables reflets de la pensée religieuse de l’époque. Dans le poème qui suit, l’allusion à Cham – le fils de Noé, qui selon plusieurs sources juives, chrétiennes et musulmanes, aurait été maudit par son père, condamnant sa descendance à avoir la peau noire et à servir la descendance de ses frères, une justification religieuse de la mise en esclavage des Africains – illustre bien les cas de poèmes forgés à l’époque musulmane et attribués ensuite à ‘Antara.
« Oui, ma mère et le corbeau ont le même teint,
Et tu nous reproches d’être les descendants de Cham,
Je prends grand soin de mes sabres blancs
Et de mes lances noires, si tu veux venir à moi,
Si tu n’avais pas fui le jour de la bataille,
L’un d’entre nous aurait mené l’autre à la mort, sans faille. »
Le poème est très court, mais riche en allusions et doubles lectures : Cham est une allusion à l’esclavage, comme on l’a vu, le corbeau fait référence à sa peau noire, mais aussi à la connotation négative du volatile et enfin au surnom donné aux poètes noirs dans la tradition arabe, surnommés les Corbeaux des Arabes ; les sabres blancs et les lances noires sont un jeu de mot souvent utilisé par le poète, double allusion à sa bravoure et à son métissage puisque souvent ils se vante d’avoir pour seuls parents un sabre blanc – comme son père – et une lance noire – comme sa mère, le héros ayant acquis sa noblesse par les armes et non par la généalogie.
Le second poème est dû à Qays ibn ‘Amrū Abū l-Maḥāsin al-Najāshī, qui est un poète du 7e siècle. Son surnom, al-Najāshī – le Négus, en arabe – est lié selon les uns à ses origines éthiopiennes du côté maternel, selon d’autres à sa simple ressemblance avec les Éthiopiens, en raison de la couleur de sa peau. Il est probablement né à Najrān, dans la péninsule Arabique, avant l’avènement de l’islam, et serait devenu musulman quelques années après l’hégire – le départ des compagnons de Muḥammad de La Mecque vers Médine (appelée alors Yathrib) en 622, événement qui marque le début du calendrier musulman. Il aurait alors vécu en Irak, puis en Syrie. Plusieurs sources mentionnent ses relations avec les personnalités importantes du début de l’islam, comme Abū Bakr, ‘Umar et Mu‘āwiya, parmi les premiers califes, et même ‘Ali, le gendre de Muḥammad, qu’il aurait accompagné au combat. Mais ‘Alī finit par punir le poète, parce qu’il s’était enivré durant le mois de Ramadan ; al-Najāshī quitta alors l’Irak pour rejoindre Mu‘āwiya en Syrie. Plus tard, il retourna dans la péninsule Arabique, au Yémen plus précisément, où il mourut. La poésie d’al-Najāshī se compose essentiellement de louanges – notamment celles des personnages précités – mais aussi de satires, visant notamment les Banū Ajlān, les habitants d’al-Kūfa et les Yéménites.
Le poème qui suit fait l’éloge des troupes de ‘Alī, le gendre du prophète des musulmans. Un jour que les troupes de ‘Alī et celles de Mu‘āwiya allaient s’affronter, les poètes des deux parties firent l’éloge de leurs armées respectives. Après qu’un poète du côté des troupes de Mu‘āwiya eut glorifié la Khuḍriyya, leur corps d’élite, al-Najāshī fit de même à propos des meilleurs soldats de ‘Alī, appelés Rajrāja en référence aux tremblements – rajraja en arabe – de leurs armes et de leurs armures lorsqu’ils marchent vers l’ennemi. Le sujet du poème n’est pas anodin, puisque la rivalité entre Mu‘āwiya et ‘Alī conduira plus tard au grand schisme de l’islam entre sunnites et chiites, les premiers considérant que Mu‘āwiya était bien le successeur de Muḥammad après sa mort – le calife – tandis que les seconds estimaient que ce rôle revenait de plein droit à ‘Alī en raison de son lien familial avec leur prophète.
« Mu‘awiya, si tu viens à nous, écumant,
Accompagné de ta Khuḍriyya, tu feras face à une Rajrāja,
Les pointes de ses lances baignées du sang de l’ennemi,
Lorsque les chevaux salivants s’élancent,
Ses cavaliers, tels des lions prêts à combattre,
Se tournent vers Dieu dans la bataille,
Elle ne s’arrête pas face à la mort,
Pas plus qu’elle ne hurle devant la peur,
Ils n’attendent que le moment de la confrontation,
Munis de leurs longues épées,
Leurs pas précèdent celles-ci,
Et leurs bras sont parfaits,
Gare à toi, sois sûr de leurs gestes,
Ils ont saisi leurs épées luisantes,
Prêtes à s’entrechoquer. »
Le dernier poème, plus tardif puisqu’il date de l’époque abbasside, est attribué à Abū Dulāma. Son œuvre se distingue assez de celle des auteurs précédents, car elle est essentiellement satirique – son œuvre nous est d’ailleurs parvenue surtout par le biais des auteurs récoltant les bons mots des anciens. Le poète s’appelait en réalité Zand (ou Zayd, selon certaines lectures) bin al-Jawn – ce dernier terme faisant référence à la couleur de sa peau. Son surnom, Abū Dulāma, « le père de Dulāma », fait également référence à la couleur de peau – la racine dalima signifie « être très noir ». Certaines sources précisent qu’il était un affranchi de la tribu des Banū Asad, mais que son père, lui-même poète, avait été l’esclave d’un certain Qasqās ou Fadfād. Certains comme Ibn al-Mu‘tazz considèrent qu’il était un Arabe bédouin à la peau noire, tandis que d’autres comme al-Aṣma‘ī précisaient que sa mère était éthiopienne. En raison de sa condition, encore une fois, nous n’avons guère plus d’informations quant à sa généalogie ou ses origines. Abū Dulāma était originaire d’al-Kūfa, où il commença à étudier avant de se rendre à Bagdad, qui était alors la capitale de l’État abbasside, après avoir pris le parti des Abbassides contre les Omeyyades. Il s’installa dans cette ville prestigieuse où il se mit au service du calife al-Saffāḥ (722-vers 754), puis de ses successeurs al-Manṣūr et al-Mahdī, pour lesquels il composa des poèmes. Il avait la réputation d’être un grand jouisseur, un homme coquet et séduisant, et surtout un amateur de banquets et de boisson, peu porté sur le jeûne et la prière, qu’il raillait d’ailleurs – ce qui poussa certains observateurs à remettre en cause sa foi ou tout au moins sa religiosité. Cela est parfaitement illustré par ce poème, où il se moque ouvertement du pèlerinage à la Mecque. En effet, Abū Dulāma utilisait tous les subterfuges possibles pour échapper aux exigences religieuses, comme la prière et le jeûne. Un jour, un certain Mūsā bin Dāwud al-Hāshimī lui proposa de se rendre avec lui en pèlerinage à La Mecque, lui promettant de le rémunérer pour cet acte. Abū Dulāma accepta et reçut donc dix mille dirhams, mais aussitôt il s’enfuit avec l’argent et alla le dépenser en beuveries. Lorsque Mūsa le retrouva, le poète composa ces vers :
« Chers tous, dites-le ensemble :
Que Dieu bénisse Mūsā bin Dāwud,
Ses joues soyeuses semblent teintées d’or,
Lorsqu’il apparaît dans ses vêtements noirs,
Je demande l’aide de Dāwud et de ses os,
Pour éviter d’accomplir le rude pèlerinage, fils de Dāwud,
J’ai appris que la route du pèlerinage engendrait la soif,
Or, je suis loin de me contenter d’une seule goutte de vin,
Mon Dieu, il n’y a pour moi aucune rétribution à demander,
Pas plus que louer ma religion n’apporte de grâce. »

