Simon Pierre
Lapsus révélateur.
Bolloré et le parti indigéniste au Maroc
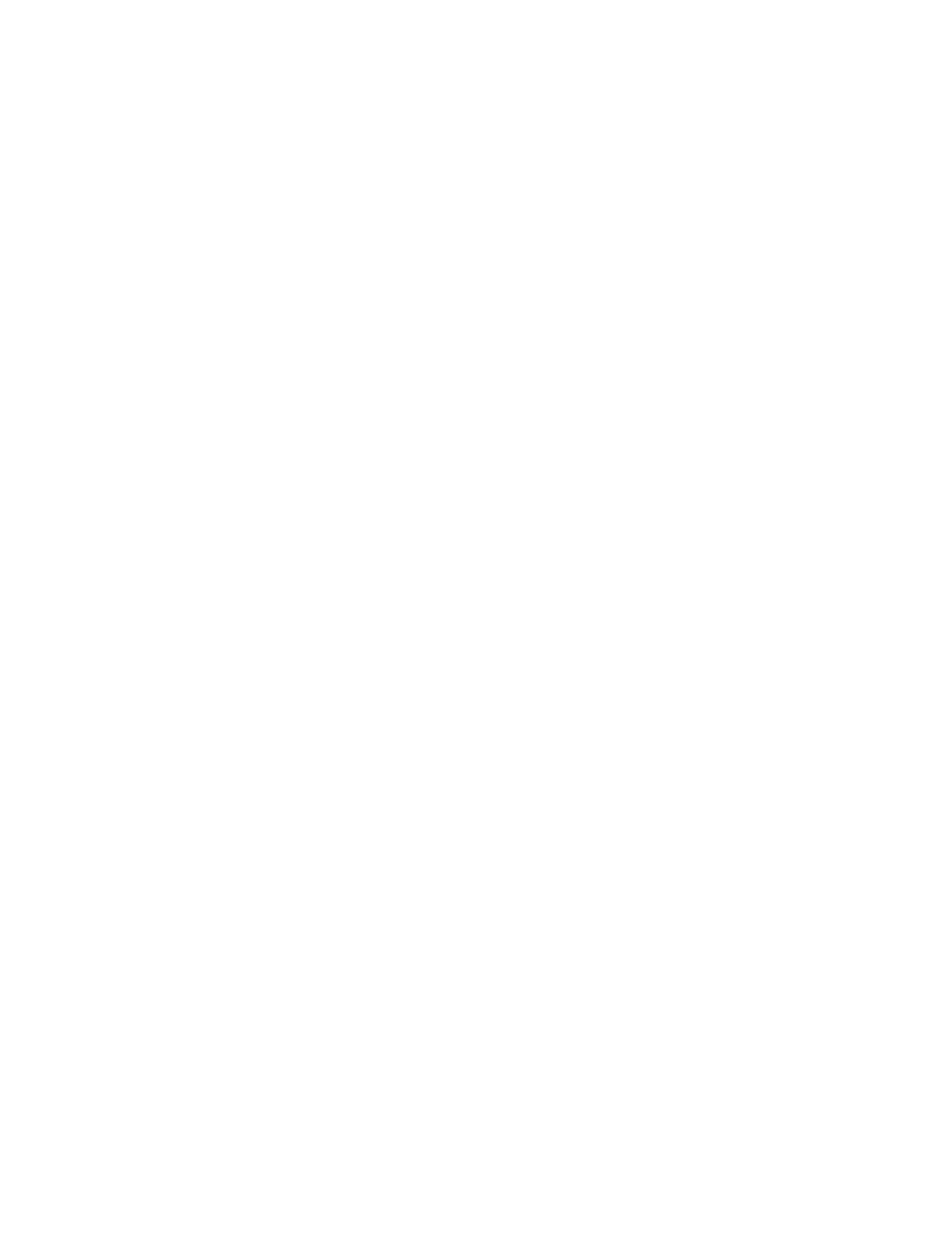
Dia al-Azzawi, 1989
À l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, et des juteux contrats signés entre les capitalismes des deux rives, l'historien Simon Pierre revient sur une petite phrase de l'oligarque Vincent Bolloré à propos de la famille royale marocaine.
Convoqué en début d’année devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée aux attributions de fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT), Vincent Bolloré, propriétaire, entre autres nombreux médias de toutes natures, des chaines CNews et C8 où sévissent des propagandistes d’extrême droite, s’est fendu, pour sa défense, d’une remarque qui, à première vue, pourrait paraître surprenante ou inattendue :
"Je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman –non seulement j’ai beaucoup d’amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité–, mais figurez-vous que le commandeur des Croyants, descendant du Prophète, Mohammed V, à la fin du milieu des années 1950, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays… par notre pays, et il ne savait pas où revenir, et il est venu chez nous, et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson, en novembre 1955, et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du Prophète, et son fils qui était là, et maintenant bien sûr le fils de son fils qui est sur le trône. Donc ce n’est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler aussi des autres religions."
Dans le cadre de ce billet, nous ne reviendrons pas sur le parallèle, souligné par le député François Ruffin [alors] proche de LFI, qui avait partagé l’extrait, avec les propos ridicules et révélateurs de Nadine Morano. Elle s’était en effet défendu des mêmes affects au prétexte de l’existence théorique d’une « amie tchadienne » qui serait « plus noire qu’une Arabe ». Nous nous proposons plutôt ici l’exégèse du sous-texte de cette déclaration. Peu nous importe également que l’anecdote soit vraie, fantasmée ou attribuée à posteriori à la mauvaise période, comme l’a brillamment suggéré Cédric Mathiot en comparant avec une réinterprétation similaire de la même famille à propos de Léon Blum. Ce qui nous concernera ici, c’est le sens politique de cette mémoire familiale, la vision du monde que charrie cet imaginaire.
Pour ce faire, il convient de partir du lapsus de Bolloré, qui, s’il est peut-être feint pour les raisons que nous allons voir, n’en est pas moins révélateur. Devant des parlementaires de la République, le magnat de l’import-export désignait la France comme « votre pays ». Il y articulait sa posture « indigéniste », au sens originel du parti monarchiste réactionnaire soutien du sultan marocain, avec le tour de passe-passe revenant à camoufler, derrière le prétexte d’un œcuménisme religieux (parler aux autres religions), un programme identitaire de diffamation (« parler aussi des autres religions »).
En effet, voir Bolloré l’Africain s’auto-investir de la sorte de la représentation des potentats indigènes rappelle Tintin au Congo s’instaurant conseiller du roi des Babaoro’m, sauveur blanc contre les manipulations d’autres « méchants blancs ». Outre les indices de sa prosodie, que l’on pourra juger subjectifs, cette prétention de parler au nom de la famille chérifienne suggère que le lapsus pourrait être contrôlé.
Cependant, cette expression reflète aussi une revendication, limpide pour qui connaît ces enjeux et leurs usages pervers : fusionner réaction et souverainisme des deux rives. Cette tactique consiste en la coalition des autoritaires et identitaires des Suds et d’Occident, à rassembler d’un bloc les oppresseurs indigènes comme impérialistes, tous ensemble. L’adversaire tout désigné de ce simulacre d’anti-impérialisme est le républicain de gauche. Il est dépeint à la fois comme le seul colonisateur et comme le déstabilisateur de l’ordre traditionnel, ancien et donc bon puisque naturel, hiérarchique et stable. Ce leitmotiv est en effet ressuscité aujourd’hui, dans la phraséologie poutinienne en Afrique comme en Europe, et elle est structurée par des idéologues comme Bernard Lugan. D’une main, ce dernier n’a de cesse de flatter les régimes aristocratiques et leurs fondateurs indigénistes comme le Maroc de Lyautey. De l’autre, il vilipende tous les non-Occidentaux qui, en allant contre « l’ethno-différentialisme » qu’il leur assigne, auraient eu le tort de croire que 1776, 1789 et 1793 eussent pu fonder autant l’émancipation politique et sociale du Tiers-Monde que celle du Nord. Une telle justification culturaliste ne résiste d’ailleurs nullement à la logique, car si les mêmes romantiques attardés fantasment la monarchie traditionnelle des braves indigènes, c’est justement parce qu’ils échouent encore à l’imposer à leurs compatriotes… mais, pour cause, n’y désespèrent pas.
On reconnaît dans l’implicite du récit de Bolloré la convocation, et partant la filiation et l’héritage, d’un très ancien parti indigéniste au sein de l’impérialisme occidental. Or, si ce dernier a pu originellement être anticolonialiste, il n’a en revanche jamais été anti-impérialiste. Depuis les années 1840, bien loin de s’opposer à l’empire, monarchistes et indigénistes contestent pour une même raison les deux politiques républicaines d’implantation de colons prolétaires européens et d’administration directe des territoires conquis et de leurs « indigènes » ; c’est-à-dire « étrangers » En effet, ils sont surtout terrorisés à l’idée que ces deux vecteurs de modernisation finissent par diffuser quelques idéaux progressistes dans l’empire et, conséquemment, mettent en péril l’ordre local. Pour les indigénistes, la préservation de cet ordre dépend de l’autorité et des privilèges étriqués des chefferies indigènes sujettes, reliques et figées. Cette délégation à des élites communautaires vassales et folkloriques, soumises et impuissantes, doit rester le garant de la tranquillité, du profit et de la puissance de l’empire.
Ce courant mobilise alors depuis l’origine les mêmes affects romantiques, les mêmes sophismes naturalistes et essentialistes, et, en pratique, jusqu’à De Gaulle, ne cesse d’inviter à l’imitation de l’indirect rule de la sage monarchie britannique conservatrice : la cooptation des chefs traditionnels et la rétention de toute idée progressiste, de tout droit universel, auprès des sujets colonisés. En réalité, le parti indigéniste, tout traditionnaliste et aristocratique, n’en est pas moins capitaliste, hier comme aujourd’hui. Il était tout aussi désireux d’utiliser les deniers publiques pour conquérir le monde, de se doter des actions dans les banques de surendettement des États faibles, de se découper des marchés protégés – c’est-à-dire captifs – pour l’exportations de leurs produits industriels, et, en bout de course, de s’assurer les plus bas prix aux importations de produits exotiques et de matières premières.
En somme, les monarchistes ont toujours défendu l’idée de se contenter d’exploiter économiquement en sous-traitant, sans se mélanger. Pour ce faire, ils ont toujours revendiqué la cristallisation, voire la sacralisation, de l’hétérogénéité et de l’inégalité, de caste et de culture, entre les humains qui peuplent le monde européanisé. Ainsi, à l’inverse de ce que le confusionnisme de l’internationale réactionnaire voudrait feindre de croire : ils ont toujours lutté pour la préservation d’un ordre mondial dont l’Europe chrétienne garderait les privilèges les plus éminents, au premier rang desquels celui d’y tolérer l’instable libéralisme politique. Pour le dire autrement, ce parti ne s’oppose guère qu’à son ennemi juré : « votre pays », c’est-à-dire à la République, à son idéal égalitaire en métropole, à ses investissements coloniaux au profit d’immigrants sans terres, et à la diffusion dangereuse de ses idées humanistes, matérialistes et égalitaristes auprès des élites colonisées. Cette tartufferie dialectique est d’autant plus ennuyeuse qu’elle s’accompagne de l’imputation aux républicains du monopole du colonialisme, alors même que seule l’extrême gauche républicaine des Radicaux puis des Socialistes a su contester l’impérialisme, de Droite comme de Gauche, au nom des droits des indigènes.
Lorsque le camp réactionnaire n’a jamais critiqué l’assujettissement du monde à la chrétienté, d’Alger jusqu’à Beyrouth, et a au contraire soutenu l’exploitation impériale, depuis les esclaves des comptoirs sénégalais et des îles à sucre jusqu’à la prédation des hydrocarbures du Gabon, les contempler se repeindre aujourd’hui en antiimpérialistes sur le seul fondement de leur hostilité passée à l’encontre de la colonisation de peuplement et à l’administration directe républicaine n’est rien moins que sordide. Ils réussissent pourtant, par une habile triangulation, à faire passer leur racisme, leur conservatisme et leur ethnocentrisme pour de la tolérance et du respect des particularismes. Il suffit pour cela que l’ordre traditionnel local soit plus despotique et oppressif que celui du capitalisme libéral européen pour trouver grâce à leurs yeux, surtout si, du même coup, il garantit la passivité des non-Européens face à leur exploitation.
Au crédit des mots de Bolloré, il faut souligner que ce courant a comme principale incarnation et modèle fondateur le maréchal Lyautey, celui qui, justement, fit du régime marocain « descendant du Prophète », le laboratoire et le modèle du programme idéologique indigéniste. Les réactionnaires ont beau jeu de reprocher aux républicains d’être prométhéens, alors qu’ils ont alors eux-mêmes reporté sur le petit sultanat marocain magnifiquement archaïque tous leurs fantasmes rétrogrades et leurs idéaux autoritaires, imaginant et façonnant, en puérils démiurges, un régime médiéval, romantique et féodal. Ce « chérif couronné » s’y entoure des grands princes des confédérations tribales, chambre des pairs représentant la noblesse des chérifiens, des chefs de tribus et autres élites confrériques (toutes aussi foncièrement capitalistes) : en tous cas ceux qui, issus des élites traditionnelles, accepteront d’obéir en tout et pour tout à l’ordre impérial, au Makhzen renforcé et centralisé, et à son institution religieuse uniformisée et assujettie.
En revanche, l’écrasante majorité du peuple ne compte dans ce modèle que comme arrière plan muet, dégâts collatéraux des trente années de conquête du territoire, chair à canon de la guerre mondiale et acteurs folkloriques d’une tburida (« fantasia ») déchargée de son hostilité. Pour le reste, maniant ses figurines politiques, le Résident général est là pour « interpréter » les volontés du souverain qui trône sans se mouvoir, comme une reine des fourmis, et s’assurer de leur exécution dans ces mêmes principautés tribales rétives aux grands princes qu’il investit de cette noble sacralité imaginaire. Incidemment, on ne s’étonnera guère que les fondamentaux démocratiques des régimes d’assemblée tribale des montagnes et des oasis du pays sība (infra), tout aussi traditionnels et anciens, et probablement davantage que la monarchie, n’aient retenu ni l’attention ni l’intérêt du parti du despotisme indigène.
Ainsi, en 1912, le dernier sultan Moulay Hafid, arrivé au pouvoir en 1908 à Fès au profit d’une révolution anti-chrétienne, avant que sa dynastie ne fût sauvé in extremis à Marrakech par l’armée française d’une autre famille chérifienne, est destitué par les mêmes Français. Son frère Moulay Youssef est désigné sultan, d’autorité, par le maréchal Lyautey. Il est immédiatement transporté et installé à Rabat sous protection militaire française. Dès lors, ce « sultan des chrétiens (nṣārā) » devient l’ennemi principal, pendant 22 ans, des peuples du « Pays sība ». Selon le lexique monarchiste des deux rives, le concept désigne les terres « dissidentes » ou « licencieuses » à l’égard du Makhzen. En revanche, selon le prisme des démocrates au premier rang desquels Charles de Foucauld qui leur avait consacré de longues pages durant les années 1880, il s’agit tout bonnement d’un pays « libre » ou « indépendant ».
Depuis les cèdres de Chefchaouen jusqu’aux palmeraies de l’Adrar, et des montagnes à arganiers du Sous jusqu’aux plaines arides de la Moulouya, ils affrontent du même coup les troupes françaises du proconsulat lyautéen et les auxiliaires du Makhzen: goumiers, spahis et mokhaznis. Devant cette scène hallucinante, les citadins, pétrifiés et interdits, se sont soumis d’instinct à l’Empire français : ils gardent un silence gêné devant la résistance héroïque de ceux dont ils ont toujours craint la liberté.
En 1927, du Rif d’al-Khattabi à l’Anti-Atlas des ‘Attâ et au désert des Rguibat, en passant par le Moyen-Atlas des Haddidou, des milliers de Marocains libres – ou dissidents, selon le bord – continuent de résister aux légionnaires franco-marocains. Et, tandis que le sība se disloque, ce moment exotique alimente les chroniques journalistiques parisiennes, et stimule jusqu’à l’enthousiasme anti-impérialiste socialiste en Europe. Cette année là, un certain Sidi Mohammed, un des fils de Moulay Youssef est désigné, à nouveau par le Résident du protectorat, pour devenir le second « sultan des Français ».
De leur côté, dès le retour au pouvoir de la Gauche entre 1924 et 1927, la IIIe République avait petit à petit tâché de reprendre en main le proconsulat monarchiste de Lyautey. De 1924 à 1932, quelles que soient les coalitions, les républicains de Gauche Herriot et Briand se succèdent aux postes de ministre des Affaires étrangères et, ce faisant, contrôlent la Résidence marocaine. Le cartel, notamment sous pression de la SFIO, tente d’équilibrer le rapport de force avec l’empire des féodaux de France et du Maroc. Ainsi, en 1930, avant même que la guerre de conquête du sība ne soit achevée, dans l’espoir de « pacifier » la résistance au Makhzen des Français, sans plus massacrer, le Résident général des républicains propose aux peuples « indépendants » une paix des braves : un décret du sultan leur garantira leur autonomie législative et judiciaire traditionnelle contre toute irruption des préfets (qāyid) et juges (qāḍī) citadins et makhzéniens. En pratique, il leur est offerte la possibilité de s’auto-administrer, et de se pourvoir en appel ou au criminel devant les tribunaux républicains. Étrangement, cet indirect rule-ci, ce respect de l’ordre traditionnel là, n’est jamais vanté ni proclamé par nos indigénistes romantiques, monarchistes et prétendument anticolonialistes, de France comme du Maroc.
Le décret fut tout d’abord servilement signé par le sultan des Français. Cependant, il suscita une contestation qui, au bout du compte, permit à se dernier de renforcer son autorité, et de se parer d’une vertu nationaliste aux accents modernes. En effet, tandis que les citadins de la première génération avaient contemplé l’extermination de tous les ‘arûbi-s et shluh-s ruraux qu’ils avaient craint pendant de si longs siècles. Le pouvoir des citadins, des jurisconsultes, du makhzen s’étendait au détriment de ceux qui avaient levé l’étendard du jihad. Le paradoxe d’alors comme d’aujourd’hui, c’est que le sība était combattu comme rebelle au pouvoir califal. Ce faisant, quiconque parmi les bourgeois et les savants des villes aurait tenté de faire violence à ses affects socio-culturels et à ses intérêts institutionnels et économiques pour soutenir le jihad du sība eût été condamné comme bandit et hérétique, bien avant d’être anti-français.
Malgré tout, petit à petit, quelques jeunes activistes avaient commencé à intégrer des éléments idéologiques et rhétoriques modernes et à les investir d’un sens nationaliste panislamique et panarabiste – au grand dam du lobby indigéniste réactionnaire, disons-le. Toutefois, c’est au décret appelé – a posteriori et de manière erronée et abusive – le « décret berbère » de 1930 que la jeune génération bourgeoise des cités crut pouvoir résoudre la dissonance qui les étreignait. Émus de ce que cette réforme semblait être à la fois anti-arabe et anti-islamique, ils s’y opposèrent au nom de la continuité du droit musulman, en arabe, comme facteur corrélé de l’unité du Maghrib.
Ce faisant, ils rendirent service aux monarchistes des deux rives qui combattaient, au Maroc comme en France, cette politique de la Gauche républicaine au pouvoir. Car celle-ci privait les uns d’une autorité, indue, sur le pays dissident, et diffusait pour les autres le risque de l’anarchie tribale et de l’irruption du droit républicain dans la quiétude de leur petit protectorat indigène. En somme, ce mouvement nationaliste pionnier permit paradoxalement au roitelet des Français d’imposer son despotisme aux pays anciennement indépendants, et de renvoyer dans les cordes le projet de pacification non-monarchique de la Gauche. Tandis que le palais royal gagna en plus au retrait du décret lié à l'alternance de droite , l’onction du panarabisme et du panislamisme, ses patrons réactionnaires français y consolidèrent leur régime archaïsant du « chérif couronné » comme unique représentant autoritaire de l’ensemble de l’indigénat musulman. Se croyant victorieux, les jeunes insurgés permirent en fait au makhzen d’imposer ses juges et ses caïds au pays sība, ils fondèrent alors les deux piliers arabe et islamique binaires d’une identité nationale uniformisatrice et unilatéralement hiérarchique ; celle-là même dont, justement, le monarchisme féodal lyautéen avait établi les fondations.
Cette alliance de fait entre la réaction française, le makhzen et l’indépendantisme bourgeois marocain offre au jeune sultan Mohammed la possibilité de jouer sur les deux tableaux dans le but exclusif de grapiller de plus en plus de « pouvoir » – ce dont la presse américaine se fait l’écho. Le sultan s’appuie sur l’essor des revendications arabistes et islamiques urbaines qui n’osent faire sans le « commandeur des croyants », tout en obtenant du même coup la sympathie et le soutien de la droite monarchiste française. Ces derniers cherchent en effet toujours à privilégier le despote d’un territoire, afin de s’y assurer une « stabilité » en contrepartie de quelques pouvoirs de prestige ou de contention à l’encontre de ses sujets. Pour le parti indigéniste d’hier comme d’aujourd’hui, le maître mot est la consolidation des hiérarchies indigènes, afin d’éviter la contagion des idées libérales et subversives.
Il est donc tout à fait normal que Bolloré, leader économique du parti réactionnaire français au XXIe siècle, se juche ainsi sur cette posture d’amoureux de la « commanderie des croyants ». Il ne fait que payer son tribut d’incantation au projet de califat maghrébin de Lyautey, et des réactionnaires, monarchistes et indigénistes. Il ne fait que réitérer (deux fois) l’intérêt de faire croire aux indigènes à la superstition attachée au sang « des descendants du Prophète ». Ce n’est bien sûr ni l’Islam ni les musulmans à qui il attache cette vénération de pacotille, c’est seulement l’ordre traditionnel, irrationnel et irréfutable : c’est la soumission de l’indigène à son despote qu’il vénère. Cet ordre maintient les musulmans à leur place dans l’ordre international, il évite qu’ils ne contestent le capitalisme européen mondialisé du magnat africain. Et accessoirement, ce régime leur interdit, au terme de leur immigration, de devenir français ou de réclamer les droits civiques qu’il avait fallu manœuvrer astucieusement pour leur interdire au temps des colonies. Les réactionnaires tentent de limiter la diffusion de ces mêmes droits universels que, selon eux, « la gueuse » avait déjà ignominieusement dilapidé en l’accordant aux villains de France. C’est cet aspect de la chose traditionnelle pour qui Bolloré a de « la proximité », celui de la grande mosquée de Paris et des ministères des cultes étatiques.
Or, par un concours de circonstance autant que par une volonté propre assez ferme, puis dans un second temps par la malice et à l’habileté de « son fils qui était là », Moulay Hassan, Mohammed Ben Youssef réussit alors, en l’espace de vingt ans, à se muer du « sultan des Français » en figure du mouvement indépendantiste. Et c’est tant ce processus que l’échec final de la Gauche républicaine d’une part et des indépendantistes progressistes d’autre part, entre 1958 et 1960, qui explique la réconciliation et la concrétion des deux partis aristocratiques, colonial et indigène, dont se réclame Bolloré, à la fin des années 1950.
C’est en ce sens que « votre pays », c’est-à-dire la république laïque en France, serait venu perturber « son ami », le despotisme chérifien du makhzen au Maroc en renvoyant Mohammed Ben Youssef en aout 1953. Malheureusement pour ce schéma, la destitution du « commandeur des croyants » et « descendant du Prophète » n’a rien à voir avec une volonté de la Gauche républicaine. En fait, la décision de son exil et de son remplacement par son cousin Ben Arafa provient essentiellement de la crispation des milieux militaires et de la droite. En l’occurrence, il s’agit du général Guillaume, issu justement du milieu lyautéiste favorable à l’indirect rule, sous l’autorité à Paris de la coalition la plus à droite qu’ait connue la IVe république.
Ainsi, leur positionnement indigéniste prétendument anticolonialiste ne présuppose aucun respect pour la souveraineté ou la légalité. Bien au contraire, cela correspond parfaitement à leur conception paternaliste et surplombante : si le chérif couronné cesse de servir, ou pire, qu’il morde la main qui le nourrit (infra), alors il suffira d’en changer, via la même cour de notables constituée par les mêmes monarchistes. Dans ces conditions, l’indigénisme ne confère aucune clairvoyance politique, et n’a pas prémuni le parti réactionnaire de décisions inconsidérées. En effet, cette droite militariste se montre incapable d’anticiper comment les nationalistes bourgeois allaient pouvoir retourner leur propre propagande monarchiste, celle du protectorat, contre ce dernier, et susciter une révolte nationaliste anticoloniale. Persuadés qu’il était aussi facile de renvoyer cette marionnette que d’avoir nommé son père quarante ans plus tôt, ces décideurs ne perçoivent pas que leur makhzen a pu capitaliser, outre du fait que leur armée coloniale écrasait le sība du Maroc qui combattait ses troupes autant que celles de la France, de l’autorité et de l’idéologie nationaliste et monarchiste qu’ils lui avaient eux-mêmes fourni sur un plateau. En effet, cela n’avait cessé de se renforcer depuis l’alternance de droite de 1933 (gouvernements de Pierre Laval, tristement célèbre après 1940), celle-là même qui avait décidé le retrait du "décret berbère, et surtout avec le retour des résidents issus des armées monarchistes et centralisatrices de Lyautey (pétainistes de 1936 à 1943, puis gaullistes de 1947 à 1954).
Le récit réactionnaire peut bien prétendre avoir refusé l’idée de la mission civilisatrice (parce qu’ils préféraient les hiérarchies médiévales locales) et rejeté la colonisation (parce qu’ils méprisaient les colons). D’une part, c’est bien au contraire parce que leur France s’arrangeait au mieux de monarques croupions qu’ils ne pensaient pas que le régime du protectorat n’ait jamais à cesser. Et d’autre part, depuis les années 1930, cette droite indigéniste avait fini par fusionner avec les groupes de défenses des intérêts coloniaux. Elle était désormais tout à fait en phase avec une nouvelle forme de droite populiste, défendant les privilèges de la caste des colons européens, avec les conséquences que l’on sait en Algérie.
La droite peut bien essayer de conspuer à tort ces fichus républicains, responsables d’avoir permis à cette troisième génération de citadins, parfois même d’origine rurale, de s’éduquer dans des filières francophones et modernes, et d’avoir produit ce groupe féru d’idéaux révolutionnaires, progressistes, égalitaires voire socialistes. Ils dépassèrent même un temps le lobby des élites intellectuelles bourgeoises et conservatrices, en dirigeant notamment le Parti de l’Indépendance (Istiqlāl). Pour autant, c’est bien la propagande des monarchistes qu’ils ont cru utile de manipuler : ils activèrent le sentiment national-identitaire façonné par les Lyautéites autour du culte du calife, « chérif couronné », sultan bien aimé de l’islam et des musulmans ; celui que, déjà, on acclame comme « roi » dans les manifestations de 1955 – empruntant aux monarchistes européens ce terme archaïque et totalisant que l’Islam avait aboli pour le remplacer par sultan : le « détenteur de la force publique ». Les indépendantistes marocains, y compris les plus progressistes, croient leur tactique nécessaire par populisme, alors qu’ils pavent en fait la route à cette même stratégie monarchiste de long terme. Ils ne le comprendront que bien tard, trop tard, lorsqu’ils seront renversés en 1960.
En attendant la fermeture de cette parenthèse, à l’inverse de ce que susurre Bolloré, ce sera à la Gauche républicaine de tenter de réparer les dégâts de la destitution causée par la Droite militaire. Un nouveau résident, civil, est envoyé au Maroc dès 1954, prélude de quelques jours à la formation de la coalition de Mendès France. Pour éteindre l’incendie, il doit, comme en Indochine, lancer le processus d’indépendance. Et tout cela est si vrai que ce n’est pas en 1953 ou 1954 que les aïeuls Bolloré sont sensés avoir invité « Mohammed V », par courage politique contre « votre pays ». Leur détestation de l’État républicain et laïc, des idéaux universalistes et démocratiques, n’aura pas non plus suffi à leur insuffler ce genre de courage contre le gouvernement Mendès-France de 1954 et 1955. En fait, en ce début novembre 1955, si l’on en croit cette mémoire fantasmée, la famille Bolloré n’accueillit celle du sultan Mohammed Ben Youssef que lorsqu’il « revint en France »France, c’est-à-dire vers la France. Ce dernier lapsus, celui-là inconscient et d’autant plus révélateur, rappelle clairement le lieu de rattachement de la dynastie. Il n’aurait jamais été question que de son transit en région parisienne de deux jours, uniquement pour signer les accords de Celle-Saint-Cloud. Il ne se serait guère agit que de le loger à 4 km du château où il était invité par « votre pays » ! Et cela aurait tout au plus duré deux à trois nuits.
Même dans ce référentiel grotesque et archaïque – s’il n’est pas complètement imaginaire – il n’y a là rien de l’héroïsme chevaleresque d’un Lyautey contre « votre pays ». Il y a seulement un opportunisme : offrir son appui, tout à la fois à l’État (en contexte républicain) et à celui qui allait reprendre les rênes du Maroc, et les clefs du coffre (infra). En effet, au terme d’une très courte parenthèse, l’alliance des réactionnaires des deux rives se reconstituera à travers l’intrication du renversement de la IVe république par De Gaulle en 1958, et du renversement du gouvernement non-monarchiste au Maroc par Moulay al-Hassan le 20 mai 1960. En d’autres termes, un même processus unit en même temps la dissolution du gouvernement social-démocrate à Paris, et l’effondrement de la parenthèse national-progressiste de l’Istiqlal à Rabat.
Car, ce dont parle Bolloré dans ce petit laïus, c’est du fait que le bon musulman est celui qui obéit sagement à son calife restauré, qui se conforme à la projection imaginaire de ce romantisme surplombant, qu’il obéisse bien sagement à son héritier, son ami Hassan II, avec qui il partage le même mépris et la même crainte de la populace maghrébine. Il faut que le musulman obéisse à son monarque absolu en raison de sa sacralité – peu importe que celle-ci soit hétérodoxe, parce qu’elle conforte l’ordre international qui permet à la France de commander, et au capital de Bolloré de prospérer. De concert avec la préoccupation principale de Hassan II, le musulman doit s’astreindre à ne jamais chercher résidence et encore moins naturalisation ou mariage mixte au pays des droits civiques : qu’il reste en somme un étranger, et donc un indigène. Ainsi devra-t-il se contenter de défendre l’islam, celui qui assure la mainmise des élites traditionnelles et du néo-makhzen en train de se réinstaller, et qu’il ne demande rien d’autre que d’obéir en souriant, en Afrique comme en Europe.
Finalement, ce que dénonce subrepticement Bolloré dans ce petit lapsus contrôlé, c’est l’inoculation républicaine des prétentions universalistes et révolutionnaires qui, de Messali Hadj à Ben Barka, ont fait le lit du camp islamo-progressiste, et de là seraient, selon cette réaction en passe de reconquérir l’hégémonie intellectuelle et médiatique, à catégoriser dans l’islamo-gauchisme. Il réunit dans « votre pays », pêle-mêle, tout ce qui releverait d’une manipulation des républicains et démocrates pour utiliser les masses indigènes contre la hiérarchie et l’ordre mondial, capitaliste… et chrétien. Dès lors, le subterfuge consiste à se prétendre islamophile, même dans ce sens autoritaire et paternaliste, pour se donner le droit de « parler des autres religions » (plutôt que de « parler avec les autres religions ») pour s’assurer, si l’islam est marocain, que l’Europe soit catholique, et que le catholicisme conserve la position dominante.
Et du même coup, tout intriqué là dedans, ce que rappelle Bolloré c’est que sa famille s’est empressée d’accueillir le sultan… une fois que celui-ci était assuré de remonter sur le trône, c’est-à-dire qu’il reprenait sa place d’agent de la France : ce pourquoi il y « revenait ». Cet admirable courage politique au service de la cause monarchiste n’est rien de plus qu’un éclaircissement : ce qui comptait alors, et compte encore, c’est simplement que l’empire africain de Bolloré s’appuie sur la collaboration des milieux d’affaires coloniaux et du néo-makhzen.
Et pour cause, la politique constante du protectorat, monarchistes et républicains, avait été d’associer leurs créatures, Moulay Youssef puis son fils Mohammed, en leur donnant des parts dans les entreprises coloniales le plus importantes, en intéressant leur compte personnel au détriment de la balance commerciale de la caisse publique. Ce fonds d’actions « Copropar » est devenu, sous la férule de « son fils qui était là » Hassan II, puis sous l’affairisme décomplexé « du fils de son fils », le fondement du rachat de la plus grosse entreprise coloniale, l’ONA. Celle-ci est devenue la base de l’empire économique qui contrôle aujourd’hui 1/3 des activités du royaume, et la majorité des investissements étrangers de bon nombre de pays d’Afrique francophone, où prospère aussi le groupe Bolloré. La famille avait donc accueilli le « sultan des français », rebelle rapidement restauré, et surtout son fils, comme futur associé dans ses affaires coloniales. De fait, le Maroc et notamment l’entreprise royale sont devenus les deux importants relais d’investissement vers l’Afrique subsaharienne où l’empire familial Bolloré se développe en parfaite harmonie avec l’empire familial alaouite.
C’est à ce sujet que ces deux princes africains, produits du même ordre capitaliste impérial, de la même monarchie réactionnaire, sont « restés amis » et « proches » : c’est cet islam là que vante Bolloré d’une main, pour pouvoir de l’autre vilipender les prolétaires immigrés, ceux qui auraient le tort de ne pas rester à leur place d’étranger en France, ou de ne pas rester se courber devant leur chérif couronné.

