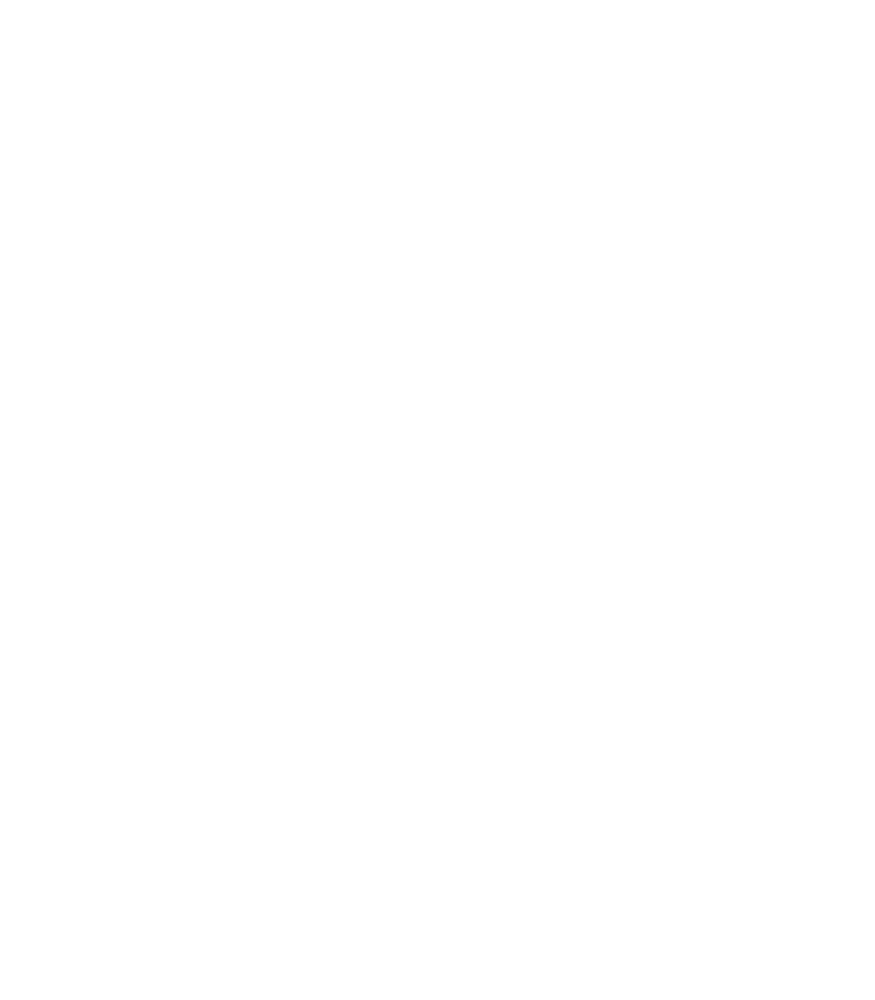
Dia al-Azzawi, Ishtar My Love, 1965
Persistante nostalgie arabe
Hamza Esmili
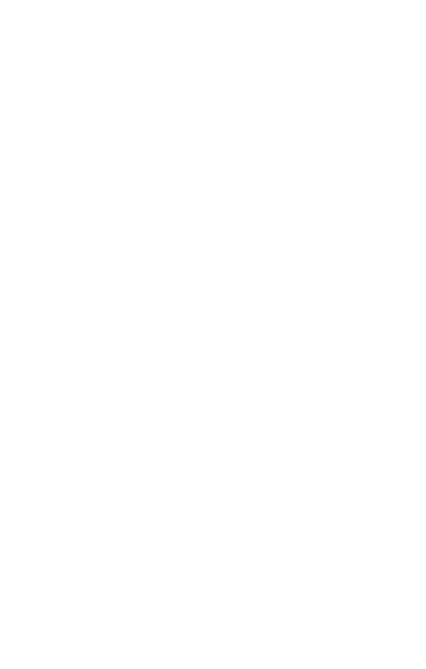
« Je suis l’Iraq. Ma langue est son cœur et mon sang est son Euphrate. Mon être en est un fragment[1] » déclame le poète. Ces vers auraient pu être dédiés à Feurat Alani, prénommé en hommage à l’illustre fleuve et auteur d’un remarquable premier roman intitulé Je me souviens de Falloujah.
Accompagné du dessinateur Léonard Cohen, Feurat Alani avait déjà signé une magnifique série animée diffusée par Arte – laquelle faisait récit d’une enfance entre l’Iraq de ses parents et la France où il est né. À bien des égards, Je me souviens de Falloujah prend la suite de cette première œuvre. L’auteur y reconstitue le corps-à-corps entre le silence d’un père et la volonté de savoir de son fils. Ce donné sociohistorique – ces pères qui ne parlent pas – est abondamment décrit parmi les œuvres littéraires ou cinématographiques que produisent les enfants de l’immigration postcoloniale en France. La singularité de Feurat Alani est pourtant de ne pas appartenir au sens strict à cette dernière. Comme son double dans le roman, qui porte le même prénom – quoique latinisé sous la forme d’Euphrate –, l’auteur est issu d’une famille d’exilés iraqiens. À l’inverse de ses camarades maghrébins de destin – tout du moins celui de la cité et de la condition collective qui s’y élabore –, Feurat-Euphrate n’est guère lié à la France par l’histoire longue de la colonisation et de ses réminiscences contemporaines. L’expérience du déclassement et du mépris n’en est cependant pas atténuée : Euphrate endure tôt l’épreuve du racisme imbécile, comme ce jour où un vendeur de jeux vidéo se moque de l’accent de sa mère, ce qui conduit en retour à la solidarité instinctive de Kader – camarade de classe d’origine marocaine qui assiste à la scène.
Mais le silence de Rami – le père d’Euphrate – ne tient pas seulement à la violence du déracinement migratoire et des contradictions postcoloniales qu’il met au jour[2]. Il est d’abord fondé par la destruction effective de l'Iraq et du monde d’aspirations qui s'y étaient logées. Cette expérience spécifique produit un autre écart indicible, qui sépare cette fois Euphrate de ses camarades Arabes de France. Au lendemain de la première guerre du Golfe, le même Kader qui avait témoigné son soutien à Euphrate face à la violence raciste lui dit nonchalamment que « les Américains, ils vous ont bien niqué ».
D’un silence l’autre
La tragédie, qui n’a guère commencé avec l’invasion américaine de 1991, est relatée par le jeu de miroirs auquel s’adonnent le père et son fils. En 2019, Rami perd la mémoire à la suite d’une grave maladie ; dans la chambre 219 de la clinique Bizet à Paris, l’amnésie ne tolère qu’Euphrate comme interlocuteur. Le père ne se souvient plus que de son enfance à Falloujah, qu’il raconte dès lors pour la première fois à son fils après des décennies de silence obstiné. Comme contrepartie, il revient à Euphrate de faire récit à Rami de son existence en France. En filigrane, le fils doit également répondre à la lancinante question qui hante le père au seuil de sa disparition : a-t-il réussi sa vie ?
Rami a fui l’Iraq peu de temps après la prise de pouvoir du Baath et la mise en place de son système de répression aussi paranoïaque que généralisée. Arrivé à Paris, il y épouse une touriste iraqienne de passage – union dont naissent Euphrate et sa petite sœur Arwa. En France, Rami devient vendeur de cartes postales à la sauvette sur le parvis de Notre-Dame. Il y découvre le monde social que composent la précarité existentielle et les incessantes courses-poursuites avec la police.
La famille s’installe à la malnommée cité des Tilleuls, où l’expérience historique d’une immigration méprisée par la société d’accueil et celle attenante de la marginalité urbaine dispensent solidairement leurs effets[3]. Euphrate se souvient ainsi des années héroïne, lorsque les enfants jouaient dans le bac à sable jonché de seringues usagées. La désaffiliation parmi les enfants de l’immigration donne au fils sa première rencontre avec la mort – sous la forme funeste de la vision d’un plus âgé au corps parsemé de tâches bleues. Mais l’heure est également aux solidarités de quartier – aussi riches qu’aliénantes. Euphrate, Kader et un troisième comparse veulent venger la grave agression subie par l’un de leurs amis. Sitôt formulé, le projet de représailles achoppe néanmoins sur l’inexpérience des apprentis justiciers, lesquels attirent l’attention de la police dès les préparatifs de l’expédition punitive. Il en résulte une nuit en garde à vue pour Euphrate.
À mesure que l’expérience de la cité s’approfondit, l’écart entre le père et son fils se fait symétriquement plus béant. Le mutisme du premier n’en devient que plus insupportable pour le second. Euphrate découvre une valise cachée au fond d’une armoire. L’explication attendue ne viendra pas – à l’exception très relative d’une liste de noms griffonnés sur la feuille blanche que le père offre à son fils en guise de récit familial.
Le fleuve des souvenirs
Le silence de Rami est néanmoins partiellement mis en échec par les soubresauts de l’Histoire. En 1989, une courte accalmie interrompt provisoirement la guerre sans fin dans laquelle est happée la société iraqienne. Le lien avec la famille demeurée au pays est rétabli. Pour la première fois, Euphrate, Arwa et leur mère prennent ainsi l’avion pour Bagdad. Seul Rami refuse le voyage.
Entre l’enfant d’immigrés et les siens en Iraq, les retrouvailles paraissent d’abord être la rencontre entre qui a eu accès à l’Europe – ou au premier monde, selon un vocable heureusement désuet – et ceux qui lui demeurent étrangers. Arrivé à Bagdad et confronté à la modernité triomphante de l’État du Baath, Euphrate comprend qu’il est pauvre en France. Quelques semaines plus tard, il se rend néanmoins compte qu’il est le seul parmi les enfants de son âge à ne pas jouer pieds-nus.
En allant à Falloujah, Euphrate est cependant pris à son tour dans la réalité interne à la société iraqienne. À la suite de la prise de pouvoir de Saddam Hussein, la ville d’origine de Rami est devenue un fief d’officiers baathistes. Quoique le silence demeure – son père l’avait prévenu, l’Iraq est fait de murmures –, le récit de la brutalisation de la société iraqienne s’esquisse au fil des ombres projetées. En Iraq comme ailleurs, la tragédie historique est inextricablement enchevêtrée dans le drame intime[4]. Samiya, la belle-mère persécutrice du père d’Euphrate, a souffert de la violence coloniale britannique. Fille des marges rurales de l’Ouest iraqien, elle transfère sur Rami le lourd ressentiment qu’elle conçoit à l’encontre des élites citadines – conflit social que redouble une différenciation culturelle et religieuse de plus en plus marquée. Cette trame historique khaldounienne opère dès lors comme l’arrière-plan indicible du roman : la prise de pouvoir de Saddam Hussein – et de la cohorte d’officiers qui l’accompagnent – remet sur le devant de la scène politique un groupe social longtemps méprisé.
La marginalité est cependant toujours relative. Rami – orphelin de mère et mal-aimé par celle qui lui succède au sein du foyer familial – se lie ainsi à Hatem. Quoique enfant de la ville, celui-ci est le fils moqué d’un éleveur de buffles bidoune – c’est-à-dire dépourvu de la citoyenneté iraqienne et des droits qui l’accompagnent. Nulle extériorité n’est à l’œuvre ; les bidoune sont simplement le reliquat d’un procès de nationalisation contraint par l’occupant britannique et demeuré inachevé. L’Euphrate scelle l’amitié de Rami l’orphelin et de Hatem le bidoune – deux parmi les réprouvés de l’Iraq moderne. À Falloujah, les enfants s’essayent à dompter le fleuve illustre en y plongeant pour enterrer une pastèque dans son sol boueux. Le rite d’initiation lors duquel Rami aurait perdu la vie sans la diligence de Hatem annonce un lien indéfectible qui les mène – près d’une décennie plus tard – à militer ensemble à l’ombre de la révolution de 1958.
Étudiants à Bagdad, les deux amis s’engagent ainsi pleinement dans la construction d’un rêve de socialisme arabe. L’heure est pourtant à la lutte postrévolutionnaire que se livrent marxistes et nationalistes. La victoire des seconds – d’abord sous la forme du coup d’État de 1963 qui voit l’assassinat de la figure révolutionnaire d’Abd al-Karim Qasim par le Baath[5] – puis lors de la prise de pouvoir – progressive mais in fine totale – de Saddam Hussein lors des années suivantes signifie pour Rami l’épreuve de la prison et de la torture. L’expérience du palais de la fin – cousin d’une autre prison baathiste, celle de Saednaya en Syrie dont il est dit de qui y entre qu’il est perdu et de qui en sort qu’il est né à nouveau – mène le père d’Euphrate à l’exil et au silence dont il fait vœu pour le restant de sa vie.
Mais Rami ne peut se résoudre à la destruction programmée et retransmise sur télévision globale de son pays. L’invasion de 1991, l’embargo qui la suit et le cynisme du programme onusien pétrole contre nourriture, les mensonges de Bush et la seconde agression américaine de 2003, puis la guerre civile dans laquelle s’abîme définitivement la société iraqienne sont autant de coups portés au corps du père.
Rami meurt en France, sans que la blessure ne soit jamais refermée. Son fils jure fidélité au fleuve des souvenirs. Malgré la somme des petites et grandes violences, il se découvre tout au long du récit d’Euphrate-Feurat une persistante nostalgie arabe, qui établit de facto l’auteur en exact inverse de l’Arabe du futur que tous appellent de leurs vœux. La nostalgie ne se découvre pourtant pas en-dehors du drame ; c’est en son cœur que parfums et souvenirs tourbillonnent. Peut-être est-ce cette même nostalgie arabe qui conduit une talentueuse réalisatrice libanaise à constater que, au seuil de leur disparition, nos pères ressemblent tous à Nasser[6] – c’est-à-dire à leurs rêves perdus.
L’Euphrate comme fil d'une histoire collective qui persiste malgré tout est peut-être aussi celui auquel se raccrochaient les révolutionnaires de 2019. Ceux-ci étaient issus d’une génération née après le Baath et durant l’occupation américaine puis iranienne, comme un éternel recommencement. Ils disaient :
Notre pays,
Nous vivons par tes bienfaits,
Nous ne sommes d'aucun autre que toi,
Nous appartenons à cette vie,
Nous appartenons au Tigre et à l'Euphrate,
Nous ne sommes d'aucun autre que toi.
Aujourd'hui le peuple en paix appelle,
Hurlant à la face du plomb et donnant notre sang,
Nous sortons avec tout ce que nous avons.
Notre pays,
Nous te devons tout ce que nous sommes,
Nous ne sommes d'aucun autre que toi.
[1] أنــا العِـراقُ، لسانـي قلبــهُ، ودمي فراتُـــهُ، وكياني منهُ، أشطــارُ Il s’agit du grand poète iraqien Mohammed Mahdi al-Jawahiri (1897-1992).
[2] Abdelmalek Sayad, « Immigration et “pensée d'État” », Actes de la recherche en sciences sociales, nº 129, 1999, p. 5-14.
[3] La période est aussi celle des assassinats racistes. En 1993, Hassan Laaraj de la cité des Tilleuls meurt ainsi égorgé par deux Français de souche qui ne seront jamais punis. URL : https://www.humanite.fr/la-justice-en-panne-un-apres-la-mort-de-hassan-80415
[4] Le récit des violences intimes et de leur conversion politique sous la forme d’un régime totalitaire fait immanquablement penser au film The White Ribbon de Michael Haneke.
[5] Qasim, figure d’un socialisme arabe en cours de gestation, a fait l’objet d’une tentative d’assassinat par le Baath dès 1959, par la main de Saddam Hussein lui-même, lequel n'était alors qu'un jeune officier nationaliste et ambitieux.
[6] Farah Kassem, My father looks like Abdel Nasser, URL : https://www.youtube.com/watch?v=reDH-EwtvuE
[2] Abdelmalek Sayad, « Immigration et “pensée d'État” », Actes de la recherche en sciences sociales, nº 129, 1999, p. 5-14.
[3] La période est aussi celle des assassinats racistes. En 1993, Hassan Laaraj de la cité des Tilleuls meurt ainsi égorgé par deux Français de souche qui ne seront jamais punis. URL : https://www.humanite.fr/la-justice-en-panne-un-apres-la-mort-de-hassan-80415
[4] Le récit des violences intimes et de leur conversion politique sous la forme d’un régime totalitaire fait immanquablement penser au film The White Ribbon de Michael Haneke.
[5] Qasim, figure d’un socialisme arabe en cours de gestation, a fait l’objet d’une tentative d’assassinat par le Baath dès 1959, par la main de Saddam Hussein lui-même, lequel n'était alors qu'un jeune officier nationaliste et ambitieux.
[6] Farah Kassem, My father looks like Abdel Nasser, URL : https://www.youtube.com/watch?v=reDH-EwtvuE

