Nader Andrawos
L'ombre portée du débat entre Edward Saïd et Michael Walzer
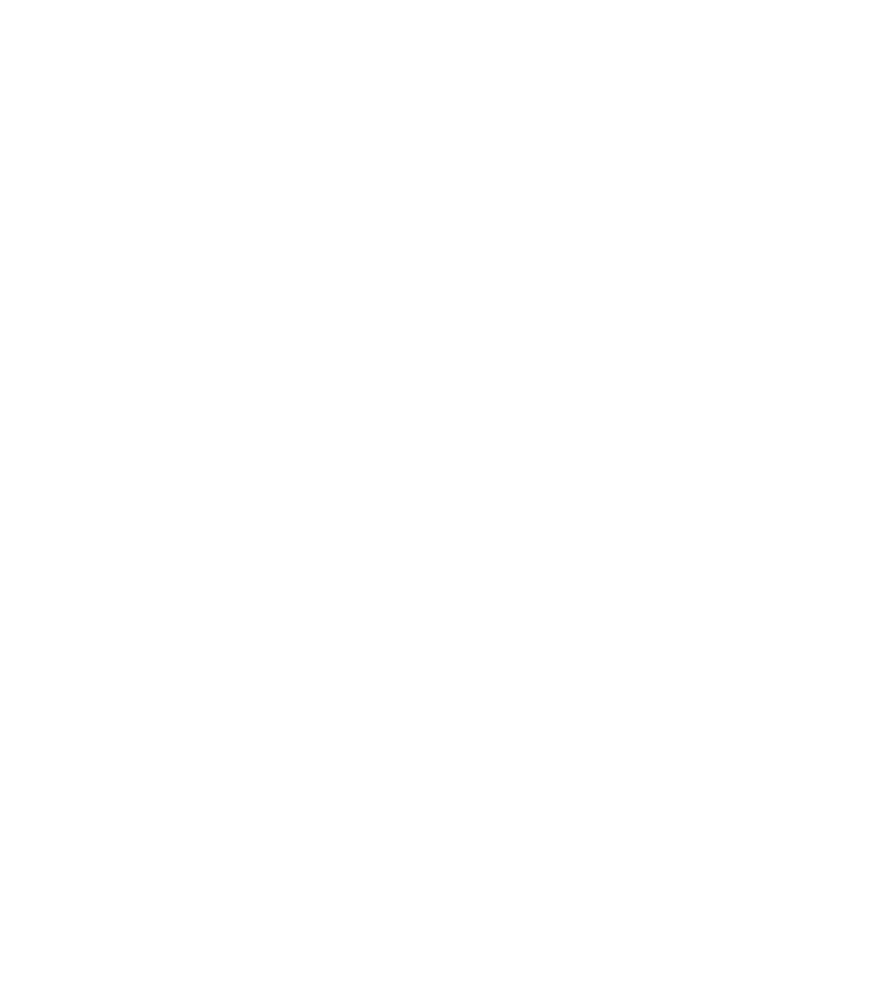
Desert Interpretation, Dia al-Azzawi
Ce texte a d'abord été publié en anglais dans New Lines Magazine.
Il existe un écart béant entre l'image publique d’Edward Said et la façon dont lui-même se percevait. Cela se comprend aisément. Son nom est associé à plusieurs des grandes controverses intellectuelles et politiques de notre époque — la Palestine, l’orientalisme, la théorie postcoloniale, les politiques identitaires. On se souvient de Said pour ses innombrables prises de position, engagements et alliances : porte-parole de la cause palestinienne, promoteur d’une critique littéraire qualifiée de « postmoderne », amoureux de la culture bourgeoise et humaniste occidentale la plus distinguée, militant révolutionnaire et héritier de Frantz Fanon. Certains de ces visages sont en tension les uns avec les autres, si bien qu'on les a souvent traités comme autant de facettes distinctes de sa vie et de son œuvre. Pourtant, s’il y avait un fil conducteur connectant ces dimensions multiples, une méthode constante dans l’œuvre de Said, ce serait ce qu’il appelait lui-même la « critique séculière ».
On comprend le mieux ce que Said entendait par « critique séculière » en revenant sur sa confrontation intellectuelle avec le philosophe politique Michael Walzer. Leur dialogue critique a été déclenché par le livre de Walzer Exodus and Revolution (1985). Examiner cette controverse spécifique a deux avantages : d’une part, bien qu’il semble porter sur un sujet ésotérique — l’Ancien Testament —, il concerne en réalité des thèmes bien plus larges : les révolutions du Tiers-Monde, la sociologie des intellectuels, le devenir de la gauche, ainsi que les méthodes d’interprétation au sein de ces thématiques. D’autre part, ce débat entre deux intellectuels influents touche à une question encore brûlante aujourd’hui. Walzer était l’un des principaux représentants du sionisme libéral, courant aux prises aujourd’hui avec crise existentielle la plus sérieuse de son histoire. Revisiter ce débat entre Said et Walzer permet de reconsidérer le sort du sionisme libéral à la lumière de ses thèses et incarnations passées. Rétrospectivement, la posture de Walzer semble bien moins « libérale » — encore moins « séculière », « universaliste » ou « humaniste » — que ce que sa réputation laisse croire, tandis que Said apparaît fidèle à ses engagements séculiers et internationalistes.
Le 21 septembre 2024, Walzer publia une tribune dans le New York Times intitulée « Les bombes-bipers d’Israël n’ont pas leur place dans une guerre juste », où il critique l’usage par Israël de ces dispositifs contre le Hezbollah au Liban, ayant causé de nombreuses victimes civiles. À mi-parcours du texte, il clarifie : « Cependant, il nous faut faire ici une distinction. Condamner un acte de guerre ne revient pas à condamner la guerre elle-même », celle-ci étant juste selon lui, puisque les ennemis d’Israël sont animés d’une « intention immorale et injuste », ce qui rend la réponse israélienne – à Gaza et au Liban – justifiée. Pour Walzer, seule la manière de mener la guerre pose problème ; sauf cet usage des bipers, il affirme qu’Israël agit de manière « limitée » et « contrôlée ».
Or, cet argument contredit les principes qu’il avait lui-même énoncés dans son ouvrage majeur de 1977, Just and Unjust Wars, notamment celui de proportionnalité — il est difficile de voir comment la riposte israélienne serait proportionnée au danger encouru. Ce cas de casuistique philosophique révèle un dilemme, et peut-être une crise profonde, au sein du sionisme libéral : comment préserver les engagements libéraux dans un contexte où le caractère ethnique et religieux de l’État israélien devient de plus en plus manifeste ? Il est frappant de voir Walzer attribuer à l’État israélien des vertus morales comme si ses dirigeants partageaient ses principes. Comment expliquer ce décalage entre l’universalisme moral revendiqué du sionisme libéral et son attachement à un État ethno-national qui viole ces mêmes principes ?
Quand Exodus and Revolution paraît en 1985, Walzer est déjà reconnu comme le principal intellectuel du sionisme libéral, aussi bien dans les milieux académiques que dans le débat public américain. Né en 1935, Walzer incarne une génération d’intellectuels progressistes marqués par l’opposition à la guerre du Vietnam mais ayant ensuite joué un rôle dans la légitimation d’interventions militaires américaines comme celle en Afghanistan. Cette génération, en général sociale-démocrate, était favorable à des interventions militaires jugées bienveillantes, mais hostile aux héritages des mouvements tiers-mondistes et anticoloniaux. Il existe une continuité entre cette génération et celle précédante des « libéraux de la guerre froide », mais aussi des ruptures, d’abord liées à deux critères de différenciation : notamment leur identification avec la « Nouvelle Gauche » des années 1960 (droits civiques, féminisme, anti-guerre), et leur attachement à Israël et au sionisme bien plus prononcé que s’agissant des libéraux précédents.
Just and Unjust Wars a assis la réputation de Walzer comme théoricien de la guerre juste, mais il s’était déjà fait connaître en tant que penseur politique pour ses écrits sur la guerre du Vietnam, et plus encore pour sa défense d’Israël après la guerre des Six Jours de 1967. Walzer a ainsi été longtemps auteur et rédacteur de la revue Dissent, une revue fondée en 1954 comme tribune d’une gauche démocratique critique à la fois du capitalisme occidental et du totalitarisme soviétique. Malgré sa critique de la guerre du Vietnam, Walzer a démontré dans Just and Unjust Wars qu’il n’était ni un pacifiste ni nécessairement anti-guerre. Ce livre combine une révision de la théorie catholique de la guerre juste avec des exemples historiques allant de la guerre du Péloponnèse à celle du Vietnam, en passant par la guerre des Six Jours. Il s’agissait pour Walzer de comprendre pourquoi il rejetait la guerre du Vietnam tout en soutenant l’attaque israélienne de 1967. Bien que la guerre des Six Jours n’occupe que cinq pages du livre (sous le titre « Frappes préventives »), elle a façonné l’ensemble du projet et motivé la question que Walzer cherchait à explorer. Just and Unjust Wars allait devenir un texte canonique en éthique militaire, en droit international et en théorie politique.
Comparé à ses autres œuvres majeures, Exodus and Revolution est un livre relativement secondaire. Il s’inscrit dans une veine séparée et bien moins connue de son œuvre, entamée avec sa thèse doctorale, The Revolution of the Saints (1965), et poursuivie dans les quatre volumes qu’il a codirigés sous le titre The Jewish Political Tradition. Ces travaux interrogent le rôle des traditions religieuses dans la formation de l’Histoire. The Revolution of the Saints est une étude sociologique et historique sur le rôle des sectes calvinistes et puritaines dans le façonnement moral et politique du monde moderne. The Jewish Political Tradition propose une reconstruction de l’enseignement politique talmudique. Exodus and Revolution propose une lecture de la tradition interprétative du Livre de l’Exode, allant de la lecture juive du Midrash à The Federalist Papers en passant par la théologie de la libération.
Walzer eut l’idée d’écrire ce livre lors d’une visite à Montgomery, en Alabama, en 1960, où il couvrait un sit-in mené par des étudiants noirs, qu’il qualifia de « début du radicalisme des années soixante ». Dans une église baptiste, il entendit un sermon qui associait l’Exode biblique à la lutte des Noirs du Sud des États-Unis. Cette analogie le marqua si profondément qu’il commença à voir Moïse et l’Exode partout — chez les révolutionnaires américains, chez Oliver Cromwell, chez les abolitionnistes, les théologiens de la libération, et chez les prédicateurs du mouvement des droits civiques. Walzer en vint à la conclusion que l’Exode devait constituer le paradigme de la libération, la clé de voûte de toute la tradition révolutionnaire.
Certes, comme Walzer le reconnaît d’ailleurs en passant, cette affirmation entre en contradiction avec les révolutionnaires français ou Marx, qui n’avaient jamais fait appel au récit mosaïque. Mais cet obstacle à son hypothèse ne l’ébranle pas. Dans une démarche pour le moins étrange, il déniche une citation dans un texte d’un membre du Comité de salut public de 1793 affirmant que la Terreur devrait durer « trente à cinquante ans ». Walzer y voit une invocation inconsciente par les Français des quarante années passées dans le désert par les Israélites. C’est là sa « preuve » pour affirmer que, même en l’absence explicite de toute référence à l’Exode, celle-ci opère à un niveau inconscient, influençant toute pensée sur la « libération » ou l’« émancipation ».
Mais la véritable portée politique de son livre apparaît dans le dernier chapitre, où il aborde directement le sionisme. Walzer y distingue deux formes : le « sionisme de l’Exode » et le « sionisme messianique ». Le sionisme de l’Exode s’appuie sur le souvenir de la sortie d’Égypte, du périple de quarante ans dans le désert et de l’arrivée en Terre promise. Le sionisme messianique, souligne la prochaine venue du Messie et la rupture apocalyptique qui doit accompagner cet évènement. Le sionisme de l’Exode accorde la priorité à la capacité d’agir politique des peuples façonnant leur propre histoire, en ce qu’il raconte une lutte contre l’oppression et le processus de maturation politique qui en découle. Le sionisme messianique, quant à lui, est moins « tragique » dans ses sensibilités ; il vise une rupture définitive, et non l’apprentissage lent et éprouvant du désert. Le sionisme de l’Exode est modéré, raisonnable, traduisible, accessible à tous les révolutionnaires et ouvert à une appropriation séculière. Le sionisme messianique, en revanche, appartient à la droite dont Walzer s’efforce de se démarquer. L’objectif du livre est ainsi de proposer un point de vue permettant au sionisme libéral d’offrir une alternative au sionisme de droite sur le même terrain religieux et textuel.
Mais cette stratégie montre vite ses limites, puisque le récit de l’Exode est lui-même apocalyptique. Il inclut la conquête de la Terre promise et le commandement divin d’exterminer ses habitants. Walzer souligne que « les Cananéens sont explicitement exclus du champ de la préoccupation morale. Selon les commandements du Deutéronome, ils doivent être expulsés ou tués — tous, hommes, femmes et enfants — et leurs idoles détruites. » Pour les consciences contemporaines, c’est un génocide. Walzer se réfère alors à des rabbins médiévaux, dont Maïmonide, qui ont « annulé » ce commandement «en affirmant qu’il ne «concernait que des peuples spécifiques aujourd’hui disparus ou méconnaissables. » Cette question capitale de la relation aux étrangers, aux habitants de la terre, est traitée en quatre pages sur deux cents.
C’est pourquoi Said a intitulé sa critique du livre A Canaanite Reading (« Une lecture cananéenne »). Ce point n’est pas la seule cible de sa critique, mais il en structure l’ensemble. Le livre de Walzer, selon Said, confirmait ce qu’il avait déjà développé en 1979 dans Zionism from the Standpoint of Its Victims, à savoir que le sionisme repose sur le fantasme d’une terre vide. Et si des « étrangers » s’y trouvent, ils sont soit « explicitement exclus de toute considération morale », soit réputés « inexistants ou méconnaissables » — selon les propres mots de Walzer. Ce dernier se préoccupe uniquement des sionistes de droite qui invoquent le commandement d’exterminer pour justifier leurs actes, mais il reste indifférent à la question contemporaine du traitement d’autres habitants de cette terre. « L’interdit ne pouvait avoir aucun effet pratique ; les Juifs revenant sur la terre ne rencontreraient pas de Hittites ni d’Amoréens », écrivit Walzer, sans jamais nommer ceux que les Juifs de retour pourraient effectivement rencontrer.
La première moitié de la critique de Said traite du livre en lui-même ; la seconde relève d’une sociologie des intellectuels qui situe l’œuvre de Walzer dans son contexte social et historique. Said commence son texte en reconnaissant l’érudition de Walzer, avant de mettre à bas ses thèses.
Said qualifie la méthode de Walzer de « stratégie d’inclusion par report » : celui-ci ne cesse de repousser la prise en compte des objections ou des limites à ses thèses, prétendant qu’il les traitera plus tard, mais elles sont finalement oubliées, neutralisant leur effet. « En réalité, écrit Said, sa prose exhale un brouillard qui obscurcit les problèmes inhérents à ses arguments mais qu’il esquive négligemment avant qu’ils ne deviennent gênants. Et la grande esquive, c’est l’histoire. » Le résultat, selon lui, est que des idées profondément conservatrices se trouvent présentées en discours progressiste ou radical.
Dans l’introduction de son livre, Walzer écrit : « Je ne cherche pas à dénigrer le sacré, mais à explorer le séculier : mon sujet n’est pas ce que Dieu a fait, mais ce que les hommes et les femmes ont fait, d’abord avec le texte biblique lui-même, puis dans le monde, avec ce texte entre les mains. » Mais pour Said, Walzer échoue à explorer réellement le séculier, car il abandonne toute rigueur historique. Il pense séculariser le sacré, mais en réalité, il sacralise le séculier.
« Au vu de l’histoire récente », écrit Said, « on aurait pu s’attendre à ce que Walzer réexamine entièrement la question d’une politique inspirée par Dieu, et qu’il en tire des réflexions plus sobres, peut-être même ironiques. » Said ne ménage pas ses mots : « Pourquoi Walzer est-il aussi peu dialectique, aussi simplificateur, aussi an-historique et réducteur ? »
Said identifie une tension idéologique majeure entre la manière dont Walzer présente le sionisme comme un mouvement de libération nationale et le fait que, dans les années 1970-1980, les intellectuels occidentaux se sont de plus en plus détournés de ce type de mouvements. Dans les années 1950 et 1960, la décolonisation était une cause fameuse, surtout chez les étudiants et les intellectuels. Said affirme que, dans les années 1970 et 1980, la popularité de cette cause avait décliné parmi les intellectuels et dans le discours politique en général (à l’exception notable du Nicaragua et de l’Afrique du Sud). Ce déclin correspondait à un basculement significatif dans le spectre politique : une préoccupation croissante pour la « culture » et les discours civilisationnels ou religieux avait éclipsé les notions précédemment centrales, comme l’oppression et la libération nationale, dans la manière de penser la question coloniale. Alors, demandait Said, comment se fait-il que le sionisme soit encore défendu dans ces termes ?
Walzer lui-même est symptomatique de ce tournant intellectuel, passant du marxisme à une politique de l’identité (au sens large, incluant les identités religieuses ou nationales). Même ses œuvres plus théoriques — comme Spheres of Justice (1983) — valorisent les « communautés » comme cadres de production des valeurs, s’inscrivant ainsi dans cette tendance culturaliste. Alors pourquoi Walzer a-t-il encore besoin de la notion de « révolution », alors qu’il est lui-même un penseur postrévolutionnaire ?
Avant 1967, alors que l’alliance avec les États-Unis n’était pas encore décisive pour la sécurité d’Israël, la gauche occidentale pouvait encore soutenir Israël comme un projet d’expérimentation socialiste. Après 1967, cette image d’Israël devint de moins en moins tenable, en raison de sa domination militaire, du rôle croissant de l’occupation et de sa dépendance au soutien des grandes puissances — en particulier des États-Unis —, une caractéristique classique du colonialisme de peuplement. Parallèlement, la Nouvelle Gauche se définissait par son opposition à la guerre du Vietnam et à la guerre froide. Le soutien à Israël commença alors à s’effriter sous l’effet de ces facteurs. C’est dans ce contexte que se situe le « mode d’analyse » de Walzer, tel que le décrit Said. L’objectif de Walzer était de convaincre sa génération issue de la Nouvelle Gauche que soutenir Israël ne signifiait pas trahir leurs engagements progressistes.
Said cherchait à mettre en lumière un problème plus profond dans la philosophie politique de Walzer, un problème qui traverse également d’autres aspects de son œuvre. Il relevait une asymétrie ou une tension entre la prétention à l’universalité et l’attachement de Walzer à une forme de politique fondée sur l’identité ou la culture. Dans Spheres of Justice, Walzer critique la théorie politique libérale pour son incapacité à prendre en compte la pluralité et l’incommensurabilité des « biens sociaux » et de leurs modes de distribution spécifiques (« sphères de justice »). Il en déduit qu’il ne peut y avoir de formule unique pour l’égalité, puisque les biens sociaux sont valorisés différemment selon les communautés. Une implication de ce raisonnement est que chaque communauté dispose de critères de justice propres et qu’il n’est donc possible de la critiquer que « de l’intérieur », à partir de ses propres normes. Les principes de justice deviennent ainsi subordonnés à la culture et à l’identité locales.
Cet attachement au contexte local trouve sa formulation la plus aboutie dans Interpretation and Social Criticism (1987). Dans ce livre, Walzer distingue différentes formes de critique. La critique politique (dirigée contre l’autorité de l’État) lui semble épuisée et cède la place à une critique culturelle (des valeurs), tandis que la priorité donnée aux identités ethniques, religieuses ou nationales comme cadres d’expérience est posée comme allant de soi.
C’est dans ce cadre que Walzer élabore la figure de l’« intellectuel lié » (connected intellectual) : celui qui conserve un attachement moral et affectif à sa communauté d’origine. Il évoque plusieurs exemples, mais son héros est Albert Camus. Bien qu’icône de l’anticolonialisme pour beaucoup d’intellectuels français, Camus critiqua la violence du FLN et défendit la communauté des pieds-noirs à laquelle il appartenait. Pour Walzer, le critique doit s’adresser à « son peuple » pour faire appel à sa conscience, et les ressources d’identité, de loyauté et d’appartenance intime priment sur les prescriptions morales abstraites.
Walzer veut donc tout à la fois : l’exigence de la critique et de la réflexion — voire de l’universalisme —, mais toujours qualifiée par les impératifs de la communauté et de l’appartenance. Cette position lui permet de légitimer une politique ethnico-religieuse dans un langage acceptable pour la gauche. C’est aussi ce qui éclaire sa stratégie vis-à-vis d’Israël et du sionisme : au final, cela revient à construire un univers moral fermé, où les frontières de la communauté sont présupposées, et où les formes d’autorité ethno-religieuse sont priorisées. L’effort de maintenir ensemble des principes universels et un attachement à des appartenances religieuses et ethniques particulières devient de plus en plus difficile. L’emprunt bancal de Walzer aux récits religieux pour défendre des principes universels est le symptôme de cette tension.
C’est là l’enjeu véritable : comment un intellectuel peut-il concilier des engagements moraux universels avec une loyauté à l’égard d’une communauté particulière ? Said formule deux questions cruciales : est-ce que la « distance critique » et l’« intimité avec son peuple » s’excluent mutuellement ? Et le critique qui accepte le risque d’être isolé mérite-t-il davantage de respect que celui qui reste un « membre loyal de la majorité complice » ? Le terme décisif est ici risque. Pour Said, l’attachement à une communauté n’est pas un critère suffisant de la validité d’une critique (même s’il en reconnaît l’importance) : l’autre critère essentiel est le degré d’exposition de l’intellectuel au risque d’exclusion ou de représailles. C’est, selon lui, la véritable leçon des « traditions occidentales et juives ». Et c’est le problème fondamental de Exodus and Revolution : aucun des arguments de Walzer ne l’expose à un risque, car il ne met rien en jeu. Ses engagements « séculiers » et « religieux » peuvent tous deux être satisfaits, puisqu’il ne les confronte jamais réellement au risque.
Said critique tout particulièrement une déclaration de Walzer justifiant la morale du « faire partir les gens », c’est-à-dire le fait d’exclure certaines personnes d’une communauté nationale en facilitant leur migration. Walzer répond que c’est une reconnaissance réaliste des politiques de partition, inévitables selon lui dans tout projet d’autodétermination nationale. Mais pour Said, cela révèle surtout que la citoyenneté israélienne repose sur des critères ethno-religieux, rendant impossible qu’Israël soit « un État pour tous ses citoyens ». Ce point semble échapper à Walzer, dont la réponse est un classique tu quoque (« et toi alors ? ») : il affirme être resté cohérent toute sa vie (comme si c’était une vertu en soi) et attaque Said pour ses liens avec Yasser Arafat (dont il fut un proche conseiller jusqu’au processus d’Oslo). Plus insidieux encore est la citation suivante :
« [Said] n’a fait aucun effort pour traiter de la ferveur religieuse des Arabes musulmans contemporains, alors que Exodus and Revolution est au moins un effort pour traiter de la ferveur religieuse des Juifs contemporains. Mais peut-être que le seul engagement approprié est l’opposition absolue, un rejet non seulement du fondamentalisme, mais de toute la tradition religieuse. En tant que membre de la minorité chrétienne palestinienne, confronté à un islam de plus en plus violent, c’est sans doute un choix naturel, peut-être même inévitable, pour Said — même si je ne sais pas s’il l’a jamais publiquement suggéré à ses camarades musulmans de l’OLP. Ce n’est cependant pas un choix naturel pour moi, en raison de la manière dont le judaïsme croise et détermine en partie la culture juive. »
Walzer semblait ici suggérer que le statut chrétien « minoritaire » de Said le disqualifiait d’une forme de « lien » avec le mouvement national palestinien, un lien que lui-même (Walzer) revendiquait pleinement avec le judaïsme et Israël. En réduisant ainsi la politique et la critique à une identité ethno-religieuse, Walzer pouvait alors esquiver le cœur des critiques de Said concernant la méthode — ou l’absence de méthode — d’un tel « traitement » du religieux. Il n’avait pas à répondre aux questions méthodologiques, car son identité l’en exonérait, tandis que celle de Said le disqualifiait pour les poser.
Revenir aujourd’hui sur la confrontation entre Said et Walzer permet de mieux comprendre comment le sionisme libéral investit des dimensions ethno-religieuses tout en les niant. En plaçant le récit de l’Exode au centre de son récit sur la « libération nationale » et la « révolution », Walzer entendait en séculariser les enseignements. Mais ce qui s’est produit, en réalité, fut un renversement : c’est le « séculier » — en l’occurrence un État-nation particulier, immergé dans l’Histoire, nommé Israël — qui s’est trouvé sacralisé, jusqu’à incarner une mission morale sacrée. Dans ce contexte, il devient de plus en plus impossible de maintenir l’équilibre entre être à la fois libéral et sioniste, surtout à mesure qu’Israël devient de plus en plus militarisé et illibéral.
Le sionisme libéral (ou même socialiste) pense pouvoir contrôler les conséquences de ses propres désirs — par exemple en distinguant un sionisme messianique d’un sionisme de l’Exode, ce dernier étant censé incarner une politique raisonnable et universelle. Mais, à terme, cette tentative de distinguer les « bons » et les « mauvais » désirs ethno-religieux s’effondre, car le terrain sur lequel repose cette distinction est d’emblée cédé à ceux qui sont prêts à prendre les risques pour réaliser leurs fantasmes. Et une fois ces fantasmes réalisés, les intellectuels libéraux peuvent toujours préserver leur bonne conscience, en projetant leurs désirs sur les autres, puis en se présentant comme victimes d’une tragédie historique. « Nos intentions étaient bonnes. »
Mais au-delà de l’actualité immédiate, cette confrontation nous ramène aux questions que Said posait sur la méthode et la critique. L’impact des violences à Gaza sur le monde académique et intellectuel est encore incertain. Il y a peut-être ici une opportunité pour défaire la tyrannie des guerres culturelles, des politiques identitaires et des débats stériles sur la laïcité. Said est souvent perçu comme un penseur postmoderne, réduisant la vérité au jeu vide du pouvoir (bien qu’il ait toujours refusé cette étiquette). Il a aussi été critiqué par des laïcs de gauche pour son manque de distance critique vis-à-vis des mouvements islamiques (critique également formulée par Walzer). Un écrivain militant l’a même récemment accusé… d’orientalisme, en raison de sa sensibilité séculière.
Toutes ces lectures échouent à saisir la spécificité du mode de critique de Said. Il ne s’est pas contenté de proposer un vocabulaire ; il a développé une sociologie concrète des intellectuels, qui diagnostique les pathologies de la vie intellectuelle et académique. La « critique séculière » de Said n’est pas exempte d’ambiguïtés ni de limites, mais elle peut peut-être offrir des ressources à celles et ceux qui cherchent une voie au-delà des impasses intellectuelles qui paraissent omniprésentes aujourd’hui.
On comprend le mieux ce que Said entendait par « critique séculière » en revenant sur sa confrontation intellectuelle avec le philosophe politique Michael Walzer. Leur dialogue critique a été déclenché par le livre de Walzer Exodus and Revolution (1985). Examiner cette controverse spécifique a deux avantages : d’une part, bien qu’il semble porter sur un sujet ésotérique — l’Ancien Testament —, il concerne en réalité des thèmes bien plus larges : les révolutions du Tiers-Monde, la sociologie des intellectuels, le devenir de la gauche, ainsi que les méthodes d’interprétation au sein de ces thématiques. D’autre part, ce débat entre deux intellectuels influents touche à une question encore brûlante aujourd’hui. Walzer était l’un des principaux représentants du sionisme libéral, courant aux prises aujourd’hui avec crise existentielle la plus sérieuse de son histoire. Revisiter ce débat entre Said et Walzer permet de reconsidérer le sort du sionisme libéral à la lumière de ses thèses et incarnations passées. Rétrospectivement, la posture de Walzer semble bien moins « libérale » — encore moins « séculière », « universaliste » ou « humaniste » — que ce que sa réputation laisse croire, tandis que Said apparaît fidèle à ses engagements séculiers et internationalistes.
Le 21 septembre 2024, Walzer publia une tribune dans le New York Times intitulée « Les bombes-bipers d’Israël n’ont pas leur place dans une guerre juste », où il critique l’usage par Israël de ces dispositifs contre le Hezbollah au Liban, ayant causé de nombreuses victimes civiles. À mi-parcours du texte, il clarifie : « Cependant, il nous faut faire ici une distinction. Condamner un acte de guerre ne revient pas à condamner la guerre elle-même », celle-ci étant juste selon lui, puisque les ennemis d’Israël sont animés d’une « intention immorale et injuste », ce qui rend la réponse israélienne – à Gaza et au Liban – justifiée. Pour Walzer, seule la manière de mener la guerre pose problème ; sauf cet usage des bipers, il affirme qu’Israël agit de manière « limitée » et « contrôlée ».
Or, cet argument contredit les principes qu’il avait lui-même énoncés dans son ouvrage majeur de 1977, Just and Unjust Wars, notamment celui de proportionnalité — il est difficile de voir comment la riposte israélienne serait proportionnée au danger encouru. Ce cas de casuistique philosophique révèle un dilemme, et peut-être une crise profonde, au sein du sionisme libéral : comment préserver les engagements libéraux dans un contexte où le caractère ethnique et religieux de l’État israélien devient de plus en plus manifeste ? Il est frappant de voir Walzer attribuer à l’État israélien des vertus morales comme si ses dirigeants partageaient ses principes. Comment expliquer ce décalage entre l’universalisme moral revendiqué du sionisme libéral et son attachement à un État ethno-national qui viole ces mêmes principes ?
Quand Exodus and Revolution paraît en 1985, Walzer est déjà reconnu comme le principal intellectuel du sionisme libéral, aussi bien dans les milieux académiques que dans le débat public américain. Né en 1935, Walzer incarne une génération d’intellectuels progressistes marqués par l’opposition à la guerre du Vietnam mais ayant ensuite joué un rôle dans la légitimation d’interventions militaires américaines comme celle en Afghanistan. Cette génération, en général sociale-démocrate, était favorable à des interventions militaires jugées bienveillantes, mais hostile aux héritages des mouvements tiers-mondistes et anticoloniaux. Il existe une continuité entre cette génération et celle précédante des « libéraux de la guerre froide », mais aussi des ruptures, d’abord liées à deux critères de différenciation : notamment leur identification avec la « Nouvelle Gauche » des années 1960 (droits civiques, féminisme, anti-guerre), et leur attachement à Israël et au sionisme bien plus prononcé que s’agissant des libéraux précédents.
Just and Unjust Wars a assis la réputation de Walzer comme théoricien de la guerre juste, mais il s’était déjà fait connaître en tant que penseur politique pour ses écrits sur la guerre du Vietnam, et plus encore pour sa défense d’Israël après la guerre des Six Jours de 1967. Walzer a ainsi été longtemps auteur et rédacteur de la revue Dissent, une revue fondée en 1954 comme tribune d’une gauche démocratique critique à la fois du capitalisme occidental et du totalitarisme soviétique. Malgré sa critique de la guerre du Vietnam, Walzer a démontré dans Just and Unjust Wars qu’il n’était ni un pacifiste ni nécessairement anti-guerre. Ce livre combine une révision de la théorie catholique de la guerre juste avec des exemples historiques allant de la guerre du Péloponnèse à celle du Vietnam, en passant par la guerre des Six Jours. Il s’agissait pour Walzer de comprendre pourquoi il rejetait la guerre du Vietnam tout en soutenant l’attaque israélienne de 1967. Bien que la guerre des Six Jours n’occupe que cinq pages du livre (sous le titre « Frappes préventives »), elle a façonné l’ensemble du projet et motivé la question que Walzer cherchait à explorer. Just and Unjust Wars allait devenir un texte canonique en éthique militaire, en droit international et en théorie politique.
Comparé à ses autres œuvres majeures, Exodus and Revolution est un livre relativement secondaire. Il s’inscrit dans une veine séparée et bien moins connue de son œuvre, entamée avec sa thèse doctorale, The Revolution of the Saints (1965), et poursuivie dans les quatre volumes qu’il a codirigés sous le titre The Jewish Political Tradition. Ces travaux interrogent le rôle des traditions religieuses dans la formation de l’Histoire. The Revolution of the Saints est une étude sociologique et historique sur le rôle des sectes calvinistes et puritaines dans le façonnement moral et politique du monde moderne. The Jewish Political Tradition propose une reconstruction de l’enseignement politique talmudique. Exodus and Revolution propose une lecture de la tradition interprétative du Livre de l’Exode, allant de la lecture juive du Midrash à The Federalist Papers en passant par la théologie de la libération.
Walzer eut l’idée d’écrire ce livre lors d’une visite à Montgomery, en Alabama, en 1960, où il couvrait un sit-in mené par des étudiants noirs, qu’il qualifia de « début du radicalisme des années soixante ». Dans une église baptiste, il entendit un sermon qui associait l’Exode biblique à la lutte des Noirs du Sud des États-Unis. Cette analogie le marqua si profondément qu’il commença à voir Moïse et l’Exode partout — chez les révolutionnaires américains, chez Oliver Cromwell, chez les abolitionnistes, les théologiens de la libération, et chez les prédicateurs du mouvement des droits civiques. Walzer en vint à la conclusion que l’Exode devait constituer le paradigme de la libération, la clé de voûte de toute la tradition révolutionnaire.
Certes, comme Walzer le reconnaît d’ailleurs en passant, cette affirmation entre en contradiction avec les révolutionnaires français ou Marx, qui n’avaient jamais fait appel au récit mosaïque. Mais cet obstacle à son hypothèse ne l’ébranle pas. Dans une démarche pour le moins étrange, il déniche une citation dans un texte d’un membre du Comité de salut public de 1793 affirmant que la Terreur devrait durer « trente à cinquante ans ». Walzer y voit une invocation inconsciente par les Français des quarante années passées dans le désert par les Israélites. C’est là sa « preuve » pour affirmer que, même en l’absence explicite de toute référence à l’Exode, celle-ci opère à un niveau inconscient, influençant toute pensée sur la « libération » ou l’« émancipation ».
Mais la véritable portée politique de son livre apparaît dans le dernier chapitre, où il aborde directement le sionisme. Walzer y distingue deux formes : le « sionisme de l’Exode » et le « sionisme messianique ». Le sionisme de l’Exode s’appuie sur le souvenir de la sortie d’Égypte, du périple de quarante ans dans le désert et de l’arrivée en Terre promise. Le sionisme messianique, souligne la prochaine venue du Messie et la rupture apocalyptique qui doit accompagner cet évènement. Le sionisme de l’Exode accorde la priorité à la capacité d’agir politique des peuples façonnant leur propre histoire, en ce qu’il raconte une lutte contre l’oppression et le processus de maturation politique qui en découle. Le sionisme messianique, quant à lui, est moins « tragique » dans ses sensibilités ; il vise une rupture définitive, et non l’apprentissage lent et éprouvant du désert. Le sionisme de l’Exode est modéré, raisonnable, traduisible, accessible à tous les révolutionnaires et ouvert à une appropriation séculière. Le sionisme messianique, en revanche, appartient à la droite dont Walzer s’efforce de se démarquer. L’objectif du livre est ainsi de proposer un point de vue permettant au sionisme libéral d’offrir une alternative au sionisme de droite sur le même terrain religieux et textuel.
Mais cette stratégie montre vite ses limites, puisque le récit de l’Exode est lui-même apocalyptique. Il inclut la conquête de la Terre promise et le commandement divin d’exterminer ses habitants. Walzer souligne que « les Cananéens sont explicitement exclus du champ de la préoccupation morale. Selon les commandements du Deutéronome, ils doivent être expulsés ou tués — tous, hommes, femmes et enfants — et leurs idoles détruites. » Pour les consciences contemporaines, c’est un génocide. Walzer se réfère alors à des rabbins médiévaux, dont Maïmonide, qui ont « annulé » ce commandement «en affirmant qu’il ne «concernait que des peuples spécifiques aujourd’hui disparus ou méconnaissables. » Cette question capitale de la relation aux étrangers, aux habitants de la terre, est traitée en quatre pages sur deux cents.
C’est pourquoi Said a intitulé sa critique du livre A Canaanite Reading (« Une lecture cananéenne »). Ce point n’est pas la seule cible de sa critique, mais il en structure l’ensemble. Le livre de Walzer, selon Said, confirmait ce qu’il avait déjà développé en 1979 dans Zionism from the Standpoint of Its Victims, à savoir que le sionisme repose sur le fantasme d’une terre vide. Et si des « étrangers » s’y trouvent, ils sont soit « explicitement exclus de toute considération morale », soit réputés « inexistants ou méconnaissables » — selon les propres mots de Walzer. Ce dernier se préoccupe uniquement des sionistes de droite qui invoquent le commandement d’exterminer pour justifier leurs actes, mais il reste indifférent à la question contemporaine du traitement d’autres habitants de cette terre. « L’interdit ne pouvait avoir aucun effet pratique ; les Juifs revenant sur la terre ne rencontreraient pas de Hittites ni d’Amoréens », écrivit Walzer, sans jamais nommer ceux que les Juifs de retour pourraient effectivement rencontrer.
La première moitié de la critique de Said traite du livre en lui-même ; la seconde relève d’une sociologie des intellectuels qui situe l’œuvre de Walzer dans son contexte social et historique. Said commence son texte en reconnaissant l’érudition de Walzer, avant de mettre à bas ses thèses.
Said qualifie la méthode de Walzer de « stratégie d’inclusion par report » : celui-ci ne cesse de repousser la prise en compte des objections ou des limites à ses thèses, prétendant qu’il les traitera plus tard, mais elles sont finalement oubliées, neutralisant leur effet. « En réalité, écrit Said, sa prose exhale un brouillard qui obscurcit les problèmes inhérents à ses arguments mais qu’il esquive négligemment avant qu’ils ne deviennent gênants. Et la grande esquive, c’est l’histoire. » Le résultat, selon lui, est que des idées profondément conservatrices se trouvent présentées en discours progressiste ou radical.
Dans l’introduction de son livre, Walzer écrit : « Je ne cherche pas à dénigrer le sacré, mais à explorer le séculier : mon sujet n’est pas ce que Dieu a fait, mais ce que les hommes et les femmes ont fait, d’abord avec le texte biblique lui-même, puis dans le monde, avec ce texte entre les mains. » Mais pour Said, Walzer échoue à explorer réellement le séculier, car il abandonne toute rigueur historique. Il pense séculariser le sacré, mais en réalité, il sacralise le séculier.
« Au vu de l’histoire récente », écrit Said, « on aurait pu s’attendre à ce que Walzer réexamine entièrement la question d’une politique inspirée par Dieu, et qu’il en tire des réflexions plus sobres, peut-être même ironiques. » Said ne ménage pas ses mots : « Pourquoi Walzer est-il aussi peu dialectique, aussi simplificateur, aussi an-historique et réducteur ? »
Said identifie une tension idéologique majeure entre la manière dont Walzer présente le sionisme comme un mouvement de libération nationale et le fait que, dans les années 1970-1980, les intellectuels occidentaux se sont de plus en plus détournés de ce type de mouvements. Dans les années 1950 et 1960, la décolonisation était une cause fameuse, surtout chez les étudiants et les intellectuels. Said affirme que, dans les années 1970 et 1980, la popularité de cette cause avait décliné parmi les intellectuels et dans le discours politique en général (à l’exception notable du Nicaragua et de l’Afrique du Sud). Ce déclin correspondait à un basculement significatif dans le spectre politique : une préoccupation croissante pour la « culture » et les discours civilisationnels ou religieux avait éclipsé les notions précédemment centrales, comme l’oppression et la libération nationale, dans la manière de penser la question coloniale. Alors, demandait Said, comment se fait-il que le sionisme soit encore défendu dans ces termes ?
Walzer lui-même est symptomatique de ce tournant intellectuel, passant du marxisme à une politique de l’identité (au sens large, incluant les identités religieuses ou nationales). Même ses œuvres plus théoriques — comme Spheres of Justice (1983) — valorisent les « communautés » comme cadres de production des valeurs, s’inscrivant ainsi dans cette tendance culturaliste. Alors pourquoi Walzer a-t-il encore besoin de la notion de « révolution », alors qu’il est lui-même un penseur postrévolutionnaire ?
Avant 1967, alors que l’alliance avec les États-Unis n’était pas encore décisive pour la sécurité d’Israël, la gauche occidentale pouvait encore soutenir Israël comme un projet d’expérimentation socialiste. Après 1967, cette image d’Israël devint de moins en moins tenable, en raison de sa domination militaire, du rôle croissant de l’occupation et de sa dépendance au soutien des grandes puissances — en particulier des États-Unis —, une caractéristique classique du colonialisme de peuplement. Parallèlement, la Nouvelle Gauche se définissait par son opposition à la guerre du Vietnam et à la guerre froide. Le soutien à Israël commença alors à s’effriter sous l’effet de ces facteurs. C’est dans ce contexte que se situe le « mode d’analyse » de Walzer, tel que le décrit Said. L’objectif de Walzer était de convaincre sa génération issue de la Nouvelle Gauche que soutenir Israël ne signifiait pas trahir leurs engagements progressistes.
Said cherchait à mettre en lumière un problème plus profond dans la philosophie politique de Walzer, un problème qui traverse également d’autres aspects de son œuvre. Il relevait une asymétrie ou une tension entre la prétention à l’universalité et l’attachement de Walzer à une forme de politique fondée sur l’identité ou la culture. Dans Spheres of Justice, Walzer critique la théorie politique libérale pour son incapacité à prendre en compte la pluralité et l’incommensurabilité des « biens sociaux » et de leurs modes de distribution spécifiques (« sphères de justice »). Il en déduit qu’il ne peut y avoir de formule unique pour l’égalité, puisque les biens sociaux sont valorisés différemment selon les communautés. Une implication de ce raisonnement est que chaque communauté dispose de critères de justice propres et qu’il n’est donc possible de la critiquer que « de l’intérieur », à partir de ses propres normes. Les principes de justice deviennent ainsi subordonnés à la culture et à l’identité locales.
Cet attachement au contexte local trouve sa formulation la plus aboutie dans Interpretation and Social Criticism (1987). Dans ce livre, Walzer distingue différentes formes de critique. La critique politique (dirigée contre l’autorité de l’État) lui semble épuisée et cède la place à une critique culturelle (des valeurs), tandis que la priorité donnée aux identités ethniques, religieuses ou nationales comme cadres d’expérience est posée comme allant de soi.
C’est dans ce cadre que Walzer élabore la figure de l’« intellectuel lié » (connected intellectual) : celui qui conserve un attachement moral et affectif à sa communauté d’origine. Il évoque plusieurs exemples, mais son héros est Albert Camus. Bien qu’icône de l’anticolonialisme pour beaucoup d’intellectuels français, Camus critiqua la violence du FLN et défendit la communauté des pieds-noirs à laquelle il appartenait. Pour Walzer, le critique doit s’adresser à « son peuple » pour faire appel à sa conscience, et les ressources d’identité, de loyauté et d’appartenance intime priment sur les prescriptions morales abstraites.
Walzer veut donc tout à la fois : l’exigence de la critique et de la réflexion — voire de l’universalisme —, mais toujours qualifiée par les impératifs de la communauté et de l’appartenance. Cette position lui permet de légitimer une politique ethnico-religieuse dans un langage acceptable pour la gauche. C’est aussi ce qui éclaire sa stratégie vis-à-vis d’Israël et du sionisme : au final, cela revient à construire un univers moral fermé, où les frontières de la communauté sont présupposées, et où les formes d’autorité ethno-religieuse sont priorisées. L’effort de maintenir ensemble des principes universels et un attachement à des appartenances religieuses et ethniques particulières devient de plus en plus difficile. L’emprunt bancal de Walzer aux récits religieux pour défendre des principes universels est le symptôme de cette tension.
C’est là l’enjeu véritable : comment un intellectuel peut-il concilier des engagements moraux universels avec une loyauté à l’égard d’une communauté particulière ? Said formule deux questions cruciales : est-ce que la « distance critique » et l’« intimité avec son peuple » s’excluent mutuellement ? Et le critique qui accepte le risque d’être isolé mérite-t-il davantage de respect que celui qui reste un « membre loyal de la majorité complice » ? Le terme décisif est ici risque. Pour Said, l’attachement à une communauté n’est pas un critère suffisant de la validité d’une critique (même s’il en reconnaît l’importance) : l’autre critère essentiel est le degré d’exposition de l’intellectuel au risque d’exclusion ou de représailles. C’est, selon lui, la véritable leçon des « traditions occidentales et juives ». Et c’est le problème fondamental de Exodus and Revolution : aucun des arguments de Walzer ne l’expose à un risque, car il ne met rien en jeu. Ses engagements « séculiers » et « religieux » peuvent tous deux être satisfaits, puisqu’il ne les confronte jamais réellement au risque.
Said critique tout particulièrement une déclaration de Walzer justifiant la morale du « faire partir les gens », c’est-à-dire le fait d’exclure certaines personnes d’une communauté nationale en facilitant leur migration. Walzer répond que c’est une reconnaissance réaliste des politiques de partition, inévitables selon lui dans tout projet d’autodétermination nationale. Mais pour Said, cela révèle surtout que la citoyenneté israélienne repose sur des critères ethno-religieux, rendant impossible qu’Israël soit « un État pour tous ses citoyens ». Ce point semble échapper à Walzer, dont la réponse est un classique tu quoque (« et toi alors ? ») : il affirme être resté cohérent toute sa vie (comme si c’était une vertu en soi) et attaque Said pour ses liens avec Yasser Arafat (dont il fut un proche conseiller jusqu’au processus d’Oslo). Plus insidieux encore est la citation suivante :
« [Said] n’a fait aucun effort pour traiter de la ferveur religieuse des Arabes musulmans contemporains, alors que Exodus and Revolution est au moins un effort pour traiter de la ferveur religieuse des Juifs contemporains. Mais peut-être que le seul engagement approprié est l’opposition absolue, un rejet non seulement du fondamentalisme, mais de toute la tradition religieuse. En tant que membre de la minorité chrétienne palestinienne, confronté à un islam de plus en plus violent, c’est sans doute un choix naturel, peut-être même inévitable, pour Said — même si je ne sais pas s’il l’a jamais publiquement suggéré à ses camarades musulmans de l’OLP. Ce n’est cependant pas un choix naturel pour moi, en raison de la manière dont le judaïsme croise et détermine en partie la culture juive. »
Walzer semblait ici suggérer que le statut chrétien « minoritaire » de Said le disqualifiait d’une forme de « lien » avec le mouvement national palestinien, un lien que lui-même (Walzer) revendiquait pleinement avec le judaïsme et Israël. En réduisant ainsi la politique et la critique à une identité ethno-religieuse, Walzer pouvait alors esquiver le cœur des critiques de Said concernant la méthode — ou l’absence de méthode — d’un tel « traitement » du religieux. Il n’avait pas à répondre aux questions méthodologiques, car son identité l’en exonérait, tandis que celle de Said le disqualifiait pour les poser.
Revenir aujourd’hui sur la confrontation entre Said et Walzer permet de mieux comprendre comment le sionisme libéral investit des dimensions ethno-religieuses tout en les niant. En plaçant le récit de l’Exode au centre de son récit sur la « libération nationale » et la « révolution », Walzer entendait en séculariser les enseignements. Mais ce qui s’est produit, en réalité, fut un renversement : c’est le « séculier » — en l’occurrence un État-nation particulier, immergé dans l’Histoire, nommé Israël — qui s’est trouvé sacralisé, jusqu’à incarner une mission morale sacrée. Dans ce contexte, il devient de plus en plus impossible de maintenir l’équilibre entre être à la fois libéral et sioniste, surtout à mesure qu’Israël devient de plus en plus militarisé et illibéral.
Le sionisme libéral (ou même socialiste) pense pouvoir contrôler les conséquences de ses propres désirs — par exemple en distinguant un sionisme messianique d’un sionisme de l’Exode, ce dernier étant censé incarner une politique raisonnable et universelle. Mais, à terme, cette tentative de distinguer les « bons » et les « mauvais » désirs ethno-religieux s’effondre, car le terrain sur lequel repose cette distinction est d’emblée cédé à ceux qui sont prêts à prendre les risques pour réaliser leurs fantasmes. Et une fois ces fantasmes réalisés, les intellectuels libéraux peuvent toujours préserver leur bonne conscience, en projetant leurs désirs sur les autres, puis en se présentant comme victimes d’une tragédie historique. « Nos intentions étaient bonnes. »
Mais au-delà de l’actualité immédiate, cette confrontation nous ramène aux questions que Said posait sur la méthode et la critique. L’impact des violences à Gaza sur le monde académique et intellectuel est encore incertain. Il y a peut-être ici une opportunité pour défaire la tyrannie des guerres culturelles, des politiques identitaires et des débats stériles sur la laïcité. Said est souvent perçu comme un penseur postmoderne, réduisant la vérité au jeu vide du pouvoir (bien qu’il ait toujours refusé cette étiquette). Il a aussi été critiqué par des laïcs de gauche pour son manque de distance critique vis-à-vis des mouvements islamiques (critique également formulée par Walzer). Un écrivain militant l’a même récemment accusé… d’orientalisme, en raison de sa sensibilité séculière.
Toutes ces lectures échouent à saisir la spécificité du mode de critique de Said. Il ne s’est pas contenté de proposer un vocabulaire ; il a développé une sociologie concrète des intellectuels, qui diagnostique les pathologies de la vie intellectuelle et académique. La « critique séculière » de Said n’est pas exempte d’ambiguïtés ni de limites, mais elle peut peut-être offrir des ressources à celles et ceux qui cherchent une voie au-delà des impasses intellectuelles qui paraissent omniprésentes aujourd’hui.

