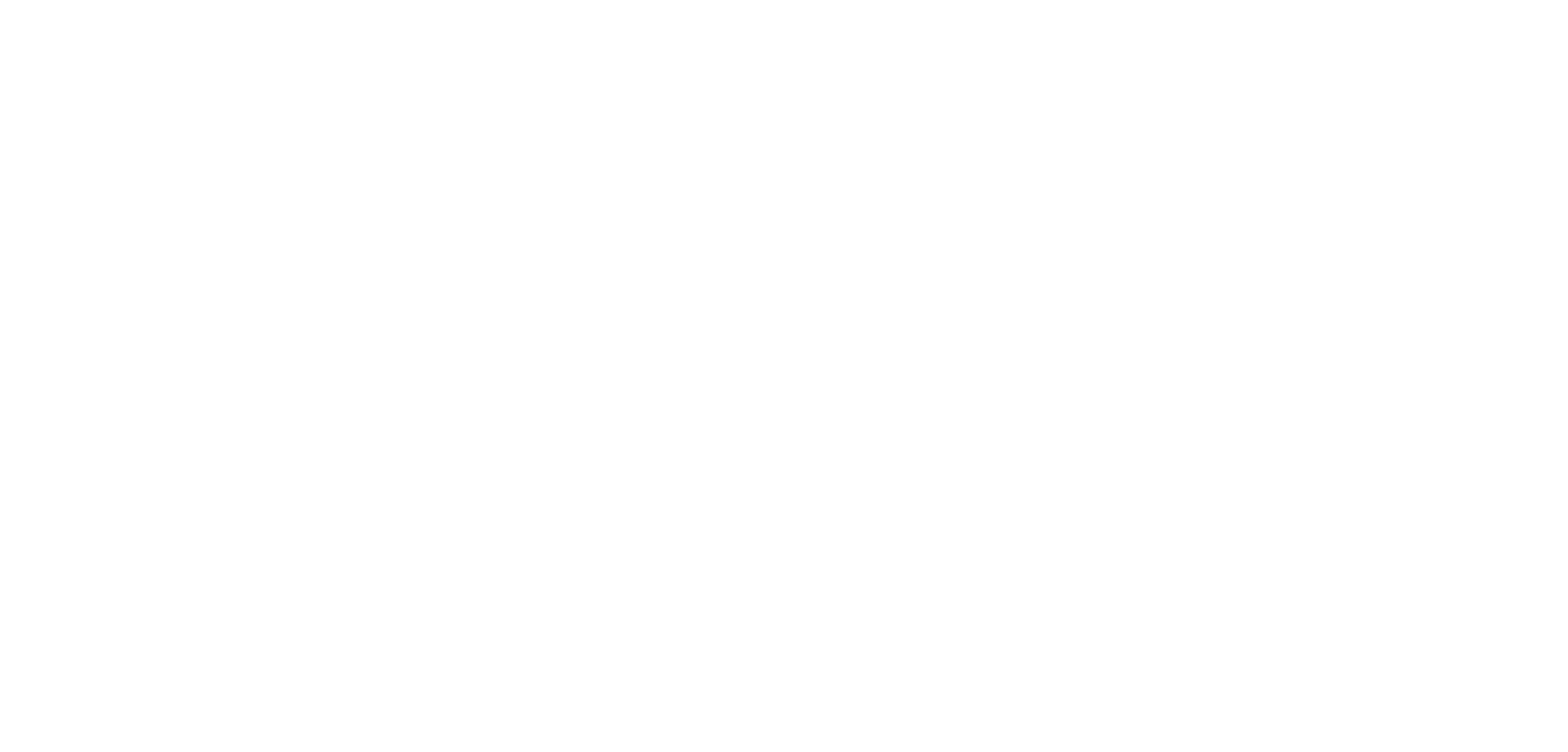
L'utopie et sa réception.
À propos de la révolution syrienne
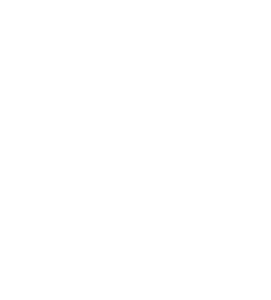
Qu’ont les sciences sociales à dire de plus à propos de la révolution et de la guerre en Syrie ? La tension réside dans l’attribut : de plus, c’est-à-dire par-delà ce qui a déjà été dit depuis d’autres formes de connaissance et de discours. Aussi la difficulté est-elle plus marquée qu’il n’y parait, la résoudre revient nécessairement à réaffirmer la singularité des sciences sociales à l’heure où celles-ci sont le plus souvent silencieuses face à la trame du contemporain dans laquelle elles sont pourtant immergées.
Dix ans après 2011, on peine pourtant à concevoir à ce qui pourrait être encore dit de la Syrie. L’actualité du pays est un point de fixation de l’époque, tant que l’évocation semble se suffire à elle-même : elle désignera alors – concurremment ou simultanément – le chaos d’une situation politique réputée illisible, la violence religieuse et l’inexorable échec des révolutions arabes – l’ensemble redoublant et figurant jusqu’à l’excès le célèbre « il n’y a pas d’alternative[1] ».
Paradoxalement, l’omniprésence de la séquence syrienne dans notre actualité collective aide à circonscrire le propos : si les sciences sociales ont ainsi quelque chose à dire de la Syrie, il s’agit d’autre chose que ce que l’on en affirme depuis la variété des dispositifs idéologiques contemporains. Deux parmi ceux-ci doivent être spécifiés : l’un, que l’on nomme géopolitique, retranscrit la séquence syrienne dans les termes de l’affrontement de blocs étatiques ou supra-étatiques réputés absolument hétérogènes ; l’autre, humanitaire, s’atteste depuis la prise en compte exclusive de la souffrance que produit une violence non qualifiée.
La rationalité géopolitique est fondée par la localisation de rapports de force présumés opérants en tout temps et en tout lieu. Parés du récit de l’affrontement d’États mauvais (« l’Empire ») et bons (« la résistance »), les tenants d’une telle forme de savoir – au sein d’un spectre politique allant de la gauche anti-impérialiste à l’extrême-droite – ont ainsi d’abord cru voir dans l’explosion révolutionnaire de 2011 la velléité expansionniste d’un camp au détriment d’un autre. Il s’est alors agi, en un geste critique depuis lors régulièrement réitéré en d’autres crises politiques, de conduire le repérage en fractale de l’affrontement originel : d’abord par le postulat de manifestations téléguidées depuis l’étranger puis, à la suite de la militarisation du conflit, par l’attribution d’une tutelle nationale cachée à telle ou telle brigade révolutionnaire.
Bien qu’elle s’oppose au récit géopolitique, la logique humanitaire en représente pourtant une suite paradoxale : actant le postulat d’une complexité insaisissable (« on ne sait pas qui est avec qui »), celle-ci s’attache néanmoins à la violence de facto occasionnée par la « tragédie syrienne ». Si la rationalité géopolitique opère au-delà de la politique en affirmant l’existence de forces supérieures aux acteurs – et qui leur sont ainsi le plus souvent dissimulées –, la logique humanitaire agit en-deçà : réduisant le collectif à des individus-victimes[2], elle abstrait la violence de la configuration pratique dans laquelle celle-ci survient.
À l’opposé de l’une et de l’autre, les sciences sociales ont un rôle singulier : il s’agit de retrouver les figures politiques qu’investissent des collectifs historiques dont la caractéristique première est d’être « à distance [relative] de l’État[3] » – c’est-à-dire dont la dynamique interne n’est guère réductible à l’identité naturalisée que vise à imposer l’étatisme. Une telle sociologie de la connaissance, inspirée de l’œuvre de Karl Mannheim, s’attelle à repérer – via l’enquête – la variété des idéologies à l’œuvre dans une même séquence historique. La notion d’idéologie est cependant moins empruntée au marxisme – et ainsi rapportée au « reflet » qu’il s’agit d’objectiver – que définie par la production sociale d’idéaux dans le cours de l’expérience pratique des acteurs[4].
S’il s’agit d’un postulat épistémologique, celui-ci est cependant porté à une singulière acuité par la configuration historique de la révolution syrienne. Dès 2011, le régime se retire de régions de plus en plus vastes[5] du pays, sans que ne s’y instituent pourtant d’autorités étatiques alternatives. Ainsi une forme de « que faire ? » s’atteste-t-elle au sein des « zones libérées » (al-manatiq’ al-mouharrara) : d’hésitations en hésitations, la discussion immanente au collectif des idéaux de justice et de solidarité qui doivent avoir cours fonde la problématique révolutionnaire par-delà toute focalisation organisationnelle. Il faut également dire un mot de l’enquête qui fonde le propos. Celle-ci a eu lieu en 2016 et 2017 à la frontière turco-syrienne et en 2017 en Iraq. S’il s’agissait originellement d’interroger les parcours d’émigrés de France et de Belgique vers la Syrie, une série de renversements épistémologiques et empiriques ont ainsi été à l’origine d’un intérêt en propre pour l’expérience politique de la révolution. Il est vrai que l’interlocution avec ses acteurs était facilitée tant par notre origine nationale – et la maitrise native de la langue arabe à laquelle elle se superpose – que par des engagements personnels dans la trame politique du Printemps arabe. À chaque séjour de recherche, une centaine d’entretiens a ainsi été conduite avec des témoins, des militants et des combattants appartenant à l’ensemble des parties engagées dans la configuration politico-militaire des zones libérées. Si nous ne visions guère à l’exhaustivité, la fluidité des parcours biographiques et des appartenances organisationnelles a pourtant de facto permis la constitution d’une large perspective sur la séquence historique ouverte en 2011[6].
Récits de 2011
En Tunisie, un homme s’immole par le feu : giflé par une policière, l’incident figure une vie entièrement fondée dans l’épreuve de l’injustice (la h’ogra[7]). Une condition collective résonne dans le geste de Mohamed el-Bouazizi : d’abord à Sidi Bouzid, la scène du drame, puis dans le reste du pays et, enfin, à travers ce qu’il est convenu d’appeler le monde arabe – et au-delà[8].
Si les révolutions arabes ont ainsi pour coup d’envoi canonique l’acte désespéré de l’homme de Sidi Bouzid, le fracas se déplace rapidement en direction de l’est : d’abord en Lybie, en Égypte et au Yémen, où la contestation fait chuter des régimes que l’on avait cru inamovibles, puis en Syrie. Là, une autre histoire canonique – c’est-à-dire répétée jusqu’à qu’elle devienne espace de référence collective – se laisse entendre : en février de la fatidique année 2011, des enfants à Deraa – non loin de la frontière jordanienne – s’affirment révolutionnaires(thowâr). Sur l’un des murs de la ville, ils écrivent en dialecte « c’est ton tour, docteur[9] ». La réponse de l’ophtalmologue-président est terrible : la quinzaine d’adolescents est enlevée, emprisonnée et cruellement torturée. Alors, dans cette région où il demeure aux us tribaux une signification collective, une délégation des sages(woujah’â’) demande à la Sûreté militaire la liberté pour leurs enfants. Dans la mémoire révolutionnaire, la scène est restée vive : les notables ont posé à terre leurs turbans, signe d’apaisement et de demande de négociation, mais le gouverneur local, s’il décrypte correctement le geste, envoie à la déchetterie les couvre-chefs.
La colère éclate : d’abord le 15 mars dans un rassemblement demeuré prudent, le 18 à la sortie de la prière du vendredi et puis de plus en plus fréquemment dans la vieille ville ou autour de la mosquée al-Omari. Face au réel qui lui échappe, l’État dépêche une unité militaire d’élite : c’est la division antiterroriste, aussitôt à l’œuvre dans la répression des manifestations. De plus en plus de martyrs tombent mais leur enterrement est la scène de la geste contestataire sans cesse renouvelée – et amplifiée[10]. Alors, actant l’insurrection populaire, l’armée de terre et ses chars d’assaut entrent dans la ville : le 25 avril 2011, le pouvoir croit avoir échappé au pire. La ville est assiégée, les entrées et sorties contrôlées par l’armée, l’électricité coupée et la mosquée al-Omari où se retrouvaient les manifestants prise d’assaut – « ils ont profané les Corans », dit-on encore quelques années après les évènements. Pour la première fois dans le cours de la révolution syrienne, un habitant déclaré terroriste est exécuté en place publique.
Mais du graffiti de Deraa à la reprise en main militaire de Homs, la contestation s'est approfondie en même temps qu’elle migrait. Aussi la participation aux premières manifestations fait-elle figure de rite de passage : elle est la césure qui congédie la « vie d’avant » au profit d’un ordre que l’on affirme désormais révolutionnaire. Abou Obeïda – manifestant qui prendra les armes quelques années plus tard – fait ainsi récit :
« Nous sommes sortis spontanément, par surprise. La Révolution, à ses débuts, n’avait aucune idéologie. « Le peuple veut faire chuter le régime », point. On était influencé par le Printemps arabe, parce ce qui se passait dans les pays de la région. Nous avions des élites politiques et intellectuelles, mais nous ne les avons connues qu’avec la Révolution, ils étaient exilés ou en prison ».
Les élites« exilées ou en prison », le mouvement transite par le charisme communautaire, c’est-à-dire que le collectif en lutte se reconnaitdans des figures : à Homs, il y a l’actrice Fadwa Soulaïmane, l’étudiant en cinéma tout juste rentré des États-Unis Bassel Shahada et, surtout, le jeune footballeur Abdelbassit as-Sarout[11]. Ce dernier n’a rien d’un nanti : issu du quartier pauvre de Bayada, en banlieue nord de la ville, enfant d’une famille nombreuse d’origine rurale, l’homme incarne mieux que quiconque la condition collective des uns et des autres. Alors, avec l’accent prononcé du Golan dont les siens sont originaires, Abdelbassit déclame les chants mi-poème mi-slogan que la foule des manifestants reprend en cœur, si bien que de très prisées vidéos[12] seront bientôt faites de ses élans.
À Homs, la révolutiona trouvé sa première capitale. Aussi l’État ne s’y trompe-t-il pas : les quartiers sortis de son giron – Baba Amr, Karm az-Zeitoun, Khalidiya, Bayada – sont bombardés, d’abord à l’artillerie lourde puis par l’aviation. En réponse, les révolutionnaires s’arment : en plus des contestataires de la première heure, c’est le début des défections (inchiqâqât) dans les rangs des militaires, qui bientôt forment l’Armée syrienne libre (al jaych as-suri al hor) – contrepoint discursif et stratégique de la gouvernementale Armée arabe syrienne. Homs, à la fois profondément contestataire et assiégée par les troupes gouvernementales et ses auxiliaires para-étatiques[13], est alors l’indisputée capitale de la révolution. Au fil des manifestations, une routine s’installe : tant à Homs, Deraa qu’à Lattaquié (pourtant fief familial de Bachar al-Assad), on se donne rendez-vous aux abords de la mosquée de la vieille ville à la sortie de la prière le vendredi[14]. Chaque semaine, un nom est donné à la manifestation à venir, puisant dans la variété des appartenances collectives : le 25 mars, c’est le vendredi d’al-‘Izza (l’honneur), le 1er avril, celui des chouh’ada’ (les martyrs), le 8 avril, as-somoud (la résistance),le 15 avril, al-‘Isrâr (la persévérance), le 22 avril, al-‘adîma (le grand vendredi) etc. L’unanimité autour de la contestation naissante est d’emblée singulière : si la séquence du Printemps arabe a affermi parmi les manifestants l’idée de temps exceptionnels (ainsi avait-on écrit, sur le mur de Deraa, « c’est ton tour »), la révolution ne fut nulle part ailleurs qu’en Syrie un fait aussi massif et durable. Un même déroulé est ainsi sans cesse réitéré : l’immédiate répression a pour conséquence paradoxale la suspension du monopole de la violence physique et symbolique de l’État, conduisant alors à une extension exponentielle du périmètre et de la profondeur de la révolte.
Mais l’absence de continuité territoriale et de structures gouvernementales stabilisées favorise la dispersion des configurations pratiques en même temps que l’imbrication de la contestation aux liens de solidarités qui s’éprouvent parmi les collectifs localisés. Si la situation de Homs n’est ainsi guère celle d’Alep ou de la Ghouta, la société révolutionnaire s’affirme cependant par le drapeau de l’Armée libre que l’on arbore dans les manifestations dont la fréquence et le caractère massivement suivi demeurent malgré la militarisation du conflit[15]. Il ne s’agit pourtant pas de « souveraineté révolutionnaire » : l’Armée libre n’est elle-même qu’une constellation de brigades peu centralisées – elles ne sont ainsi que les pendants militaires des collectifs localisés –, mais son existence forme une totalité discursive qui permet en retour la discussion réflexive des options historiques qui s’offrent à la société révolutionnaire.
Le collectif et ses sages
À la suite de la politique de la terre brûlée qu’affirme explicitement l’État – en témoigne le fameux slogan des partisans de Bachar al-Assad : « al-Assad aw nihriq al-balad » (Assad ou nous brûlons le pays), la société révolutionnaire se refonde par l’attachement à d’alternatives instances– parmi elles, les woujah’a’, c’est-à-dire les notables dont le charisme est entièrement immanent au collectif. Mahmoud Moussa, directeur d’école à Bdama – dans le nord-ouest de la Syrie – fait ainsi récit de son entrée en révolution :
« Moi j’étais à la maison après avoir mangé, environ deux ou trois heures de l’après-midi, quand j’ai entendu un takbir dans la rue. J'ai été étonné. Qui ? On discutait, on essayait de voir qui avait fait ça, avec les professeurs, les gens de confiance. Les gens avaient peur, ils refusaient... Je leur ai dit moi, je les ai prévenus le même jour, si nous l'on sort pas, d'autres sortiront et ce ne sera pas en notre intérêt. Effectivement, ils sont sortis, les contrebandiers sont sortis. Je suis sorti moi aussi, juste après la mosquée (la prière du vendredi). Avec chaussures, sans chaussures, je ne me souviens plus. On regardait Al Jazeera, on avait mal de voir les gens sortir à Daraa, Banias Lattaquié, etc. [sans que nous on sorte]. Une grande partie de ceux qui étaient dans la rue étaient mes élèves : « Professeur, viens ! Professeur ! ». Je suis parti avec eux. Mais je ne pouvais pas crier ! J'ai marché avec eux, et après une certaine distance, on était dans une zone montagneuse, donc c'était en montée, et ils ont dit « la chute du régime ». Je leur ai dit, « quoi, la chute du gouvernement, pourquoi on dirait ce genre de choses ? ». Pour être franc, j'ai vite pris une position centrale, je ne voulais pas que le contrebandier[16] me montre le chemin. Je leur ai dit, doucement, on a qu'à porter les slogans de démocratie, liberté, les slogans connus. Alors, ils ont commencé à crier démocratie et liberté ».
Les sages sont le plus souvent silencieux ou prudents (« Je leur ai dit, doucement, on a qu'à porter les slogans de démocratie, liberté, les slogans connus »), mais leur silence figure ainsi paradoxalement le refus de toute réinstitution du monopole du discours et de la représentation à la suite du retrait de l’État syrien. Insécable partie du collectif révolutionnaire, ils en expriment – en contrepoint des partis politiques, des syndicats, de la société civile et des intellectuels libéraux ou issus du réformisme islamique – les hésitations face au déchainement de la violence étatique. Ainsi ne s’engagent-ils guère de prime abord dans l’entreprise révolutionnaire : craignant le régime dont ils savent la violence ordinaire[17], ils suivent de loin les manifestations ou, à l’instar Mahmoud Moussa, n’y participent que lorsqu’ils sont directement sollicités. La prudence de celui qui affirme pourtant sa disposition biographique[18] à se révolter doit être pleinement entendue : l’homme est une figure du collectif et craint de voir celui-ci dé-fait par la violence d’État. Aussi le charisme de Mahmoud Moussa – reconnu par les manifestants l’appelant dès lors à se joindre à eux – témoigne-t-il de la continuité qui lie la « vie d’avant » à l’ordre révolutionnaire qui s’établit lorsque l’État rompt les conventions collectives les plus sacrées – c’est-à-dire la vie des gens et la pérennité des liens qu’ils établissent. Directeur d’école, expression incarnée d’un idéal socialiste devenu résiduel, l’homme était ainsi un sage avant la révolution : lorsque celle-ci survient, il la rejoint – tout en se refusant à crier avec ses anciens élèves.
La tension qui appert entre l’action révolutionnaire et la prudence des sages indique alors la nature de l’autorité charismatique qui leur est conférée : celle-ci ne peut être que formelle. Pour autant, par la reconnaissance qu’on lui accorde de fait, le dire des sages fait office de médiation entre le collectif saisi par la révolution et tout forme de représentation extérieure à ses solidarités historiques. Cette fonction, essentielle, empêche alors l’établissement de toute institution du monopole du discours. Ainsi la différence entre l’une et l’autre forme d’autorité est-elle connue du collectif révolutionnaire : les sages agissent à l’intérieur du collectifdont ils sont le produit et l’expression, à l’inverse des partis porteurs de programmes et établis sur le fondement de capitaux légitimés par des champs sociaux nécessairement institués par leur distance relative à l’égard de la totalité. Le discours de la révolution gagne en immanence : les idéaux qui émergent au sein des zones libérées sont ainsi entièrement immergés dans l’expérience pratique de la société révolutionnaire.
L’utopie sur un fil
En 2011, Abou Youssef a 35 ans. Il habite Mâri’ – ville située dans le « rif » septentrional d’Alep, c’est-à-dire dans la profondeur rurale de la métropole du Nord. À Mâri’, il fait partie des initiateurs des manifestations pacifiques. Puis, lorsque la révolution se militarise progressivement face à la répression étatique, il est l’un des premiers à porter les armes. Aux yeux de tous et en marge des manifestations, il est chargé de la protection du collectif contre les miliciens para-étatiques (les sinistres chabih’a) qui l’infiltrent.
Il est vrai que, avant même le passage – progressif et hétérogène – à la révolution armée, la potentialité de la mort était omniprésente au sein de la contestation. Le bilan lors des six premiers mois – lorsque les manifestants chantaient encore « silmiyya, silmiyya[19] » – est ainsi lourd : 2355 manifestants meurent à la suite de la répression étatique (dont 100 enfants, 76 femmes, et 184 soldats dissidents) et 90 autres personnes décèdent sous la torture dans les prisons et les commissariats. Si la contestation s’institue alors initialement par des revendications relevant d’un classique libéralisme politique (ainsi en va-t-il de la critique de la corruption économique, des inégalités, de l’opacité du régime, du manque de liberté d’expression et de pluralisme, de l’idéologie panarabe étouffant ainsi les droits culturels des minorités etc.), l’inouï du massacre d’État transfigure la réalité en même temps que le rapport au monde de ceux et celles qui en sont la cible. La violence contre-révolutionnaire est ainsi à l’origine d’engagements existentiels irréductibles à la stratégie d’agents se positionnant dans le nouveau champ de la révolution. La mort – possible et probable – est alors comprise comme le tragique prix à payer pour l’existence enfin libéré d’un État réduit à son expression belliqueuse.
Aussi le libéralisme des débuts évolue-t-il progressivement vers une forme de pessimisme pacifiste, tandis qu’émerge en contrepoint une autre utopie – celle qui se fonde par la présentification hic et nunc de la justice divine. À l’instar de la séquence révolutionnaire de l’an 1979 en Iran[20], le nom d’Allah insuffle à la contestation une force non programmatique et constituée depuis l’universel en partage. Ainsi en va-t-il du slogan « ma lana ghirek ya Allah » (« nous n’avons que toi ô Allah ») : la permanence divine est alors opposée aux fluctuations de la « communauté internationale » et de ses permanents renversements d’alliances (une célèbre chanson révolutionnaire dit, après avoir énoncé le slogan, « ton protocole nous tue » en se référant au Conseil de sécurité des Nations-Unis[21]). Khalil, de la région d’Alep, fait récit :
« Au début des manifestations, c’était « la chute du régime » qu’on scandait. Mais quand le régime commence à tirer sur les foules, tuer les femmes et les enfants dans les rues, bombarder les quartiers, etc. l’histoire a bifurqué. On est passé de la chute du régime à la lutte pour le triomphe de la religion, le triomphe de l’opprimé et l’élévation de la parole « il n’y a de Dieu qu’Allah et Mohammed est son prophète ». Nous sommes passés de la revendication de la chute de la constitution à la lutte pour le triomphe de la religion ».
Faut-il alors s’en étonner ? C’est dans cette configuration de plus en plus extrême que la révolutionredouble son caractère ordinairement chiliastique : la lutte devient djihad[22]. Celui-ci incarne pourtant une potentialitéaussi contingente que singulière : le djihad n’est ni la mise en œuvre civilisationnelle d’un projet global ni la traduction utilitaire d’une lutte de positions que l’on mène par ailleurs. L’écart est alors exprimé par Abou Youssef distinguant le temps de la révolution de celui de la politique partisane :
« Dans notre révolution, les gens qui sont organisés de manière partisane sont effectivement les Frères musulmans. Mais ils agissent depuis l’étranger où ils vivent en exil. Ils ont essayé d’avoir une main à l’intérieur, mais ils n’ont qu’une existence marginale dans la révolution. Leur objectif est l’après révolution. Si jamais ça débouche sur des élections, ils peuvent l’emporter ou avoir une représentation, mais dans la révolution, c’est une autre réalité : ils sont tout à fait minoritaires. Et moi personnellement, je considère que toute politique partisane – en temps de révolution – est antinomique à la révolution. Dans la révolution, il n’y a pas de partis politiques. Et les Frères musulmans sont arrivés sur le tard ».
Abou Youssef indique la péremption dans le cours de la geste révolutionnaire de la temporalité ordinaire de la politique moderne. Ainsi ne s’agit-il guère de l’idéologie religieuse des Frères musulmans qui est rejetée (« la Syrie est un pays à majorité musulmane » dit-il placidement dans la suite de l’entretien) mais la forme partisane dont ils sont l’expression la plus aboutie en Syrie. Si la conscience utopique est ainsi ce qui « qui ne coïncide pas avec l’être à ses alentours[23] », sa nature est pourtant essentiellement constituée par le congédiement de l’à-venir[24] : le surcroît d’intensité d’une présentification hic et nunc se dispense ainsi de toute projection dans un futur par nécessité incertain. À l’inverse, les chants, les danses, les prières collectives et l’élégie des morts sont autant de moments où se réalise la société révolutionnaire[25] lorsque sont ainsi suspendus les temps gouvernementaux. Khadija, commerçante d’Alep dont le mari et le fils sont morts au combat, relate :
« On a tellement appris à vivre en temps de guerre qu’au plus fort des bombardements, nous fêtions un mariage. Bien sûr, on vivait déjà sous terre à ce moment-là, le jeune marié avait été amputé de la main après une blessure au front contre les forces gouvernementales, mais c’était une fête heureuse, avec de la musique, de la dance, de la dabké ! Mon Dieu, nous devions être 150, il y avait même un DJ ! Alors, c’est vrai, à un moment, on a senti que la terre tremblait, mais on s’est dit que c’était parce que nous dansions trop fort ! Seulement, quand on a voulu sortir, on s’est rendu compte que l’immeuble en-dessous duquel on était avait été bombardé, nous étions littéralement ensevelis sous les décombres. Alors tu sais ce qu’on a fait ? On a continué la fête et la danse, jusqu’à ce que la garde civile bénévole nous sorte de là. Quand j’ai perdu mon fils, il y a quatre mois, je ne vais pas te mentir, j’étais triste. Il était grand, beau et fort comme un taureau. Il avait 19 ans. Il venait de passer ses examens à l’Université de Gaziantep, et il était revenu en Syrie combattre sur le front d’Alep, sa ville. Alors oui, je l’ai enterré, oui je l’ai pleuré, mais la lutte ne s’arrête pas. Si mon second fils me disait qu’il voulait y aller lui aussi, je lui dirai oui, vas-y, va défendre les tiens. Et tu sais pourquoi ? Parce que quelques soient vos coalitions internationales, vos stratégies, vos frappes et vos injustices, nous continuerons le combat, parce que nous faisons le djihad pour nos morts, pour notre terre, pour notre existence et pour nos façons de vivre ».
Au long de la séquence révolutionnaire, les morts « tombent en martyrs », l’on attend la « délivrance[26] » face à l’oppression étatique et combattre les armes à la main n’est que le versant existentiel et oblatif de la piété collective dans les zones libérées. Tant que le réel pouvait être ainsi soutenu[27], l’utopie du djihad était le lieu de l’intensification du rapport au réel révolutionnaire. La rétribution de la mort héroïquedans l’au-delà n’était alors que le versant individuel du triomphe– collectif et immanent – de la justice divinepar l’épreuve de la guerre, si bien que le shah’îd[28]était appelé à témoigner transcendantalementde la révolution pour laquelle il donna sa vie. En contrepartie, « l’alliance entre les vivants et les morts » fonde la permanence sensible du djihad face à l’État répressif.
L’État de la guerre
Mais l’esthétisationdu monde par la conscienceaussi utopique qu’existentielle du djihad a un terrible revers : lorsque l’échec advient, sous la forme de l’intervention à partir de 2014 de puissances étatiques bien supérieures[29] à celle à laquelle l’on faisait face jusque-là, celui-atteste de la fin d’un monde en même temps que de la radicale défaite du collectif rassemblé autour de la révolution. Une figure, présente dans les zones libérées mais jusque-là relativement discrète[30], cherche à s’imposer : « si le djihad a échoué, c’est qu’il n’a pas été formé d’État, seul capable de répondre à la violence du régime », est-il ainsi murmuré. La confrontation est violente : en janvier 2014, ceux qui s’affirment désormais « soldats » de l’État islamique sont expulsés d’Alep par les factions demeuréesrévolutionnaires au prix d’un lourd tribut de sang. En miroir, l’autorité nationale qui s’institue à l’Est élimine de ses vastes territoires toute velléité contestataire : l’Armée libre en est définitivement chassée et un monopole de la violence est ainsi réinstitué au sein de l’État islamique. Au sein du collectif révolutionnaire, peu sont tentés par la volonté de puissancedu califat. La majorité accepte la défaite qui s’annonce : certains s’exilent[31], d’autres continuent un combat que l’on sait de plus en plus voué à l’échec[32].
D’emblée, l’État islamique se fonde en gouvernement territorialisé : si les zones libérées étaient le site d’un ordre imparfait, où la morale du collectif était ainsi en concurrence avec l’éclatement du monopole de la violence légitime et la subséquente prolifération des milices, le gouvernement qui s’établit à Raqqa et à Mossoul opère le lissage de l’espace néo-national. Au territoire de son avènement, l’État islamique reconstitue la continuité de l’espace et du pouvoir en même temps qu’il établit des frontières : à l’extérieur, avec des droits de douane que l’on ne paye qu’à l’entrée, et à l’intérieur, en instituant un strict ordre symbolique fondé sur la conjonction de l’extrême violence et de la persuasion juridico-légale – c’est-à-dire l’élaboration d’un discours à destination de la population que l’on vise à administrer. Le nouveau gouvernement congédie alors toute médiation subjective constituée par l’utopie religieuse : les sujets musulmanssont exclusivement définis par leur appartenance à l’État islamique et, par réciproque, seuls ceux qui y appartiennent sont présumés musulmans[33]– ainsi s’agit-il d’une théologie de l’appartenance nationale.
Une politique de reterritorialisation fait ainsi suite à une politique de déterritorialisation : la succession est tout à la fois hétérogène et violente. Le fragile équilibre qui demeure pourtant dans les zones libérées – même lorsqu’elle sont l’une après l’autre défaite sous les constants bombardements au baril[34] puis par les Soukhoï russes[35] – mêle alors des politiques aussi distinctes en nature que logées dans le même espace-temps révolutionnaire[36] : soldats mutinés et anciens du parti Baath, tenants ensemble de l’ancienne mouture socialiste et panarabe de l’État, salafisteset réformateurs islamiques[37] et, surtout, le collectif affirmant le principe unique de dé-faire le régime[38].
Post-scriptum : les sciences sociales et la dépolitisation
Il est tentant, à des fins de modélisation simplificatrice, de s’autonomiser de la réflexivité des acteurs et des courants idéologiques qu’ils investissent en pratique. Un tel mouvement est alors efficacement figuré par la sociologie qui, classant les pratiques, mettant à jour l’illusio des agents et l’attribuant aux champs réputés autonomes du restant de l’espace social, s’ingénie à dépolitiser la trame des évènements historiques. Ainsi a-t-on cru pouvoir localiser un « capital social révolutionnaire[39] » parmi ceux qui s’engagent – parfois au prix de leur vie – et ainsi traduire cet engagement dans les termes situés de la lutte de positions et des conversions possibles d’un champ à l’autre. La levée de l’obstacle que représente alors la pensée émique est permise par l’ordinaire raison économique : une offre – nécessairement extérieure – a rencontré une demande – nécessairement inconsciente d’elle-même. La modélisation formelle s’accuse ainsi par un efficace congédiement de tout contenu idéologique – c’est-à-dire de toute pensée des gens – et se condamnait simultanément à l’aveuglement quant à la potentialité de la critique telle qu’elle émerge parmi les acteurs historiques.
Mais l’impasse que constitue le déni de profondeur existentielle[40] est alors tant théorique que politique : en opérant la translation mutatis mutandis des catégories du gouvernement civil à la révolution qui les défait pourtant, toute singularité est ainsi rendue inintelligible. La dépolitisation à l’œuvre contribue – en Syrie comme ailleurs[41] – à effacer les catégories fondant l’espace de la discussion politique. Dans la brèche qui a ainsi été ouverte s’engouffrent alors toutes les paroles qui participent à obscurcir un peu plus les options historiques qui s’offrent à tous et toutes.
[1] La formule, que l’on associe communément à l’offensive néo-libérale des années 1980, a cependant trouvé une vigueur renouvelée dans la réaction des États postcoloniaux confrontés aux contestations du Printemps arabe.
[2] Sur la prise en charge politique de la souffrance, voir TROM, D. 2007. La promesse et l’obstacle. La gauche radicale et le problème juif, Paris : Cerf, pp. 67-69.
[3] LAZARUS, S. 1996. Anthropologie du nom, Paris : Seuil
[4] KARSENTI, B., LEMIEUX, C. 2017. Socialisme et sociologie, Paris : Éditions de l’EHESS
[5] Jusqu’à 80% du territoire syrien a ainsi été hors de contrôle du régime.
[6] À l’inverse, nous n’avons pas mené d’entretiens avec les militants déjà en exil à cette date : si ceux-ci ont le plus souvent été solidaires de la révolution, nous avons cependant choisi de considérer que les mobilisations « à l’extérieur » étaient pourtant d’une nature distincte de ce qu’il nous semblait observer dans les zones libérées.
[7] Le terme, issu de l’arabe dialectal maghrébin, désigne par la force de l’indistinction l’injustice du quotidien.
[8] Ainsi des mouvements se réclamant du moment 2011 éclatent-ils en Espagne (Los Indignados), aux Etats-Unis (Occupy Wall Street), au Québec (sous le nom du Printemps érable) etc.
[9] Bachar al-Assad est de formation ophtalmologue.
[10] Remercions ici Cécile Boex pour ce film amateur de Fadwa Souleïmane, l’une des figures du mouvement à Homs, prenant la parole durant les obsèques de manifestants assassinés.
https://vimeo.com/197396799 (consulté le 5 août 2020)
[11] Pour un portrait de Abdelbassit as-Sarout, voir le texte que lui a dédié l’intellectuel syrien Yassine al-Haj Saleh à l’occasion de son décès au combat en 2019 : https://publicseminar.org/essays/a-revolutions-course-through-a-revolutionarys-trajectory/ (consulté le 5 août 2021). Voir également le film The Return to Homs, du réalisateur Talal Derki.
[12] BOËX, C. 2018. Figures remixées des martyrs de la révolte en Syrie sur YouTube: Réinterprétations politiques et mémoires vernaculaires de la mort héroïque. Archives de sciences sociales des religions, 181(1), pp. 95-118.
[13] Apparu dans le contexte révolutionnaire, le terme désigne les milices para-étatiques dont il est dit qu’elles sont responsabilités des exactions les plus cruelles. Par ailleurs, dès le début de la contestation, le Hezbollah libanais entre en guerre aux côtés de l’État syrien.
[14] LITTELL, J. 2012. Carnets de Homs, Paris : Gallimard
[15] Il demeure des manifestations massives et régulières dans les zones encore libérées et sporadiques dans celles considérées comme loyalistes.
[16] La zone où vivait Mahmoud Moussa, frontalière de la Turquie, était réputée pour la contrebande de produits en tout genre.
[17] La mémoire de la destruction de Hama par Hafez el-Assad et son frère en 1982, c’est-à-dire le massacre de 40 000 réputés « Frères musulmans » est incontournable dans la conscience révolutionnaire.
[18] Ainsi l’homme – pourtant fonctionnaire – a-t-il toujours refusé d’être membre du Baath, un geste potentiellement lourd de conséquences en Syrie.
[19] En arabe, « pacifique, pacifique ».
[20] FOUCAULT, M. 2001. Dits et Écrits, II, 1976-1988, Paris : Gallimard
[21] La chanson est d’Abdelbassit as-Sarout, célèbre poète-chanteur-combattant de la révolution syrienne. Voir https://www.youtube.com/watch?v=VvNcKiVRmWY (consulté le 17 novembre 2021. Sur la figure d’Abdelbassit as-Sarout, voir le portait que lui dédie Yassine Haj-Saleh : https://publicseminar.org/essays/a-revolutions-course-through-a-revolutionarys-trajectory/ (consulté le 515 novembre 202A). Voir également le film The Return to Homs, du réalisateur Talal Derki.
[22] Celui-ci n’a rien d’une millénaire et civilisationnelle « guerre sainte ». Le djihad, de la même racine que djuhd (« l’effort »), désigne l’engagement subjectif le plus affirmé. Celui-ci peut alors être guerrier, mais non nécessairement.
[23] MANNHEIM, K. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, Paris : Maison Sciences de l’Homme, p. 159.
[24] Mannheim écrit aussi que « l’attribut réel du vécu chiliastique, son attribut unique peut-être, c’est l’être-présent absolu, la présence absolue ». MANNHEIM, K. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, op.cit. p. 176.
[25] Rappelons ainsi la formule de Levinas : « Rien n’est plus étrange ni plus étranger que l’autre homme et c’est dans la clarté de l’utopie que se montre l’homme ».
[26] En arabe, al-faraj.
[27] MANNHEIM, K. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, op.cit. p. 172.
[28] Shah’id, généralement traduit par martyr, dérive pourtant de la racine verbale témoigner (shah’ada). Si ce sens n’existe pas dans le français « martyr », il est pourtant celui de l’origine grecque du mot (« mártus »).
[29] La Russie intervient en Syrie à partir de l’année 2014, tant par le bombardement systématique et permanent des zones libérées qu’à travers l’envoi de troupes au sol.
[30] L’État islamique, alors une simple organisation au nom grandiloquent, était ainsi présent dans les zones libérées depuis 2013. La position de ses dirigeants était alors hétérogène : combattant l’État syrien aux côtés des révolutionnaires, des tentatives d’hégémonie étaient de plus en plus fréquentes.
[31] 8 millions – sur 24 – de Syriens vivent désormais en exil. Sur l’exil d’un intellectuel révolutionnaire de premier plan, voir AUGIER, J. 2021. Par une espèce de miracle. L’exil de Yassin al-Haj Saleh, Arles : Actes Sud
[32] De défaite en défaite, le même schéma se répète : assiégées au sol, les zones libérées sont continuellement bombardées par les aviations russe et syrienne – jusqu’à ce que les révolutionnaires et les civils acceptent d’être évacués, dans des bus verts devenus tragiquement célèbres, vers une autre zone libérée (et ainsi bientôt soumise au même traitement).
[33] La question de l’excommunication des populations qui n’ont pas répondu à l’appel du califat est ainsi centrale dans la doctrine de l’État islamique. Sa justification théologique est à l’origine d’un débat religieux et politique violent focalisé sur « al ‘odr bil jahl », l’excuse de l’ignorance.
[34] Affaibli, l’État syrien recourt à l’arme du baril rempli d’explosifs, de matières chimiques et de ferraille et ainsi largué depuis le ciel sans téléguidage sur les zones libérées.
[35] En 2014, la Russie accentue son soutien à l’État syrien en cours de délitement par l’intervention militaire directe.
[36] La comparaison évidente est celle qui lie l’hétérogénéité révolutionnaire d’Alep à la situation de Barcelone en 1936. Voir ORWELL, G. 1955 [1938]. Hommage à la Catalogne, Paris : Gallimard
[37] Voir infra.
[38] Pour la chronique des années sans régime, voir le film de Waad el-Kataeb For Sama.
[39] BACZKO, A., DORRONSORO, G., QUESNAY, A. 2016. Le capital social révolutionnaire : L’exemple de la Syrie entre 2011 et 2014. Actes de la recherche en sciences sociales, 211-212, 24-35.
[40] MANNHEIM, K. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, op.cit. p. 14
[41] KARSENTI, B.2018. La petite musique de la dépolitisation. Les Temps Modernes, 2(2), pp. 115-132.

