Yassin al-Haj Saleh
LETTRE À SAMIRA
Le régime est tombé !
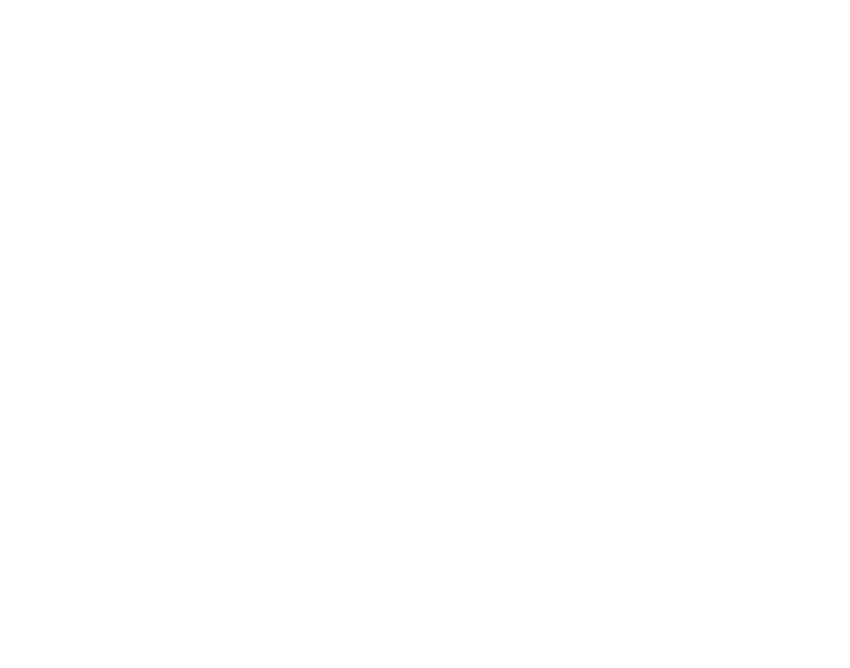
Dia al-Azzawi, 2011
Cette lettre est la seizième d'une série adressée par Yassin al-Haj Saleh à son épouse Samira al-Khalil, enlevée à Douma lors la soirée du 9 décembre 2013, dans lesquelles il tente de lui expliquer ce qui s'est passé en son absence. Elle a d'abord été publiée en arabe, puis traduite en français par Hamza Esmili.
Ma chère Samour,
Après des années de silence, j’ai commencé à t’écrire une lettre en octobre 2024, que j’ai intitulée La Gardienne de l’Espoir. Car ton absence, depuis onze ans, a estompé mon espoir, tant sur le plan intime que collectif. Mais je me suis arrêté après quelques lignes : que pouvais-je te dire de l’état du monde en ton absence, alors que tu es cet état du monde ? Que pourraient t’en dire ceux qui ne partagent pas cette absence ? Toi seule as tout vécu, toi seule peux en témoigner pleinement. Quant à moi, j’ai tenté, tout au long des années, d’oublier ton absence, de ne pas la porter à chaque instant et à chaque minute. Mais elle revenait sans cesse, surgissant sans prévenir, m'arrachant à mes illusions comme tu as été arrachée il y a onze ans.
Je t’écris, après tant d’années, pour te confier ce qui aurait été la plus grande des nouvelles si tu avais été encore là : le régime est tombé ! Bachar al-Assad s’est enfui en Russie ! Il n’a pas dit un mot pour son prétendu public, ni pour les Syriens. En quelques jours, un slogan ironique s’est répandu dans le pays : « Notre leader éternel… s’est enfui un dimanche ! » C’est une histoire étrange, Samour. Hay’at Tahrir al-Sham, autrefois Jabhat al-Nusra au moment de ton enlèvement, a lancé, en coordination avec d’autres groupes, une offensive pour reconquérir des territoires que le régime avait repris, malgré leur statut de « zones de désescalade » selon l’accord d’Astana conclu sous l’égide de la Turquie, de l’Iran et de la Russie. En un éclair, Alep est tombée. Puis Hama, après une brève résistance. Ensuite Homs. Et enfin Damas, libérée à 6h18 du matin, le 8 décembre 2024 – une heure désormais inscrite sur les vitres de certaines voitures, la veille de l’anniversaire de ton enlèvement.
L’opération, qui a duré tout juste douze jours, a été marquée par un courage sidérant, une coordination parfaite, une discipline sans faille qui a conduit à un faible nombre de violations. J’ai craint qu’en quittant Hama pour Homs, ils ne sèment un carnage, mais rien de tel ne s’est produit. Ceux qui avaient fui Homs, par crainte de représailles sectaires et de massacres – y compris certains de nos proches – y sont retournés après deux ou trois jours. Lulu et Najat sont restées sur place et n’ont rencontré aucun problème. Je mentionne Najat et Lulu uniquement parce qu’Afif nous a quittés il y a quelques mois. J’aurais tant voulu qu’il soit là pour voir le jour de la libération ! Je ne t’ai jamais dit non plus que le Dr Munif est mort subitement deux ans avant lui. Afif n’avait plus le goût de vivre après la perte de son frère, et la situation du pays était devenue si pourrie, si désespérée. Waad et Jojo ont pu se rendre à Homs pour faire leurs adieux à leur père et soutenir leur mère et leur sœur. Je t’ai dit que Jojo vivait en Allemagne depuis des années, qu’elle a épousé un Palestinien nommé Fajr, un homme aimant, et qu’ils ont une fille, Tamara, qui a maintenant presque trois ans. Waad et Thaer ont un fils, Assi, qui a presque dix ans, et ils ont finalement réussi à s’installer à Berlin après des années d’insécurité à Beyrouth. Peu après leur arrivée, le régime s’est effondré.
Tout est allé si vite que Bachar al-Assad, son frère Maher et les chefs de ses services de renseignement ont fui chacun de son côté. On a d'abord cru voir Ali Mamlouk, le chef du Bureau de la sécurité nationale, monter à bord d’une une petite embarcation dans la ville d’Arida, en direction du Liban, comme un réfugié syrien traversant la mer vers l’Europe depuis les côtes turques ou nord-africaines. Mais ce n’était pas lui, simplement un officier moins important.Les hauts responsables de la machine de mort semblent s’être dispersés entre la Russie, les Émirats arabes unis et le Liban.
Les nouveaux maîtres du pays ont surpris tout le monde par leur retenue. Ils ont apaisé les communautés, évité d’imposer un ordre brutal, cherché à apparaître respectables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Certes, il y a eu des frictions, mais leur priorité était d’instaurer un semblant d’ordre. Les puissances internationales ont accueilli ces événements avec méfiance et réticence. Si elles en avaient eu le temps, elles auraient tout fait pour préserver le statu quo sanglant qui régnait depuis 2013. Le miracle, ce n’est pas seulement la chute du régime qui gouvernait le pays depuis cinquante-quatre ans, c’est aussi la rapidité de son effondrement, si soudaine que personne n’a compris ce qui se passait. Même ceux qui ont pris le pouvoir semblent ne pas avoir anticipé à quel point le régime allait vite s’écrouler. Mais ils ont eu le courage – et il faut leur reconnaître cela – de s’emparer des quatre grandes villes qui forment la colonne vertébrale du pays, en un temps record, avec des pertes humaines très limitées.
J’étais en France quand tout cela s’est produit, Samour. J’y avais publié un livre en français, et une très douce soirée de lancement avait été organisée à Paris, en présence de nos proches, amis et connaissances. Je travaillais aussi avec des partenaires pour organiser la deuxième édition d’une cérémonie de remise de prix en ton nom. Je ne t’en avais pas encore parlé. L’idée est de décerner un prix en ton nom à une femme de la région arabe ou méditerranéenne qui accomplit un travail important dans le domaine de la littérature, de l’art ou des droits humains, sans pour autant être une vedette célèbre. La première édition a eu lieu en 2023, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le prix avait été décerné à Reem al-Ghazi, une réalisatrice de documentaires syrienne, dont tu connais sans doute au moins le nom. Cette fois-ci, la cérémonie s’est tenue le jour de l’anniversaire de ton absence et celle de nos bien-aimés Razan, Wael et Nazem en pensée. Le prix a été décerné à deux femmes : Naama Hassan, une poétesse et romancière de Gaza, et Garance Le Caisne, une journaliste française. Cette dernière a écrit deux livres, l’un sur le dossier César, dont tu avais entendu parler dans les mois précédant ton enlèvement, l’autre sur Mazen Al-Hamadeh, ce jeune militant de Deir Ezzor arrêté, torturé avec une cruauté indicible, marqué à jamais dans son corps et son esprit. Après sa libération, Mazen Al-Hamadeh avait parcouru l’Europe pour témoigner du calvaire des prisonniers en Syrie. Puis, de manière obscure, il était retourné en Syrie en 2020. Son corps a été retrouvé dans ls réfrigérateurs d’une morgue après la chute du régime. Il aurait été exécuté seulement quelques jours plus tôt. Garance a aussi co-réalisé un film sur la quête de justice, sans cesse frustrée, des Syriens en Europe.
Comme la cérémonie a eu lieu deux jours après la fuite de Bachar, que cette fuite signifiait sans conteste l’effondrement total de son régime, l’ambiance a basculé de la gravité du souvenir de ton absence, de celle de Razan, de Wael, de Nazem, à une fête musicale très joyeuse, en présence d'Abu Gabi, le chanteur et musicien palestino-syrien, accompagné de la chanteuse syrienne Rasha Rizk et du musicien Harith Mehdi. Certaines de tes camarades étaient là : Wijdan, Afaf, Hind, Doha, Lina. La soirée s’est prolongée pendant trois heures, une célébration de la chute du régime, où le public, emporté par l’émotion, chantait et dansait avec les artistes. Cette soirée avait ainsi réuni Samira et la Syrie, l’une des deux paraissant sur le point de sortir de l’ombre.
En ce qui me concerne, la Syrie ne sortira jamais complètement de l’absence tant que toi, Samour, tu n’en sortiras pas. C’est ce qui m’a laissé presque paralysé, partagé entre la joie de mes amis et une épine insurmontable dans la gorge. Que la Syrie change, qu’elle se libère, que des milliers de prisonniers soient libérés des terribles geôles assadiennes, alors que ton long silence perdure, cela signifie qu’une partie de la Syrie n’a pas été libérée, pas qu'en ce qui nous concerne toi et moi, ni même de tes compagnons d’absence, mais celle de dizaines de milliers d’autres. Plus de 113 000 sont disparus, selon les sources les plus fiables en matière de droits humains.
L’un des moments les plus marquants après la chute du régime a été la libération des détenus de Saydnaya. Ils n’étaient guère plus de 1 500. Une terrible nouvelle, car elle signifie que la machine de mort a tourné à plein régime pendant des années. Pour les familles qui se sont rendues dans cette prison infernale à la recherche de leurs proches, il ne restait qu’une seule alternative : chercher dans les fosses communes, de plus en plus nombreuses. Mais l’histoire la plus bouleversante, parmi ces récits de cruel espoir, est celle d’une mère septuagénaire venue de Raqqa pour retrouver son fils, disparu depuis 2011. Elle ne l’a pas trouvé. Alors, elle a pris avec elle un nœud coulant, imbibé de rouge, comme si elle emportait quelque chose que son enfant avait connu, comme si c’était tout ce qu’il restait de lui, un dernier vestige de son existence. Il existe des photos d’elle, debout, le nœud coulant enroulé autour de ses épaules. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ma propre mère. Combien un cœur doit-il endurer !
Après des années de silence, j’ai commencé à t’écrire une lettre en octobre 2024, que j’ai intitulée La Gardienne de l’Espoir. Car ton absence, depuis onze ans, a estompé mon espoir, tant sur le plan intime que collectif. Mais je me suis arrêté après quelques lignes : que pouvais-je te dire de l’état du monde en ton absence, alors que tu es cet état du monde ? Que pourraient t’en dire ceux qui ne partagent pas cette absence ? Toi seule as tout vécu, toi seule peux en témoigner pleinement. Quant à moi, j’ai tenté, tout au long des années, d’oublier ton absence, de ne pas la porter à chaque instant et à chaque minute. Mais elle revenait sans cesse, surgissant sans prévenir, m'arrachant à mes illusions comme tu as été arrachée il y a onze ans.
Je t’écris, après tant d’années, pour te confier ce qui aurait été la plus grande des nouvelles si tu avais été encore là : le régime est tombé ! Bachar al-Assad s’est enfui en Russie ! Il n’a pas dit un mot pour son prétendu public, ni pour les Syriens. En quelques jours, un slogan ironique s’est répandu dans le pays : « Notre leader éternel… s’est enfui un dimanche ! » C’est une histoire étrange, Samour. Hay’at Tahrir al-Sham, autrefois Jabhat al-Nusra au moment de ton enlèvement, a lancé, en coordination avec d’autres groupes, une offensive pour reconquérir des territoires que le régime avait repris, malgré leur statut de « zones de désescalade » selon l’accord d’Astana conclu sous l’égide de la Turquie, de l’Iran et de la Russie. En un éclair, Alep est tombée. Puis Hama, après une brève résistance. Ensuite Homs. Et enfin Damas, libérée à 6h18 du matin, le 8 décembre 2024 – une heure désormais inscrite sur les vitres de certaines voitures, la veille de l’anniversaire de ton enlèvement.
L’opération, qui a duré tout juste douze jours, a été marquée par un courage sidérant, une coordination parfaite, une discipline sans faille qui a conduit à un faible nombre de violations. J’ai craint qu’en quittant Hama pour Homs, ils ne sèment un carnage, mais rien de tel ne s’est produit. Ceux qui avaient fui Homs, par crainte de représailles sectaires et de massacres – y compris certains de nos proches – y sont retournés après deux ou trois jours. Lulu et Najat sont restées sur place et n’ont rencontré aucun problème. Je mentionne Najat et Lulu uniquement parce qu’Afif nous a quittés il y a quelques mois. J’aurais tant voulu qu’il soit là pour voir le jour de la libération ! Je ne t’ai jamais dit non plus que le Dr Munif est mort subitement deux ans avant lui. Afif n’avait plus le goût de vivre après la perte de son frère, et la situation du pays était devenue si pourrie, si désespérée. Waad et Jojo ont pu se rendre à Homs pour faire leurs adieux à leur père et soutenir leur mère et leur sœur. Je t’ai dit que Jojo vivait en Allemagne depuis des années, qu’elle a épousé un Palestinien nommé Fajr, un homme aimant, et qu’ils ont une fille, Tamara, qui a maintenant presque trois ans. Waad et Thaer ont un fils, Assi, qui a presque dix ans, et ils ont finalement réussi à s’installer à Berlin après des années d’insécurité à Beyrouth. Peu après leur arrivée, le régime s’est effondré.
Tout est allé si vite que Bachar al-Assad, son frère Maher et les chefs de ses services de renseignement ont fui chacun de son côté. On a d'abord cru voir Ali Mamlouk, le chef du Bureau de la sécurité nationale, monter à bord d’une une petite embarcation dans la ville d’Arida, en direction du Liban, comme un réfugié syrien traversant la mer vers l’Europe depuis les côtes turques ou nord-africaines. Mais ce n’était pas lui, simplement un officier moins important.Les hauts responsables de la machine de mort semblent s’être dispersés entre la Russie, les Émirats arabes unis et le Liban.
Les nouveaux maîtres du pays ont surpris tout le monde par leur retenue. Ils ont apaisé les communautés, évité d’imposer un ordre brutal, cherché à apparaître respectables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Certes, il y a eu des frictions, mais leur priorité était d’instaurer un semblant d’ordre. Les puissances internationales ont accueilli ces événements avec méfiance et réticence. Si elles en avaient eu le temps, elles auraient tout fait pour préserver le statu quo sanglant qui régnait depuis 2013. Le miracle, ce n’est pas seulement la chute du régime qui gouvernait le pays depuis cinquante-quatre ans, c’est aussi la rapidité de son effondrement, si soudaine que personne n’a compris ce qui se passait. Même ceux qui ont pris le pouvoir semblent ne pas avoir anticipé à quel point le régime allait vite s’écrouler. Mais ils ont eu le courage – et il faut leur reconnaître cela – de s’emparer des quatre grandes villes qui forment la colonne vertébrale du pays, en un temps record, avec des pertes humaines très limitées.
J’étais en France quand tout cela s’est produit, Samour. J’y avais publié un livre en français, et une très douce soirée de lancement avait été organisée à Paris, en présence de nos proches, amis et connaissances. Je travaillais aussi avec des partenaires pour organiser la deuxième édition d’une cérémonie de remise de prix en ton nom. Je ne t’en avais pas encore parlé. L’idée est de décerner un prix en ton nom à une femme de la région arabe ou méditerranéenne qui accomplit un travail important dans le domaine de la littérature, de l’art ou des droits humains, sans pour autant être une vedette célèbre. La première édition a eu lieu en 2023, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le prix avait été décerné à Reem al-Ghazi, une réalisatrice de documentaires syrienne, dont tu connais sans doute au moins le nom. Cette fois-ci, la cérémonie s’est tenue le jour de l’anniversaire de ton absence et celle de nos bien-aimés Razan, Wael et Nazem en pensée. Le prix a été décerné à deux femmes : Naama Hassan, une poétesse et romancière de Gaza, et Garance Le Caisne, une journaliste française. Cette dernière a écrit deux livres, l’un sur le dossier César, dont tu avais entendu parler dans les mois précédant ton enlèvement, l’autre sur Mazen Al-Hamadeh, ce jeune militant de Deir Ezzor arrêté, torturé avec une cruauté indicible, marqué à jamais dans son corps et son esprit. Après sa libération, Mazen Al-Hamadeh avait parcouru l’Europe pour témoigner du calvaire des prisonniers en Syrie. Puis, de manière obscure, il était retourné en Syrie en 2020. Son corps a été retrouvé dans ls réfrigérateurs d’une morgue après la chute du régime. Il aurait été exécuté seulement quelques jours plus tôt. Garance a aussi co-réalisé un film sur la quête de justice, sans cesse frustrée, des Syriens en Europe.
Comme la cérémonie a eu lieu deux jours après la fuite de Bachar, que cette fuite signifiait sans conteste l’effondrement total de son régime, l’ambiance a basculé de la gravité du souvenir de ton absence, de celle de Razan, de Wael, de Nazem, à une fête musicale très joyeuse, en présence d'Abu Gabi, le chanteur et musicien palestino-syrien, accompagné de la chanteuse syrienne Rasha Rizk et du musicien Harith Mehdi. Certaines de tes camarades étaient là : Wijdan, Afaf, Hind, Doha, Lina. La soirée s’est prolongée pendant trois heures, une célébration de la chute du régime, où le public, emporté par l’émotion, chantait et dansait avec les artistes. Cette soirée avait ainsi réuni Samira et la Syrie, l’une des deux paraissant sur le point de sortir de l’ombre.
En ce qui me concerne, la Syrie ne sortira jamais complètement de l’absence tant que toi, Samour, tu n’en sortiras pas. C’est ce qui m’a laissé presque paralysé, partagé entre la joie de mes amis et une épine insurmontable dans la gorge. Que la Syrie change, qu’elle se libère, que des milliers de prisonniers soient libérés des terribles geôles assadiennes, alors que ton long silence perdure, cela signifie qu’une partie de la Syrie n’a pas été libérée, pas qu'en ce qui nous concerne toi et moi, ni même de tes compagnons d’absence, mais celle de dizaines de milliers d’autres. Plus de 113 000 sont disparus, selon les sources les plus fiables en matière de droits humains.
L’un des moments les plus marquants après la chute du régime a été la libération des détenus de Saydnaya. Ils n’étaient guère plus de 1 500. Une terrible nouvelle, car elle signifie que la machine de mort a tourné à plein régime pendant des années. Pour les familles qui se sont rendues dans cette prison infernale à la recherche de leurs proches, il ne restait qu’une seule alternative : chercher dans les fosses communes, de plus en plus nombreuses. Mais l’histoire la plus bouleversante, parmi ces récits de cruel espoir, est celle d’une mère septuagénaire venue de Raqqa pour retrouver son fils, disparu depuis 2011. Elle ne l’a pas trouvé. Alors, elle a pris avec elle un nœud coulant, imbibé de rouge, comme si elle emportait quelque chose que son enfant avait connu, comme si c’était tout ce qu’il restait de lui, un dernier vestige de son existence. Il existe des photos d’elle, debout, le nœud coulant enroulé autour de ses épaules. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ma propre mère. Combien un cœur doit-il endurer !
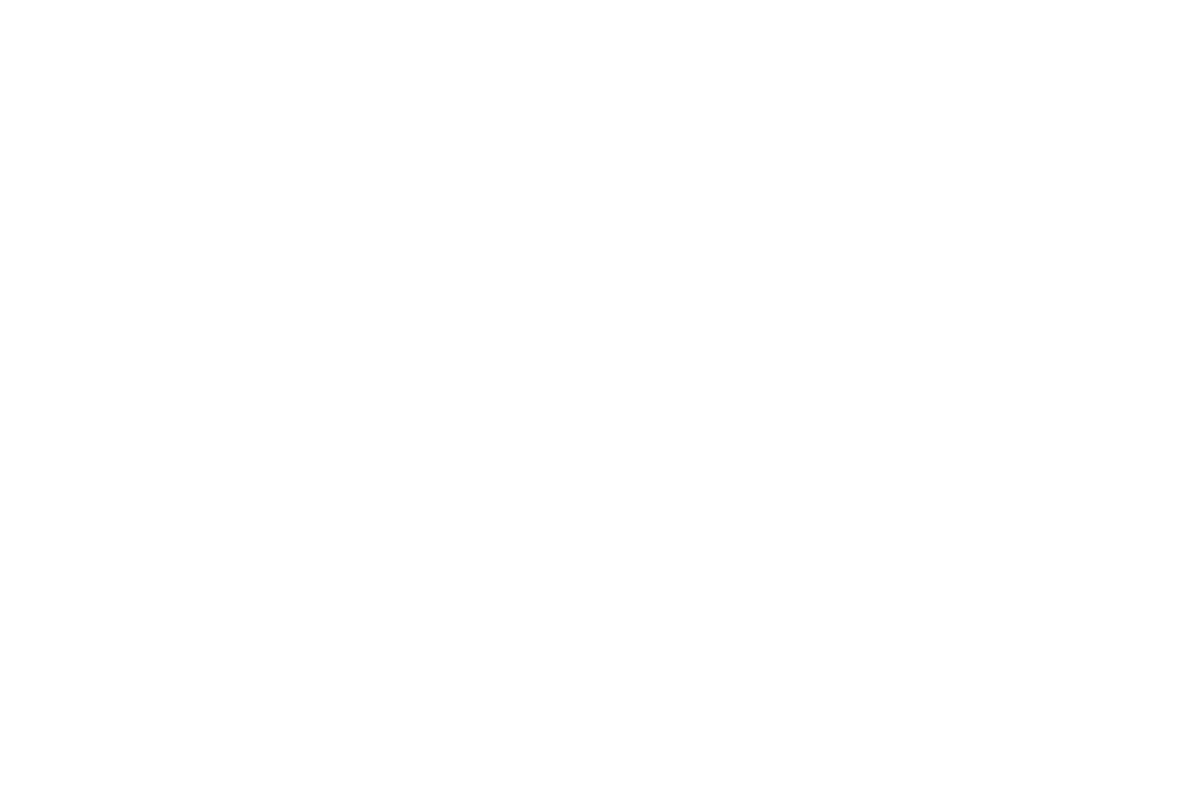
Un ami m’a écrit depuis Damas pour me dire que la première chose qu’il a faite à son retour dans la ville a été de visiter la tombe de son père, disparu il y a douze ans. Puis, il s’est rendu à Douma, devant ce qui fut autrefois le bureau du Centre de documentation des violations, là où toi et Razan travailliez au moment de mon départ catastropique de la Ghouta orientale. C’est aussi de cet endroit que vous avez plus tard été enlevées, en compagnie de Wael et Nazem. Il m’a écrit que la porte avait changé, que ses coups n’avaient reçu aucune réponse. Cette porte, criblée d’éclats d’obus et de balles, ne quitte jamais ma mémoire, grâce à une photo de toi en train d’en franchir le seuil, un châle blanc sur ton épaule. Cette image, après ton absence, est devenue célèbre, reproduite sur des posters et des affiches.
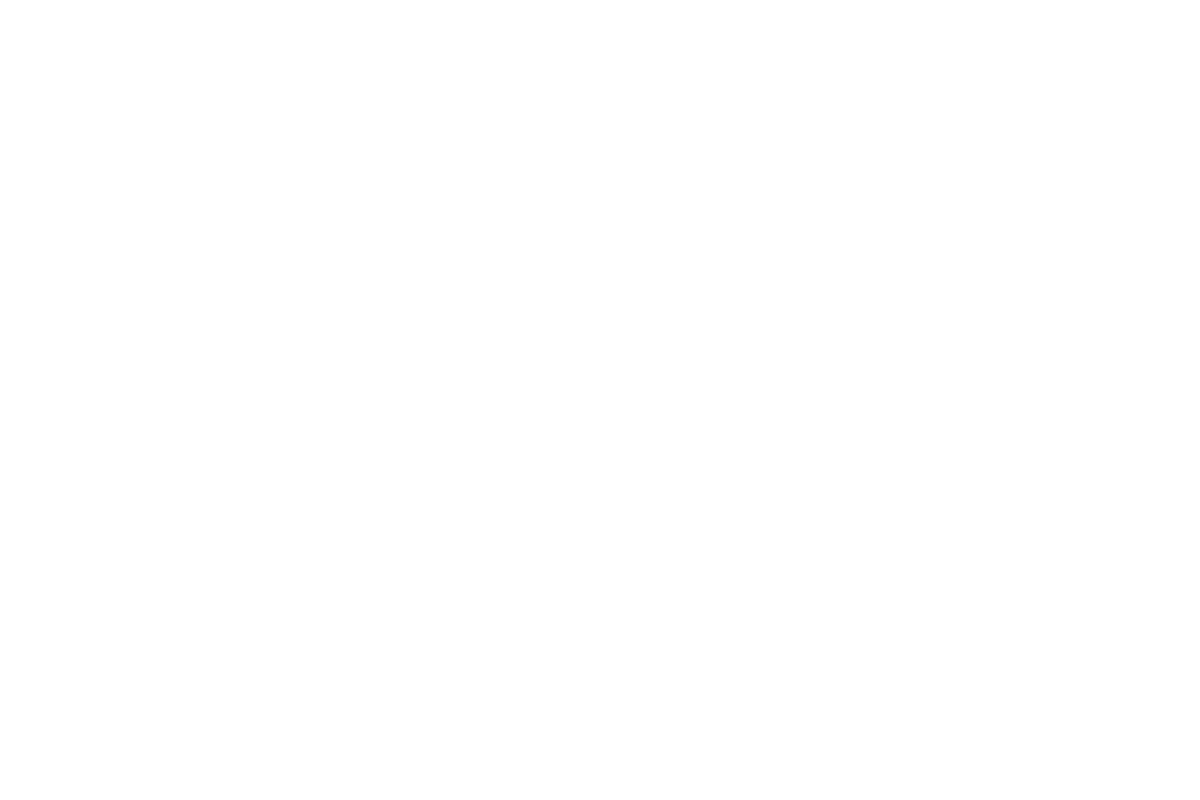
Je veux y aller, comme un pèlerinage jusqu’au dernier endroit lié à toi. Dans quelques jours, je serai à Damas, Samour, après une absence de presque onze ans et neuf mois de cette ville qui a été le théâtre de notre vie commune, de notre amour, de notre premier baiser, puis de notre mariage. C’est aussi là que nous sommes devenus demandés par les services de renseignement.
Nous savons que tu es devenue une demandée seulement après ton départ de la ville, le 3 avril 2013. Mais il semble qu’un rapport de renseignement ait été établi bien avant cela, concernant ton arrestation, la mienne, celle de Thaer, Waad et du Dr Munif, avant même la fin de l’année 2012. Pour une raison inconnue, les poursuites à ton encontre n’ont été activées qu'à la suite de l’arrestation de Thaer, qui a eu lieu après mon départ clandestin pour la Ghouta orientale. Il ne te viendra pas à l’esprit comment j’ai appris cela. J’ai reçu des pages de ce rapport envoyées comme photos par un journaliste syrien, correspondant pour un quotidien américain. Dans les tout premiers jours de l’effondrement du régime, il a pu pénétrer dans l’un des centres de renseignement les plus redoutés, le centre 215 de la Sécurité militaire. Là, il est tombé sur ce document, l’a photographié et m’en a envoyé les images. Que ce genre de chose puisse arriver est précisément la preuve que le régime est tombé.
Nous savons que tu es devenue une demandée seulement après ton départ de la ville, le 3 avril 2013. Mais il semble qu’un rapport de renseignement ait été établi bien avant cela, concernant ton arrestation, la mienne, celle de Thaer, Waad et du Dr Munif, avant même la fin de l’année 2012. Pour une raison inconnue, les poursuites à ton encontre n’ont été activées qu'à la suite de l’arrestation de Thaer, qui a eu lieu après mon départ clandestin pour la Ghouta orientale. Il ne te viendra pas à l’esprit comment j’ai appris cela. J’ai reçu des pages de ce rapport envoyées comme photos par un journaliste syrien, correspondant pour un quotidien américain. Dans les tout premiers jours de l’effondrement du régime, il a pu pénétrer dans l’un des centres de renseignement les plus redoutés, le centre 215 de la Sécurité militaire. Là, il est tombé sur ce document, l’a photographié et m’en a envoyé les images. Que ce genre de chose puisse arriver est précisément la preuve que le régime est tombé.
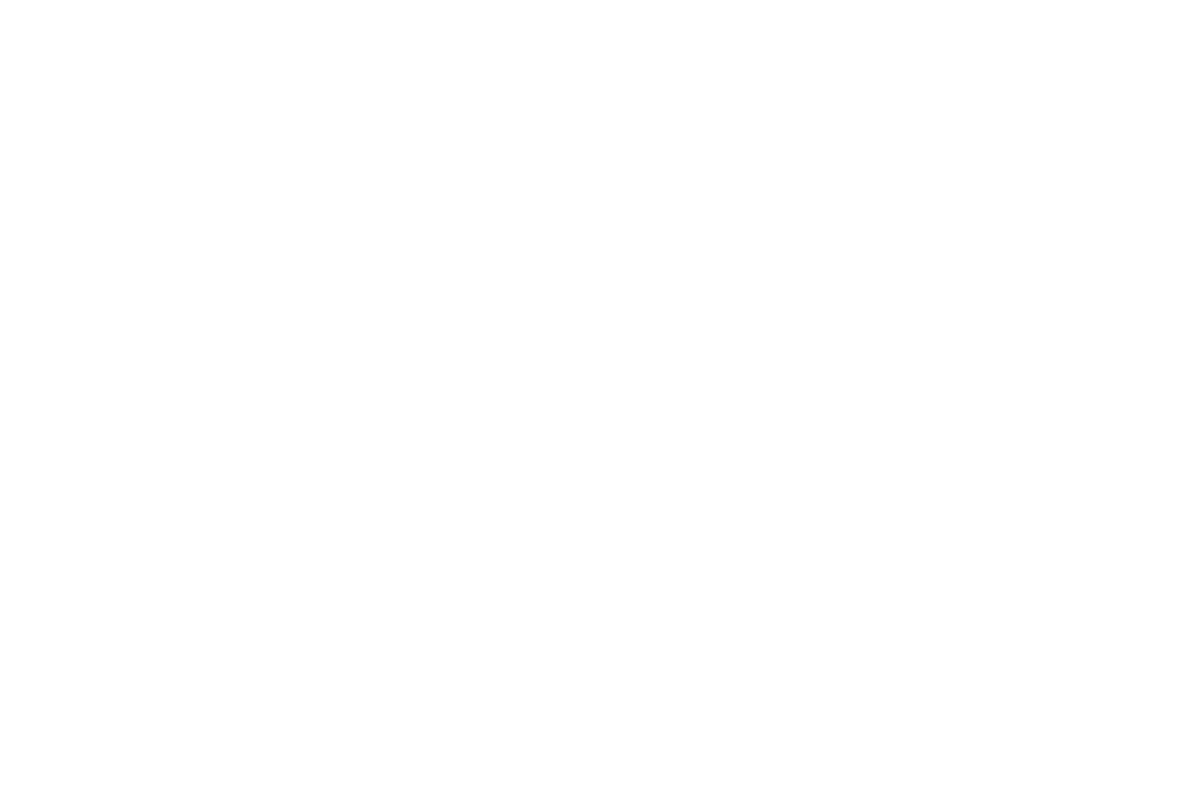
Dans la jungle des centres de renseignement assadiens, les premières pages du rapport s’adressent à la branche 261, demandant qu’elle transmette à la branche 294 une copie du document numéro 128148 daté du 18 novembre 2012, « concernant le dénommé Yassin Haj Saleh et ses compagnons ». Le document est signé par le chef de la branche 294. Quatre des cinq noms mentionnés dans le rapport – toi, Waad, Thaer et moi – sont précédés du qualificatif « dénommé ». Seul le Dr Munif échappe à cette désignation et est mentionné par son titre : docteur.
Le rapport affirme que nous partageons les mêmes idées, toi et moi, et que nous vivons en dehors du pays, bien que les contrôles de sécurité aux frontières n’aient trouvé aucune trace de notre départ ou de notre retour selon le document. Ce qui était bien entendu faux. Il indique également que nous travaillons « au service des coordinations de groupes armés situés à l’intérieur du pays » et que nous travaillons « pour des journaux du Golfe sur Internet et sur les réseaux sociaux /Facebook/ ». Puis, il ajoute que nous recevons « un soutien financier de l’étranger en échange d’incitation et de mobilisation ». L’adresse bancaire censée être utilisée pour ces transactions n’est rien d’autre que… le lien de ma page Facebook. Le rapport inclut aussi ton numéro de téléphone portable, mais pas le mien, que l’auteur du rapport ne possédait pas. Aujourd’hui, nous savons, Thaer, Waad, Jojo et moi, qui est cette personne. S’agissant justement de Thaer et Waad, le rapport les décrit comme étant « extrêmement actifs au service des groupes armés ». Ce qui m’échappe, c’est pourquoi ce rapport, rédigé à la fin de 2012, fait référence à une simple rencontre familiale entre nous cinq qui avait eu lieu au début de 2011, avant la révolution, avant l’apparition de toute « coordination » ou « groupe armé ».
Mais l’histoire la plus absurde dans ce mélange de banalité et de tragédie est celle de mon prétendu séjour à l’ambassade américaine de Damas avec d’autres opposants. Tu te souviens sûrement de cette histoire, Samour. Tandis que j’étais dans la Ghouta orientale, j’avais reçu des questions d’un journaliste que je ne connaissais pas – sans ce rapport, je ne me serais même pas souvenu de son nom, Jawad al-Sayegh – qui me demandait, entre autres choses, si j’avais effectivement séjourné à l’ambassade des États-Unis à Damas. Elle était pourtant fermée à l’époque, du fait de la rupture des relations américano-syriennes à la suite de la répression sauvage par le régime des manifestations pacifiques. Tu te rappelles qu’un journaliste propagandiste de quatrième zone avait lancé cette rumeur dès 2011, dans le but de me dépeindre comme un traître, ainsi que d’autres opposants, et de ridiculiser notre cause. Parmi ceux qu’il visait, il y avait aussi Razan Zaitouneh et Riad al-Turk. D’ailleurs, le « cousin » Riad al-Turk est décédé le 1er janvier 2024, à plus de 93 ans. Si seulement il avait vécu pour voir ces jours !
Lorsque j’ai lu ces questions envoyées par e-mail, j’ai été agacé par celle-ci en particulier et j’étais sur le point d’ignorer ce journaliste et son site chinois, Asia Times, dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Mais une idée m’a traversé l’esprit : retourner la question contre lui, jouer le jeu à ma manière.Tu te souviens sûrement de cette interview. Elle a été publiée à la fin du mois de mai 2013, quelques jours après ton arrivée en Ghouta orientale. À l’époque, j’avais répondu, comme tu le sais, que j’étais à mon aise dans l’ambassade de la superpuissance américaine à Damas, avec une électricité et une connexion Internet ininterrompues, des installations excellentes, et la compagnie d’autres opposants bien connus. La publication de l’interview a provoqué un rare scandale. Les adversaires de la révolution syrienne y ont vu une preuve irréfutable que nous étions des agents des Américains. Certains de nos amis ont été déconcertés par mes propos. Bien que j’aie répondu à la question avec le plus grand sérieux, j’avais fait usage d’une langue si excessive et emphatique qu’elle ne pouvait tromper nulle personne perspicace quant à son caractère ironique. Le rapport des renseignements lui-même semble perplexe à propos de cette affaire. Il mentionne l’embarras des opposants comme des loyalistes face à mes propos, cite ma réponse originale, mais sans y ajouter le moindre commentaire. À mon avis, le fond de cet embarras s’explique par le fait que cette entité, laquelle contrôle la vie et la mort des Syriens, n’est ni qualifiée ni autorisée à réfléchir et à juger de la validité des informations qu’elle reçoit. Il s’agit de collectionneurs d’informations brutes, dépourvus de toute compétence et surtout de la liberté de séparer le vrai du faux. Ils ne se sont évidemment pas posés la question de savoir si les Américains auraient vraiment confié les clés de leur ambassade fermée à des dissidents syriens. Rien n’est réel, mais cette rumeur est devenue une histoire que l’on raconte sans peine.
Après onze ans, huit mois et vingt-six jours d’absence, je suis arrivé à Damas, en franchissant la frontière libanaise dans l’après-midi du 29 décembre 2024, accompagné de deux amies, Leyla Dakhli, historienne franco-tunisienne résidant en Allemagne, et Justine Augier, écrivaine française, ainsi que Joseph [Confavreux], un journaliste français de Mediapart. Je n’avais jamais été aussi proche de toi depuis notre séparation ce jour maudit du 10 juillet 2013, lorsque je suis parti pour Raqqa, depuis ta longue absence silencieuse, entamée le soir du 9 décembre 2013. Quoiqu’il s’agisse d’un moment de joie et de célébration, que mes amies Leyla et Justine ont tenu à partager avec moi, une partie de moi est restée en retrait, car la Syrie ne sera pas libre tant que ma part d’elle, toi, demeure prisonnière d’un tunnel long et impénétrable.
Le soir même, nous nous sommes rendus tous les quatre au café Al-Rawda, que tu connais, où j’avais l’habitude de retrouver des amis avant la révolution. J’y ai rencontré Azza Abu Rabia et d’autres amies et amis, dans une atmosphère festive très joyeuse, entre chants, slogans déclamés en cœur, fumée de narguilé, flashs d’appareils photo et de téléphones et… les larmes.
Dès les premiers instants, on remarque la dégradation et le délabrement qui marquent Damas. Cela se voit dans les rues, dans les bâtiments, dans les taxis, dans l’hôtel où nous avons séjourné. Partout, l’usure du temps a laissé son empreinte, bien que des efforts de restauration et de rénovation soient visibles çà et là. Mais le temps et le manque d’entretien ont conspiré contre la plus ancienne ville encore habitée au monde. Au-delà de cela, la pauvreté est omniprésente à Damas. Elle s’incarne dans la présence massive de mendiants, y compris des femmes et des enfants, et dans les étals de fortune qui envahissent les trottoirs, rendant la marche presque impossible dans certaines portions de la ville. Damas, comme toute la Syrie, a souffert des sanctions internationales qui, comme à chaque précédent, ont davantage affecté la population que le régime lui-même. Mais la ville et le pays ont d’abord souffert d’un régime d’une cupidité extrême, de rare corruption et égoïsme, totalement dépourvu d’intérêt pour la nation, dont l’avidité ne s’est satisfaite ni d'argent, ni de pouvoir ou de possession des biens matériels. Aujourd’hui, Damas est une ville où l’air est gravement pollué. Cela a prolongé la toux dont je souffrais avant d’y arriver, une pollution exacerbée, selon certains, par l’afflux massif de véhicules venus d’Idlib et de la frontière turque. La ville est si congestionnée que la voiture qui nous a amenés de la frontière syro-libanaise a mis plus d’une demi-heure pour aller de la place des Omeyyades à notre hôtel, Burj al-Fardous, un trajet qui ne nécessite que dix minutes en temps normal.
L’une des premières choses que j’ai faites, avec l’aide de Sherine al-Hayek, une jeune amie, a été d’obtenir un numéro de téléphone syrien et d’acheter un petit sac à bandoulière pour transporter de l’argent liquide. Désormais, l’argent ne se porte plus dans les poches, tant la dévaluation de la livre syrienne a été considérable. À notre arrivée, cent dollars américains valaient 1 300 000 livres syriennes, soit 260 billets de 5 000 livres, la plus grosse coupure disponible. Chez les cambistes, on voyait des piles de billets attachées par des élastiques, chacune représentant à peine un demi-million de livres syriennes. J’ai entendu une blague disant que Bachar el-Assad avait promis de ne pas quitter le pouvoir avant que tous les Syriens ne deviennent pas tous millionnaires, et qu’il est parti après avoir tenu sa promesse.
Le lendemain, nous avons visité tous quatre la prison de Saydnaya, désormais un site sécurisé et surveillé, dont l’accès nécessite une autorisation spéciale. Joseph avait obtenu ce permis, mais de manière étrange, il était écrit en arabe qu’il s’agissait d’une accréditation pour une couverture journalistique dans les gouvernorats de Quneitra et Lattaquié, alors que Saydnaya relève de celui de Damas. Il y a clairement un désordre administratif symptomatique du chaos bureaucratique ambiant. Finalement, nous avons été autorisés à entrer dans ce fief de la terreur.
Nous avons vu les ailes de dortoirs collectifs, chacune regroupant dix cellules. Saydnaya m’a rappelé la prison centrale d’Alep, al-Muslimiya, où j’avais passé onze ans et quatre mois dans l’« aile politique ». Mais ce qui m’a frappé, sans que je puisse en comprendre la raison, est que nombre de murs intérieurs de ces cellules étaient en métal et non en béton. Les portes des dortoirs étaient également en métal, contrairement à celles d’al-Muslimiya, où les cellules étaient fermées par des grilles de fer, comme s’il n’y avait ainsi que trois murs au lieu de quatre.
Je ne trouve pas de mots plus justes pour résumer Saydnaya que ceux qu’emploiera plus tard Oum Hazem dans un reportage de Hala al-Humaidan sur la quête des traces des disparus. Oum Hazem, qui a perdu son mari et deux frères, n’a trouvé aucune trace d’eux en se rendant dans cet « abattoir humain » qu’elle décrit ainsi : « Une odeur rance, de l’humidité, du sang… et personne. »
Mais l’impression la plus marquante que laisse cet endroit, ce vaste espace entouré de murailles et gardé en permanence, où le bâtiment de la prison elle-même n’occupe pas plus de cinq pour cent de la superficie totale, est celle que diffuse la Syrie d’Assad dans son ensemble : un mélange rare de décrépitude et de violence sanglante, de ruine et de cruauté sauvage. Ce lieu misérable était méthodiquement entouré de murs et de gardes armés. On sait que ses prisonniers étaient affamés et que certains étaient exécutés chaque semaine. C’est un espace conçu pour annihiler tout espoir, un lieu où l’idée même de survie devient absurde, semblable à l’enfer de Dante.
Ce qui me venait à l’esprit, ma Samour, tandis que je marchais aujourd’hui devant le bâtiment fortifié et surveillé de l’état-major, les sites des administrations militaires de la Défense à Damas, ou encore devant le siège de la radio et de la télévision fortifié comme une citadelle, est que le régime avait tout prévu pour affronter une attaque armée contre les centres névralgiques de son pouvoir. Mais en réalité, il n’y a eu ni bataille ni résistance. Le régime s’est effondré sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré à Damas. Il était vain et rongé de l’intérieur, dépourvu de toute raison d’être. Il a fondu, s’est enfuit comme dissous dans son propre vide, ne perdant pas une bataille, mais perdant toute justification d’exister, s’évaporant sans la moindre résistance. Et cela, alors même que les puissances régionales et internationales s’employaient déjà à le réhabiliter, malgré sa longue histoire de crimes indicibles.
Au premier jour de l’année 2025, j’étais à la porte du Centre de Documentation des Violations, d’où toi, Razan, Wael et Nazem avez été enlevés. J’avais convié des amis et des proches à un rassemblement de deux heures devant ce bureau, qui a été transformé en logement pour une jeune famille. L’endroit avait été rénové et semblait désormais offrir un cadre de vie plus digne. Mais contrairement à ce que l’on m’avait dit, la porte du bâtiment n’avait pas changé, si ce n’est qu’elle avait été repeinte en blanc cassé alors qu’elle était auparavant d’un brun rouillé.
J’ai frappé à la porte de l’ancien bureau, accompagné de Lulu, de Lina Sinjab – que tu connais et qui travaille toujours pour la BBC – et d’un photographe britannique travaillant avec elle. Au bout d’une demi-minute, un jeune homme d’une trentaine d’années, ou un peu moins, nous a ouvert. Je lui ai expliqué la raison de notre présence, il ne savait rien de votre histoire, mais il nous a dit qu’il vivait ici depuis sept mois. Il s’est montré cordial et nous a permis, le photographe, Lulu et moi, de visiter les lieux, à l’exception d’une pièce où sa femme s’était réfugiée. C’était l’ancien bureau de Razan.
L’appartement avait été largement rénové, mais sa structure était restée la même. Dans la salle qui servait à la fois de salon et d’espace de travail, il y avait désormais un mobilier neuf plus élégant. Notre lit, dans la pièce intérieure, avait disparu, tout comme tout autre lit. La cour arrière où nous nous installions le soir était toujours là, mais elle aussi avait été rénovée.
Le rassemblement a réuni un nombre respectable de personnes, dont ton amie et ancienne codétenue Buthaina, accompagnée de son mari, Nizar. Nous avons brandi des posters avec des images, l’une de vous quatre, ainsi que de toi seule, de Razan seule, de Wael seul, de Nazem seul, une image de Razan et Wael ensemble, et enfin la couverture de ton livre Journal du siège à Douma 2013, dont je t’avais déjà parlé.
Le rapport affirme que nous partageons les mêmes idées, toi et moi, et que nous vivons en dehors du pays, bien que les contrôles de sécurité aux frontières n’aient trouvé aucune trace de notre départ ou de notre retour selon le document. Ce qui était bien entendu faux. Il indique également que nous travaillons « au service des coordinations de groupes armés situés à l’intérieur du pays » et que nous travaillons « pour des journaux du Golfe sur Internet et sur les réseaux sociaux /Facebook/ ». Puis, il ajoute que nous recevons « un soutien financier de l’étranger en échange d’incitation et de mobilisation ». L’adresse bancaire censée être utilisée pour ces transactions n’est rien d’autre que… le lien de ma page Facebook. Le rapport inclut aussi ton numéro de téléphone portable, mais pas le mien, que l’auteur du rapport ne possédait pas. Aujourd’hui, nous savons, Thaer, Waad, Jojo et moi, qui est cette personne. S’agissant justement de Thaer et Waad, le rapport les décrit comme étant « extrêmement actifs au service des groupes armés ». Ce qui m’échappe, c’est pourquoi ce rapport, rédigé à la fin de 2012, fait référence à une simple rencontre familiale entre nous cinq qui avait eu lieu au début de 2011, avant la révolution, avant l’apparition de toute « coordination » ou « groupe armé ».
Mais l’histoire la plus absurde dans ce mélange de banalité et de tragédie est celle de mon prétendu séjour à l’ambassade américaine de Damas avec d’autres opposants. Tu te souviens sûrement de cette histoire, Samour. Tandis que j’étais dans la Ghouta orientale, j’avais reçu des questions d’un journaliste que je ne connaissais pas – sans ce rapport, je ne me serais même pas souvenu de son nom, Jawad al-Sayegh – qui me demandait, entre autres choses, si j’avais effectivement séjourné à l’ambassade des États-Unis à Damas. Elle était pourtant fermée à l’époque, du fait de la rupture des relations américano-syriennes à la suite de la répression sauvage par le régime des manifestations pacifiques. Tu te rappelles qu’un journaliste propagandiste de quatrième zone avait lancé cette rumeur dès 2011, dans le but de me dépeindre comme un traître, ainsi que d’autres opposants, et de ridiculiser notre cause. Parmi ceux qu’il visait, il y avait aussi Razan Zaitouneh et Riad al-Turk. D’ailleurs, le « cousin » Riad al-Turk est décédé le 1er janvier 2024, à plus de 93 ans. Si seulement il avait vécu pour voir ces jours !
Lorsque j’ai lu ces questions envoyées par e-mail, j’ai été agacé par celle-ci en particulier et j’étais sur le point d’ignorer ce journaliste et son site chinois, Asia Times, dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Mais une idée m’a traversé l’esprit : retourner la question contre lui, jouer le jeu à ma manière.Tu te souviens sûrement de cette interview. Elle a été publiée à la fin du mois de mai 2013, quelques jours après ton arrivée en Ghouta orientale. À l’époque, j’avais répondu, comme tu le sais, que j’étais à mon aise dans l’ambassade de la superpuissance américaine à Damas, avec une électricité et une connexion Internet ininterrompues, des installations excellentes, et la compagnie d’autres opposants bien connus. La publication de l’interview a provoqué un rare scandale. Les adversaires de la révolution syrienne y ont vu une preuve irréfutable que nous étions des agents des Américains. Certains de nos amis ont été déconcertés par mes propos. Bien que j’aie répondu à la question avec le plus grand sérieux, j’avais fait usage d’une langue si excessive et emphatique qu’elle ne pouvait tromper nulle personne perspicace quant à son caractère ironique. Le rapport des renseignements lui-même semble perplexe à propos de cette affaire. Il mentionne l’embarras des opposants comme des loyalistes face à mes propos, cite ma réponse originale, mais sans y ajouter le moindre commentaire. À mon avis, le fond de cet embarras s’explique par le fait que cette entité, laquelle contrôle la vie et la mort des Syriens, n’est ni qualifiée ni autorisée à réfléchir et à juger de la validité des informations qu’elle reçoit. Il s’agit de collectionneurs d’informations brutes, dépourvus de toute compétence et surtout de la liberté de séparer le vrai du faux. Ils ne se sont évidemment pas posés la question de savoir si les Américains auraient vraiment confié les clés de leur ambassade fermée à des dissidents syriens. Rien n’est réel, mais cette rumeur est devenue une histoire que l’on raconte sans peine.
* * * * *
Après onze ans, huit mois et vingt-six jours d’absence, je suis arrivé à Damas, en franchissant la frontière libanaise dans l’après-midi du 29 décembre 2024, accompagné de deux amies, Leyla Dakhli, historienne franco-tunisienne résidant en Allemagne, et Justine Augier, écrivaine française, ainsi que Joseph [Confavreux], un journaliste français de Mediapart. Je n’avais jamais été aussi proche de toi depuis notre séparation ce jour maudit du 10 juillet 2013, lorsque je suis parti pour Raqqa, depuis ta longue absence silencieuse, entamée le soir du 9 décembre 2013. Quoiqu’il s’agisse d’un moment de joie et de célébration, que mes amies Leyla et Justine ont tenu à partager avec moi, une partie de moi est restée en retrait, car la Syrie ne sera pas libre tant que ma part d’elle, toi, demeure prisonnière d’un tunnel long et impénétrable.
Le soir même, nous nous sommes rendus tous les quatre au café Al-Rawda, que tu connais, où j’avais l’habitude de retrouver des amis avant la révolution. J’y ai rencontré Azza Abu Rabia et d’autres amies et amis, dans une atmosphère festive très joyeuse, entre chants, slogans déclamés en cœur, fumée de narguilé, flashs d’appareils photo et de téléphones et… les larmes.
Dès les premiers instants, on remarque la dégradation et le délabrement qui marquent Damas. Cela se voit dans les rues, dans les bâtiments, dans les taxis, dans l’hôtel où nous avons séjourné. Partout, l’usure du temps a laissé son empreinte, bien que des efforts de restauration et de rénovation soient visibles çà et là. Mais le temps et le manque d’entretien ont conspiré contre la plus ancienne ville encore habitée au monde. Au-delà de cela, la pauvreté est omniprésente à Damas. Elle s’incarne dans la présence massive de mendiants, y compris des femmes et des enfants, et dans les étals de fortune qui envahissent les trottoirs, rendant la marche presque impossible dans certaines portions de la ville. Damas, comme toute la Syrie, a souffert des sanctions internationales qui, comme à chaque précédent, ont davantage affecté la population que le régime lui-même. Mais la ville et le pays ont d’abord souffert d’un régime d’une cupidité extrême, de rare corruption et égoïsme, totalement dépourvu d’intérêt pour la nation, dont l’avidité ne s’est satisfaite ni d'argent, ni de pouvoir ou de possession des biens matériels. Aujourd’hui, Damas est une ville où l’air est gravement pollué. Cela a prolongé la toux dont je souffrais avant d’y arriver, une pollution exacerbée, selon certains, par l’afflux massif de véhicules venus d’Idlib et de la frontière turque. La ville est si congestionnée que la voiture qui nous a amenés de la frontière syro-libanaise a mis plus d’une demi-heure pour aller de la place des Omeyyades à notre hôtel, Burj al-Fardous, un trajet qui ne nécessite que dix minutes en temps normal.
L’une des premières choses que j’ai faites, avec l’aide de Sherine al-Hayek, une jeune amie, a été d’obtenir un numéro de téléphone syrien et d’acheter un petit sac à bandoulière pour transporter de l’argent liquide. Désormais, l’argent ne se porte plus dans les poches, tant la dévaluation de la livre syrienne a été considérable. À notre arrivée, cent dollars américains valaient 1 300 000 livres syriennes, soit 260 billets de 5 000 livres, la plus grosse coupure disponible. Chez les cambistes, on voyait des piles de billets attachées par des élastiques, chacune représentant à peine un demi-million de livres syriennes. J’ai entendu une blague disant que Bachar el-Assad avait promis de ne pas quitter le pouvoir avant que tous les Syriens ne deviennent pas tous millionnaires, et qu’il est parti après avoir tenu sa promesse.
Le lendemain, nous avons visité tous quatre la prison de Saydnaya, désormais un site sécurisé et surveillé, dont l’accès nécessite une autorisation spéciale. Joseph avait obtenu ce permis, mais de manière étrange, il était écrit en arabe qu’il s’agissait d’une accréditation pour une couverture journalistique dans les gouvernorats de Quneitra et Lattaquié, alors que Saydnaya relève de celui de Damas. Il y a clairement un désordre administratif symptomatique du chaos bureaucratique ambiant. Finalement, nous avons été autorisés à entrer dans ce fief de la terreur.
Nous avons vu les ailes de dortoirs collectifs, chacune regroupant dix cellules. Saydnaya m’a rappelé la prison centrale d’Alep, al-Muslimiya, où j’avais passé onze ans et quatre mois dans l’« aile politique ». Mais ce qui m’a frappé, sans que je puisse en comprendre la raison, est que nombre de murs intérieurs de ces cellules étaient en métal et non en béton. Les portes des dortoirs étaient également en métal, contrairement à celles d’al-Muslimiya, où les cellules étaient fermées par des grilles de fer, comme s’il n’y avait ainsi que trois murs au lieu de quatre.
Je ne trouve pas de mots plus justes pour résumer Saydnaya que ceux qu’emploiera plus tard Oum Hazem dans un reportage de Hala al-Humaidan sur la quête des traces des disparus. Oum Hazem, qui a perdu son mari et deux frères, n’a trouvé aucune trace d’eux en se rendant dans cet « abattoir humain » qu’elle décrit ainsi : « Une odeur rance, de l’humidité, du sang… et personne. »
Mais l’impression la plus marquante que laisse cet endroit, ce vaste espace entouré de murailles et gardé en permanence, où le bâtiment de la prison elle-même n’occupe pas plus de cinq pour cent de la superficie totale, est celle que diffuse la Syrie d’Assad dans son ensemble : un mélange rare de décrépitude et de violence sanglante, de ruine et de cruauté sauvage. Ce lieu misérable était méthodiquement entouré de murs et de gardes armés. On sait que ses prisonniers étaient affamés et que certains étaient exécutés chaque semaine. C’est un espace conçu pour annihiler tout espoir, un lieu où l’idée même de survie devient absurde, semblable à l’enfer de Dante.
Ce qui me venait à l’esprit, ma Samour, tandis que je marchais aujourd’hui devant le bâtiment fortifié et surveillé de l’état-major, les sites des administrations militaires de la Défense à Damas, ou encore devant le siège de la radio et de la télévision fortifié comme une citadelle, est que le régime avait tout prévu pour affronter une attaque armée contre les centres névralgiques de son pouvoir. Mais en réalité, il n’y a eu ni bataille ni résistance. Le régime s’est effondré sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré à Damas. Il était vain et rongé de l’intérieur, dépourvu de toute raison d’être. Il a fondu, s’est enfuit comme dissous dans son propre vide, ne perdant pas une bataille, mais perdant toute justification d’exister, s’évaporant sans la moindre résistance. Et cela, alors même que les puissances régionales et internationales s’employaient déjà à le réhabiliter, malgré sa longue histoire de crimes indicibles.
* * * * *
Au premier jour de l’année 2025, j’étais à la porte du Centre de Documentation des Violations, d’où toi, Razan, Wael et Nazem avez été enlevés. J’avais convié des amis et des proches à un rassemblement de deux heures devant ce bureau, qui a été transformé en logement pour une jeune famille. L’endroit avait été rénové et semblait désormais offrir un cadre de vie plus digne. Mais contrairement à ce que l’on m’avait dit, la porte du bâtiment n’avait pas changé, si ce n’est qu’elle avait été repeinte en blanc cassé alors qu’elle était auparavant d’un brun rouillé.
J’ai frappé à la porte de l’ancien bureau, accompagné de Lulu, de Lina Sinjab – que tu connais et qui travaille toujours pour la BBC – et d’un photographe britannique travaillant avec elle. Au bout d’une demi-minute, un jeune homme d’une trentaine d’années, ou un peu moins, nous a ouvert. Je lui ai expliqué la raison de notre présence, il ne savait rien de votre histoire, mais il nous a dit qu’il vivait ici depuis sept mois. Il s’est montré cordial et nous a permis, le photographe, Lulu et moi, de visiter les lieux, à l’exception d’une pièce où sa femme s’était réfugiée. C’était l’ancien bureau de Razan.
L’appartement avait été largement rénové, mais sa structure était restée la même. Dans la salle qui servait à la fois de salon et d’espace de travail, il y avait désormais un mobilier neuf plus élégant. Notre lit, dans la pièce intérieure, avait disparu, tout comme tout autre lit. La cour arrière où nous nous installions le soir était toujours là, mais elle aussi avait été rénovée.
Le rassemblement a réuni un nombre respectable de personnes, dont ton amie et ancienne codétenue Buthaina, accompagnée de son mari, Nizar. Nous avons brandi des posters avec des images, l’une de vous quatre, ainsi que de toi seule, de Razan seule, de Wael seul, de Nazem seul, une image de Razan et Wael ensemble, et enfin la couverture de ton livre Journal du siège à Douma 2013, dont je t’avais déjà parlé.
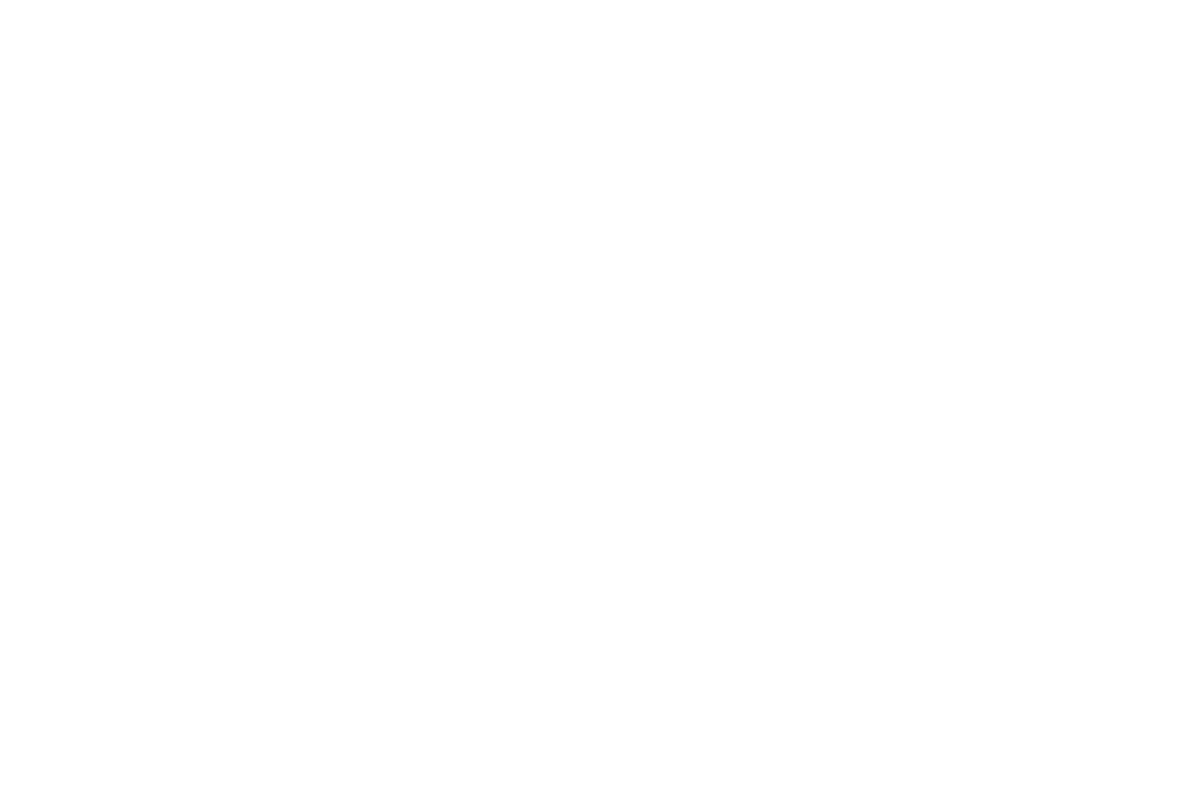
Il y avait également de nombreux journalistes et reporters venus toute région, des Syriens, des Arabes, des Européens... Je pense avoir donné une vingtaine d’interviews au cours des deux heures du sit-in, ainsi qu’une demi-heure avant et une autre après. J’ai raconté votre histoire, nommé les coupables : Jaïsh al-Islam, dont les dirigeants sont d’ailleurs revenus à Douma. Parmi eux, l’instigateur du crime et la figure à l’origine de notre calvaire, le juriste religieux Samir Kaaka. Je ne suis pas certain que l’autre personne clé de cette machine répressive, le responsable sécuritaire Omar al-Dirani, fasse partie des revenants. Depuis le printemps 2018, ils avaient été déplacés vers la région d’al-Bab, dans le nord de la Syrie. J’ai affirmé dans ces entretiens que nous aspirons à connaître la vérité complète sur votre sort, à obtenir justice en demandant des comptes aux coupables. J’ai dit que le critère permettant de mesurer les avancées vers la justice en Syrie est votre affaire et plus largement la question des disparitions forcées. Car ce crime représente l’une des formes les plus extrêmes de l’absence de justice dans notre terrible pays.
Après neuf jours à Damas, je suis parti pour Homs avec Najat et Lulu, qui avaient passé deux semaines à Damas pour changer d’air. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser, Samour, que c’était la première fois que je me rendais à Homs sans toi. Nous sommes arrivés dans l’après-midi, vers trois heures, dans une voiture louée par ta sœur et sa fille. Najat a estimé que je devais passer cette première nuit chez Fatima et Bassam, pendant qu’elle et Alaa préparaient la maison qu’elles avaient quittée depuis déjà un moment. La rencontre avec Fatima a été émouvante. Nous avons pleuré dans les bras l’un de l’autre. Comme elle te ressemble, ta petite sœur ! Nous avons veillé jusqu’à une heure du matin, parlant, buvant du arak. Toi et ta longue absence étiez le sujet de notre longue conversation. L’un des constats les plus douloureux qui m’est apparu progressivement, après des années de ton absence, est que ton histoire n’est pas suffisamment connue, et aussi qu’il y a une tendance parmi certains cercles de proches et connaissances à me tenir pour responsable de ta disparition, sans jamais m’avoir interrogé sur le sujet, sans avoir lu ce que j’ai écrit à ton sujet, sans même avoir lu ton propre livre, tout cela étant facilement accessible à tous ceux qui le veulent. Il s’est produit une superposition de plusieurs éléments : des divergences politiques, des tensions personnelles, la déliquescence de la révolution après ton enlèvement, et cette fracture entre ceux qui sont restés et ceux qui ont dû partir. Tout cela a été utilisé contre moi. Nous avons parlé pendant neuf heures. Nos cœurs se sont apaisés. Mais après cette longue journée, cette nuit d’échanges, et tout ce qui n’a pas été dit, j’ai compris à quel point il est cruel que ton absence puisse être utilisée contre moi.
Le lendemain, Bassam m’a emmené en voiture parcourir les abords du quartier détruit de Baba Amr, la rue entre les deux horloges, l’ancienne et la nouvelle, ainsi que le boulevard du Brésil. La ville était animée, vibrante, bien que marquée, comme Damas, par une décrépitude avancée. Bassam avait organisé une rencontre avec un groupe de jeunes hommes et femmes pour discuter de la situation du pays. J’ai demandé à y assister et il s’est montré enthousiaste. De l’autre côté de la rue où se trouve son magasin de produits naturels – savons, baumes, crèmes – qu’il a lui-même développés et transformés en un projet prospère au fil des années, nous nous sommes assis sur le trottoir, sous le soleil doux de janvier, certains sur des chaises, d’autres sur des blocs de béton. Nous avons discuté pendant une heure de ce qui s’est passé, de ce qui se passe et de ce qu’il faudrait faire. Nous étions trois hommes dans la soixantaine, tous d’anciens prisonniers politiques, trois jeunes femmes dans la vingtaine et trois jeunes hommes du même âge. Ce petit colloque en plein air, un mois exactement après la chute du régime, le 8 janvier 2025, symbolisait cette nouvelle réalité, événement impensable un mois plus tôt. Les jeunes veulent agir, mais ils ont besoin d’être guidés, orientés, organisés. Ils pensent que nous pouvons les aider.
Après ce colloque du trottoir, nous nous sommes rendus chez « la doyenne » Najat, qui avait décidé que nous passerions tous la nuit ensemble : Fatima, Bassam, Thaer – arrivé en Syrie de Berlin après avoir rendu visite à son père à Beyrouth –, Alaa et moi. Les larmes étaient présentes, mais ce furent celles de Thaer cette fois-ci, découvrant pour la première fois cette maison en l’absence d’Afif. Murad était là aussi. Il nous a raconté une anecdote. En se promenant dans la ville où il est né, après plus de dix ans passés en Allemagne, il a été submergé par l’émotion. Il a alors enlevé ses chaussures pour honorer un vœu qu’il avait fait s’il revenait un jour à Homs, et il s’est assis sur un trottoir, la tête entre les mains. Une minute plus tard, un jeune homme est venu le voir, cherchant à le réconforter et lui proposant son aide. Il l’avait pris pour un sans-abri ou un mendiant. Murad, avec son allure bohème, pouvait facilement prêter à confusion. Murad lui a répondu qu’il était juste épuisé par une longue absence. « Tu viens d’où ? » lui a demandé le jeune homme – « D’Allemagne. » L’autre a souri : « Dans ce cas, c’est toi qui devrais me donner de l’argent ! » Nous avons veillé jusqu’à deux heures du matin, parlant de politique, buvant du arak, échangeant nos récits.
Le sentiment général dans le pays, selon Abed al-Rays, est celui d’un soulagement, d’une délivrance, d’une longue expiration. al-Rays, un ami de Homs que j’avais rencontré une seule fois avant la révolution, m’a invité à prendre la parole devant un petit groupe d’auditeurs au monastère des Pères Jésuites à Homs. Cette rencontre a eu lieu dans l’après-midi du 9 janvier, durant deux heures, à propos de la pensée, de la politique, et du rôle des intellectuels.
Lulu est désormais une militante engagée dans une organisation récemment fondée, dédiée à la paix civile à Homs, cette ville dont tu as connu une partie des souffrances avant ton enlèvement, et qui a continué à en subir d'autres pendant encore près de deux ans plus tard. Tout cela a conduit à un nombre incalculable de victimes, une destruction massive de l'infrastructure urbaine et, surtout, une fracture profonde dans le tissu social, en particulier entre sunnites et alaouites. Après la libération, les quartiers alaouites ont été « ratissés » à la recherche d’armes et de personnes recherchées, peut-être aussi pour signifier une présence. Cela a conduit à une manifestation d’Alaouites où des slogans sectaires ont été scandés, à laquelle a répondu dès le lendemain une manifestation sunnite où d'autres slogans sectaires ont également été brandis. Les ratissages ont pris fin la veille de notre arrivée, mais la situation à Homs demeure fragile et instable. Les rues des quartiers alaouites se vident dès le coucher du soleil. Dans les quartiers sunnites, la destruction est immense ; cependant, ce qui n'a pas été détruit reste animé jusqu’à près de minuit.
Rien de comparable avec Lattaquié, où je me suis rendu trois jours après Homs, évidemment accueilli chez nos amis Haitham et Zubaida, dans la même chambre que nous occupions tous deux lorsque nous visitions la ville. Le soir même, nous nous sommes retrouvés dans un petit bar du quartier des Américains à Lattaquié, en compagnie de Haitham, de l’écrivain Nabil Suleiman – que tu connais, ainsi que certaines de ses œuvres, qui figuraient dans notre bibliothèque –, de Amer al-Marei, fils du Dr Munif, et de sa jeune compagne, ainsi que d’autres amis. Un chanteur originaire de Lattaquié, Samer Ahmad, s’est joint à nous pour un moment. Il a une chanson intitulée Allah y’raïhna minno – « Que Dieu nous en débarasse ! » –, une phrase qu'il répétait depuis des années et qui est finalement devenue le refrain d’une chanson en dialecte syrien. La chanson se moque de Bachar al-Assad et exprime une confiance inébranlable dans la Syrie et son peuple. Nous sommes rentrés chez nous vers minuit.
Sur la route de Homs à Lattaquié, nous avons croisé huit ou neuf checkpoints armés. Certains nous ont laissés passer sans nous arrêter, mais deux d’entre eux ont demandé à voir nos papiers d’identité, au conducteur et à moi, un autre nous a fait ouvrir le coffre de la voiture et un dernier nous a demandé si nous transportions des armes. Tout cela s’est déroulé sur la seule première moitié du trajet ; la seconde était libre de tout contrôle jusqu’à l’entrée de la ville, où un dernier checkpoint tenu par un seul homme ne nous a même pas arrêtés. Le chauffeur a justifié cela par le fait que la région à l’ouest de Homs était infestée de bandes armées spécialisées dans les vols et les enlèvements, et que ces checkpoints avaient été installés principalement pour empêcher leurs crimes. Quelques jours plus tard, dans la ville de Fahil, à l’ouest de Homs, quinze anciens soldats des forces du régime ont été exécutés, bien qu’ils n’aient pas opposé de résistance, selon des informations concordantes. Certains étaient même déjà retraités. La situation sécuritaire est instable, et aucune règle claire ne semble avoir été établie pour gérer les crises émergentes. Le pays est dans un état de fluidité totale, sans structure définie, et les rumeurs se propagent dans tous les sens.
Jad, le fils de Haitham et Zubaida, est maintenant un jeune homme de vingt et un ans. Il étudie la littérature française à l’université, mais il apprend aussi l’allemand et envisage de partir en Allemagne pour acquérir des compétences professionnelles dans l’hôtellerie, la restauration ou la menuiserie.
Les sentiments oscillent ici entre « délivrance » et anxiété face aux dangers de l’extrémisme religieux ou politique. Mais il y a aussi une soif de réunions, d’échanges, de débats, et une quête de réponses que personne ne semble encore posséder.
Le lendemain après-midi, Amer al-Marei m’avait organisé une rencontre avec une trentaine de personnes intéressées à la chose publique. Nous avons échangé nos analyses de la situation et des devenirs possibles. J’ai expliqué que nous ne nous dirigeons pas vers la démocratie, en raison de la nature même du nouveau pouvoir en place, qui est tout sauf démocratique voire qui, jusqu’à il y a quelques années, rendait blasphématoire l’idée même de démocratie. Cependant, j’ai exclu la possibilité d’un État islamique, je pense plutôt que nous allons vers une nouvelle forme de politique des notables, où les groupes sociaux sont représentés par leurs figures tutélaires, comme c’était le cas lors des années qui ont suivi l’indépendance de la Syrie. Ce type de gouvernance exclurait, ou du moins limiterait, la présence de qui – comme nous – incarne un réel pluralisme intellectuel et politique. J’ai insisté sur l’importance d’œuvrer à l’adoption de lois interdisant et criminalisant la torture, en nous appuyant sur notre expérience historique où la torture est allée de pair avec la destruction sociale et humaine, le sectarisme, et, in fine, l’effondrement du pays.
L’audience était variée, aussi bien en termes de genre que d’âge et d’origines sociales, liée par un état d’esprit résolument positif. On sentait que l’apaisement des gens quant à la chose publique conduisait à un apaisement des échanges entre eux. Cela pourrait peut-être expliquer en partie pourquoi la violence n’est pas généralisée dans les villes, malgré le chaos et l’instabilité. C’est la « délivrance » qui élargit l’infrastructure sociale du pays, malgré la misère et la dégradation de ses infrastructures civiles. Mais si des solutions efficaces tardent à être mises en place, cette morale collective pourrait de nouveau être écrasée, générant de nouvelles pathologies.
Après deux jours à Lattaquié, je suis retourné à Damas. Mes amis Farouk Mardam Bey, Subhi Hadidi et Ziad Majed, que tu connais, étaient arrivés quelques heures avant moi. Farouk revenait dans sa ville natale pour la première fois en un demi-siècle. Subhi foulait le sol syrien pour la première fois en trente-huit ans d’exil. À leur arrivée, ils ont été accueillis par une procession shāmiyya devant l’hôtel Umayya, organisée à l’initiative d’une dame damascène. Ziad s’est retrouvé, sans comprendre comment, porté sur les épaules d’un inconnu, au milieu de cris chantant la Syrie, la liberté, contre les assadiens. Nous avons dîné ensemble, invités par cette même dame, en compagnie de la journaliste Zeina Shahla, de l’écrivaine Colette Bahna, ainsi que de deux militants d’Idlib. Tous quatre avaient choisi de rester en Syrie pendant ces années terribles après 2011. Sur le bras de Zeina, infatigable et combative, était tatouée une date en chiffres : 08/12/2024.
Le lendemain matin, je suis allé dans le quartier de Sha’lan, sur les traces de l’appartement où je m’étais caché pendant près d’un an, où tu étais avec moi la plupart du temps. J’hésitais sur l’entrée de l’immeuble, était-ce celle-ci, ou cette autre, ou encore une troisième ? J’ai pris des photos des trois entrées et les ai envoyées à Rashad, notre cher ami qui m’avait prêté cet appartement, risquant sa propre sécurité pour le faire. Rashad, d’ailleurs, est aujourd’hui marié à une femme syrienne tout aussi agréable et intéressante que lui, également artiste. Ils vivent en France, dans la ville de Troyes. Quelques minutes plus tard, Rashad m’a répondu : aucune des trois entrées que j’avais photographiées n’était notre entrée. Il m’a rappelé ce dont j’aurais dû me souvenir immédiatement : derrière cet appartement où nous avons séjourné, il y avait une mosquée. Le lendemain, je suis retourné sur place et j’ai pris une nouvelle photo de l’entrée, dont il a cette fois attesté de la validité. Mais je n’ai pas eu de réponse lorsque j’ai sonné à la porte extéieure. L’immeuble semblait abandonné. Rashad m’a appris que sa sœur avait vendu l’appartement, sans savoir à qui il appartenait désormais.
Le jour de la triple erreur, j’ai aussi cherché la boutique de vêtements Stefanel, où notre ami Adnan Makkiya travaillait il y a douze ans. Pendant les trois ou quatre années qui ont précédé la révolution, c’est là que tu achetais mes vêtements, profitant des meilleures affaires grâce à notre ami Adnan. À l’époque, cela m’avait valu une réputation d’élégance parmi nos amis. Après le début de la révolution, Adnan a disparu, restant caché avec sa famille pendant cinq ans, avant d’être exfiltré clandestinement vers le Liban, puis de se réfugier en Allemagne. Là-bas, lui et sa famille ont vécu trois ans à Alheim, dans des conditions si mauvaises qu’il en était venu à demander à rentrer en Syrie par protestation. Finalement, la situation s’est améliorée : ils ont pu s’installer dans un logement convenable, avec de bons voisins, dans une ville non loin de Munich. Je n’ai pas retrouvé Stefanel. Après avoir posé plusieurs questions, j’ai appris que la boutique s’appelait désormais Viale, du nom de la marque de vêtements qui l’exploite aujourd’hui.
Je n’ai pas non plus retrouvé le premier logement où je m’étais caché. Tu te souviens que, le soir du 30 mars 2011, après le premier discours de Bachar al-Assad – qui était une déclaration de guerre –, j’avais pris mon ordinateur et quelques vêtements avant de commencer une vie de clandestinité dont je n’imaginais pas qu’elle allait durer plus de deux ans à Damas. Je ne t’avais pas dit adieu correctement ce jour-là, mais tu savais où j’étais, et nous nous retrouvions chaque fois après quelques jours.
Tu sais comme mon sens de l’orientation est déficient, autant que mon sens du temps est aiguisé. À l’inverse, notre ami Farouk, qui a aujourd’hui quatre-vingts ans, a su retrouver les maisons où il a vécu ou celles qui faisaient partie de son univers, après cinquante ans d’absence. Pour être honnête, Samour, je n’irai pas chercher l’appartement où nous avons vécu pendant trois mois à al-Muhajirin, car je suis sûr de ne pas pouvoir le retrouver dans un quartier que je connais à peine. D’ailleurs, Hani et Salma, qui nous avaient prêté ce logement à l’époque, sont aujourd’hui à Damas. J’ai revu Hani seul au café Al-Rawda, le jeudi 16 janvier, où notre ami Abdelhay al-Sayed – que tu connais aussi – et moi échangions publiquement quant à la « La question de la justice et de la réconciliation dans la Syrie d’aujourd’hui ». La salle donnant sur la rue était pleine, rassemblant un public diversifié. J’ai murmuré à Abdelhay que c’était la première fois que je parlais devant un auditoire syrien, en Syrie. Mais je me suis aussitôt rappelé que j’avais déjà pris la parole devant un public syrien en 2005, lors du Forum Atassi. Et que, la même année, le 8 mars, des étudiants baathistes m’avaient traîné dans la rue devant l’ancien Palais de Justice, rue Nasr, où ils m’avaient battu. Je me suis aussi souvenu que le forum avait été fermé quelques mois plus tard.
Le vendredi 17 janvier, je suis allé à Suweïda avec Ola Ramadan et Jalal Nawfal. Nous nous sommes immédiatement rendus sur la place de la Dignité, où les gens manifestaient depuis août 2023 et célébraient depuis le 8 décembre 2024. Là-bas, nous avons retrouvé ton amie et ancienne camarade d’emprisonnement, Wijdan Nassif, ainsi que mon ami et ancien camarade d’emprisonnement, Akram Maarouf. Après deux heures passées sur la place et de nombreuses photos, nous avons été invités chez une figure locale bien connue, Adnan Abu Assi, l’un des « activistes de la place ». Il nous a assuré que l’invitation ne durerait qu’un quart d’heure, le temps d’un café. Mais tu connais l’hospitalité des habitants de Soueïda, le café a été suivi de fruits, d’un excellent vin local et d’une conversation chaleureuse qui s’est prolongée pendant plus d’une heure. Nous étions une vingtaine. De là, nous sommes allés chez la famille de Wijdan, à Shahba, où nous étions attendus pour un repas de fatayer d’épinards, de houmous et de pommes de terre. Sur les conseils de Tawfiq, un ancien prisonnier politique de tes camarades, nous avons pris la route pour Damas avant la tombée de la nuit, car certaines zones du trajet ne sont pas sûres. En chemin, Tawfiq, qui nous ramenait en voiture, commentait les checkpoints du régime : ici, il y avait un poste de contrôle terrible, là, c’était encore pire. Nous sommes finalement traversé devant la « Branche Palestine », cette prison barbare qui de l’extérieur ressemble à une forteresse.
Accompagné d’Abu Louay, c’est-à-dire notre ami Adnan – tu te souviens de lui –, je suis allé, le dimanche 18 janvier, devant le dernier logement où nous avions vécu avant de basculer dans la clandestinité. C’est sans doute le seul endroit que je peux véritablement appeler ma maison, après celle de mon enfance, où j’ai passé mes onze premières années sous la férule de ma mère. Nous avions loué cet appartement en 2004 et y étions restés jusqu’au 30 mars 2011. Tu y séjournais ensuite de façon intermittente, lorsque tu n’étais pas avec moi dans l’un des quatre logements où je me cachais, jusqu’à ce que la propriétaire menace de jeter nos affaires à la rue si nous ne libérions pas les lieux. Mais à ce moment-là, à la fin de 2013, tu avais déjà disparu et j’étais moi à Istanbul.
Devant l’immeuble, après quatorze ans d’absence, j’ai constaté que la porte était fermée et que la sonnette ne fonctionnait pas, faute d’électricité. J’ai pris quelques photos du bâtiment avec mon téléphone. J’ai remarqué que le parking était plus encombré qu’avant. L’espace boisé qui séparait la cour de la rue semblait plus vivant, les arbres avaient poussé. Soudain, la porte s’est ouverte. Samer, notre ancien voisin, m’a reconnu immédiatement. Moi, je ne l’aurais jamais reconnu. Nous nous sommes serrés dans les bras. Il nous a invités, Abu Louay et moi, à entrer. J’ai rencontré sa femme, Samar, et leur fille cadette, Zeina, qui a maintenant dix-neuf ans. Maya, l’aînée, était au travail, dans un centre de soins au laser. Alors que nous prenions le café, j’ai remarqué les divans où nous étions assis, il me semblait qu’ils m’étaient familiers. Avec une pointe de gêne, j’ai demandé à Samer si c’étaient les nôtres. Il a souri : « Oui, ce sont vos divans ! Samira nous avait dit de les prendre après ton départ volontaire. »
Samar a ajouté qu’ils avaient aussi conservé pour nous un tapis, une carpette et un chauffage électrique. J’ai répondu que je viendrais peut-être les chercher si jamais je devais avoir un jour un logement à Damas. J’ai envoyé quelques photos de la maison à Jojo, en Allemagne. Nous avons eu les larmes aux yeux. Comme cette absence, Samour, n’a de cesse blesser le cœur !
J’ai demandé à Samer s’il pouvait parler à son voisin pour que je puisse jeter un œil à notre ancien appartement. L’homme a accepté, bien qu’il était clair qu’il ne comprenait pas pourquoi un ancien locataire s’y intéressait après tant d’années. Il m’a laissé voir l’entrée et la pièce qui servait de salon. Tout avait changé. Il était évident que la famille qui y résidait aujourd’hui était aisée. Ce que j’ai vu de notre appartement, Samour, était plus luxueux que de nos jours. Je n’ai pas pu voir la pièce qui était mon bureau. Depuis l’extérieur du bâtiment, j’ai remarqué que le balcon avait été entièrement vitré, ajoutant ainsi cet espace à l’intérieur. Je me suis souvenu de toi, assise là, partageant un maté avec nos invités, Iyad en particulier. J’ai remarqué aussi que la fenêtre de la cuisine donnant sur la rue en face avait désormais un verre teinté de bleu, ce qui n’était pas le cas autrefois. De là, la vue s’ouvrait, au-delà de la rue, sur un espace vide, sans constructions, et plus loin, sur la montagne, qui, à compter de la fin janvier ou de début février, était partiellement recouverte de neige.
Les fiers parents m’ont montré une vidéo de la remise de diplôme de Maya à l’institut où elle avait étudié, avec une moyenne de 99 %. Ils m’ont dit que son lieu de travail n’était pas loin. J’ai demandé à lui rendre visite, et nous y sommes allés, toute la famille, Abu Louay et moi. Cependant, Zeina avait déjà averti sa sœur de notre venue, gâchant ainsi la surprise. Hélas, Maya ne se souvenait pas de moi, pas plus que Zeina. Toutes deux, en revanche, se souvenaient parfaitement de toi.
De là, nous sommes retournés au marché le plus proche de notre ancien domicile, qui était aussi, jusqu’en 2011, le seul marché de la banlieue. Il y avait plus de magasins que jadis, l’endroit semblait plus vivant. La banlieue était plus peuplée qu’auparavant et paraissait avoir prospéré, contrairement aux quartiers du centre de la capitale que j’avais visités. L’air y était pur, à l’opposé de celui de Damas, lourdement pollué. Une part de moi était cependant détachée de la bonne compagnie d’Abu Louay, Samer, Samar et Zeina. Une part de moi était en colère et accablée. Sur la route du retour à Damas, dans la voiture d’Abu Louay, je lui ai dit qu’il n’y avait qu’une seule personne au monde que je me sentirais capable de tuer : Samir Kaaka, le responsable juridique de Jaysh al-Islam, principal instigateur de ton enlèvement et de ceux de Razan, Wael et Nazem. Le monde serait un endroit légèrement moins immonde sans cet être malveillant, rongé par la haine. Abu Louay n’a rien répondu. Je crois qu’il doute de ma capacité à passer à l’acte contre cet homme méprisable.
Après le déjeuner, j’ai emmené des amis – une jeune amie syrienne, un ami palestino-syrien-canadien et une journaliste française – pour rechercher le premier endroit où je m’étais caché. La première tentative fut infructueuse. Ce n’est qu’en arrivant rue du Pakistan, non loin du restaurant où nous avions mangé, que j’ai compris pourquoi je ne l’avais pas trouvé. Je regardais du mauvais côté de la rue : je cherchais à droite en suivant le sens de la circulation, alors que l’endroit se trouvait à gauche. Je l’ai alors localisé sans difficulté, bien qu'avec l’aide d’un commerçant du quartier. L’endroit avait été transformé en entrepôt pharmaceutique central appartenant au Syndicat des pharmaciens syriens, la porte extérieure était solidement verrouillée.
Passer trois jours à Alep, où j’avais étudié et où j’avais été emprisonné, fut un exercice de réapprentissage de la confiance, du sentiment de sérénité en marchant dans une ville où j’avais vécu trois ans avant mon incarcération et trois ans après. Tu connais cette sensation d’étouffement, cette impression que l’espace se resserre, que le climat général est hostile, voire menaçant. Je pense que c’est ce que ressentent les femmes dans nos sociétés lorsqu’elles évoluent dans des lieux publics où elles sont exposées au harcèlement, ne serait-ce que par le regard. Nous étions plongés en permanence dans une atmosphère oppressante, encerclés par un système de domination omniprésent, d’une masculinité brutale et intrusive. Avons-nous définitivement tourné la page de ce chapitre abject, Samour ? Il est difficile de l’affirmer à ce stade. Devant nous s’étend une route tortueuse, parsemée d’épreuves et de surprises. Dans les milieux alaouites dont tu es issue, la peur règne et des abus sont fréquemment signalés dans certaines régions. Officiellement, il s’agirait de traquer les criminels et les shabihas, mais les témoignages se multiplient sur des exactions et des humiliations rappelant celles que nous connaissions des forces de sécurité du régime.
Dans le bus qui nous a emmenés à Alep, deux amis égyptiens et moi, nous avons échangé avec une jeune femme d’Alep, journaliste spécialisée dans les questions sociales, qui paraissait enthousiaste face aux changements récents dans le pays. À notre arrivée, un taxi l’attendait. Elle nous a invités à monter avec elle. Ce que nous avons accepté avec gratitude, avant de découvrir qu’elle avait réglé sans nous le dire la course du taxi, qu’elle avait quitté avant nous. Une telle générosité envers des inconnus est devenue rare dans de nombreux pays. Le lendemain matin, j’ai marché seul en direction du parc public où j’aimais me promener naguère. Il s’y trouvait un vendeur de café amer, versant celui-ci de la carafe qu’il transportait à des gobelets en carton. Je lui ai commandé une tasse, avant de m’apercevoir que j’avais oublié le sac contenant mon argent syrien. Je lui ai expliqué que j’avais oublié d’emporter de l’argent. Sans hésitation, il m’a répondu : « C’est offert !» Mais je me suis immédiatement souvenu que j’avais un peu d’argent en euro, dont je lui ai donné une petite fraction. La générosité des Alépins est désarmante. Ils tiennent à faire montre de leur hospitalité, en opposition au stéréotype du Damascène avare.
Une chose m’a dérangé : une porte en métal avait été ajoutée au jardin public, il semble que le parc était ainsi fermée la nuit au temps du régime. Avant, l’entrée principale restait ouverte en permanence, accueillante et généreuse. Dans plusieurs endroits de la ville, les portes étaient devenues plus étroites. Durant les années sanguinaires après 2011, le pays s’était refermé, réduit, comme si la Syrie toute entière avait été miniaturisée pour faciliter la surveillance des Syriens.
Le soir du même jour, Marcelle Shehwaro et moi avons participé à un débat au centre culturel d’Aziziyah. Tu connais Marcelle de nom. Elle était l’une des figures de la révolte d’Alep et de son université, son parcours militant fait l’objet d’une riche biographie en anglais qui sera bientôt publiée. Nous avons parlé de la manière de réintroduire la politique en Syrie sous forme de débat public. Marcelle m’a posé plus de questions que je ne lui en ai posées. Puis, nous avons interagi avec un auditoire qui remplissait les deux salles du centre. Beaucoup restaient debout, faute de places assises. C’était encourageant et émouvant. J’aurais tant voulu que tu sois là, Samour !
Bien sûr, tu étais présente tout au long de l’échange. Ton nom a été évoqué dès l’introduction et ma présentation, dans les questions de mes amis et dans le contenu de certaines de mes réponses du public. C’était le premier événement intellectuel et politique organisé à Alep après la libération – ou la chute, selon le terme que chacun préfère employer. Certains insistent sur le terme libération, qui implique que le régime était une force coloniale. D’autres parlent de chute, insistant sur l’effondrement du régime et la fuite humiliante de Bachar. Je suis certain que tu aurais préféré le premier terme. Baker m’a dit que Tihama le reprenait chaque fois qu’il employait chute au lieu de libération. Baker et Tihama sont toujours à Gaziantep, en Turquie.
Alors que les gens arrivaient et que Marcelle et moi nous tenions en retrait, comme pour accueillir les arrivants, un homme de mon âge m’a salué. Il m’a regardé dans les yeux et m’a demandé : « Tu me reconnais ? » J’ai hésité une seconde, désolé de ne pas pouvoir me souvenir de lui. « Je suis untel », m’a-t-il dit. Nous nous sommes pris dans nos bras, avec chaleur, trente-quatre ans à peu près notre dernière rencontre. C’était mon camarade et compagnon de cellule à la prison centrale d’Alep. Il avait été libéré après onze ans d’incarcération. Quand je suis sorti cinq ans après lui, j’avais tenté de revoir ceux parmi les camardes d’emprisonnement qui n’évitaient pas de me rencontrer. Il n’en faisait pas partie, je comprends pourquoi. L’homme voulait éviter la répression du régime qui ne manquerait pas s’abattre sur lui, et peut-être sur sa famille, s’il gardait contact avec ses précédents amis sortants de prison.Mais dès que l’occasion s’est présentée après la chute du régime, il est venu assister à un événement public où je prenais la parole. Toute notre histoire se condense dans ce moment, Samour. La tyrannie nous avait séparés, nous forçant à nous replier sur nous-mêmes, enfermés dans des cercles de plus en plus restreints. La fin de la mainmise tyrannique a rouvert ces cercles les uns aux autres. Lui et moi étions en début de trentaine à sa sortie de prison ; nous nous rencontrons pour la première fois après la détention en milieu de soixantaine.
Le lendemain, j’ai accompagné Nesma et Halim, un couple de jeunes militants, à Alep-Est. La dévastation était immense, suscitant en moi un mélange d’affliction et de désespoir. Comment pourra-t-on déblayer ces montagnes de gravats ? Comment reconstruire les habitations détruites pour permettre aux résidents de revenir, eux qui vivent dans des camps d'infortune ou, pour ceux qui ont pu se le permettre, dans d’autres quartiers encore debout ? La pauvreté de la partie orientale de la ville brisait le cœur.
Je suis retourné à Damas avec Marcelle le matin du 24 janvier. Elle venait assister à une conférence sur la justice, réunissant plusieurs organisations syriennes. Selon ce qu’elle m’a raconté le soir même, la moitié des participants étaient des femmes, certaines venues de leurs points d’exil dans des pays proches ou lointains, d’autres depuis l’intérieur de la Syrie. C’est d’ailleurs un point de tension au sein des milieux militants laïcs, qui mérite d’être pris en compte. Ceux qui viennent de l’étranger sont souvent plus visibles, tandis que ceux qui sont restés en Syrie sont plus en retrait. On sent une gêne, une difficulté à communiquer entre ces deux groupes, des choses non dites. Un phénomène similaire s’était produit en Palestine après les accords d’Oslo, en Espagne après la chute de Franco, et en Grèce après la fin de la dictature des généraux. Comme les gens ressemblent aux gens, Samour !
À Damas, chaque jour apporte son lot de nouvelles activités : débats, projections, conférences, séminaires. Ces rencontres se tiennent dans des hôtels, des cafés – notamment Al-Rawda –, ou encore dans des centres culturels, lesquels étaient bien moins actifs avant la chute/libération. La ville semblait devenue l’une des plus dynamiques au monde en matière de débat public, de projections cinématographiques, de conférences, de congrès. Notre ami Osama Mohammed a projeté pour la première fois à Damas son film Les Étoiles du jour, la salle était pleine. À Jaramana, Notre terrible pays a été projeté, avec Razan et toi présentes à l’écran.
À Damas, je suis retourné aux rencontres avec des amis, des journalistes, des médias étrangers, et l’achat de souvenirs, parmi lesquels des chaussettes arborant une image de Hafez al-Assad exhibant ses muscles, vêtu d’un simple caleçon, et un portrait caricatural de Bachar, le cou exagérément allongé. Je n’ai pas réussi à mettre la main sur des tasses à l’effigie du père et du fils en sous-vêtements, dont j’ai vu des photos sur Internet. Après la chute du régime, dans le chaos des premiers jours, certains ont mis la main sur des clichés de la famille, dont deux où Hafez et Bachar posaient en caleçons, qui ont ont circulé sur les réseaux sociaux. La famille Assad a fini par être surnommée « La famille Abu Kalsoun ».
Le matin du 29 janvier, nous sommes retournés à Suweïda avec Wijdan Nassif et Jalal Nawfal. Akram et d’autres militants de la ville avaient obtenu de moi la promesse de revenir, et nous nous étions mis d’accord tous les trois pour accomplir ce voyage. Nous voulions aussi réfléchir aux moyens de construire une majorité politique dépassant les divisions communautaires, ainsi qu’à l’idée d’une Conférence nationale ou d’un Dialogue national, dont on parlait beaucoup après la chute du régime. Comment organiser la représentation politique dans cette nouvelle phase ? Notre hôte à Suweïda était notre ancien camarade de prison, Akram Maarouf. Après sa libération, il était devenu ingénieur et avait fondé une famille, avec son épouse et ses trois enfants. Deux parmi ceux-ci, un garçon et une fille, vivaient désormais en Allemagne. Notre premier repas à Suweïda fut un miliḥiya, un plat similaire au milḥi de la région voisine de Deraa : un grand plateau de morceaux d’agneau cuits avec leurs os, posés sur du riz, le tout mijoté dans du yaourt, lequel est servi aussi séparément dans des bols. Autour du plat principal, des kebbés frits et farcis de viande hachée. C’était absolument délicieux.
Environ cinquante personnes ont assisté à notre réunion, dont sept femmes. Mais la majorité du public était âgée, la plupart avaient la cinquantaine ou plus, à l’exception d’une jeune militante de vingt-sept ans, bien connue en ville. Le soir, nous avons été invités à une soirée avec oud, musique et vin local, chez Adnan Abu Assi lui-même. Lui, sa femme et ses enfants étaient engagés dans l’opposition et faisaient partie des figures les plus actives de la Place de la Dignité de Soueïda depuis août 2023. Son fils aîné avait même été brièvement arrêté à seize ans.
Au cours de cette soirée joyeuse, nous avons appris que Ahmad al-Char'a avait rencontré des factions militaires, qui avaient accepté de se dissoudre pour intégrer la nouvelle armée. Cela faisait suite à la dissolution de l’ancien corps militaire, du Parti Ba'th et du Parlement. Ahmad al-Char'a avait été proclamé président de transition et se voyait accorder le pouvoir de désigner un conseil législatif temporaire. Nous nous retrouvions ainsi face à une dictature transitoire, avec le risque qu’elle se transforme en une dictature permanente. Le même soir, sur la place des Omeyyades, des partisans scandaient : « Al-Joulani pour toujours ! Al-Joulani pour toujours ! Pas comme toi, Assad ! » Cela semblait être une référence au passé, qui pouvait aussi dessiner les contours d’un futur inquiétant : une Syrie assadienne sans Assad. L’appel à une éternité politique dépasse la seule dictature. Il ouvre la voie à l’anéantissement, car un pouvoir éternel ne peut exister sans une machine d’élimination, un système fondé sur la torture, les arrestations prolongées et des massacres à la manière du régime Assad.
Après un fastueux petit-déjeuner le lendemain matin, nous sommes rentrés à Damas. Jalal devait intervenir à 16 heures au café Al-Rawda, aux côtés d’un autre psychiatre, pour parler des enjeux psycho-politiques actuels en Syrie. Wijdan, en tant que figure du Mouvement politique des femmes, continuait d’observer la situation politique avec un mélange typiquement syrien d’enthousiasme et d’inquiétude. Elle m’a confié que ce qui l’exaspérait le plus était cette tendance, fréquente dans nos cercles, à la lamentation et aux plaintes face aux épreuves. Elle m’a donné quelques exemples. Je ne pouvais qu’être entièrement d’accord avec elle.
Lors de mon dernier jour à Damas, je suis retourné à Douma avec des amis. Nous avons fixé une plaque commémorative à l’entrée de l’immeuble où tu avais vécu avec Razan, Wael et Nazem, avant votre enlèvement. On pouvait y lire : « Dans cet immeuble ont résidé Razan Zaitouneh et Samira al-Khalil, puis Wael Hamada et Nazem al-Hamadi, jusqu’à leur enlèvement dans la nuit du 9 décembre 2013. » Nous avons frappé aux portes des appartements pour demander aux habitants l’autorisation d’installer la plaque. Tous n’ont pas ouvert, mais personne ne s’y est opposé. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part d’un couple quinquagénaire, tout particulièrement de la femme. Il s’agissait d’un spectacle étrange : une quinzaine d’hommes et de femmes gravissant les escaliers, équipés de caméras, de micros et de téléphones. Sur le trottoir, devant l’immeuble, nous étions peut-être une quarantaine à immortaliser ce moment. C’est Muawiya Hammoud, un quadragénaire originaire de Moadamiya, près de Damas, qui a fixé la plaque au mur, que Sherine al-Hayek et lui m’avaient aidé à la faire fabriquer.
* * * * *
Après neuf jours à Damas, je suis parti pour Homs avec Najat et Lulu, qui avaient passé deux semaines à Damas pour changer d’air. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser, Samour, que c’était la première fois que je me rendais à Homs sans toi. Nous sommes arrivés dans l’après-midi, vers trois heures, dans une voiture louée par ta sœur et sa fille. Najat a estimé que je devais passer cette première nuit chez Fatima et Bassam, pendant qu’elle et Alaa préparaient la maison qu’elles avaient quittée depuis déjà un moment. La rencontre avec Fatima a été émouvante. Nous avons pleuré dans les bras l’un de l’autre. Comme elle te ressemble, ta petite sœur ! Nous avons veillé jusqu’à une heure du matin, parlant, buvant du arak. Toi et ta longue absence étiez le sujet de notre longue conversation. L’un des constats les plus douloureux qui m’est apparu progressivement, après des années de ton absence, est que ton histoire n’est pas suffisamment connue, et aussi qu’il y a une tendance parmi certains cercles de proches et connaissances à me tenir pour responsable de ta disparition, sans jamais m’avoir interrogé sur le sujet, sans avoir lu ce que j’ai écrit à ton sujet, sans même avoir lu ton propre livre, tout cela étant facilement accessible à tous ceux qui le veulent. Il s’est produit une superposition de plusieurs éléments : des divergences politiques, des tensions personnelles, la déliquescence de la révolution après ton enlèvement, et cette fracture entre ceux qui sont restés et ceux qui ont dû partir. Tout cela a été utilisé contre moi. Nous avons parlé pendant neuf heures. Nos cœurs se sont apaisés. Mais après cette longue journée, cette nuit d’échanges, et tout ce qui n’a pas été dit, j’ai compris à quel point il est cruel que ton absence puisse être utilisée contre moi.
Le lendemain, Bassam m’a emmené en voiture parcourir les abords du quartier détruit de Baba Amr, la rue entre les deux horloges, l’ancienne et la nouvelle, ainsi que le boulevard du Brésil. La ville était animée, vibrante, bien que marquée, comme Damas, par une décrépitude avancée. Bassam avait organisé une rencontre avec un groupe de jeunes hommes et femmes pour discuter de la situation du pays. J’ai demandé à y assister et il s’est montré enthousiaste. De l’autre côté de la rue où se trouve son magasin de produits naturels – savons, baumes, crèmes – qu’il a lui-même développés et transformés en un projet prospère au fil des années, nous nous sommes assis sur le trottoir, sous le soleil doux de janvier, certains sur des chaises, d’autres sur des blocs de béton. Nous avons discuté pendant une heure de ce qui s’est passé, de ce qui se passe et de ce qu’il faudrait faire. Nous étions trois hommes dans la soixantaine, tous d’anciens prisonniers politiques, trois jeunes femmes dans la vingtaine et trois jeunes hommes du même âge. Ce petit colloque en plein air, un mois exactement après la chute du régime, le 8 janvier 2025, symbolisait cette nouvelle réalité, événement impensable un mois plus tôt. Les jeunes veulent agir, mais ils ont besoin d’être guidés, orientés, organisés. Ils pensent que nous pouvons les aider.
Après ce colloque du trottoir, nous nous sommes rendus chez « la doyenne » Najat, qui avait décidé que nous passerions tous la nuit ensemble : Fatima, Bassam, Thaer – arrivé en Syrie de Berlin après avoir rendu visite à son père à Beyrouth –, Alaa et moi. Les larmes étaient présentes, mais ce furent celles de Thaer cette fois-ci, découvrant pour la première fois cette maison en l’absence d’Afif. Murad était là aussi. Il nous a raconté une anecdote. En se promenant dans la ville où il est né, après plus de dix ans passés en Allemagne, il a été submergé par l’émotion. Il a alors enlevé ses chaussures pour honorer un vœu qu’il avait fait s’il revenait un jour à Homs, et il s’est assis sur un trottoir, la tête entre les mains. Une minute plus tard, un jeune homme est venu le voir, cherchant à le réconforter et lui proposant son aide. Il l’avait pris pour un sans-abri ou un mendiant. Murad, avec son allure bohème, pouvait facilement prêter à confusion. Murad lui a répondu qu’il était juste épuisé par une longue absence. « Tu viens d’où ? » lui a demandé le jeune homme – « D’Allemagne. » L’autre a souri : « Dans ce cas, c’est toi qui devrais me donner de l’argent ! » Nous avons veillé jusqu’à deux heures du matin, parlant de politique, buvant du arak, échangeant nos récits.
Le sentiment général dans le pays, selon Abed al-Rays, est celui d’un soulagement, d’une délivrance, d’une longue expiration. al-Rays, un ami de Homs que j’avais rencontré une seule fois avant la révolution, m’a invité à prendre la parole devant un petit groupe d’auditeurs au monastère des Pères Jésuites à Homs. Cette rencontre a eu lieu dans l’après-midi du 9 janvier, durant deux heures, à propos de la pensée, de la politique, et du rôle des intellectuels.
Lulu est désormais une militante engagée dans une organisation récemment fondée, dédiée à la paix civile à Homs, cette ville dont tu as connu une partie des souffrances avant ton enlèvement, et qui a continué à en subir d'autres pendant encore près de deux ans plus tard. Tout cela a conduit à un nombre incalculable de victimes, une destruction massive de l'infrastructure urbaine et, surtout, une fracture profonde dans le tissu social, en particulier entre sunnites et alaouites. Après la libération, les quartiers alaouites ont été « ratissés » à la recherche d’armes et de personnes recherchées, peut-être aussi pour signifier une présence. Cela a conduit à une manifestation d’Alaouites où des slogans sectaires ont été scandés, à laquelle a répondu dès le lendemain une manifestation sunnite où d'autres slogans sectaires ont également été brandis. Les ratissages ont pris fin la veille de notre arrivée, mais la situation à Homs demeure fragile et instable. Les rues des quartiers alaouites se vident dès le coucher du soleil. Dans les quartiers sunnites, la destruction est immense ; cependant, ce qui n'a pas été détruit reste animé jusqu’à près de minuit.
Rien de comparable avec Lattaquié, où je me suis rendu trois jours après Homs, évidemment accueilli chez nos amis Haitham et Zubaida, dans la même chambre que nous occupions tous deux lorsque nous visitions la ville. Le soir même, nous nous sommes retrouvés dans un petit bar du quartier des Américains à Lattaquié, en compagnie de Haitham, de l’écrivain Nabil Suleiman – que tu connais, ainsi que certaines de ses œuvres, qui figuraient dans notre bibliothèque –, de Amer al-Marei, fils du Dr Munif, et de sa jeune compagne, ainsi que d’autres amis. Un chanteur originaire de Lattaquié, Samer Ahmad, s’est joint à nous pour un moment. Il a une chanson intitulée Allah y’raïhna minno – « Que Dieu nous en débarasse ! » –, une phrase qu'il répétait depuis des années et qui est finalement devenue le refrain d’une chanson en dialecte syrien. La chanson se moque de Bachar al-Assad et exprime une confiance inébranlable dans la Syrie et son peuple. Nous sommes rentrés chez nous vers minuit.
Sur la route de Homs à Lattaquié, nous avons croisé huit ou neuf checkpoints armés. Certains nous ont laissés passer sans nous arrêter, mais deux d’entre eux ont demandé à voir nos papiers d’identité, au conducteur et à moi, un autre nous a fait ouvrir le coffre de la voiture et un dernier nous a demandé si nous transportions des armes. Tout cela s’est déroulé sur la seule première moitié du trajet ; la seconde était libre de tout contrôle jusqu’à l’entrée de la ville, où un dernier checkpoint tenu par un seul homme ne nous a même pas arrêtés. Le chauffeur a justifié cela par le fait que la région à l’ouest de Homs était infestée de bandes armées spécialisées dans les vols et les enlèvements, et que ces checkpoints avaient été installés principalement pour empêcher leurs crimes. Quelques jours plus tard, dans la ville de Fahil, à l’ouest de Homs, quinze anciens soldats des forces du régime ont été exécutés, bien qu’ils n’aient pas opposé de résistance, selon des informations concordantes. Certains étaient même déjà retraités. La situation sécuritaire est instable, et aucune règle claire ne semble avoir été établie pour gérer les crises émergentes. Le pays est dans un état de fluidité totale, sans structure définie, et les rumeurs se propagent dans tous les sens.
Jad, le fils de Haitham et Zubaida, est maintenant un jeune homme de vingt et un ans. Il étudie la littérature française à l’université, mais il apprend aussi l’allemand et envisage de partir en Allemagne pour acquérir des compétences professionnelles dans l’hôtellerie, la restauration ou la menuiserie.
Les sentiments oscillent ici entre « délivrance » et anxiété face aux dangers de l’extrémisme religieux ou politique. Mais il y a aussi une soif de réunions, d’échanges, de débats, et une quête de réponses que personne ne semble encore posséder.
Le lendemain après-midi, Amer al-Marei m’avait organisé une rencontre avec une trentaine de personnes intéressées à la chose publique. Nous avons échangé nos analyses de la situation et des devenirs possibles. J’ai expliqué que nous ne nous dirigeons pas vers la démocratie, en raison de la nature même du nouveau pouvoir en place, qui est tout sauf démocratique voire qui, jusqu’à il y a quelques années, rendait blasphématoire l’idée même de démocratie. Cependant, j’ai exclu la possibilité d’un État islamique, je pense plutôt que nous allons vers une nouvelle forme de politique des notables, où les groupes sociaux sont représentés par leurs figures tutélaires, comme c’était le cas lors des années qui ont suivi l’indépendance de la Syrie. Ce type de gouvernance exclurait, ou du moins limiterait, la présence de qui – comme nous – incarne un réel pluralisme intellectuel et politique. J’ai insisté sur l’importance d’œuvrer à l’adoption de lois interdisant et criminalisant la torture, en nous appuyant sur notre expérience historique où la torture est allée de pair avec la destruction sociale et humaine, le sectarisme, et, in fine, l’effondrement du pays.
L’audience était variée, aussi bien en termes de genre que d’âge et d’origines sociales, liée par un état d’esprit résolument positif. On sentait que l’apaisement des gens quant à la chose publique conduisait à un apaisement des échanges entre eux. Cela pourrait peut-être expliquer en partie pourquoi la violence n’est pas généralisée dans les villes, malgré le chaos et l’instabilité. C’est la « délivrance » qui élargit l’infrastructure sociale du pays, malgré la misère et la dégradation de ses infrastructures civiles. Mais si des solutions efficaces tardent à être mises en place, cette morale collective pourrait de nouveau être écrasée, générant de nouvelles pathologies.
* * * * *
Après deux jours à Lattaquié, je suis retourné à Damas. Mes amis Farouk Mardam Bey, Subhi Hadidi et Ziad Majed, que tu connais, étaient arrivés quelques heures avant moi. Farouk revenait dans sa ville natale pour la première fois en un demi-siècle. Subhi foulait le sol syrien pour la première fois en trente-huit ans d’exil. À leur arrivée, ils ont été accueillis par une procession shāmiyya devant l’hôtel Umayya, organisée à l’initiative d’une dame damascène. Ziad s’est retrouvé, sans comprendre comment, porté sur les épaules d’un inconnu, au milieu de cris chantant la Syrie, la liberté, contre les assadiens. Nous avons dîné ensemble, invités par cette même dame, en compagnie de la journaliste Zeina Shahla, de l’écrivaine Colette Bahna, ainsi que de deux militants d’Idlib. Tous quatre avaient choisi de rester en Syrie pendant ces années terribles après 2011. Sur le bras de Zeina, infatigable et combative, était tatouée une date en chiffres : 08/12/2024.
Le lendemain matin, je suis allé dans le quartier de Sha’lan, sur les traces de l’appartement où je m’étais caché pendant près d’un an, où tu étais avec moi la plupart du temps. J’hésitais sur l’entrée de l’immeuble, était-ce celle-ci, ou cette autre, ou encore une troisième ? J’ai pris des photos des trois entrées et les ai envoyées à Rashad, notre cher ami qui m’avait prêté cet appartement, risquant sa propre sécurité pour le faire. Rashad, d’ailleurs, est aujourd’hui marié à une femme syrienne tout aussi agréable et intéressante que lui, également artiste. Ils vivent en France, dans la ville de Troyes. Quelques minutes plus tard, Rashad m’a répondu : aucune des trois entrées que j’avais photographiées n’était notre entrée. Il m’a rappelé ce dont j’aurais dû me souvenir immédiatement : derrière cet appartement où nous avons séjourné, il y avait une mosquée. Le lendemain, je suis retourné sur place et j’ai pris une nouvelle photo de l’entrée, dont il a cette fois attesté de la validité. Mais je n’ai pas eu de réponse lorsque j’ai sonné à la porte extéieure. L’immeuble semblait abandonné. Rashad m’a appris que sa sœur avait vendu l’appartement, sans savoir à qui il appartenait désormais.
Le jour de la triple erreur, j’ai aussi cherché la boutique de vêtements Stefanel, où notre ami Adnan Makkiya travaillait il y a douze ans. Pendant les trois ou quatre années qui ont précédé la révolution, c’est là que tu achetais mes vêtements, profitant des meilleures affaires grâce à notre ami Adnan. À l’époque, cela m’avait valu une réputation d’élégance parmi nos amis. Après le début de la révolution, Adnan a disparu, restant caché avec sa famille pendant cinq ans, avant d’être exfiltré clandestinement vers le Liban, puis de se réfugier en Allemagne. Là-bas, lui et sa famille ont vécu trois ans à Alheim, dans des conditions si mauvaises qu’il en était venu à demander à rentrer en Syrie par protestation. Finalement, la situation s’est améliorée : ils ont pu s’installer dans un logement convenable, avec de bons voisins, dans une ville non loin de Munich. Je n’ai pas retrouvé Stefanel. Après avoir posé plusieurs questions, j’ai appris que la boutique s’appelait désormais Viale, du nom de la marque de vêtements qui l’exploite aujourd’hui.
Je n’ai pas non plus retrouvé le premier logement où je m’étais caché. Tu te souviens que, le soir du 30 mars 2011, après le premier discours de Bachar al-Assad – qui était une déclaration de guerre –, j’avais pris mon ordinateur et quelques vêtements avant de commencer une vie de clandestinité dont je n’imaginais pas qu’elle allait durer plus de deux ans à Damas. Je ne t’avais pas dit adieu correctement ce jour-là, mais tu savais où j’étais, et nous nous retrouvions chaque fois après quelques jours.
Tu sais comme mon sens de l’orientation est déficient, autant que mon sens du temps est aiguisé. À l’inverse, notre ami Farouk, qui a aujourd’hui quatre-vingts ans, a su retrouver les maisons où il a vécu ou celles qui faisaient partie de son univers, après cinquante ans d’absence. Pour être honnête, Samour, je n’irai pas chercher l’appartement où nous avons vécu pendant trois mois à al-Muhajirin, car je suis sûr de ne pas pouvoir le retrouver dans un quartier que je connais à peine. D’ailleurs, Hani et Salma, qui nous avaient prêté ce logement à l’époque, sont aujourd’hui à Damas. J’ai revu Hani seul au café Al-Rawda, le jeudi 16 janvier, où notre ami Abdelhay al-Sayed – que tu connais aussi – et moi échangions publiquement quant à la « La question de la justice et de la réconciliation dans la Syrie d’aujourd’hui ». La salle donnant sur la rue était pleine, rassemblant un public diversifié. J’ai murmuré à Abdelhay que c’était la première fois que je parlais devant un auditoire syrien, en Syrie. Mais je me suis aussitôt rappelé que j’avais déjà pris la parole devant un public syrien en 2005, lors du Forum Atassi. Et que, la même année, le 8 mars, des étudiants baathistes m’avaient traîné dans la rue devant l’ancien Palais de Justice, rue Nasr, où ils m’avaient battu. Je me suis aussi souvenu que le forum avait été fermé quelques mois plus tard.
* * * * *
Le vendredi 17 janvier, je suis allé à Suweïda avec Ola Ramadan et Jalal Nawfal. Nous nous sommes immédiatement rendus sur la place de la Dignité, où les gens manifestaient depuis août 2023 et célébraient depuis le 8 décembre 2024. Là-bas, nous avons retrouvé ton amie et ancienne camarade d’emprisonnement, Wijdan Nassif, ainsi que mon ami et ancien camarade d’emprisonnement, Akram Maarouf. Après deux heures passées sur la place et de nombreuses photos, nous avons été invités chez une figure locale bien connue, Adnan Abu Assi, l’un des « activistes de la place ». Il nous a assuré que l’invitation ne durerait qu’un quart d’heure, le temps d’un café. Mais tu connais l’hospitalité des habitants de Soueïda, le café a été suivi de fruits, d’un excellent vin local et d’une conversation chaleureuse qui s’est prolongée pendant plus d’une heure. Nous étions une vingtaine. De là, nous sommes allés chez la famille de Wijdan, à Shahba, où nous étions attendus pour un repas de fatayer d’épinards, de houmous et de pommes de terre. Sur les conseils de Tawfiq, un ancien prisonnier politique de tes camarades, nous avons pris la route pour Damas avant la tombée de la nuit, car certaines zones du trajet ne sont pas sûres. En chemin, Tawfiq, qui nous ramenait en voiture, commentait les checkpoints du régime : ici, il y avait un poste de contrôle terrible, là, c’était encore pire. Nous sommes finalement traversé devant la « Branche Palestine », cette prison barbare qui de l’extérieur ressemble à une forteresse.
* * * * *
Accompagné d’Abu Louay, c’est-à-dire notre ami Adnan – tu te souviens de lui –, je suis allé, le dimanche 18 janvier, devant le dernier logement où nous avions vécu avant de basculer dans la clandestinité. C’est sans doute le seul endroit que je peux véritablement appeler ma maison, après celle de mon enfance, où j’ai passé mes onze premières années sous la férule de ma mère. Nous avions loué cet appartement en 2004 et y étions restés jusqu’au 30 mars 2011. Tu y séjournais ensuite de façon intermittente, lorsque tu n’étais pas avec moi dans l’un des quatre logements où je me cachais, jusqu’à ce que la propriétaire menace de jeter nos affaires à la rue si nous ne libérions pas les lieux. Mais à ce moment-là, à la fin de 2013, tu avais déjà disparu et j’étais moi à Istanbul.
Devant l’immeuble, après quatorze ans d’absence, j’ai constaté que la porte était fermée et que la sonnette ne fonctionnait pas, faute d’électricité. J’ai pris quelques photos du bâtiment avec mon téléphone. J’ai remarqué que le parking était plus encombré qu’avant. L’espace boisé qui séparait la cour de la rue semblait plus vivant, les arbres avaient poussé. Soudain, la porte s’est ouverte. Samer, notre ancien voisin, m’a reconnu immédiatement. Moi, je ne l’aurais jamais reconnu. Nous nous sommes serrés dans les bras. Il nous a invités, Abu Louay et moi, à entrer. J’ai rencontré sa femme, Samar, et leur fille cadette, Zeina, qui a maintenant dix-neuf ans. Maya, l’aînée, était au travail, dans un centre de soins au laser. Alors que nous prenions le café, j’ai remarqué les divans où nous étions assis, il me semblait qu’ils m’étaient familiers. Avec une pointe de gêne, j’ai demandé à Samer si c’étaient les nôtres. Il a souri : « Oui, ce sont vos divans ! Samira nous avait dit de les prendre après ton départ volontaire. »
Samar a ajouté qu’ils avaient aussi conservé pour nous un tapis, une carpette et un chauffage électrique. J’ai répondu que je viendrais peut-être les chercher si jamais je devais avoir un jour un logement à Damas. J’ai envoyé quelques photos de la maison à Jojo, en Allemagne. Nous avons eu les larmes aux yeux. Comme cette absence, Samour, n’a de cesse blesser le cœur !
J’ai demandé à Samer s’il pouvait parler à son voisin pour que je puisse jeter un œil à notre ancien appartement. L’homme a accepté, bien qu’il était clair qu’il ne comprenait pas pourquoi un ancien locataire s’y intéressait après tant d’années. Il m’a laissé voir l’entrée et la pièce qui servait de salon. Tout avait changé. Il était évident que la famille qui y résidait aujourd’hui était aisée. Ce que j’ai vu de notre appartement, Samour, était plus luxueux que de nos jours. Je n’ai pas pu voir la pièce qui était mon bureau. Depuis l’extérieur du bâtiment, j’ai remarqué que le balcon avait été entièrement vitré, ajoutant ainsi cet espace à l’intérieur. Je me suis souvenu de toi, assise là, partageant un maté avec nos invités, Iyad en particulier. J’ai remarqué aussi que la fenêtre de la cuisine donnant sur la rue en face avait désormais un verre teinté de bleu, ce qui n’était pas le cas autrefois. De là, la vue s’ouvrait, au-delà de la rue, sur un espace vide, sans constructions, et plus loin, sur la montagne, qui, à compter de la fin janvier ou de début février, était partiellement recouverte de neige.
Les fiers parents m’ont montré une vidéo de la remise de diplôme de Maya à l’institut où elle avait étudié, avec une moyenne de 99 %. Ils m’ont dit que son lieu de travail n’était pas loin. J’ai demandé à lui rendre visite, et nous y sommes allés, toute la famille, Abu Louay et moi. Cependant, Zeina avait déjà averti sa sœur de notre venue, gâchant ainsi la surprise. Hélas, Maya ne se souvenait pas de moi, pas plus que Zeina. Toutes deux, en revanche, se souvenaient parfaitement de toi.
De là, nous sommes retournés au marché le plus proche de notre ancien domicile, qui était aussi, jusqu’en 2011, le seul marché de la banlieue. Il y avait plus de magasins que jadis, l’endroit semblait plus vivant. La banlieue était plus peuplée qu’auparavant et paraissait avoir prospéré, contrairement aux quartiers du centre de la capitale que j’avais visités. L’air y était pur, à l’opposé de celui de Damas, lourdement pollué. Une part de moi était cependant détachée de la bonne compagnie d’Abu Louay, Samer, Samar et Zeina. Une part de moi était en colère et accablée. Sur la route du retour à Damas, dans la voiture d’Abu Louay, je lui ai dit qu’il n’y avait qu’une seule personne au monde que je me sentirais capable de tuer : Samir Kaaka, le responsable juridique de Jaysh al-Islam, principal instigateur de ton enlèvement et de ceux de Razan, Wael et Nazem. Le monde serait un endroit légèrement moins immonde sans cet être malveillant, rongé par la haine. Abu Louay n’a rien répondu. Je crois qu’il doute de ma capacité à passer à l’acte contre cet homme méprisable.
Après le déjeuner, j’ai emmené des amis – une jeune amie syrienne, un ami palestino-syrien-canadien et une journaliste française – pour rechercher le premier endroit où je m’étais caché. La première tentative fut infructueuse. Ce n’est qu’en arrivant rue du Pakistan, non loin du restaurant où nous avions mangé, que j’ai compris pourquoi je ne l’avais pas trouvé. Je regardais du mauvais côté de la rue : je cherchais à droite en suivant le sens de la circulation, alors que l’endroit se trouvait à gauche. Je l’ai alors localisé sans difficulté, bien qu'avec l’aide d’un commerçant du quartier. L’endroit avait été transformé en entrepôt pharmaceutique central appartenant au Syndicat des pharmaciens syriens, la porte extérieure était solidement verrouillée.
* * * * *
Passer trois jours à Alep, où j’avais étudié et où j’avais été emprisonné, fut un exercice de réapprentissage de la confiance, du sentiment de sérénité en marchant dans une ville où j’avais vécu trois ans avant mon incarcération et trois ans après. Tu connais cette sensation d’étouffement, cette impression que l’espace se resserre, que le climat général est hostile, voire menaçant. Je pense que c’est ce que ressentent les femmes dans nos sociétés lorsqu’elles évoluent dans des lieux publics où elles sont exposées au harcèlement, ne serait-ce que par le regard. Nous étions plongés en permanence dans une atmosphère oppressante, encerclés par un système de domination omniprésent, d’une masculinité brutale et intrusive. Avons-nous définitivement tourné la page de ce chapitre abject, Samour ? Il est difficile de l’affirmer à ce stade. Devant nous s’étend une route tortueuse, parsemée d’épreuves et de surprises. Dans les milieux alaouites dont tu es issue, la peur règne et des abus sont fréquemment signalés dans certaines régions. Officiellement, il s’agirait de traquer les criminels et les shabihas, mais les témoignages se multiplient sur des exactions et des humiliations rappelant celles que nous connaissions des forces de sécurité du régime.
Dans le bus qui nous a emmenés à Alep, deux amis égyptiens et moi, nous avons échangé avec une jeune femme d’Alep, journaliste spécialisée dans les questions sociales, qui paraissait enthousiaste face aux changements récents dans le pays. À notre arrivée, un taxi l’attendait. Elle nous a invités à monter avec elle. Ce que nous avons accepté avec gratitude, avant de découvrir qu’elle avait réglé sans nous le dire la course du taxi, qu’elle avait quitté avant nous. Une telle générosité envers des inconnus est devenue rare dans de nombreux pays. Le lendemain matin, j’ai marché seul en direction du parc public où j’aimais me promener naguère. Il s’y trouvait un vendeur de café amer, versant celui-ci de la carafe qu’il transportait à des gobelets en carton. Je lui ai commandé une tasse, avant de m’apercevoir que j’avais oublié le sac contenant mon argent syrien. Je lui ai expliqué que j’avais oublié d’emporter de l’argent. Sans hésitation, il m’a répondu : « C’est offert !» Mais je me suis immédiatement souvenu que j’avais un peu d’argent en euro, dont je lui ai donné une petite fraction. La générosité des Alépins est désarmante. Ils tiennent à faire montre de leur hospitalité, en opposition au stéréotype du Damascène avare.
Une chose m’a dérangé : une porte en métal avait été ajoutée au jardin public, il semble que le parc était ainsi fermée la nuit au temps du régime. Avant, l’entrée principale restait ouverte en permanence, accueillante et généreuse. Dans plusieurs endroits de la ville, les portes étaient devenues plus étroites. Durant les années sanguinaires après 2011, le pays s’était refermé, réduit, comme si la Syrie toute entière avait été miniaturisée pour faciliter la surveillance des Syriens.
Le soir du même jour, Marcelle Shehwaro et moi avons participé à un débat au centre culturel d’Aziziyah. Tu connais Marcelle de nom. Elle était l’une des figures de la révolte d’Alep et de son université, son parcours militant fait l’objet d’une riche biographie en anglais qui sera bientôt publiée. Nous avons parlé de la manière de réintroduire la politique en Syrie sous forme de débat public. Marcelle m’a posé plus de questions que je ne lui en ai posées. Puis, nous avons interagi avec un auditoire qui remplissait les deux salles du centre. Beaucoup restaient debout, faute de places assises. C’était encourageant et émouvant. J’aurais tant voulu que tu sois là, Samour !
Bien sûr, tu étais présente tout au long de l’échange. Ton nom a été évoqué dès l’introduction et ma présentation, dans les questions de mes amis et dans le contenu de certaines de mes réponses du public. C’était le premier événement intellectuel et politique organisé à Alep après la libération – ou la chute, selon le terme que chacun préfère employer. Certains insistent sur le terme libération, qui implique que le régime était une force coloniale. D’autres parlent de chute, insistant sur l’effondrement du régime et la fuite humiliante de Bachar. Je suis certain que tu aurais préféré le premier terme. Baker m’a dit que Tihama le reprenait chaque fois qu’il employait chute au lieu de libération. Baker et Tihama sont toujours à Gaziantep, en Turquie.
Alors que les gens arrivaient et que Marcelle et moi nous tenions en retrait, comme pour accueillir les arrivants, un homme de mon âge m’a salué. Il m’a regardé dans les yeux et m’a demandé : « Tu me reconnais ? » J’ai hésité une seconde, désolé de ne pas pouvoir me souvenir de lui. « Je suis untel », m’a-t-il dit. Nous nous sommes pris dans nos bras, avec chaleur, trente-quatre ans à peu près notre dernière rencontre. C’était mon camarade et compagnon de cellule à la prison centrale d’Alep. Il avait été libéré après onze ans d’incarcération. Quand je suis sorti cinq ans après lui, j’avais tenté de revoir ceux parmi les camardes d’emprisonnement qui n’évitaient pas de me rencontrer. Il n’en faisait pas partie, je comprends pourquoi. L’homme voulait éviter la répression du régime qui ne manquerait pas s’abattre sur lui, et peut-être sur sa famille, s’il gardait contact avec ses précédents amis sortants de prison.Mais dès que l’occasion s’est présentée après la chute du régime, il est venu assister à un événement public où je prenais la parole. Toute notre histoire se condense dans ce moment, Samour. La tyrannie nous avait séparés, nous forçant à nous replier sur nous-mêmes, enfermés dans des cercles de plus en plus restreints. La fin de la mainmise tyrannique a rouvert ces cercles les uns aux autres. Lui et moi étions en début de trentaine à sa sortie de prison ; nous nous rencontrons pour la première fois après la détention en milieu de soixantaine.
Le lendemain, j’ai accompagné Nesma et Halim, un couple de jeunes militants, à Alep-Est. La dévastation était immense, suscitant en moi un mélange d’affliction et de désespoir. Comment pourra-t-on déblayer ces montagnes de gravats ? Comment reconstruire les habitations détruites pour permettre aux résidents de revenir, eux qui vivent dans des camps d'infortune ou, pour ceux qui ont pu se le permettre, dans d’autres quartiers encore debout ? La pauvreté de la partie orientale de la ville brisait le cœur.
* * * * *
Je suis retourné à Damas avec Marcelle le matin du 24 janvier. Elle venait assister à une conférence sur la justice, réunissant plusieurs organisations syriennes. Selon ce qu’elle m’a raconté le soir même, la moitié des participants étaient des femmes, certaines venues de leurs points d’exil dans des pays proches ou lointains, d’autres depuis l’intérieur de la Syrie. C’est d’ailleurs un point de tension au sein des milieux militants laïcs, qui mérite d’être pris en compte. Ceux qui viennent de l’étranger sont souvent plus visibles, tandis que ceux qui sont restés en Syrie sont plus en retrait. On sent une gêne, une difficulté à communiquer entre ces deux groupes, des choses non dites. Un phénomène similaire s’était produit en Palestine après les accords d’Oslo, en Espagne après la chute de Franco, et en Grèce après la fin de la dictature des généraux. Comme les gens ressemblent aux gens, Samour !
À Damas, chaque jour apporte son lot de nouvelles activités : débats, projections, conférences, séminaires. Ces rencontres se tiennent dans des hôtels, des cafés – notamment Al-Rawda –, ou encore dans des centres culturels, lesquels étaient bien moins actifs avant la chute/libération. La ville semblait devenue l’une des plus dynamiques au monde en matière de débat public, de projections cinématographiques, de conférences, de congrès. Notre ami Osama Mohammed a projeté pour la première fois à Damas son film Les Étoiles du jour, la salle était pleine. À Jaramana, Notre terrible pays a été projeté, avec Razan et toi présentes à l’écran.
À Damas, je suis retourné aux rencontres avec des amis, des journalistes, des médias étrangers, et l’achat de souvenirs, parmi lesquels des chaussettes arborant une image de Hafez al-Assad exhibant ses muscles, vêtu d’un simple caleçon, et un portrait caricatural de Bachar, le cou exagérément allongé. Je n’ai pas réussi à mettre la main sur des tasses à l’effigie du père et du fils en sous-vêtements, dont j’ai vu des photos sur Internet. Après la chute du régime, dans le chaos des premiers jours, certains ont mis la main sur des clichés de la famille, dont deux où Hafez et Bachar posaient en caleçons, qui ont ont circulé sur les réseaux sociaux. La famille Assad a fini par être surnommée « La famille Abu Kalsoun ».
* * * * *
Le matin du 29 janvier, nous sommes retournés à Suweïda avec Wijdan Nassif et Jalal Nawfal. Akram et d’autres militants de la ville avaient obtenu de moi la promesse de revenir, et nous nous étions mis d’accord tous les trois pour accomplir ce voyage. Nous voulions aussi réfléchir aux moyens de construire une majorité politique dépassant les divisions communautaires, ainsi qu’à l’idée d’une Conférence nationale ou d’un Dialogue national, dont on parlait beaucoup après la chute du régime. Comment organiser la représentation politique dans cette nouvelle phase ? Notre hôte à Suweïda était notre ancien camarade de prison, Akram Maarouf. Après sa libération, il était devenu ingénieur et avait fondé une famille, avec son épouse et ses trois enfants. Deux parmi ceux-ci, un garçon et une fille, vivaient désormais en Allemagne. Notre premier repas à Suweïda fut un miliḥiya, un plat similaire au milḥi de la région voisine de Deraa : un grand plateau de morceaux d’agneau cuits avec leurs os, posés sur du riz, le tout mijoté dans du yaourt, lequel est servi aussi séparément dans des bols. Autour du plat principal, des kebbés frits et farcis de viande hachée. C’était absolument délicieux.
Environ cinquante personnes ont assisté à notre réunion, dont sept femmes. Mais la majorité du public était âgée, la plupart avaient la cinquantaine ou plus, à l’exception d’une jeune militante de vingt-sept ans, bien connue en ville. Le soir, nous avons été invités à une soirée avec oud, musique et vin local, chez Adnan Abu Assi lui-même. Lui, sa femme et ses enfants étaient engagés dans l’opposition et faisaient partie des figures les plus actives de la Place de la Dignité de Soueïda depuis août 2023. Son fils aîné avait même été brièvement arrêté à seize ans.
Au cours de cette soirée joyeuse, nous avons appris que Ahmad al-Char'a avait rencontré des factions militaires, qui avaient accepté de se dissoudre pour intégrer la nouvelle armée. Cela faisait suite à la dissolution de l’ancien corps militaire, du Parti Ba'th et du Parlement. Ahmad al-Char'a avait été proclamé président de transition et se voyait accorder le pouvoir de désigner un conseil législatif temporaire. Nous nous retrouvions ainsi face à une dictature transitoire, avec le risque qu’elle se transforme en une dictature permanente. Le même soir, sur la place des Omeyyades, des partisans scandaient : « Al-Joulani pour toujours ! Al-Joulani pour toujours ! Pas comme toi, Assad ! » Cela semblait être une référence au passé, qui pouvait aussi dessiner les contours d’un futur inquiétant : une Syrie assadienne sans Assad. L’appel à une éternité politique dépasse la seule dictature. Il ouvre la voie à l’anéantissement, car un pouvoir éternel ne peut exister sans une machine d’élimination, un système fondé sur la torture, les arrestations prolongées et des massacres à la manière du régime Assad.
* * * * *
Après un fastueux petit-déjeuner le lendemain matin, nous sommes rentrés à Damas. Jalal devait intervenir à 16 heures au café Al-Rawda, aux côtés d’un autre psychiatre, pour parler des enjeux psycho-politiques actuels en Syrie. Wijdan, en tant que figure du Mouvement politique des femmes, continuait d’observer la situation politique avec un mélange typiquement syrien d’enthousiasme et d’inquiétude. Elle m’a confié que ce qui l’exaspérait le plus était cette tendance, fréquente dans nos cercles, à la lamentation et aux plaintes face aux épreuves. Elle m’a donné quelques exemples. Je ne pouvais qu’être entièrement d’accord avec elle.
* * * * *
Lors de mon dernier jour à Damas, je suis retourné à Douma avec des amis. Nous avons fixé une plaque commémorative à l’entrée de l’immeuble où tu avais vécu avec Razan, Wael et Nazem, avant votre enlèvement. On pouvait y lire : « Dans cet immeuble ont résidé Razan Zaitouneh et Samira al-Khalil, puis Wael Hamada et Nazem al-Hamadi, jusqu’à leur enlèvement dans la nuit du 9 décembre 2013. » Nous avons frappé aux portes des appartements pour demander aux habitants l’autorisation d’installer la plaque. Tous n’ont pas ouvert, mais personne ne s’y est opposé. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part d’un couple quinquagénaire, tout particulièrement de la femme. Il s’agissait d’un spectacle étrange : une quinzaine d’hommes et de femmes gravissant les escaliers, équipés de caméras, de micros et de téléphones. Sur le trottoir, devant l’immeuble, nous étions peut-être une quarantaine à immortaliser ce moment. C’est Muawiya Hammoud, un quadragénaire originaire de Moadamiya, près de Damas, qui a fixé la plaque au mur, que Sherine al-Hayek et lui m’avaient aidé à la faire fabriquer.
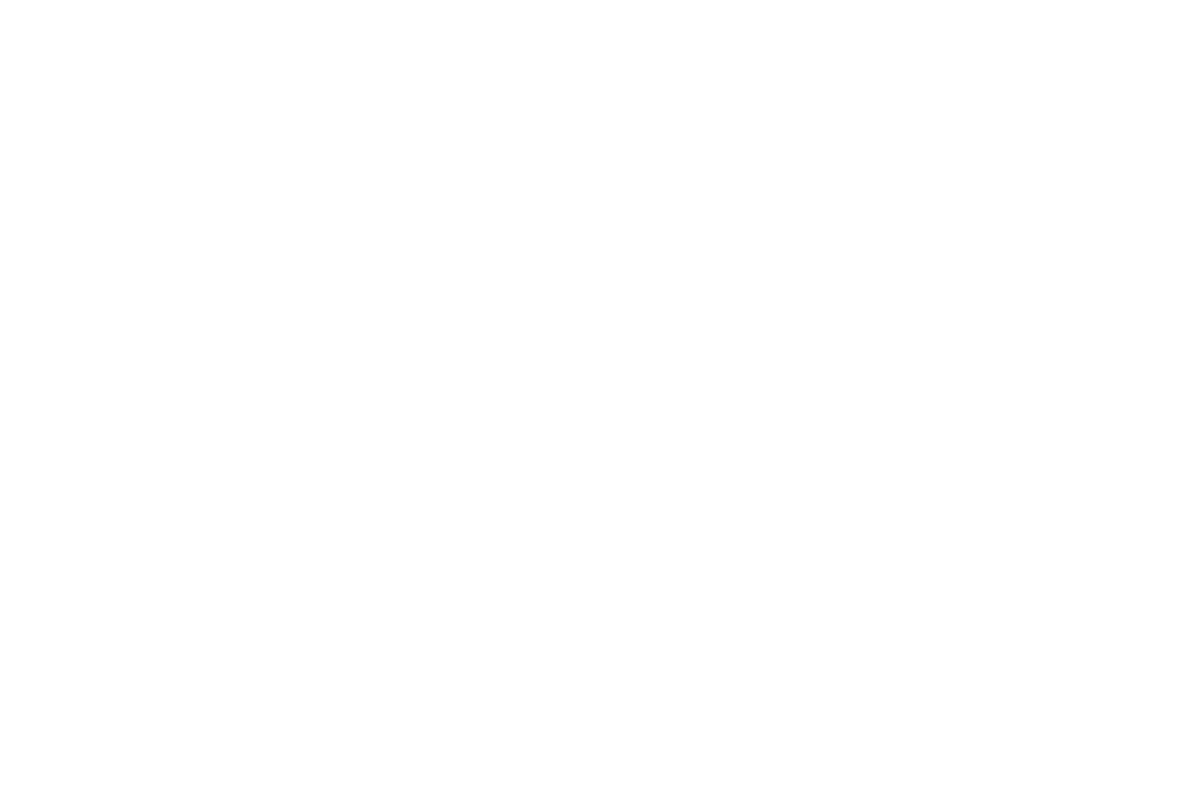
J’ai demandé à Sherine de me photographier au moment où je m’apprêtais à sortir par la porte métallique criblée d’éclats d’obus, la main levée comme pour la soutenir, imitant ainsi une photo de toi dans la même posture. Aujourd’hui, la couleur de la porte a changé. Elle est désormais d’un blanc cassé, alors qu’à ton époque, elle était brune et semble même rouge sur certaines photos. Je dois avouer que ta photo est plus belle. Ton mouvement, qui te montre soit en train d’ouvrir la porte, soit prête à en franchir le seuil, apporte une lumière qui jaillit de l’intérieur à travers les perforations du métal. Ces lueurs donnent à l’image une singularité que ma tentative de reproduction n’a pas su capturer. Dans ma version, c’est l’inverse : les trous de la porte donnent sur l’obscurité, tandis que la lumière vient de l’extérieur.
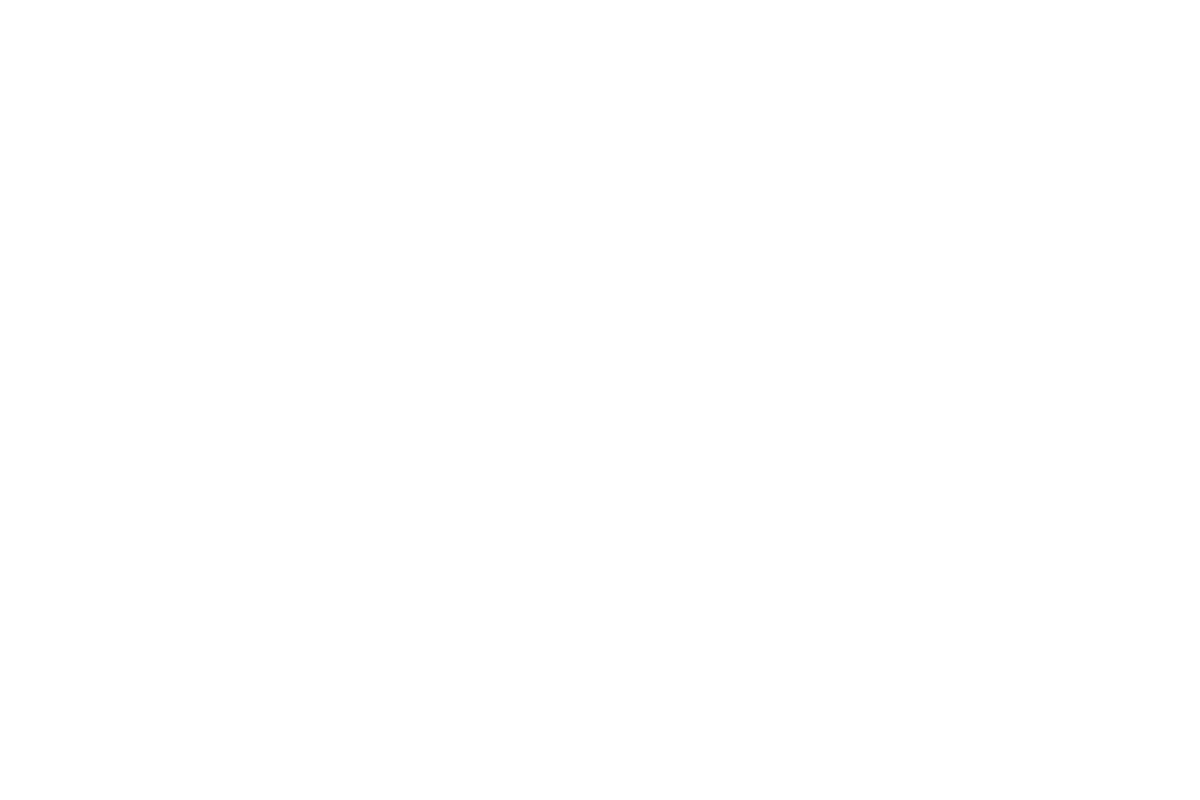
Sa couleur, tu sais, ressemble à celle de ton sac à main, celui que tu avais emporté en arrivant dans la Ghouta orientale, cet après-midi du 18 mai 2013. Je l’ai récupéré à Gaziantep, en Turquie, en 2018, après le déplacement forcé des gens de Douma. C’est le Dr Mohammed Katoub qui l’a apporté. Il a eu la sensibilité de s’éclipser aussitôt après m’avoir remis ce si lourd trésor. Pour la première fois, j’avais entre les mains un objet venant de toi. Il contenait ta carte d’identité, un document attestant que tu travaillais au Centre de documentation des violations, quelques bijoux, des papiers, un portefeuille renfermant des photos de nous deux, un chapelet en métal, des pinces à cheveux, et même un vieux mouchoir en papier, effiloché par le temps, que j’ai laissé dans le sac. Je le traite comme une relique sacrée.
Ou comme un sac d’explosifs. Ne m’en veux pas, Samour. Ce que je veux dire, c’est que j’ai peur de l’ouvrir, de déclencher en moi une explosion de chagrins enfouis, que j’ai tenté d’enterrer pendant toutes ces années. Rien ne me fait plus violemment souffrir que cette relique, à la fois sacrée et dévastatrice, qui incarne ta disparition et ton absence. Je le garde en hauteur, hors de portée, dans mon logement berlinois.
Pendant que nous fixions la plaque près de la porte, plusieurs journalistes, syriens et étrangers, prenaient des photos. Certains d’entre eux ne savaient presque rien de votre histoire, n’ayant même pas pris la peine de faire leurs devoirs pour s’informer. D’autres la connaissaient, mais manquaient de la sensibilité requise face à une cause comme la vôtre et face aux familles des disparus, dont j’étais le seul représentant ce jour-là. Leur quête d’un simple sujet journalistique les empêchait de saisir à quel point parler de cette affaire pouvait être psychiquement épuisant. Je n’ai pas pu retenir mon emportement face à des questions mal informées ou dépourvues d’empathie. Il y avait aussi ce journaliste d’un média français de droite, que je savais obsédé par l’idée de pousser les Syriens à cadrer leur témoignage dans l’agenda de la droite française et européenne à propos de l’islam radical, de la lutte contre le terrorisme et des droits des minorités. Cet homme de petite stature, qui était en bons termes avec le régime Assad toutes ces années, m’a demandé comment j’évaluais la situation. Je lui ai répondu d’un seul mot : Bonne !
Je suis arrivé à Beyrouth avec Sherine al-Hayek après un trajet matinal depuis Damas, afin d’éviter l’affluence aux postes-frontières aux heures suivantes de la journée. Du côté syrien, un fonctionnaire m’a informé que j’étais sous le coup d’une « interdiction de sortie ». Je lui ai répondu que je le savais. J’ai même précisé que cette interdiction remontait à septembre 2004. Tu t’en souviens, n’est-ce pas ? J’étais censé aller à Beyrouth pour assister à une conférence, mais j’avais été empêché de poursuivre le trajet et renvoyé au service des officiers à Damas. Tu te rappelles aussi que je n’ai jamais pu en connaître la raison, ni la lever, ni obtenir un passeport. L’employé m’a dit qu’il ne pouvait rien décider et que je devais attendre l’arrivée d’un officier dix minutes plus tard. Moins de dix minutes plus tard, un autre fonctionnaire m’a transféré vers un guichet voisin, où l’on m’a tamponné une carte spéciale sur laquelle j’avais inscrit mon nom, ceux de mes parents, mon lieu et ma date de naissance. Il semble que ce dernier fonctionnaire était expert des cas similaires au mien. D’après notre chauffeur libanais, certains anciens douaniers, qui avaient une solide expérience, avaient été réintégrés. Celui qui m’a délivré ce document faisait visiblement partie de cette génération-là. Mais je ne sais pas si l’interdiction a été levée définitivement. La nouvelle administration semble encore chancelante dans son travail et ses apprentissages. Il faudra probablement du temps avant que les procédures ne deviennent plus claires.
Quelques jours plus tôt, à Damas, j’avais rencontré un journaliste européen qui m’avait confié qu’il n’avait pas réussi à franchir la frontière syrienne. Finalement, il y était parvenu à l’ancienne. Je lui ai demandé s’il parlait de pot-de-vin. Il m’a répondu oui.
Aujourd’hui, 2 février. Ton anniversaire. Je l’ai évoqué au réveil, en prenant mon café chez Samer et Livia, à Beyrouth, où je suis arrivé hier. Tu te souviens d’eux ? Ils s’étaient mariés en 2004, à Alep, dans une belle demeure ancienne appelée Khan al-Shouneh, et nous étions parmi leurs invités. Livia est une Américaine qui parle couramment l’arabe. Samer, lui, est originaire d’Alep. Aujourd’hui, ils ont trois enfants : Ramla, qui étudie l’histoire et les relations internationales à Brown University aux États-Unis, Naji, qui fait des études d’économie et de relations internationales à Northeastern University également aux États-Unis, et le plus jeune, Yamen, en classe de troisième. Grand et athlétique, il pratique la boxe.
Pendant toutes ces années, j’ai célébré seul ton anniversaire, me souvenant de ta présence aimante, de ta tendresse, de ta douceur débordante, de ta générosité d’âme et de nos soirées entre amis, la nuit du 2 février ou la veille, la date officielle de mon propre anniversaire, censé précéder le tien d’un jour. Que la date de ma naissance soit en réalité inconnue, que celle qui figure sur mes papiers soit erronée, tout cela t’importait peu. Tu aimais que nous soyons enregistrés à un jour d’intervalle et tu voulais toujours que nous fêtions ensemble, chez nous, pour toi un verre de gin au citron que je te préparais ou du vin rouge, de l’arak pour la plupart de nos amis et moi-même.
Les années de ta disparition sont désormais aussi longues que celles que nous avons vécues ensemble, un peu plus de onze ans. Comme j’ai guerroyé pendant toutes ces années contre cette absence sourde et interminable, Samour ! Nous vivons la présence avec une attention distraite, toujours partiellement absents. Si le manque s’impose, nous regrettons de ne pas avoir pleinement habité le temps partagé, nous cherchons à le raviver à chaque instant, mais il nous échappe tout autant. Comme si la présence n’était que le produit du manque. Comme si nous n’étions pleinement là qu’en étant absents. Je formule cette pensée sous une forme générale, non seulement parce que je ne supporte pas admettre qu’elle est mon expérience personnelle au temps de ta présence et de ton absence, mais aussi parce que j’essaie de créer un repère. Pendant toutes ces années, je n’ai eu aucun guide pour m’aider à traiter de cette expérience. Certes, il y a eu de nombreux soutiens, des solidarités permanentes, mais l’exil, combiné à ta disparition et à l’effondrement brutal de notre pays pendant onze ans, m’a laissé seul et isolé face à ton absence. C’est une expérience première, au sens le plus fort du terme, une expérience sans précédent, sans modèle connu pour l’affronter. Je ne suis pas certain d’avoir su la traduire en mots. Tu sais pourtant que c’est tout ce que j’ai pour habiter ce monde. Je me sens comme ces mères ayant perdu un enfant ou des enfants, privées de soutien suffisant de leur entourage et de langage à la hauteur de leur sentiment. Comme cette femme qui s’était enroulée dans une corde de pendaison imprégnée de rouge, dernier témoin, peut-être, de la vie de son fils.
Les expériences premières sont insupportables. Elles peuvent tuer. Les mères meurent, broyées par elles, après les avoir vécues jusqu’au bout, ainsi que les pères. Mais ces expériences premières peuvent aussi faire renaître, si nous savons leur donner un sens, une loi, une règle pour une vie nouvelle. Ton mari essaie de donner un sens à ta longue absence silencieuse, un sens qui le protège de la violence brute de cette expérience et de sa cruauté originelle. Il y parvient et n’y parvient pas. En ce jour où tu es née, je pense à une survivante, dans une chambre d’ami à Beyrouth.
En ce jour où tu es venue au monde, je réfléchis aux différentes formes d’expériences comme un survivant, dans une chambre d’ami à Beyrouth. C’est au survivant de raconter, de ne jamais cesser de parler, d’évoquer, tant que l’absence perdure.
Je suis rentré à Berlin via Paris après quarante jours passés en Syrie, au Liban et sur les routes du voyage. Ma routine quotidienne m’a profondément manqué en ces temps où je n’ai eu aucune routine. Ma cellule m’a profondément manqué, comme je l’ai dit à certains amis. J’ai besoin de temps pour traiter et organiser tout ce que j’ai vu, vécu et appris durant ces semaines uniques, singulières, qu’on ne vit qu’une seule fois. Un esprit nouveau prend aujourd’hui forme dans le corps décharné de notre pays, un esprit fébrile, encore incertain. À peine un jour et demi après mon retour à Berlin, une question m’a saisi : pourquoi ne suis-je pas resté là-bas ? Que fais-je ici ? Pourquoi t’ai-je laissée seule pour revenir dans ce pays lointain ? Comme s’il m’avait fallu revenir ici pour comprendre aussitôt que ma place était à tes côtés. Rester, poursuivre la quête, suivre les traces, explorer les chemins de la justice pour toi. Pourquoi mon appartement berlinois est-il devenu cet espace de la « vie normale », ce lieu vers lequel je reviens toujours ? Pourquoi choisir la normalité, quand toi, on t’a privé à la fois de la vie et de la mort, et que moi, j’ai encore le choix ?
Je t’embrasse, mon cœur.
Yassin
Ou comme un sac d’explosifs. Ne m’en veux pas, Samour. Ce que je veux dire, c’est que j’ai peur de l’ouvrir, de déclencher en moi une explosion de chagrins enfouis, que j’ai tenté d’enterrer pendant toutes ces années. Rien ne me fait plus violemment souffrir que cette relique, à la fois sacrée et dévastatrice, qui incarne ta disparition et ton absence. Je le garde en hauteur, hors de portée, dans mon logement berlinois.
Pendant que nous fixions la plaque près de la porte, plusieurs journalistes, syriens et étrangers, prenaient des photos. Certains d’entre eux ne savaient presque rien de votre histoire, n’ayant même pas pris la peine de faire leurs devoirs pour s’informer. D’autres la connaissaient, mais manquaient de la sensibilité requise face à une cause comme la vôtre et face aux familles des disparus, dont j’étais le seul représentant ce jour-là. Leur quête d’un simple sujet journalistique les empêchait de saisir à quel point parler de cette affaire pouvait être psychiquement épuisant. Je n’ai pas pu retenir mon emportement face à des questions mal informées ou dépourvues d’empathie. Il y avait aussi ce journaliste d’un média français de droite, que je savais obsédé par l’idée de pousser les Syriens à cadrer leur témoignage dans l’agenda de la droite française et européenne à propos de l’islam radical, de la lutte contre le terrorisme et des droits des minorités. Cet homme de petite stature, qui était en bons termes avec le régime Assad toutes ces années, m’a demandé comment j’évaluais la situation. Je lui ai répondu d’un seul mot : Bonne !
* * * * *
Je suis arrivé à Beyrouth avec Sherine al-Hayek après un trajet matinal depuis Damas, afin d’éviter l’affluence aux postes-frontières aux heures suivantes de la journée. Du côté syrien, un fonctionnaire m’a informé que j’étais sous le coup d’une « interdiction de sortie ». Je lui ai répondu que je le savais. J’ai même précisé que cette interdiction remontait à septembre 2004. Tu t’en souviens, n’est-ce pas ? J’étais censé aller à Beyrouth pour assister à une conférence, mais j’avais été empêché de poursuivre le trajet et renvoyé au service des officiers à Damas. Tu te rappelles aussi que je n’ai jamais pu en connaître la raison, ni la lever, ni obtenir un passeport. L’employé m’a dit qu’il ne pouvait rien décider et que je devais attendre l’arrivée d’un officier dix minutes plus tard. Moins de dix minutes plus tard, un autre fonctionnaire m’a transféré vers un guichet voisin, où l’on m’a tamponné une carte spéciale sur laquelle j’avais inscrit mon nom, ceux de mes parents, mon lieu et ma date de naissance. Il semble que ce dernier fonctionnaire était expert des cas similaires au mien. D’après notre chauffeur libanais, certains anciens douaniers, qui avaient une solide expérience, avaient été réintégrés. Celui qui m’a délivré ce document faisait visiblement partie de cette génération-là. Mais je ne sais pas si l’interdiction a été levée définitivement. La nouvelle administration semble encore chancelante dans son travail et ses apprentissages. Il faudra probablement du temps avant que les procédures ne deviennent plus claires.
Quelques jours plus tôt, à Damas, j’avais rencontré un journaliste européen qui m’avait confié qu’il n’avait pas réussi à franchir la frontière syrienne. Finalement, il y était parvenu à l’ancienne. Je lui ai demandé s’il parlait de pot-de-vin. Il m’a répondu oui.
* * * * *
Aujourd’hui, 2 février. Ton anniversaire. Je l’ai évoqué au réveil, en prenant mon café chez Samer et Livia, à Beyrouth, où je suis arrivé hier. Tu te souviens d’eux ? Ils s’étaient mariés en 2004, à Alep, dans une belle demeure ancienne appelée Khan al-Shouneh, et nous étions parmi leurs invités. Livia est une Américaine qui parle couramment l’arabe. Samer, lui, est originaire d’Alep. Aujourd’hui, ils ont trois enfants : Ramla, qui étudie l’histoire et les relations internationales à Brown University aux États-Unis, Naji, qui fait des études d’économie et de relations internationales à Northeastern University également aux États-Unis, et le plus jeune, Yamen, en classe de troisième. Grand et athlétique, il pratique la boxe.
Pendant toutes ces années, j’ai célébré seul ton anniversaire, me souvenant de ta présence aimante, de ta tendresse, de ta douceur débordante, de ta générosité d’âme et de nos soirées entre amis, la nuit du 2 février ou la veille, la date officielle de mon propre anniversaire, censé précéder le tien d’un jour. Que la date de ma naissance soit en réalité inconnue, que celle qui figure sur mes papiers soit erronée, tout cela t’importait peu. Tu aimais que nous soyons enregistrés à un jour d’intervalle et tu voulais toujours que nous fêtions ensemble, chez nous, pour toi un verre de gin au citron que je te préparais ou du vin rouge, de l’arak pour la plupart de nos amis et moi-même.
Les années de ta disparition sont désormais aussi longues que celles que nous avons vécues ensemble, un peu plus de onze ans. Comme j’ai guerroyé pendant toutes ces années contre cette absence sourde et interminable, Samour ! Nous vivons la présence avec une attention distraite, toujours partiellement absents. Si le manque s’impose, nous regrettons de ne pas avoir pleinement habité le temps partagé, nous cherchons à le raviver à chaque instant, mais il nous échappe tout autant. Comme si la présence n’était que le produit du manque. Comme si nous n’étions pleinement là qu’en étant absents. Je formule cette pensée sous une forme générale, non seulement parce que je ne supporte pas admettre qu’elle est mon expérience personnelle au temps de ta présence et de ton absence, mais aussi parce que j’essaie de créer un repère. Pendant toutes ces années, je n’ai eu aucun guide pour m’aider à traiter de cette expérience. Certes, il y a eu de nombreux soutiens, des solidarités permanentes, mais l’exil, combiné à ta disparition et à l’effondrement brutal de notre pays pendant onze ans, m’a laissé seul et isolé face à ton absence. C’est une expérience première, au sens le plus fort du terme, une expérience sans précédent, sans modèle connu pour l’affronter. Je ne suis pas certain d’avoir su la traduire en mots. Tu sais pourtant que c’est tout ce que j’ai pour habiter ce monde. Je me sens comme ces mères ayant perdu un enfant ou des enfants, privées de soutien suffisant de leur entourage et de langage à la hauteur de leur sentiment. Comme cette femme qui s’était enroulée dans une corde de pendaison imprégnée de rouge, dernier témoin, peut-être, de la vie de son fils.
Les expériences premières sont insupportables. Elles peuvent tuer. Les mères meurent, broyées par elles, après les avoir vécues jusqu’au bout, ainsi que les pères. Mais ces expériences premières peuvent aussi faire renaître, si nous savons leur donner un sens, une loi, une règle pour une vie nouvelle. Ton mari essaie de donner un sens à ta longue absence silencieuse, un sens qui le protège de la violence brute de cette expérience et de sa cruauté originelle. Il y parvient et n’y parvient pas. En ce jour où tu es née, je pense à une survivante, dans une chambre d’ami à Beyrouth.
En ce jour où tu es venue au monde, je réfléchis aux différentes formes d’expériences comme un survivant, dans une chambre d’ami à Beyrouth. C’est au survivant de raconter, de ne jamais cesser de parler, d’évoquer, tant que l’absence perdure.
* * * * *
Je suis rentré à Berlin via Paris après quarante jours passés en Syrie, au Liban et sur les routes du voyage. Ma routine quotidienne m’a profondément manqué en ces temps où je n’ai eu aucune routine. Ma cellule m’a profondément manqué, comme je l’ai dit à certains amis. J’ai besoin de temps pour traiter et organiser tout ce que j’ai vu, vécu et appris durant ces semaines uniques, singulières, qu’on ne vit qu’une seule fois. Un esprit nouveau prend aujourd’hui forme dans le corps décharné de notre pays, un esprit fébrile, encore incertain. À peine un jour et demi après mon retour à Berlin, une question m’a saisi : pourquoi ne suis-je pas resté là-bas ? Que fais-je ici ? Pourquoi t’ai-je laissée seule pour revenir dans ce pays lointain ? Comme s’il m’avait fallu revenir ici pour comprendre aussitôt que ma place était à tes côtés. Rester, poursuivre la quête, suivre les traces, explorer les chemins de la justice pour toi. Pourquoi mon appartement berlinois est-il devenu cet espace de la « vie normale », ce lieu vers lequel je reviens toujours ? Pourquoi choisir la normalité, quand toi, on t’a privé à la fois de la vie et de la mort, et que moi, j’ai encore le choix ?
Je t’embrasse, mon cœur.
Yassin

