Yassin Haj Saleh
La Syrie avant la destruction
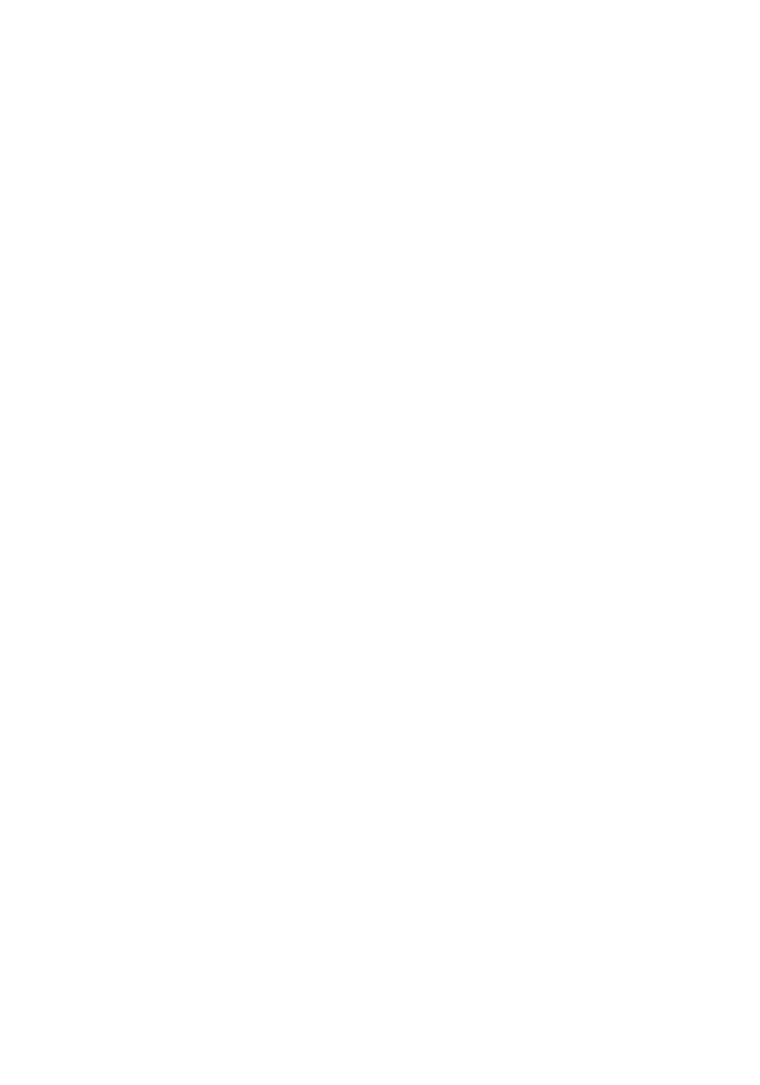
Youssef Abdelke, Figures 5, 1993
Ce texte a précédemment paru dans New Lines Magazine.
Mon père, Ibrahim al-Haj Saleh, était un homme de foi. Enfant, il avait fréquenté une école élémentaire islamique traditionnelle, connue sous le nom de "kuttab", où il avait appris à lire et à écrire. Je l'ai vu toute sa vie prier et jeûner pendant le mois sacré de Ramadan.
Ma mère, Ajaja al-Husayn, qui n'avait pas été à l'école, jeûnait également chaque Ramadan et priait occasionnellement. Elle est décédée en 1990, alors que trois de ses enfants étaient en prison. Mon père, qui s'est remarié plus tard, a effectué le pèlerinage à La Mecque quelque part au milieu des années 1990. Pourtant, jusqu'au jour où il est décédé comme octogénaire en 2011, il est resté le même homme que j'avais connu depuis ma plus tendre enfance, alors qu'il avait la trentaine : toujours rasé de près à l'exception d'une légère moustache, modéré dans son comportement et sa religiosité, réticent à rester longtemps hors de chez lui. (Mes frères prétendent que j'ai hérité de cet dernier attribut de lui.)
C'est sous la direction de mon père que j'ai mémorisé la premier sourate du Coran, celle qui porte le nom d'"al-Fatiha" (L'ouverture), alors que j'avais environ 5 ans. Je me souviens que je sautais accidentellement de "Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux" à "Maître du Jour de la Rétribution", en raison de la répétition de "le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux" dans la troisième ligne de cette courte sourate.
Nous vivions dans un petit village du nord rural de la Syrie connu sous différents noms, tels que al-Jurn, al-Jurn al-Aswad, al-Jurn al-Aswad al-Tahtani et Jurn al-Haj Saleh. Sa première école a ouvert en 1962, ce qui était une chance pour mon frère Saleh (né en 1957) qui, contrairement à nos frères aînés Muhammad (né en 1953) et Mustafa (né en 1955), n'avait pas à fréquenter une école située plusieurs kilomètres plus loin, en empruntant des chemins de terre devenant autant de vallées boueuses pendant la saison des pluies.
Je suis né en 1961. La tradition familiale veut que j'aie commencé l'école dans la deuxième moitié de l'année scolaire 1965-66 et que j'aie été le premier de ma classe. Je ne me souviens de rien de cela, bien que j'aie des souvenirs antérieurs. À l'école, où il n'y avait qu'un seul enseignant à temps plein pour les six classes, nous avons acquis des aspects des croyances et des idées des autres enseignants venus d'autres régions de Syrie dans notre région "éducativement sous-développée". Il y avait un enseignant d'éducation islamiste auprès duquel j'ai appris le poème bien connu, "O Imam des prophètes, mon soutien", ainsi qu'un autre vers du grand poète et penseur musulman sud-asiatique, Muhammad Iqbal, qui disait : "La Chine est à nous et les Arabes sont à nous / L'Inde est à nous, tout est à nous !" D'un enseignant baathiste, je me souviens encore de deux lignes de poésie comique qu'il avait composées lui-même, célébrant le coup d'État militaire du Baath : "Le 8 mars (1963) / La lumière brilla et le feu s'éteignit / Le Baath réalisa sa révolution / Et brisa les chaînes du colonialisme."
Mes souvenirs les plus heureux de l'enfance dans le village étaient liés à l'anniversaire du Prophète Muhammad, que nous appelions "al-Mawlud", célébré chaque année dans l'espace pour accueillir les invités connu dans le dialecte local sous le nom de "madhafa" ou "utha" (du turc "oda", signifiant "chambre"). Bien que cet espace ait appartenu au grand-frère de mon grand-père, Humaidi al-Haj Saleh, puis léguée à sa mort à son fils aîné, Mustafa, elle constituait un lieu commun pour les habitants du village et leurs invités. Parmi ses caractéristiques mémorables, il y avait une jarre en argile qui était remplie d'eau potable chaque jour, située dans un petit recoin alloué à cet effet. À mesure que les gouttes d'eau s'écoulaient de l'argile, elles créaient un flux qui aidait à refroidir l'eau servie aux invités. La jarre avait son propre récipient dédié en argent pour boire, lequel gravé de dessins et d'écritures, qui fut ensuite déformé lorsqu'un tracteur l'écrasa accidentellement au début des années 1970.
C'est dans ce même espace collectif que les habitants d'al-Jurn et des villages environnants ont appris la nouvelle de la guerre contre Israël en juin 1967, sur le poste de radio de mon oncle Mustafa. À un moment donné, j'ai été l'un des messagers envoyés chez nous, où les femmes du village s'étaient rassemblées, pour transmettre le mot que nous avions abattu tant d'avions ennemis jusqu'à présent.
De mon grand-oncle Humaidi, décédé vers cette époque, je me souviens qu'il s'asseyait par terre dans la madhafa sur un tapis fait de morceaux de vieux vêtements, ou sur une couverture de laine de mouton tressée, avec un grand Coran disposé devant lui sur un support spécial que nous appelions le "kursi", à partir duquel il lisait en balançant son corps d'avant en arrière.
Quant à mon grand-père lui-même, Abdallah, c'était un homme singulier, tout à fait différent des autres. Bien instruit, il possédait des vieux livres, dont je me souviens du "Collier unique" du savant du Xème siècle Ibn Abd Rabbih. Il était le chef du village, ou "mukhtar" (littéralement "l'élu", un titre officiel datant de l'époque ottomane), ainsi que son autorité religieuse ("mufti"). Rarement en contact avec les autres, il avait l'habitude de s'isoler complètement pendant plusieurs jours au moins une fois par an, se retranchant seul dans une pièce sans parler à personne, recevant sa nourriture à l'extérieur de la porte de la pièce. Cette pratique pieuse est connue sous le nom de "khalwa" (isolement).
Abdallah s'est marié trois fois, bien qu'il n'ait jamais eu plus d'une femme à la fois. Je soupçonne qu'il n'a jamais été un homme de famille et qu'il a peut-être même détesté les femmes. S'il passait devant un groupe de femmes pleurant en deuil, il les maudissait en arabe classique : "Que Dieu vous maudisse !" Je ne me souviens pas qu'il soit entré une seule fois chez nous, ni chez mon oncle Muhammad, son fils cadet issu de sa première femme, décédé précocement. Sa relation avec mon père, son fils aîné, était encore froide au moment de mon arrestation en 1980, alors qu'il avait environ 75 ans et que mon père en avait 52. La seule fois où j'ai ressenti de la chaleur de sa part était lorsque je suis allé au village vers 1979 et qu'il a appris que j'étudiais à l'université d'Alep. Malheureusement, il est décédé quelques mois seulement avant ma libération de prison à la fin de 1996.
Malgré ses bizarreries, mon grand-père - surnommé "le Savant" - pourrait avoir en partie été responsable de la réputation locale d'al-Jurn de haut-lieu de savoir, qui, dans ce contexte, signifiait la connaissance de la lecture et de l'écriture, ainsi que la manière de conduire les prières et autres cérémonies lors des célébrations de l'Aïd et du Mawlud. Les gens venaient à al-Jurn des villages environnants pour entendre les nouvelles et discuter de leurs affaires. Il était également visité par des voyageurs de plus loin, qui restaient parfois la nuit, dormant dans la madhafa.
Lors du Mawlud, la madhafa se remplissait de dizaines d'hommes, certains jouant de tambourins qu'ils réchauffaient de temps en temps au-dessus d'un feu allumé à l'extérieur de l'espace et prévu à cette fin. Mon père tapait de ses mains au rythme des tambourins, ajoutant sa voix à un chœur récitant : "Ô toi de La Mecque, ô toi de La Mecque, les louanges pour Muhammad me sont chères." J'aimais écouter cette incantation rythmée, qui est la seule dont je me souvienne maintenant. Parmi les chants en prose, je me souviens de "l'Essence muhammadienne", qui arrivait vers la fin de la cérémonie. Un jeune homme circulait dans la madhafa en portant un récipient spécial dont s'échappait de la fumée d'encens. À mesure que les vapeurs se mélangeaient au chant, qui devenait plus fort en même que les voix des hommes et des tambourins devenaient plus animés, et que les femmes ululaient aux moments de ravissement les plus intenses, l'extase transcendante saisissait certains des hommes plus jeunes. Se tenant au centre de l'espace, ils se convulsaient avant de tomber par terre. À ce moment-là, le cheikh Ibrahim - un dignitaire soufi avec un turban vert, du village voisin d'al-Tayba - murmurait quelques mots à l'oreille des hommes tombés et plaçait son épée sur eux, puis les recouvrait d'un drap ou d'une peau de mouton jusqu'à ce qu'ils se rétablissent quelques minutes plus tard.
C'était un spectacle générant une excitation extrême auprès de nous, les enfants. Le plus souvent, je m'asseyais près de mon père parmi les hommes, appréciant avec délectation tout cela. D'autres fois, je m'échappais pour jouer avec mes cousins du même âge. Les femmes étaient assises près de l'entrée, suivant les activités sans y participer directement, à l'exception des ululations, qui étaient réservées aux mères âgées. Au niveau de l'entrée se trouvaient de grands pots remplis d'une boisson si délicieuse que je n'en avais jamais assez. Je pensais que c'était ce que buvaient les résidents paradis. Ce n'est pas sans déception que j'ai appris plus tard qu'il s'agissait simplement d'eau sucrée, avec une pincée de "sel de citron" que nous utilisions pour la cuisson de la nourriture, et un peu d'eau de fleur d'oranger.
Un autre élément excitant des soirées du Mawlud était la lampe de luxe qui n'était utilisée que pour les occasions spéciales, telles que les mariages. Nos sources habituelles d'illumination étaient des lampes à pétrole, qui ne donnaient qu'une lueur faible. La lampe de luxe était beaucoup plus lumineux et fonctionnait à l'alcool plutôt qu'au simple kérosène. Cet alcool bleu précieux pouvait être versé dans nos paumes et allumé avec un briquet pour produire une flamme bleue sans fumée. Ce qui était encore plus important pour nous était que sa lumière allongeait nos ombres. J'aimais voir mon ombre s'étendre si loin. Contrairement aux lampes à kérosène, la lampe de luxe attirait également les papillons de nuit, qui tombaient morts lorsqu'ils touchaient sa base. La lampe à kérosène ne recevrait jamais l'honneur d'un tel sacrifice.
Le deuxième espace public du village, à part la madhafa, était le cimetière adjacent, dont les tombes étaient réparties sur toute une colline. Mes souvenirs d'enfance de ce cimetière sont plus joyeux que tristes. Les matins des fêtes de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha, nous enfants allions tôt au cimetière et prenions les bonbons déposés par les femmes sur les tombes des proches. Parfois, on nous demandait de lire al-Fatiha ou d'autres versets coraniques pour les âmes des morts, ce que je faisais avec le plaisir d'un élève diligent qui savait qu'une récompense était à venir.
Outre les bonbons, on pouvait aussi nous donner un ou deux francs, pour acheter plus encore de sucreries dans l'unique épicerie du village, qui appartenait à mon oncle Muhammad. Il n'y avait rien d'autre à acheter pour un enfant de mon âge que des bonbons et des graines de tournesol ou de citrouille. À l'occasion de l'Aïd, des dizaines d'hommes se rassemblaient dans la madhafa et répétaient les chants habituels avec conviction : "Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, louange à Dieu, Dieu est le plus grand en effet, louange suprême à Dieu, gloire à Dieu jour et nuit !" Pendant ce temps, nous les enfants courions du cimetière à la madhafa et attendions impatiemment que les rites religieux se terminent pour pouvoir manger un ou deux morceaux de la viande du mouton sacrifié pour l'Aïd. Cette viande, nous la saisissions avec nos mains nues sur un plateau réservé spécialement aux enfants, où la viande et son jus étaient disposés sur des pains plats fraîchement cuits. À ce jour, je maintiens que c'est le meilleur pain au monde. Le plus fin de tous ces mets était le pain "malawih" que ma mère cuisait sur le gril en métal noir convexe dans notre cuisine chaque matin. Évitant l'équipement spécial utilisé pour des boulangers moins habiles, ma mère pétrissait la pâte de malawih avec ses mains jusqu'à ce qu'elle soit assez fine et large pour recouvrir presque entièrement le gril.
Alors que l'Aïd est associé pour beaucoup à de nouveaux vêtements, je ne me souviens pas de cela dans mon cas. Notre famille devenait plus pauvre à l'époque, et les nouveaux vêtements n'étaient pas quelque chose que nous attendions. Néanmoins, les bonbons, les jeux et la bonne humeur de chacun alors qu'ils échangeaient des salutations de l'Aïd apportaient de la joie à mon cœur. Un visiteur dirait : "Un Aïd béni pour vous !" Et ma mère répondrait : "Un Aïd des plus bénis pour nous deux !" Ensuite, les adultes s'asseyaient sur des nattes de sol sur l'herbe devant la maison et buvaient du thé. Dans mes souvenirs, c'était toujours le printemps. À un moment donné chaque année, avant l'Aïd al-Fitr, mon père donnait une partie du blé cultivé sur nos terres à ceux dans le besoin parmi mes oncles. C'était son acte de "zakat" (l'aumône), obligatoire pour chaque musulman. Donnait-il aussi de notre troupeau de moutons, dont le nombre diminuait par dizaines entières, jusqu'a compter moins de dix têtes à la fin des années 1960 ? Je ne sais pas.
Ma mère, Ajaja al-Husayn, qui n'avait pas été à l'école, jeûnait également chaque Ramadan et priait occasionnellement. Elle est décédée en 1990, alors que trois de ses enfants étaient en prison. Mon père, qui s'est remarié plus tard, a effectué le pèlerinage à La Mecque quelque part au milieu des années 1990. Pourtant, jusqu'au jour où il est décédé comme octogénaire en 2011, il est resté le même homme que j'avais connu depuis ma plus tendre enfance, alors qu'il avait la trentaine : toujours rasé de près à l'exception d'une légère moustache, modéré dans son comportement et sa religiosité, réticent à rester longtemps hors de chez lui. (Mes frères prétendent que j'ai hérité de cet dernier attribut de lui.)
C'est sous la direction de mon père que j'ai mémorisé la premier sourate du Coran, celle qui porte le nom d'"al-Fatiha" (L'ouverture), alors que j'avais environ 5 ans. Je me souviens que je sautais accidentellement de "Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux" à "Maître du Jour de la Rétribution", en raison de la répétition de "le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux" dans la troisième ligne de cette courte sourate.
Nous vivions dans un petit village du nord rural de la Syrie connu sous différents noms, tels que al-Jurn, al-Jurn al-Aswad, al-Jurn al-Aswad al-Tahtani et Jurn al-Haj Saleh. Sa première école a ouvert en 1962, ce qui était une chance pour mon frère Saleh (né en 1957) qui, contrairement à nos frères aînés Muhammad (né en 1953) et Mustafa (né en 1955), n'avait pas à fréquenter une école située plusieurs kilomètres plus loin, en empruntant des chemins de terre devenant autant de vallées boueuses pendant la saison des pluies.
Je suis né en 1961. La tradition familiale veut que j'aie commencé l'école dans la deuxième moitié de l'année scolaire 1965-66 et que j'aie été le premier de ma classe. Je ne me souviens de rien de cela, bien que j'aie des souvenirs antérieurs. À l'école, où il n'y avait qu'un seul enseignant à temps plein pour les six classes, nous avons acquis des aspects des croyances et des idées des autres enseignants venus d'autres régions de Syrie dans notre région "éducativement sous-développée". Il y avait un enseignant d'éducation islamiste auprès duquel j'ai appris le poème bien connu, "O Imam des prophètes, mon soutien", ainsi qu'un autre vers du grand poète et penseur musulman sud-asiatique, Muhammad Iqbal, qui disait : "La Chine est à nous et les Arabes sont à nous / L'Inde est à nous, tout est à nous !" D'un enseignant baathiste, je me souviens encore de deux lignes de poésie comique qu'il avait composées lui-même, célébrant le coup d'État militaire du Baath : "Le 8 mars (1963) / La lumière brilla et le feu s'éteignit / Le Baath réalisa sa révolution / Et brisa les chaînes du colonialisme."
Mes souvenirs les plus heureux de l'enfance dans le village étaient liés à l'anniversaire du Prophète Muhammad, que nous appelions "al-Mawlud", célébré chaque année dans l'espace pour accueillir les invités connu dans le dialecte local sous le nom de "madhafa" ou "utha" (du turc "oda", signifiant "chambre"). Bien que cet espace ait appartenu au grand-frère de mon grand-père, Humaidi al-Haj Saleh, puis léguée à sa mort à son fils aîné, Mustafa, elle constituait un lieu commun pour les habitants du village et leurs invités. Parmi ses caractéristiques mémorables, il y avait une jarre en argile qui était remplie d'eau potable chaque jour, située dans un petit recoin alloué à cet effet. À mesure que les gouttes d'eau s'écoulaient de l'argile, elles créaient un flux qui aidait à refroidir l'eau servie aux invités. La jarre avait son propre récipient dédié en argent pour boire, lequel gravé de dessins et d'écritures, qui fut ensuite déformé lorsqu'un tracteur l'écrasa accidentellement au début des années 1970.
C'est dans ce même espace collectif que les habitants d'al-Jurn et des villages environnants ont appris la nouvelle de la guerre contre Israël en juin 1967, sur le poste de radio de mon oncle Mustafa. À un moment donné, j'ai été l'un des messagers envoyés chez nous, où les femmes du village s'étaient rassemblées, pour transmettre le mot que nous avions abattu tant d'avions ennemis jusqu'à présent.
De mon grand-oncle Humaidi, décédé vers cette époque, je me souviens qu'il s'asseyait par terre dans la madhafa sur un tapis fait de morceaux de vieux vêtements, ou sur une couverture de laine de mouton tressée, avec un grand Coran disposé devant lui sur un support spécial que nous appelions le "kursi", à partir duquel il lisait en balançant son corps d'avant en arrière.
Quant à mon grand-père lui-même, Abdallah, c'était un homme singulier, tout à fait différent des autres. Bien instruit, il possédait des vieux livres, dont je me souviens du "Collier unique" du savant du Xème siècle Ibn Abd Rabbih. Il était le chef du village, ou "mukhtar" (littéralement "l'élu", un titre officiel datant de l'époque ottomane), ainsi que son autorité religieuse ("mufti"). Rarement en contact avec les autres, il avait l'habitude de s'isoler complètement pendant plusieurs jours au moins une fois par an, se retranchant seul dans une pièce sans parler à personne, recevant sa nourriture à l'extérieur de la porte de la pièce. Cette pratique pieuse est connue sous le nom de "khalwa" (isolement).
Abdallah s'est marié trois fois, bien qu'il n'ait jamais eu plus d'une femme à la fois. Je soupçonne qu'il n'a jamais été un homme de famille et qu'il a peut-être même détesté les femmes. S'il passait devant un groupe de femmes pleurant en deuil, il les maudissait en arabe classique : "Que Dieu vous maudisse !" Je ne me souviens pas qu'il soit entré une seule fois chez nous, ni chez mon oncle Muhammad, son fils cadet issu de sa première femme, décédé précocement. Sa relation avec mon père, son fils aîné, était encore froide au moment de mon arrestation en 1980, alors qu'il avait environ 75 ans et que mon père en avait 52. La seule fois où j'ai ressenti de la chaleur de sa part était lorsque je suis allé au village vers 1979 et qu'il a appris que j'étudiais à l'université d'Alep. Malheureusement, il est décédé quelques mois seulement avant ma libération de prison à la fin de 1996.
Malgré ses bizarreries, mon grand-père - surnommé "le Savant" - pourrait avoir en partie été responsable de la réputation locale d'al-Jurn de haut-lieu de savoir, qui, dans ce contexte, signifiait la connaissance de la lecture et de l'écriture, ainsi que la manière de conduire les prières et autres cérémonies lors des célébrations de l'Aïd et du Mawlud. Les gens venaient à al-Jurn des villages environnants pour entendre les nouvelles et discuter de leurs affaires. Il était également visité par des voyageurs de plus loin, qui restaient parfois la nuit, dormant dans la madhafa.
Lors du Mawlud, la madhafa se remplissait de dizaines d'hommes, certains jouant de tambourins qu'ils réchauffaient de temps en temps au-dessus d'un feu allumé à l'extérieur de l'espace et prévu à cette fin. Mon père tapait de ses mains au rythme des tambourins, ajoutant sa voix à un chœur récitant : "Ô toi de La Mecque, ô toi de La Mecque, les louanges pour Muhammad me sont chères." J'aimais écouter cette incantation rythmée, qui est la seule dont je me souvienne maintenant. Parmi les chants en prose, je me souviens de "l'Essence muhammadienne", qui arrivait vers la fin de la cérémonie. Un jeune homme circulait dans la madhafa en portant un récipient spécial dont s'échappait de la fumée d'encens. À mesure que les vapeurs se mélangeaient au chant, qui devenait plus fort en même que les voix des hommes et des tambourins devenaient plus animés, et que les femmes ululaient aux moments de ravissement les plus intenses, l'extase transcendante saisissait certains des hommes plus jeunes. Se tenant au centre de l'espace, ils se convulsaient avant de tomber par terre. À ce moment-là, le cheikh Ibrahim - un dignitaire soufi avec un turban vert, du village voisin d'al-Tayba - murmurait quelques mots à l'oreille des hommes tombés et plaçait son épée sur eux, puis les recouvrait d'un drap ou d'une peau de mouton jusqu'à ce qu'ils se rétablissent quelques minutes plus tard.
C'était un spectacle générant une excitation extrême auprès de nous, les enfants. Le plus souvent, je m'asseyais près de mon père parmi les hommes, appréciant avec délectation tout cela. D'autres fois, je m'échappais pour jouer avec mes cousins du même âge. Les femmes étaient assises près de l'entrée, suivant les activités sans y participer directement, à l'exception des ululations, qui étaient réservées aux mères âgées. Au niveau de l'entrée se trouvaient de grands pots remplis d'une boisson si délicieuse que je n'en avais jamais assez. Je pensais que c'était ce que buvaient les résidents paradis. Ce n'est pas sans déception que j'ai appris plus tard qu'il s'agissait simplement d'eau sucrée, avec une pincée de "sel de citron" que nous utilisions pour la cuisson de la nourriture, et un peu d'eau de fleur d'oranger.
Un autre élément excitant des soirées du Mawlud était la lampe de luxe qui n'était utilisée que pour les occasions spéciales, telles que les mariages. Nos sources habituelles d'illumination étaient des lampes à pétrole, qui ne donnaient qu'une lueur faible. La lampe de luxe était beaucoup plus lumineux et fonctionnait à l'alcool plutôt qu'au simple kérosène. Cet alcool bleu précieux pouvait être versé dans nos paumes et allumé avec un briquet pour produire une flamme bleue sans fumée. Ce qui était encore plus important pour nous était que sa lumière allongeait nos ombres. J'aimais voir mon ombre s'étendre si loin. Contrairement aux lampes à kérosène, la lampe de luxe attirait également les papillons de nuit, qui tombaient morts lorsqu'ils touchaient sa base. La lampe à kérosène ne recevrait jamais l'honneur d'un tel sacrifice.
Le deuxième espace public du village, à part la madhafa, était le cimetière adjacent, dont les tombes étaient réparties sur toute une colline. Mes souvenirs d'enfance de ce cimetière sont plus joyeux que tristes. Les matins des fêtes de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha, nous enfants allions tôt au cimetière et prenions les bonbons déposés par les femmes sur les tombes des proches. Parfois, on nous demandait de lire al-Fatiha ou d'autres versets coraniques pour les âmes des morts, ce que je faisais avec le plaisir d'un élève diligent qui savait qu'une récompense était à venir.
Outre les bonbons, on pouvait aussi nous donner un ou deux francs, pour acheter plus encore de sucreries dans l'unique épicerie du village, qui appartenait à mon oncle Muhammad. Il n'y avait rien d'autre à acheter pour un enfant de mon âge que des bonbons et des graines de tournesol ou de citrouille. À l'occasion de l'Aïd, des dizaines d'hommes se rassemblaient dans la madhafa et répétaient les chants habituels avec conviction : "Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, louange à Dieu, Dieu est le plus grand en effet, louange suprême à Dieu, gloire à Dieu jour et nuit !" Pendant ce temps, nous les enfants courions du cimetière à la madhafa et attendions impatiemment que les rites religieux se terminent pour pouvoir manger un ou deux morceaux de la viande du mouton sacrifié pour l'Aïd. Cette viande, nous la saisissions avec nos mains nues sur un plateau réservé spécialement aux enfants, où la viande et son jus étaient disposés sur des pains plats fraîchement cuits. À ce jour, je maintiens que c'est le meilleur pain au monde. Le plus fin de tous ces mets était le pain "malawih" que ma mère cuisait sur le gril en métal noir convexe dans notre cuisine chaque matin. Évitant l'équipement spécial utilisé pour des boulangers moins habiles, ma mère pétrissait la pâte de malawih avec ses mains jusqu'à ce qu'elle soit assez fine et large pour recouvrir presque entièrement le gril.
Alors que l'Aïd est associé pour beaucoup à de nouveaux vêtements, je ne me souviens pas de cela dans mon cas. Notre famille devenait plus pauvre à l'époque, et les nouveaux vêtements n'étaient pas quelque chose que nous attendions. Néanmoins, les bonbons, les jeux et la bonne humeur de chacun alors qu'ils échangeaient des salutations de l'Aïd apportaient de la joie à mon cœur. Un visiteur dirait : "Un Aïd béni pour vous !" Et ma mère répondrait : "Un Aïd des plus bénis pour nous deux !" Ensuite, les adultes s'asseyaient sur des nattes de sol sur l'herbe devant la maison et buvaient du thé. Dans mes souvenirs, c'était toujours le printemps. À un moment donné chaque année, avant l'Aïd al-Fitr, mon père donnait une partie du blé cultivé sur nos terres à ceux dans le besoin parmi mes oncles. C'était son acte de "zakat" (l'aumône), obligatoire pour chaque musulman. Donnait-il aussi de notre troupeau de moutons, dont le nombre diminuait par dizaines entières, jusqu'a compter moins de dix têtes à la fin des années 1960 ? Je ne sais pas.
Un été, il me semble que c'était en 1968, j'ai appris une partie du Coran dans une école de kuttab dirigée par mon frère Muhammad, qui avait huit ans de plus que moi, sous la supervision de notre père. J'ai mémorisé la plupart des courtes sourates de la dernière section du livre. L'été suivant, j'ai fréquenté un autre kuttab dans le village voisin d'Al-Faris, dirigé par un autre parent. Ici, les étudiants apprenaient à lire, à écrire, à compter, à dicter et à épeler les mots des chapitres les plus courts du Coran.
J'ai commencé à jeûner pendant le mois de ramadan alors que j'étais en troisième année, ce qui était, je crois, également en 1968. Le premier jour, j'ai eu faim après seulement quelques heures et j'ai rompu mon jeûne bien avant l'heure de la rupture du jeûne au coucher du soleil. J'ai réussi à jeûner toute la journée pendant plus d'une semaine par la suite, mais j'ai rompu mon jeûne précocement à nouveau le neuvième jour après avoir eu faim. Néanmoins, mes efforts m'ont valu l'approbation de mes parents, qui étaient heureux de me voir me joindre aux adultes dans leur jeûne à un si jeune âge. Je me souviens encore qu'ils m'ont récompensé avec un cuisse de dinde à manger une nuit pendant le ramadan. À l'époque, il était vraiment rare de manger de la viande - cela n'arrivait que quelques fois par an. Ma mère résistait toujours aux demandes de son fils grognon de tuer l'une de ses rares poules parce qu'il voulait la manger. Elle devait rationner la nourriture pour sept enfants - plus tard huit - en plus de lui. Mais chaque fois qu'elle sacrifiait une poule, elle me régalait d'un sandwich particulièrement appétissant. (Il est fort probable qu'elle faisait sentir à chacun de ses enfants qu'ils étaient traités de cette manière.)
Ma mère travaillait toute la journée pour s'occuper de sa famille grandissante. Elle cuisinait tous les jours. Elle trayait nos brebis et barattait le lait, extrayant le beurre avant qu'il ne fonde pour le transformer en graisse de cuisson. Elle ramassait du bois de chauffage. Pendant la saison du coton, elle ramassait du coton pour un maigre salaire. Tout cela, elle mettait au monde et élevait ses enfants. Je me souviens d'elle enceinte de mes deux frères cadets, Khalil et Firas.
Mon père ne faisait pas le ménage à proprement parler, bien qu'il coupait nos cheveux et nos ongles, et s'occupait des terres agricoles. Jusqu'à environ 1968 - si ma mémoire est bonne -, il avait embauché un garçon pour garder nos moutons en échange d'un agneau par mois. Plus tard, mon frère Saleh et moi gardions le nombre décroissant de chèvres et de brebis. Ma mère a ressenti un certain soulagement lorsqu'elle a déménagé avec ses enfants plus jeunes dans la ville de Raqqa à compter de l'automne 1976. Peu de temps après, son fils aîné Muhammad est devenu médecin, et la situation financière de la famille a commencé à s'améliorer.
Parmi les traditions du ramadan observées par mon père (le fils aîné d'Abdallah al-Haj Saleh) et mon oncle Mustafa (le fils aîné de Humaidi al-Haj Saleh), il y avait la récitation du Coran entier. Ce n'était pas un exploit que n'importe qui pouvait accomplir. Encouragé par les adultes dont j'avais gagné les éloges grâce à mes performances académiques à l'école, j'ai participé à ce défi lors des ramadans que je jeûnais dans le village. En sixième année, j'ai réussi à terminer le Coran en 19 jours, un exploit dont je me suis assuré de me vanter devant mon oncle Mustafa, qui n'était pas avare en louanges. Avide d'en faire plus, j'ai recommencé le livre depuis le début, visant à le terminer une deuxième fois avant la fin du mois, mais je suis devenu paresseux avant même de finir le deuxième (et le plus long) chapitre, la sourate al-Baqarah, et j'ai abandonné, satisfait d'avoir déjà suffisamment payé ma dette.
Je me souviens à peine des études religieuses à l'école. Peut-être n'y avait-il rien de tel à l'époque. Avec un seul enseignant jusqu'à ma quatrième année, puis deux en cinquième et sixième années, dans seulement deux salles pour toutes les six années, les cours avaient tendance à se mélanger. Je me souviens de cours de lecture, d'arithmétique et de calligraphie, puis de grammaire, de science, d'histoire et de géographie. Ce que je peux encore me rappeler des cours de religion se résumait à mémoriser des chapitres ou des versets du Coran. Je ne me souviens pas où j'ai appris à prier, bien qu'il me semble que c'était avec mon père, et non à l'école. J'ai commencé à prier en sixième année, de ma propre volonté. Mon père n'a fait aucun geste pour nous l'imposer, ni n'ai-je vu aucun de mes trois frères aînés le faire. Je me lavais avec le même seau en cuivre que mon père utilisait, puis je faisais les ablutions rituelles. La plupart di temps, je priais chaque prière à son heure désignée. Mon père essayait de me faciliter les choses, disant qu'il était acceptable de combiner deux prières en une, ce que je faisais parfois. Mais je préférais prier chaque prière à l'heure prévue.
Une fois, probablement pendant l'été 1971, j'ai prié la prière du Maghreb au coucher du soleil sur un pont en bois devant la maison, sur lequel nous dormions pendant les mois chauds. Lorsque j'ai fini de prier, j'ai été submergé par une sérénité extraordinaire, un calme et une paix intérieure que je n'avais jamais ressentis auparavant. Cela ne s'est plus jamais reproduit lors des prières suivantes, mais ces précieux moments sont restés vifs et vivants dans ma mémoire. Rien n'y ressemble, sauf quelques rares moments de tranquillité glanés en lisant des livres en prison.
Mes prières n'étaient pas toujours aussi solennelles, cependant. Plus tard la même année, à l'automne, mes frères Saleh et Mustafa ont essayé de troubler mes moments sacrés en me faisant rire. C'était un an après les massacres de Septembre noir en Jordanie, la radio syrienne consacrait une heure chaque jour à la Palestine, à partir de 18h30, présentée par un homme au prétendu accent palestinien nommé Abu Salim. Une fois, Abu Salim critiquait le roi Hussein de Jordanie pour avoir promis que les guérilleros palestiniens "ne passeraient pas" de Jordanie en Palestine pour mener des opérations contre les occupants israéliens. Apparemment, la prononciation par Abu Salim des mots "ne passeront pas" ("ma yumarroosh") a suffi à me faire exploser de rire. Et Saleh pensait qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour répéter la phrase que lorsque j'étais prosterné en prière, me remplissant de colère et de rire en même temps.
C'était à peu près à la même époque, en sixième année (1970-71), que je suis tombé sur le numéro d'un magazine soviétique en langue arabe - peut-être al-Madar (L'Orbite) ou al-Ittihad al-Sufyiti (L'Union soviétique) - dont j'appréciais les images colorées. En me voyant le tenir, mon enseignant me l'a arraché furieusement de mes mains et l'a déchiré en morceaux, disant: "C'est un magazine communiste!" Contre cette injustice grossière, je ne pouvais rien faire. C'était peut-être à cette époque que le même enseignant m'a donné un livre religieux sur l'islam, avec une couverture olive et, bien sûr, sans images. Cela m'ennuyait à mourir et je ne me souviens plus du tout de son contenu maintenant. Des années plus tard, cet enseignant est devenu un "commissaire de la jeunesse" dans l'une des écoles de Raqqa, ce qui signifie qu'il devait être un baathiste.
L'automne 1971 a marqué la première grande séparation de ma vie, lorsque j'ai quitté ma mère pour vivre à Raqqa avec mes frères Saleh et Mustafa, qui étaient alors en neuvième et sixième années, respectivement. Notre frère aîné Muhammad avait terminé deuxième à Raqqa aux examens du baccalauréat cet été-là, ce qui lui a valu une place à l'Université d'Alep pour étudier la médecine. Son nom a été prononcé à la radio de Damas, et il a reçu une allocation mensuelle de 150 livres syriennes (alors équivalant à 40 dollars) de l'État, ce qui était une bouée de sauvetage pour nos parents. Notre père cherchait lui-même du travail à Raqqa à l'époque qui n'aurait pas payé plus que cette somme.
À Raqqa, j'ai continué à prier pendant un mois ou deux, puis j'ai arrêté. Il n'y avait pas de raison particulière à cela que je puisse me rappeler. Sous l'influence de mes frères Saleh et Mustafa - sans parler de l'aîné Muhammad, qui leur avait enseigné ses manières - j'ai commencé à entrer dans un monde différent, celui de la "culture", des livres, des idées et des arguments: le monde de l'esprit. Parmi les sujets débattus dans ce monde, il y avait l'existence de Dieu. Mon frère Mustafa croyait que tout pouvait s'expliquer par la nature. Je lui demandais: "Qui t'a créé?" Il répondait: "La nature!" Quand je demandais qui avait créé la nature, il répliquait: "Qui a créé Dieu?" Il disant que l'univers provenait de nébuleuses cosmiques, une thèse dont j'ai appris plus tard qu'elle venait d'Emmanuel Kant.
Mes frères et moi avons fréquenté l'école à la fois dans le village et à Raqqa. Mon père a été contraint de vivre avec nous à Raqqa tout en travaillant à temps partiel comme ouvrier, car les revenus de nos terres ne suffisaient plus pour notre famille de dix personnes, à laquelle s'est rajouté mon frère Firas en 1972. Nous entrions dans l'adolescence loin de notre mère, qui est restée avec les enfants plus jeunes dans le village. Nos revenus étaient maigres. La vie était difficile.
Un vendredi à la fin de 1971 ou au début de 1972, mon père m'a emmené prier avec lui à la mosquée al-Fawwaz, près de la chambre que mes deux frères et moi louions avec lui à Raqqa pour 45 livres syriennes (12 dollars) par mois. En entrant dans cette mosquée au milieu de la rue Tell Abyad, j'avais l'impression que tous les yeux de la salle de prière étaient fixés sur moi, me mettant profondément mal à l'aise. Jusqu'alors, je n'avais prié que parmi des amis et des proches dans les mosquées de notre village. Je me suis bien comporté pendant la prière, mais je n'ai pas voulu recommencer. Mon père n'a pas insisté, et je suis resté loin des prières dans les mosquées pendant des années. Mon seul contact avec l'islam était de lire le Coran, bien que pas trop souvent. Ce contact a eu un grand impact sur ma personnalité et mes croyances ultérieures.
J'ai commencé à jeûner pendant le mois de ramadan alors que j'étais en troisième année, ce qui était, je crois, également en 1968. Le premier jour, j'ai eu faim après seulement quelques heures et j'ai rompu mon jeûne bien avant l'heure de la rupture du jeûne au coucher du soleil. J'ai réussi à jeûner toute la journée pendant plus d'une semaine par la suite, mais j'ai rompu mon jeûne précocement à nouveau le neuvième jour après avoir eu faim. Néanmoins, mes efforts m'ont valu l'approbation de mes parents, qui étaient heureux de me voir me joindre aux adultes dans leur jeûne à un si jeune âge. Je me souviens encore qu'ils m'ont récompensé avec un cuisse de dinde à manger une nuit pendant le ramadan. À l'époque, il était vraiment rare de manger de la viande - cela n'arrivait que quelques fois par an. Ma mère résistait toujours aux demandes de son fils grognon de tuer l'une de ses rares poules parce qu'il voulait la manger. Elle devait rationner la nourriture pour sept enfants - plus tard huit - en plus de lui. Mais chaque fois qu'elle sacrifiait une poule, elle me régalait d'un sandwich particulièrement appétissant. (Il est fort probable qu'elle faisait sentir à chacun de ses enfants qu'ils étaient traités de cette manière.)
Ma mère travaillait toute la journée pour s'occuper de sa famille grandissante. Elle cuisinait tous les jours. Elle trayait nos brebis et barattait le lait, extrayant le beurre avant qu'il ne fonde pour le transformer en graisse de cuisson. Elle ramassait du bois de chauffage. Pendant la saison du coton, elle ramassait du coton pour un maigre salaire. Tout cela, elle mettait au monde et élevait ses enfants. Je me souviens d'elle enceinte de mes deux frères cadets, Khalil et Firas.
Mon père ne faisait pas le ménage à proprement parler, bien qu'il coupait nos cheveux et nos ongles, et s'occupait des terres agricoles. Jusqu'à environ 1968 - si ma mémoire est bonne -, il avait embauché un garçon pour garder nos moutons en échange d'un agneau par mois. Plus tard, mon frère Saleh et moi gardions le nombre décroissant de chèvres et de brebis. Ma mère a ressenti un certain soulagement lorsqu'elle a déménagé avec ses enfants plus jeunes dans la ville de Raqqa à compter de l'automne 1976. Peu de temps après, son fils aîné Muhammad est devenu médecin, et la situation financière de la famille a commencé à s'améliorer.
Parmi les traditions du ramadan observées par mon père (le fils aîné d'Abdallah al-Haj Saleh) et mon oncle Mustafa (le fils aîné de Humaidi al-Haj Saleh), il y avait la récitation du Coran entier. Ce n'était pas un exploit que n'importe qui pouvait accomplir. Encouragé par les adultes dont j'avais gagné les éloges grâce à mes performances académiques à l'école, j'ai participé à ce défi lors des ramadans que je jeûnais dans le village. En sixième année, j'ai réussi à terminer le Coran en 19 jours, un exploit dont je me suis assuré de me vanter devant mon oncle Mustafa, qui n'était pas avare en louanges. Avide d'en faire plus, j'ai recommencé le livre depuis le début, visant à le terminer une deuxième fois avant la fin du mois, mais je suis devenu paresseux avant même de finir le deuxième (et le plus long) chapitre, la sourate al-Baqarah, et j'ai abandonné, satisfait d'avoir déjà suffisamment payé ma dette.
Je me souviens à peine des études religieuses à l'école. Peut-être n'y avait-il rien de tel à l'époque. Avec un seul enseignant jusqu'à ma quatrième année, puis deux en cinquième et sixième années, dans seulement deux salles pour toutes les six années, les cours avaient tendance à se mélanger. Je me souviens de cours de lecture, d'arithmétique et de calligraphie, puis de grammaire, de science, d'histoire et de géographie. Ce que je peux encore me rappeler des cours de religion se résumait à mémoriser des chapitres ou des versets du Coran. Je ne me souviens pas où j'ai appris à prier, bien qu'il me semble que c'était avec mon père, et non à l'école. J'ai commencé à prier en sixième année, de ma propre volonté. Mon père n'a fait aucun geste pour nous l'imposer, ni n'ai-je vu aucun de mes trois frères aînés le faire. Je me lavais avec le même seau en cuivre que mon père utilisait, puis je faisais les ablutions rituelles. La plupart di temps, je priais chaque prière à son heure désignée. Mon père essayait de me faciliter les choses, disant qu'il était acceptable de combiner deux prières en une, ce que je faisais parfois. Mais je préférais prier chaque prière à l'heure prévue.
Une fois, probablement pendant l'été 1971, j'ai prié la prière du Maghreb au coucher du soleil sur un pont en bois devant la maison, sur lequel nous dormions pendant les mois chauds. Lorsque j'ai fini de prier, j'ai été submergé par une sérénité extraordinaire, un calme et une paix intérieure que je n'avais jamais ressentis auparavant. Cela ne s'est plus jamais reproduit lors des prières suivantes, mais ces précieux moments sont restés vifs et vivants dans ma mémoire. Rien n'y ressemble, sauf quelques rares moments de tranquillité glanés en lisant des livres en prison.
Mes prières n'étaient pas toujours aussi solennelles, cependant. Plus tard la même année, à l'automne, mes frères Saleh et Mustafa ont essayé de troubler mes moments sacrés en me faisant rire. C'était un an après les massacres de Septembre noir en Jordanie, la radio syrienne consacrait une heure chaque jour à la Palestine, à partir de 18h30, présentée par un homme au prétendu accent palestinien nommé Abu Salim. Une fois, Abu Salim critiquait le roi Hussein de Jordanie pour avoir promis que les guérilleros palestiniens "ne passeraient pas" de Jordanie en Palestine pour mener des opérations contre les occupants israéliens. Apparemment, la prononciation par Abu Salim des mots "ne passeront pas" ("ma yumarroosh") a suffi à me faire exploser de rire. Et Saleh pensait qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour répéter la phrase que lorsque j'étais prosterné en prière, me remplissant de colère et de rire en même temps.
C'était à peu près à la même époque, en sixième année (1970-71), que je suis tombé sur le numéro d'un magazine soviétique en langue arabe - peut-être al-Madar (L'Orbite) ou al-Ittihad al-Sufyiti (L'Union soviétique) - dont j'appréciais les images colorées. En me voyant le tenir, mon enseignant me l'a arraché furieusement de mes mains et l'a déchiré en morceaux, disant: "C'est un magazine communiste!" Contre cette injustice grossière, je ne pouvais rien faire. C'était peut-être à cette époque que le même enseignant m'a donné un livre religieux sur l'islam, avec une couverture olive et, bien sûr, sans images. Cela m'ennuyait à mourir et je ne me souviens plus du tout de son contenu maintenant. Des années plus tard, cet enseignant est devenu un "commissaire de la jeunesse" dans l'une des écoles de Raqqa, ce qui signifie qu'il devait être un baathiste.
L'automne 1971 a marqué la première grande séparation de ma vie, lorsque j'ai quitté ma mère pour vivre à Raqqa avec mes frères Saleh et Mustafa, qui étaient alors en neuvième et sixième années, respectivement. Notre frère aîné Muhammad avait terminé deuxième à Raqqa aux examens du baccalauréat cet été-là, ce qui lui a valu une place à l'Université d'Alep pour étudier la médecine. Son nom a été prononcé à la radio de Damas, et il a reçu une allocation mensuelle de 150 livres syriennes (alors équivalant à 40 dollars) de l'État, ce qui était une bouée de sauvetage pour nos parents. Notre père cherchait lui-même du travail à Raqqa à l'époque qui n'aurait pas payé plus que cette somme.
À Raqqa, j'ai continué à prier pendant un mois ou deux, puis j'ai arrêté. Il n'y avait pas de raison particulière à cela que je puisse me rappeler. Sous l'influence de mes frères Saleh et Mustafa - sans parler de l'aîné Muhammad, qui leur avait enseigné ses manières - j'ai commencé à entrer dans un monde différent, celui de la "culture", des livres, des idées et des arguments: le monde de l'esprit. Parmi les sujets débattus dans ce monde, il y avait l'existence de Dieu. Mon frère Mustafa croyait que tout pouvait s'expliquer par la nature. Je lui demandais: "Qui t'a créé?" Il répondait: "La nature!" Quand je demandais qui avait créé la nature, il répliquait: "Qui a créé Dieu?" Il disant que l'univers provenait de nébuleuses cosmiques, une thèse dont j'ai appris plus tard qu'elle venait d'Emmanuel Kant.
Mes frères et moi avons fréquenté l'école à la fois dans le village et à Raqqa. Mon père a été contraint de vivre avec nous à Raqqa tout en travaillant à temps partiel comme ouvrier, car les revenus de nos terres ne suffisaient plus pour notre famille de dix personnes, à laquelle s'est rajouté mon frère Firas en 1972. Nous entrions dans l'adolescence loin de notre mère, qui est restée avec les enfants plus jeunes dans le village. Nos revenus étaient maigres. La vie était difficile.
Un vendredi à la fin de 1971 ou au début de 1972, mon père m'a emmené prier avec lui à la mosquée al-Fawwaz, près de la chambre que mes deux frères et moi louions avec lui à Raqqa pour 45 livres syriennes (12 dollars) par mois. En entrant dans cette mosquée au milieu de la rue Tell Abyad, j'avais l'impression que tous les yeux de la salle de prière étaient fixés sur moi, me mettant profondément mal à l'aise. Jusqu'alors, je n'avais prié que parmi des amis et des proches dans les mosquées de notre village. Je me suis bien comporté pendant la prière, mais je n'ai pas voulu recommencer. Mon père n'a pas insisté, et je suis resté loin des prières dans les mosquées pendant des années. Mon seul contact avec l'islam était de lire le Coran, bien que pas trop souvent. Ce contact a eu un grand impact sur ma personnalité et mes croyances ultérieures.
Au lycée al-Rasheed à Raqqa, je devenais au fur et à mesure un adolescent confiant et doué académiquement, avec une tendance rebelle prononcée. Mes amis et moi enjambions le mur de l'école pour échapper aux cours de religion ou de "nationalisme socialiste" si nous pensions pouvoir nous en tirer. (Parfois, nous étions attrapés, auquel cas notre punition consistait à ramper à travers la cour de l'école.) Une fois, en cours de religion, le professeur a mentionné le mot "vulve", et un garçon nommé Abd al-Muhsin a levé la main et a demandé : "Que signifie 'vulve', monsieur ?" Le professeur a perdu son sang-froid et a ordonné au garçon de quitter la salle de classe. Il nous a alors demandé le nom du perturbateur. Personne n'a répondu. En défiance de son autorité, et par un sentiment de solidarité de groupe, nous sommes restés silencieux - jusqu'à ce qu'un garçon craque et donne le nom. Ce garçon était religieusement dévoué et peut-être ressentait-il un conflit de loyautés entre celle due à son camarade de classe et la répulsion pieuse pour une telle obscénité. Pour moi, c'était encore un point contre la piété.
En 1977, j'ai commencé à étudier la médecine à l'université d'Alep. C'est là que je suis devenu communiste. À l'époque, cela signifiait une opposition active au régime d'Assad, plutôt que la simple croyance passive en des idées transgressives. En vérité, mon communisme était toujours plus une question d'opposition politique qu'idéologique ou symbolique. Le parti que j'ai rejoint, le SCP-PB, adoptait une position plus radicale contre le régime que le Parti communiste syrien (SCP) mainstream duquel il avait fait défection cinq ans plus tôt. Sa rhétorique adoptait le langage et le vocabulaire de la démocratie, contrairement au langage communiste traditionnel. Pendant ma deuxième année à l'université, j'ai commencé à lire de nouveaux types d'ouvrages : des livres sur Lénine, des tracts soviétiques sur la philosophie marxiste, et un peu de Marx et Engels ("Le Manifeste du parti communiste" et "L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État"). J'ai également lu tous les ouvrages disponibles du militant de gauche syrien Yassin al-Hafez ainsi que d'autres d'Abdallah Laroui et Burhan Ghalioun. Et j'ai appris de mes camarades.
Pendant les trois années que j'ai passées à l'université avant mon arrestation et mon emprisonnement, j'ai vu grandir un côté sévère et austère de la religion que je n'avais jamais connu auparavant. En cours de biologie lors de ma première année, un professeur nommé Adnan Qashlan a dit quelque chose sur l'âme, qu'il attribuait à des fonctions complexes de protéines, si je me souviens bien. Une thèse plutôt réductionniste, sans aucun doute. À cela, un étudiant barbu s'est levé sans demander la permission et a récité le verset coranique : "Ils t'interrogent sur l'Esprit. Dis : L'Esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissance." L'étudiant défiait ouvertement le professeur et sa thèse "matérialiste". Pourtant, le professeur ne l'a pas expulsé de la classe ni n'a montré la moindre colère.
Personnellement, j'ai trouvé le comportement de l'étudiant grossier et étroit d'esprit. Le fait que la nature de l'Esprit soit connue seulement de son Seigneur ne signifiait pas que le reste d'entre nous ne pouvait rien apprendre à son sujet. L'étudiant montrait son pouvoir de faire taire une tentative d'explication scientifique de la réalité - une tentative ouverte à la critique, certes, mais pas depuis une position n'admettant nulle contestation. L'autorité de la religion défiait l'autorité de la science - à l'intérieur même d'une université, qui plus est.
Pendant l'été après ma deuxième année à l'université, nous étions obligés de participer à un camp d'entraînement militaire, où nous devions être formés aux techniques de combat. C'était le mois de Ramadan. Un jour, l'un des stagiaires de Raqqa fumait une cigarette lorsqu'il a été agressivement confronté par un autre, qui se plaignait de son insensibilité envers ceux qui jeûnaient. Alors que leurs voix montaient, l'officier militaire responsable de l'entraînement est venu les réprimander tous les deux, mais surtout le dévot. C'était en août 1979, juste deux mois après le massacre de dizaines de cadets de l'armée à l'École d'artillerie d'Alep par des militants liés aux Frères musulmans. Le régime était sur ses gardes contre les islamistes. Au même camp, un jour, un camarade étudiant à la mine aimable et à la barbe taillée, le seul parmi nous à porter un caftan et un chapeau confectionnés dans le même matériau, s'est approché de moi. Il m'a demandé si je voulais "participer" avec "eux". Participer à quoi ? ai-je demandé. À la récitation de louanges pour le prophète, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'avais apporté plusieurs romans avec moi pour les lire au camp, parmi eux "Najmat Aghustus" ("L'Étoile d'août") de Sonallah Ibrahim.
C'était un signe des temps que la seule femme de Raqqa dans notre classe à l'université a commencé à porter le hijab au début de 1980. À la fin de cette année, je serais arrêté. La prison a marqué la deuxième grande séparation de ma vie, après la séparation avec ma mère et notre maison à al-Jurn en 1971. Cette fois-ci, c'était une séparation du cours normal et attendu de la vie pour un jeune homme dans la vingtaine, ainsi qu'une séparation d'amis et de camarades de classe, et d'opportunités d'amour ou de sexe. (J'avais une petite amie avant la prison, bien que notre relation physique se limitait à la moitié supérieure du corps.) Plus tard, cette séparation a été atténuée dans une certaine mesure lorsque nous avons été autorisés à recevoir des livres et du matériel pour apprendre l'anglais à la prison al-Muslimiya d'Alep, à partir de la deuxième moitié de 1982. Cela a ouvert de nouvelles possibilités d'apprentissage et de renouvellement.
En prison, j'ai également eu des expériences religieuses d'une certaine sorte, que j'ai racontées en détail dans mon livre "Bil-Khalas Ya Shabab! 16 Aman fil-Sujun al-Suriya" ("Salut, les gars ! 16 ans dans les prisons de Syrie"). En 1987, nous nous sommes vu refuser toutes les visites pendant une période d'environ 20 mois. (Cela s'appliquait à ceux d'entre nous qui n'avaient pas de relations ou d'intermédiaires avec le régime, une question loin d'être dénuée de dimensions sociales, politiques et communautaires.) À ce moment-là, deux de mes frères étaient également en prison : Mustafa, qui a été arrêté cinq ans après moi, et Khalid, arrêté six mois après Mustafa. C'était plus qu'une agonie pour notre mère - c'était un assaut contre sa propre vie. De fait, elle est morte d'un cancer peu de temps après, en 1990, alors que nous étions toujours emprisonnés.
Pendant la période où les visites étaient interdites, les visiteurs pouvaient quand même venir à la prison et essayer de négocier pour entrer. Si les gardiens acceptaient de fermer les yeux, ce qui arrivait parfois, il nous était possible de parler à ces visiteurs par les fenêtres de notre aile. De ces fenêtres, nous voyions souvent notre mère, qui n'a jamais cessé d'essayer de rendre visite à ses trois fils en prison, faisant le voyage de 180 kilomètres de Raqqa à Alep sans jamais réussir à nous rencontrer dans des conditions correctes. Elle apportait de l'argent, de la nourriture et des vêtements, qu'elle parvenait parfois à nous donner et parfois pas. Une fois, peu avant le début du Ramadan, elle m'a demandé (et peut-être aussi à mes autres frères) de jeûner. Et j'ai effectivement jeûné, bien que sans observer aucun autre rite religieux. C'était un jeûne dédié à ma mère, un pont nous reliant et une demande de pardon pour toute la douleur que mes frères et moi lui avions causée. J'ai jeûné une fois de plus le premier jour du premier Ramadan après sa mort, mais plus jamais. Son absence, et la libération de mes frères de prison à la fin de 1991, ont allégé mon fardeau à cet égard.
En y repensant aujourd'hui, cette expérience de jeûne semble être un adieu libérateur. Tout comme la prison dans son ensemble a été comme une deuxième enfance pour moi, permettant (je l'espère) une émancipation de la première enfance et de ses mondes, cette brève deuxième phase de religiosité était une réminiscence conclusive de son homologue antérieur. Pourtant, en tournant la page de la religion de manière ordonnée dans ma pensée et ma pratique, je pense avoir évité le piège de son contraire, par lequel je veux dire l'hostilité fervente et hystérique envers la religion. J'ai rencontré des exemples de cette dernière et je la trouve aussi peu attrayante et moins vertueuse que le fanatisme religieux lui-même. Mes expériences de vie antérieures m'ont rendu également réfractaire aux deux.
Je consigne ces souvenirs comme un témoignage personnel, qui peut ou non ressembler à ceux des autres de ma génération, et duquel les générations plus jeunes peuvent tirer les conclusions qu'elles jugent bonnes. Pourtant, ma principale motivation pour les écrire est ma conviction que, pour beaucoup d'entre nous, intellectuels "laïcs" et militants politiques, nos positions vis-à-vis de "l'islam" (et d'autres religions) sont largement influencées par les expériences fondatrices de l'enfance et les souvenirs qui en découlent. La caractéristique distincte de ma génération, et peut-être des plus anciennes dans le monde arabe - je soutiendrais - est un développement brutalement arrêté. À partir des années 1970, les transformations politiques, sociales et économiques qui étaient en cours, souvent au bénéfice de la population générale, ont été interrompues. Cela a éteint la force émancipatrice qui poussait les sociétés arabes vers de nouvelles expériences, idées et organisations. Cela les a également empêchés de dépasser les expériences plus anciennes - ou les a ramenés vers elles après une brève séparation.
Je crois qu'un examen de la production de nos principaux intellectuels depuis les années 1980 rend cela clair. Le défunt écrivain syrien George Tarabishi a décrit la religiosité résurgente de l'époque comme un acte paradoxal d'"apostasie" de la part de ceux qui avaient été laïcs. Pourtant, en dehors des parallèles religieux inconfortables dans le terme - la certitude absolue dans la vérité de la doctrine séculière rejetée par les "apostats" -, cela cache également un déclin au sein du camp laïc lui-même. Les "apostats" aussi bien que de ceux qui "n'ont pas du tout changé" (pour citer le Coran 33:23) se ressemblent en ayant perdu beaucoup de liberté de pensée et de pratique. Les trois décennies environ entre les années 1980 et les récentes soulèvements arabes ont vu une renonciation générale à la liberté, au nom de la "raison" et de la "modernité" tout autant que de la religion.
Les expériences de l'enfance nous lient à nos origines. Leur influence ne peut être surmontée par ceux qui ne sont pas exposés à des horizons plus larges, à des interactions plus profondes et à des mondes nouveaux et différents. Nous avons été privés du langage nécessaire pour donner une expression réflexive à nos héritages de l'enfance et de l'adolescence, en raison de l'environnement restrictif qui prévalait. La libération et l'imagination que nous apercevions autrefois à l'horizon ont disparu dans un présent répétitif tournant sur lui-même. Au lieu de s'approprier nos enfances et de les dépasser, nous méprisons et rejetons ce que nous avons hérité d'elles comme une pensée "arriérée", non scientifique et superstitieuse.
Cela s'applique à beaucoup de gens de ma génération. Nous avons réprimé nos enfances et ne les avons jamais pleinement dépassées, car nous étions interdits de nous libérer et d'atteindre l'indépendance. Ce que nous avons méprisé et réprimé de cette manière a trouvé refuge dans notre inconscient, bien qu'il continue également à s'infiltrer dans notre conscience, colorant nos pensées et nos écrits, de sorte que ce qui se trouve entre les lignes contredit souvent les lignes elles-mêmes. C'est parce que, au lieu de décrire nos expériences, de les mettre en lumière et de les déplacer dans le domaine de la pensée consciente, où elles pourraient devenir des connaissances susceptibles d'être discutées et élaborées, notre compréhension de la connaissance les a emprisonnées dans les profondeurs de l'inconscient. Si elles parvenaient jamais à remonter à la surface - à la conscience -, ce ne pouvait être que entre les lignes. Sur les lignes elles-mêmes, nous étions des adultes matures, tandis qu'entre les lignes, nous sommes restés des enfants incapables de grandir. Lorsqu'une crise sociale, politique, intellectuelle et psychologique majeure éclate, comme cela s'est produit deux fois en Syrie en l'espace de 30 ans (d'abord de 1979 à 1982, puis de 2011 à nos jours), notre connaissance sobre et digne se brise et les enfants en nous sortent tous. Le refoulé remonte à la surface, et l'espace entre les lignes conteste ce que disent les lignes. La prose devient un champ de mines. La parole écrite est une contradiction manifeste, disant une chose et son contraire simultanément. Tout le monde est amené à douter de tout le monde, car parle-t-on avec cette voix ou celle-ci ? Les textes, et leur relation avec les êtres, deviennent des espaces de guerre civile.
Ls gens de ma génération passaient leur adolescence à être arrêtés, torturés et emprisonnés pendant des années. Cela n'était pas une occurrence exceptionnelle se produisant seulement à une petite minorité. Tous les jeunes Syriens étaient emprisonnés d'une manière ou d'une autre. Plusieurs sont devenus otages de leurs multiples prisons : la prison de la "connaissance", intimement liée à une autorité patriarcale, et la prison physique, qui incarnait l'interdiction de l'indépendance. Si et quand cette dernière n'était pas littéralement une des prisons d'Assad, c'était la confinement du groupe communautaire étroit (qui était aussi, en fait, l'une des prisons d'Assad). Le présent était réservé au dirigeant éternel, l'avenir était interdit d'arriver, et le passé seul était notre possession.
Ou, plutôt, il nous possédait. Sans espace où tenir des discussions publiques, nos passés étaient privés du langage collectif qui aurait pu nous aider à les maîtriser et à nous en séparer, et à nous séparer les uns des autres. Face aux éruptions et implosions simultanées de la Syrie, ni les jeunes ni les vieux ne sauveront leur dignité sans examiner l'ancien et l'illuminer d'un jour neuf. Ils peuvent également avoir besoin de produire une écriture qui ne se détruit pas par la tension entre ses lignes et ce qui se trouve entre elles, comme notre génération évasive l'a fait et continue de le faire. L'évitement ne vainc pas le déterminisme sociohistorique lorsque la politique est interdite, mais est plutôt le moyen par lequel notre libération elle-même est vaincue. Pourtant, le déterminisme, à son tour, n'est pas tout-puissant. Il n'est pas prédéterminé que l'enfant soit le père de l'homme (pour citer Wordsworth). Les deux peuvent être séparés, mais cela nécessite de prendre en charge la lutte et la trajectoire. Il s'agit d'insubordination et de confrontation, et non pas quelque chose accompli en amont ou par le simple fait d'adopter telle ou telle position intellectuelle. Nous nous séparons du passé et de l'enfance lorsque nous prenons en charge le cours de nos vies, luttons pour l'indépendance vis-à-vis de notre famille et de nos origines, et faisons l'effort de créer des futurs ouverts.
Quand je suis sorti de prison fin 1996, il m'a semblé que nous avions perdu 20 ans. Dans notre village, que j'ai visité à nouveau pour la première fois en janvier 1997, il y avait de l'électricité et de l'eau potable, sans parler de la télévision. Les maisons étaient certainement plus confortables qu'elles ne l'étaient dans mon enfance. Pourtant, l'instruction était pire et la peur était partout. L'espoir d'un avenir meilleur, qui avait existé jusqu'aux années 1970 et avait poussé beaucoup de la génération de mon père à faire de grands sacrifices pour éduquer leurs enfants et participer au progrès général, qu'ils considéraient comme leur droit, avait grandement diminué. Disparue était également la discussion intellectuelle et politique qui avait façonné les orientations et les perceptions des gens d'eux-mêmes et de leurs rôles. Il n'y avait plus de lutte pour la propriété de la politique, de la pensée et de la vie, tant la peur et la soumission étaient totales. Aux temps de mon père et de mon grand-père, les gens avaient résisté davantage.
En 1997, j'ai vu une femme à Raqqa porter le niqab, ou voile intégral, pour la première fois. C'était la femme de l'un de mes proches, de ma propre génération, qui avait quitté l'école tôt. Je me demande : Le voile du visage est-il d'une manière ou d'une autre lié à l'échec de la démocratisation du statut social, un moyen pour les gens d'élever leur position et d'atteindre un certain degré de souveraineté sur leur destin ? Peut-être. Pourtant, cela implique sans aucun doute une objectification des femmes et une appropriation d'elles par les hommes, de la même manière que la Syrie dans son ensemble a été objectifiée et transformée en propriété de la dynastie Assad, rendant tous les Syriens mineurs, incapables de transcender leur enfance ou d'atteindre leur indépendance.
En 1977, j'ai commencé à étudier la médecine à l'université d'Alep. C'est là que je suis devenu communiste. À l'époque, cela signifiait une opposition active au régime d'Assad, plutôt que la simple croyance passive en des idées transgressives. En vérité, mon communisme était toujours plus une question d'opposition politique qu'idéologique ou symbolique. Le parti que j'ai rejoint, le SCP-PB, adoptait une position plus radicale contre le régime que le Parti communiste syrien (SCP) mainstream duquel il avait fait défection cinq ans plus tôt. Sa rhétorique adoptait le langage et le vocabulaire de la démocratie, contrairement au langage communiste traditionnel. Pendant ma deuxième année à l'université, j'ai commencé à lire de nouveaux types d'ouvrages : des livres sur Lénine, des tracts soviétiques sur la philosophie marxiste, et un peu de Marx et Engels ("Le Manifeste du parti communiste" et "L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État"). J'ai également lu tous les ouvrages disponibles du militant de gauche syrien Yassin al-Hafez ainsi que d'autres d'Abdallah Laroui et Burhan Ghalioun. Et j'ai appris de mes camarades.
Pendant les trois années que j'ai passées à l'université avant mon arrestation et mon emprisonnement, j'ai vu grandir un côté sévère et austère de la religion que je n'avais jamais connu auparavant. En cours de biologie lors de ma première année, un professeur nommé Adnan Qashlan a dit quelque chose sur l'âme, qu'il attribuait à des fonctions complexes de protéines, si je me souviens bien. Une thèse plutôt réductionniste, sans aucun doute. À cela, un étudiant barbu s'est levé sans demander la permission et a récité le verset coranique : "Ils t'interrogent sur l'Esprit. Dis : L'Esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissance." L'étudiant défiait ouvertement le professeur et sa thèse "matérialiste". Pourtant, le professeur ne l'a pas expulsé de la classe ni n'a montré la moindre colère.
Personnellement, j'ai trouvé le comportement de l'étudiant grossier et étroit d'esprit. Le fait que la nature de l'Esprit soit connue seulement de son Seigneur ne signifiait pas que le reste d'entre nous ne pouvait rien apprendre à son sujet. L'étudiant montrait son pouvoir de faire taire une tentative d'explication scientifique de la réalité - une tentative ouverte à la critique, certes, mais pas depuis une position n'admettant nulle contestation. L'autorité de la religion défiait l'autorité de la science - à l'intérieur même d'une université, qui plus est.
Pendant l'été après ma deuxième année à l'université, nous étions obligés de participer à un camp d'entraînement militaire, où nous devions être formés aux techniques de combat. C'était le mois de Ramadan. Un jour, l'un des stagiaires de Raqqa fumait une cigarette lorsqu'il a été agressivement confronté par un autre, qui se plaignait de son insensibilité envers ceux qui jeûnaient. Alors que leurs voix montaient, l'officier militaire responsable de l'entraînement est venu les réprimander tous les deux, mais surtout le dévot. C'était en août 1979, juste deux mois après le massacre de dizaines de cadets de l'armée à l'École d'artillerie d'Alep par des militants liés aux Frères musulmans. Le régime était sur ses gardes contre les islamistes. Au même camp, un jour, un camarade étudiant à la mine aimable et à la barbe taillée, le seul parmi nous à porter un caftan et un chapeau confectionnés dans le même matériau, s'est approché de moi. Il m'a demandé si je voulais "participer" avec "eux". Participer à quoi ? ai-je demandé. À la récitation de louanges pour le prophète, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'avais apporté plusieurs romans avec moi pour les lire au camp, parmi eux "Najmat Aghustus" ("L'Étoile d'août") de Sonallah Ibrahim.
C'était un signe des temps que la seule femme de Raqqa dans notre classe à l'université a commencé à porter le hijab au début de 1980. À la fin de cette année, je serais arrêté. La prison a marqué la deuxième grande séparation de ma vie, après la séparation avec ma mère et notre maison à al-Jurn en 1971. Cette fois-ci, c'était une séparation du cours normal et attendu de la vie pour un jeune homme dans la vingtaine, ainsi qu'une séparation d'amis et de camarades de classe, et d'opportunités d'amour ou de sexe. (J'avais une petite amie avant la prison, bien que notre relation physique se limitait à la moitié supérieure du corps.) Plus tard, cette séparation a été atténuée dans une certaine mesure lorsque nous avons été autorisés à recevoir des livres et du matériel pour apprendre l'anglais à la prison al-Muslimiya d'Alep, à partir de la deuxième moitié de 1982. Cela a ouvert de nouvelles possibilités d'apprentissage et de renouvellement.
En prison, j'ai également eu des expériences religieuses d'une certaine sorte, que j'ai racontées en détail dans mon livre "Bil-Khalas Ya Shabab! 16 Aman fil-Sujun al-Suriya" ("Salut, les gars ! 16 ans dans les prisons de Syrie"). En 1987, nous nous sommes vu refuser toutes les visites pendant une période d'environ 20 mois. (Cela s'appliquait à ceux d'entre nous qui n'avaient pas de relations ou d'intermédiaires avec le régime, une question loin d'être dénuée de dimensions sociales, politiques et communautaires.) À ce moment-là, deux de mes frères étaient également en prison : Mustafa, qui a été arrêté cinq ans après moi, et Khalid, arrêté six mois après Mustafa. C'était plus qu'une agonie pour notre mère - c'était un assaut contre sa propre vie. De fait, elle est morte d'un cancer peu de temps après, en 1990, alors que nous étions toujours emprisonnés.
Pendant la période où les visites étaient interdites, les visiteurs pouvaient quand même venir à la prison et essayer de négocier pour entrer. Si les gardiens acceptaient de fermer les yeux, ce qui arrivait parfois, il nous était possible de parler à ces visiteurs par les fenêtres de notre aile. De ces fenêtres, nous voyions souvent notre mère, qui n'a jamais cessé d'essayer de rendre visite à ses trois fils en prison, faisant le voyage de 180 kilomètres de Raqqa à Alep sans jamais réussir à nous rencontrer dans des conditions correctes. Elle apportait de l'argent, de la nourriture et des vêtements, qu'elle parvenait parfois à nous donner et parfois pas. Une fois, peu avant le début du Ramadan, elle m'a demandé (et peut-être aussi à mes autres frères) de jeûner. Et j'ai effectivement jeûné, bien que sans observer aucun autre rite religieux. C'était un jeûne dédié à ma mère, un pont nous reliant et une demande de pardon pour toute la douleur que mes frères et moi lui avions causée. J'ai jeûné une fois de plus le premier jour du premier Ramadan après sa mort, mais plus jamais. Son absence, et la libération de mes frères de prison à la fin de 1991, ont allégé mon fardeau à cet égard.
En y repensant aujourd'hui, cette expérience de jeûne semble être un adieu libérateur. Tout comme la prison dans son ensemble a été comme une deuxième enfance pour moi, permettant (je l'espère) une émancipation de la première enfance et de ses mondes, cette brève deuxième phase de religiosité était une réminiscence conclusive de son homologue antérieur. Pourtant, en tournant la page de la religion de manière ordonnée dans ma pensée et ma pratique, je pense avoir évité le piège de son contraire, par lequel je veux dire l'hostilité fervente et hystérique envers la religion. J'ai rencontré des exemples de cette dernière et je la trouve aussi peu attrayante et moins vertueuse que le fanatisme religieux lui-même. Mes expériences de vie antérieures m'ont rendu également réfractaire aux deux.
Je consigne ces souvenirs comme un témoignage personnel, qui peut ou non ressembler à ceux des autres de ma génération, et duquel les générations plus jeunes peuvent tirer les conclusions qu'elles jugent bonnes. Pourtant, ma principale motivation pour les écrire est ma conviction que, pour beaucoup d'entre nous, intellectuels "laïcs" et militants politiques, nos positions vis-à-vis de "l'islam" (et d'autres religions) sont largement influencées par les expériences fondatrices de l'enfance et les souvenirs qui en découlent. La caractéristique distincte de ma génération, et peut-être des plus anciennes dans le monde arabe - je soutiendrais - est un développement brutalement arrêté. À partir des années 1970, les transformations politiques, sociales et économiques qui étaient en cours, souvent au bénéfice de la population générale, ont été interrompues. Cela a éteint la force émancipatrice qui poussait les sociétés arabes vers de nouvelles expériences, idées et organisations. Cela les a également empêchés de dépasser les expériences plus anciennes - ou les a ramenés vers elles après une brève séparation.
Je crois qu'un examen de la production de nos principaux intellectuels depuis les années 1980 rend cela clair. Le défunt écrivain syrien George Tarabishi a décrit la religiosité résurgente de l'époque comme un acte paradoxal d'"apostasie" de la part de ceux qui avaient été laïcs. Pourtant, en dehors des parallèles religieux inconfortables dans le terme - la certitude absolue dans la vérité de la doctrine séculière rejetée par les "apostats" -, cela cache également un déclin au sein du camp laïc lui-même. Les "apostats" aussi bien que de ceux qui "n'ont pas du tout changé" (pour citer le Coran 33:23) se ressemblent en ayant perdu beaucoup de liberté de pensée et de pratique. Les trois décennies environ entre les années 1980 et les récentes soulèvements arabes ont vu une renonciation générale à la liberté, au nom de la "raison" et de la "modernité" tout autant que de la religion.
Les expériences de l'enfance nous lient à nos origines. Leur influence ne peut être surmontée par ceux qui ne sont pas exposés à des horizons plus larges, à des interactions plus profondes et à des mondes nouveaux et différents. Nous avons été privés du langage nécessaire pour donner une expression réflexive à nos héritages de l'enfance et de l'adolescence, en raison de l'environnement restrictif qui prévalait. La libération et l'imagination que nous apercevions autrefois à l'horizon ont disparu dans un présent répétitif tournant sur lui-même. Au lieu de s'approprier nos enfances et de les dépasser, nous méprisons et rejetons ce que nous avons hérité d'elles comme une pensée "arriérée", non scientifique et superstitieuse.
Cela s'applique à beaucoup de gens de ma génération. Nous avons réprimé nos enfances et ne les avons jamais pleinement dépassées, car nous étions interdits de nous libérer et d'atteindre l'indépendance. Ce que nous avons méprisé et réprimé de cette manière a trouvé refuge dans notre inconscient, bien qu'il continue également à s'infiltrer dans notre conscience, colorant nos pensées et nos écrits, de sorte que ce qui se trouve entre les lignes contredit souvent les lignes elles-mêmes. C'est parce que, au lieu de décrire nos expériences, de les mettre en lumière et de les déplacer dans le domaine de la pensée consciente, où elles pourraient devenir des connaissances susceptibles d'être discutées et élaborées, notre compréhension de la connaissance les a emprisonnées dans les profondeurs de l'inconscient. Si elles parvenaient jamais à remonter à la surface - à la conscience -, ce ne pouvait être que entre les lignes. Sur les lignes elles-mêmes, nous étions des adultes matures, tandis qu'entre les lignes, nous sommes restés des enfants incapables de grandir. Lorsqu'une crise sociale, politique, intellectuelle et psychologique majeure éclate, comme cela s'est produit deux fois en Syrie en l'espace de 30 ans (d'abord de 1979 à 1982, puis de 2011 à nos jours), notre connaissance sobre et digne se brise et les enfants en nous sortent tous. Le refoulé remonte à la surface, et l'espace entre les lignes conteste ce que disent les lignes. La prose devient un champ de mines. La parole écrite est une contradiction manifeste, disant une chose et son contraire simultanément. Tout le monde est amené à douter de tout le monde, car parle-t-on avec cette voix ou celle-ci ? Les textes, et leur relation avec les êtres, deviennent des espaces de guerre civile.
Ls gens de ma génération passaient leur adolescence à être arrêtés, torturés et emprisonnés pendant des années. Cela n'était pas une occurrence exceptionnelle se produisant seulement à une petite minorité. Tous les jeunes Syriens étaient emprisonnés d'une manière ou d'une autre. Plusieurs sont devenus otages de leurs multiples prisons : la prison de la "connaissance", intimement liée à une autorité patriarcale, et la prison physique, qui incarnait l'interdiction de l'indépendance. Si et quand cette dernière n'était pas littéralement une des prisons d'Assad, c'était la confinement du groupe communautaire étroit (qui était aussi, en fait, l'une des prisons d'Assad). Le présent était réservé au dirigeant éternel, l'avenir était interdit d'arriver, et le passé seul était notre possession.
Ou, plutôt, il nous possédait. Sans espace où tenir des discussions publiques, nos passés étaient privés du langage collectif qui aurait pu nous aider à les maîtriser et à nous en séparer, et à nous séparer les uns des autres. Face aux éruptions et implosions simultanées de la Syrie, ni les jeunes ni les vieux ne sauveront leur dignité sans examiner l'ancien et l'illuminer d'un jour neuf. Ils peuvent également avoir besoin de produire une écriture qui ne se détruit pas par la tension entre ses lignes et ce qui se trouve entre elles, comme notre génération évasive l'a fait et continue de le faire. L'évitement ne vainc pas le déterminisme sociohistorique lorsque la politique est interdite, mais est plutôt le moyen par lequel notre libération elle-même est vaincue. Pourtant, le déterminisme, à son tour, n'est pas tout-puissant. Il n'est pas prédéterminé que l'enfant soit le père de l'homme (pour citer Wordsworth). Les deux peuvent être séparés, mais cela nécessite de prendre en charge la lutte et la trajectoire. Il s'agit d'insubordination et de confrontation, et non pas quelque chose accompli en amont ou par le simple fait d'adopter telle ou telle position intellectuelle. Nous nous séparons du passé et de l'enfance lorsque nous prenons en charge le cours de nos vies, luttons pour l'indépendance vis-à-vis de notre famille et de nos origines, et faisons l'effort de créer des futurs ouverts.
Quand je suis sorti de prison fin 1996, il m'a semblé que nous avions perdu 20 ans. Dans notre village, que j'ai visité à nouveau pour la première fois en janvier 1997, il y avait de l'électricité et de l'eau potable, sans parler de la télévision. Les maisons étaient certainement plus confortables qu'elles ne l'étaient dans mon enfance. Pourtant, l'instruction était pire et la peur était partout. L'espoir d'un avenir meilleur, qui avait existé jusqu'aux années 1970 et avait poussé beaucoup de la génération de mon père à faire de grands sacrifices pour éduquer leurs enfants et participer au progrès général, qu'ils considéraient comme leur droit, avait grandement diminué. Disparue était également la discussion intellectuelle et politique qui avait façonné les orientations et les perceptions des gens d'eux-mêmes et de leurs rôles. Il n'y avait plus de lutte pour la propriété de la politique, de la pensée et de la vie, tant la peur et la soumission étaient totales. Aux temps de mon père et de mon grand-père, les gens avaient résisté davantage.
En 1997, j'ai vu une femme à Raqqa porter le niqab, ou voile intégral, pour la première fois. C'était la femme de l'un de mes proches, de ma propre génération, qui avait quitté l'école tôt. Je me demande : Le voile du visage est-il d'une manière ou d'une autre lié à l'échec de la démocratisation du statut social, un moyen pour les gens d'élever leur position et d'atteindre un certain degré de souveraineté sur leur destin ? Peut-être. Pourtant, cela implique sans aucun doute une objectification des femmes et une appropriation d'elles par les hommes, de la même manière que la Syrie dans son ensemble a été objectifiée et transformée en propriété de la dynastie Assad, rendant tous les Syriens mineurs, incapables de transcender leur enfance ou d'atteindre leur indépendance.

