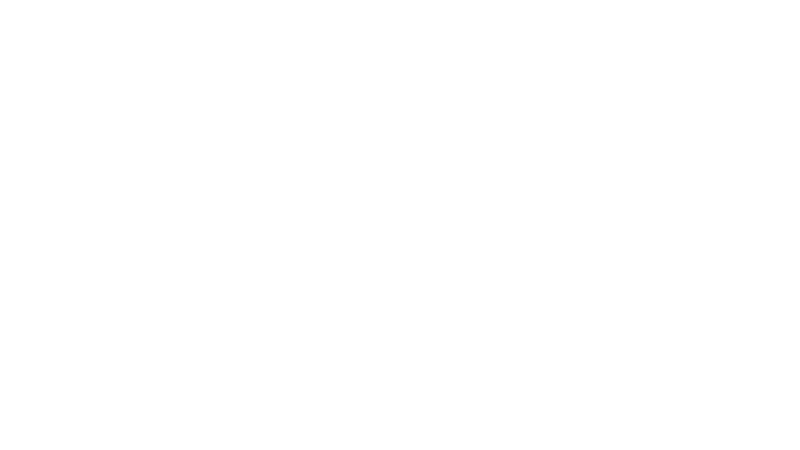
La révolution et le djihad
Olivier Roy
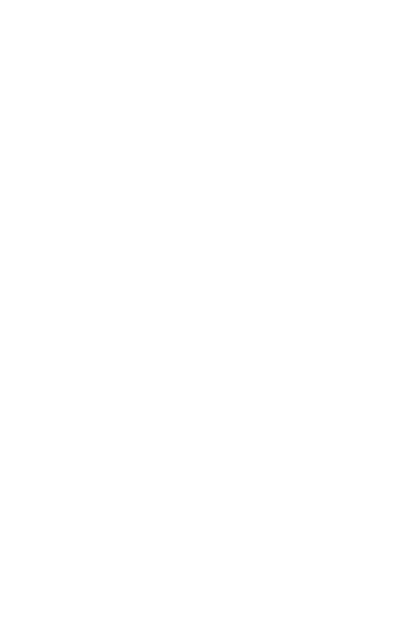
Conditions se flatte de participer à la promotion du livre de rare importance de Montassir Sakhi. La révolution et le djihad (La Découverte, 2023) n'est pas seulement l'un des meilleurs ouvrages traitant de la révolution syrienne et de ses développements successifs. Il est également un modèle de sociologie relationniste, capable de mettre en lien avec une grande finesse la trame historique des révolutions arabes et la situation en Europe de l'immigration postcoloniale et ouvrière. Aussi les quelques bonnes feuilles qui suivent doivent-elles inciter à prendre connaissance de l'ensemble du livre, dont le propos fait oeuvre de salubrité publique en ces temps de crise politique et morale généralisée. Après avoir publié un extrait du corps du texte, Conditions diffuse la préface d'Olivier Roy à l'ouvrage.
Radicalisation religieuse, djihad et terrorisme sont usuellement présentés comme formant une suite logique. Mais on ne devrait pas en conclure automatiquement que tout radicalisé est un djihadiste en puissance et tout djihadiste un terroriste virtuel. Il y a en effet bien plus de radicalisés religieux (quel que soit ce qu’on met sous cette étiquette) que de djihadistes, et bien plus de djihadistes (en l’occurrence ceux qui sont partis combattre en Syrie) que de terroristes (en mettant sous ce label ceux qui ont perpétrés les attentats du Bataclan, de l’HyperCacher et de Charlie Hebdo). En gros, on passe de dizaines de milliers de « salafistes » à quelques milliers de djihadistes, pour arriver à quelques dizaines de terroristes. Cette disproportion devrait alerter sur la pertinence de la continuité supposée.
Pourtant, la vision dominante des politiques, des médias et de nombre d’experts est celle d’une pyramide où le sommet serait le petit triangle des terroristes, porté par le parallélogramme djihadiste soutenu par la base salafiste. On peut aussi convoquer la métaphore de l’entonnoir : tout le monde entre dans l’entonnoir même si seuls les terroristes en sortent in fine. C’est donc logiquement la seule question du terrorisme qui définit rétrospectivement la politique de l’État par rapport à toutes les manifestations de religiosité ou de militance que l’on peut rencontrer dans une jeunesse musulmane (y compris les convertis, hommes ou femmes). On comprend bien sûr que la priorité de l’État soit, au moins sur le court terme, la question sécuritaire. Mais pour que l’approche sécuritaire soit efficace (et ne relève pas de l’incantation), il faudrait justement isoler les paramètres qui caractériseraient ceux qui entrent vraiment dans le terrorisme. Au lieu de cela, on entérine une confusion qui non seulement contraint l’appareil sécuritaire à une dispersion chronophage, mais laisse dans les limbes (et souvent la prison) une catégorie de jeunes revenus du djihad et qui auraient justement beaucoup à dire sur leurs motivations et sur l’échec de la grande illusion qui les a lancés sur le « chemin d’Allah ».
On connaît les problèmes posés par cette hiérarchisation des catégories : la difficulté de définir une politique précise de contreterrorisme parce qu’on a trop dilué la notion de « radicalisation », la mauvaise gestion des « signes religieux visibles » où l’on finit par appliquer des techniques de contrôle sécuritaire à des populations qui sont seulement porteuses d’une demande de religieux, la très mauvaise gestion des « returnees », qui n’ont que la case prison comme horizon et, en fin de compte, l’impossibilité de traiter politiquement un phénomène social complexe. Ce qui entraîne, d’une part, des crispations sociales et, d’autre part, manque la vraie cible : celui ou celle qui compte vraiment passer à l’acte terroriste. Car, pour démotiver les candidats au djihad, le constat d’échec est plus pertinent que la prison, et l’autocritique plus efficace que des cours de catéchisme laïque.
Montassir Sakhi déploie dans ce livre une approche différente et autrement plus heuristique : il cherche à situer le djihadisme en Syrie dans ses dimensions spatiales et temporelles propres, sans commencer par chausser les lunettes de l’antiterrorisme. Il montre en particulier que la Syrie n’est pas, pour les musulmans francophones qu’il étudie et fait parler, un djihad parmi d’autres dans la continuité du djihad global qui s’instaure avec Al-Qaida et s’achève avec Daech. Il y a certes un djihad global (avec sa généalogie propre de l’Afghanistan à la Syrie en passant par la Bosnie) et un terrorisme global (de Beghal à Abdeslam en passant par les frères Kouachi), mais le champ syrien relève de sa logique propre, à la fois spatiale et temporelle.
La Syrie a en effet attiré un nombre considérable de volontaires francophones que l’on ne retrouve ni dans le djihadisme global, car ils ne vont qu’en Syrie, ni dans le terrorisme déterritorialisé. Qui sont donc ces djihadistes spécifiques qui n’ont été étudiés que sous l’angle d’une radicalisation terroriste, laquelle n’a concerné qu’une poignée d’entre eux ? Et pourquoi est-il important de les étudier dans leur spécificité ?
Montassir Sakhi commence par essayer de comprendre ce qui fonctionne sous le nom de djihad en Syrie. Il repense donc la notion de djihad selon deux paramètres originaux : la spatialité et la temporalité. Le fil directeur est celui du sens et des intentions multiples que les volontaires mettent dans ce mot de djihad. C’est une approche qui évite délibérément le théologique et l’idéologique pour s’en tenir au sens que les djihadistes donnent à leur combat. D’autant que, comme le montre Sakhi, ce ne sont ni les études religieuses ni la lecture des textes théoriques mis sur le marché par Al-Qaida ou Daech (le premier en produisant d’ailleurs fort peu) qui les ont motivés : c’est la lecture empathique de la révolte du peuple syrien contre le régime de Bachar al-Assad en 2011. S’il ne fait aucun doute qu’il y ait une continuité dans les réseaux terroristes (de Beghal aux Kouachi et aux tueurs du Bataclan) et qu’une partie de ceux-ci sont allés en Syrie et ont fait allégeance à Daech à partir de 2014, le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 a suscité en Europe une levée de volontaires qui ne s’inscrivent pas dans la tradition du djihad global antérieur (de l’Afghanistan à l’Irak en passant par la Bosnie, le Yémen et la Tchétchénie) et qui sont passés au djihad dans le seul contexte syrien. En effet, on ne constate dans la zone francophone aucune mobilisation massive pour d’autres « djihads », en particulier contre les opérations de guerre de la France au Mali à partir de 2013, pourtant explicitement définies par le gouvernement français comme une lutte contre les terroristes djihadistes, et qui auraient pu mobiliser particulièrement des apprentis djihadistes français. Or ce n’est pas le cas : tous partent en Syrie et cela bien avant (2011) la participation française aux opérations armées contre Daech (2014), aucun ne part au Mali.
Que pensent les jeunes qui partent faire le djihad en Syrie avant 2014 ? Ils partent d’abord, montre Sakhi, pour se battre aux côtés du peuple syrien contre le régime de Bachar al-Assad, qui est l’ennemi par excellence. Ce qui les motive c’est la solidarité et non l’utopie étatique islamiste, la dignité et l’honneur et non l’idéologie ou le parti : en Syrie tout le monde est religieux et tout le monde est laïc, car le combat ne porte pas sur la place de la charia mais sur le renversement d’un régime mortifère. Le passage à la lutte armée en Syrie est une conséquence de la radicalisation du régime, pas de celle de la résistance : il n’y avait plus le choix. Une autre conceptualisation de la violence émergera évidemment avec Daech, qui reprendra une généalogie de la violence comme purification et non résistance. Mais il ne faut jamais perdre de vue cette dimension temporelle : le djihad entre 2011 et 2014 n’est pas « daechien » et il ne le deviendra que pour une minorité des volontaires. Les autres paieront pourtant le prix de l’amalgame, d’autant plus qu’ils auront du mal à s’expliquer tant les mots et les affects ont changé sans qu’eux-mêmes n’aient eu l’impression d’avoir changé.
Ces volontaires rejoignent un espace où tout est djihad : c’est la lutte du bien contre le mal, ce n’est pas un concept juridique ni une notion idéologique. Ils se vivent donc comme de modestes héros, désireux de bien faire. Mais dès leur arrivée, ils se sont trouvés assez rapidement en porte à faux avec l’imagerie qu’ils avaient en tête : les dissensions entre groupes combattants restant obscures à leurs yeux, l’allégeance à l’un ou l’autre est au début simplement une question de hasard, on choisit d’abord le groupe qui vous reçoit sans trop se poser de questions. Il n’y a pas de front clair et net entre djihadistes et baasistes, mais un entrelacs de réseaux d’allégeances fluides et complexes dont la sociologie et la signification échappent complètement aux volontaires francophones.
Mais la montée en puissance de Daech en Syrie change tout : Daech exige de faire un choix et le système exacerbé de violence établi par l’organisation met à mal l’idéalisme des arrivants. Surtout l’intervention occidentale de l’été 2014 inverse d’un seul coup le sens de leur engagement : jusqu’en 2014, ils sont contre Bachar avec le reste du monde, dont la France de François Hollande qui pousse à intervenir contre Damas. Mais à partir de l’intervention occidentale contre Daech en été 2014, ils basculent dans le mauvais camp et passent de la juste lutte du peuple syrien contre la dictature à la complicité avec le djihad global. À ce moment-là, plusieurs djihadistes embrassent sans problème la cause du califat et reformulent leur djihad en termes de lutte contre l’Occident. Les nouveaux volontaires savent ce qu’ils font. Mais ceux qui étaient partis avant l’été 2014, surtout ceux qui sont revenus en Europe avant cette date, voient leur engagement changer rétroactivement de sens. Le retour prend donc une autre dimension. Ils sont suspects, d’autant plus qu’ils ne remettent pas en cause les motivations de leur départ : participer au djihad contre un tyran, soutenir la oumma et trouver une nouvelle dignité de musulman dans leur sacrifice (mais pas dans le suicide).
On ne peut donc analyser la notion de djihad qu’en respectant cette dimension chronologique : le mot est connoté différemment au début du soulèvement et au moment de l’acmé de Daech. Or à ce moment bien des volontaires sont déjà revenus ou bien ont rejoint d’autres organisations, comme Nosra devenu Fatah al-Cham en juillet 2016, après sa rupture avec Al-Qaida, puis Hay'at Tahrir al-Cham en 2017, qui ne rentrent pas dans une logique de djihadisme global et encore moins de terrorisme, tout en défendant la lutte armée.
À cette approche temporelle, s’ajoute dans ce livre une approche originale de la dimension spatiale de la société syrienne. En effet, si la Syrie est un mythe pour les volontaires, sur le terrain il s’agit tout d’abord d’une société civile complexe, avec son anthropologie politique spécifique. Cette société préexistait évidemment à la guerre et la guerre ne la détruit pas. Elle s’y adapte, elle s’organise dans et pour la guerre, mais sans se militariser de manière radicale. Elle se reconstruit en réseaux, enclaves, bouts de territoires, juxtaposition de pouvoirs et de légitimités différentes, anciens notables, nouveaux commandants militaires, familles à la fois rurales et urbaines. La révolte est massive et n’est pas idéologique, la société civile se restructure elle-même en dehors de tout modèle étatique, alors que tant de mouvements de libération nationale du passé dans d’autres régions se sont hâtés de construire un contre-État. C’est ce qui fait la force et la faiblesse de la résistance à Bachar.
L’irruption de Daech va casser cette originalité de la révolte en Syrie. Daech amène deux notions de rupture : la volonté de créer un État hégémonique et la valorisation de la violence. L’espace n’est plus un jeu complexe de réseaux et de groupes qui se superposent sur un même territoire : il faut choisir et pour Daech, tous ceux qui ne se rallient pas à lui sont des traitres. C’est Daech qui décide de la bonne motivation, qui impose le récit du djihad. La violence n’est plus un simple moyen de guerre, elle est l’essence même de la volonté de purification à la fois de soi-même et de la société. La mort n’est plus un risque assumé, elle devient une valeur en soi : les volontaires doivent cocher sur le questionnaire de recrutement le type de mort qu’ils choisissent, du simple martyre à l’attaque suicide.
Le moment Daech a donc détruit un certain discours du djihad comme devoir humanitaire et « service » envers la communauté (voir le livre provocateur de l’historien Faisal Devji, The Terrorist in Search of Humanity, 2019), discours que l’on peut bien sûr écouter avec un certain scepticisme rétrospectif, mais qui était bien celui de milliers de volontaires. Désormais ces volontaires, comme tous ceux qui se sont trompés de combat, ne savent plus comment redonner sens à leur propre passé. Alors il faut un regard extérieur, comme celui de Montassir Sakhi, pour évoquer cette possibilité de faire sens.
Radicalisation religieuse, djihad et terrorisme sont usuellement présentés comme formant une suite logique. Mais on ne devrait pas en conclure automatiquement que tout radicalisé est un djihadiste en puissance et tout djihadiste un terroriste virtuel. Il y a en effet bien plus de radicalisés religieux (quel que soit ce qu’on met sous cette étiquette) que de djihadistes, et bien plus de djihadistes (en l’occurrence ceux qui sont partis combattre en Syrie) que de terroristes (en mettant sous ce label ceux qui ont perpétrés les attentats du Bataclan, de l’HyperCacher et de Charlie Hebdo). En gros, on passe de dizaines de milliers de « salafistes » à quelques milliers de djihadistes, pour arriver à quelques dizaines de terroristes. Cette disproportion devrait alerter sur la pertinence de la continuité supposée.
Pourtant, la vision dominante des politiques, des médias et de nombre d’experts est celle d’une pyramide où le sommet serait le petit triangle des terroristes, porté par le parallélogramme djihadiste soutenu par la base salafiste. On peut aussi convoquer la métaphore de l’entonnoir : tout le monde entre dans l’entonnoir même si seuls les terroristes en sortent in fine. C’est donc logiquement la seule question du terrorisme qui définit rétrospectivement la politique de l’État par rapport à toutes les manifestations de religiosité ou de militance que l’on peut rencontrer dans une jeunesse musulmane (y compris les convertis, hommes ou femmes). On comprend bien sûr que la priorité de l’État soit, au moins sur le court terme, la question sécuritaire. Mais pour que l’approche sécuritaire soit efficace (et ne relève pas de l’incantation), il faudrait justement isoler les paramètres qui caractériseraient ceux qui entrent vraiment dans le terrorisme. Au lieu de cela, on entérine une confusion qui non seulement contraint l’appareil sécuritaire à une dispersion chronophage, mais laisse dans les limbes (et souvent la prison) une catégorie de jeunes revenus du djihad et qui auraient justement beaucoup à dire sur leurs motivations et sur l’échec de la grande illusion qui les a lancés sur le « chemin d’Allah ».
On connaît les problèmes posés par cette hiérarchisation des catégories : la difficulté de définir une politique précise de contreterrorisme parce qu’on a trop dilué la notion de « radicalisation », la mauvaise gestion des « signes religieux visibles » où l’on finit par appliquer des techniques de contrôle sécuritaire à des populations qui sont seulement porteuses d’une demande de religieux, la très mauvaise gestion des « returnees », qui n’ont que la case prison comme horizon et, en fin de compte, l’impossibilité de traiter politiquement un phénomène social complexe. Ce qui entraîne, d’une part, des crispations sociales et, d’autre part, manque la vraie cible : celui ou celle qui compte vraiment passer à l’acte terroriste. Car, pour démotiver les candidats au djihad, le constat d’échec est plus pertinent que la prison, et l’autocritique plus efficace que des cours de catéchisme laïque.
Montassir Sakhi déploie dans ce livre une approche différente et autrement plus heuristique : il cherche à situer le djihadisme en Syrie dans ses dimensions spatiales et temporelles propres, sans commencer par chausser les lunettes de l’antiterrorisme. Il montre en particulier que la Syrie n’est pas, pour les musulmans francophones qu’il étudie et fait parler, un djihad parmi d’autres dans la continuité du djihad global qui s’instaure avec Al-Qaida et s’achève avec Daech. Il y a certes un djihad global (avec sa généalogie propre de l’Afghanistan à la Syrie en passant par la Bosnie) et un terrorisme global (de Beghal à Abdeslam en passant par les frères Kouachi), mais le champ syrien relève de sa logique propre, à la fois spatiale et temporelle.
La Syrie a en effet attiré un nombre considérable de volontaires francophones que l’on ne retrouve ni dans le djihadisme global, car ils ne vont qu’en Syrie, ni dans le terrorisme déterritorialisé. Qui sont donc ces djihadistes spécifiques qui n’ont été étudiés que sous l’angle d’une radicalisation terroriste, laquelle n’a concerné qu’une poignée d’entre eux ? Et pourquoi est-il important de les étudier dans leur spécificité ?
Montassir Sakhi commence par essayer de comprendre ce qui fonctionne sous le nom de djihad en Syrie. Il repense donc la notion de djihad selon deux paramètres originaux : la spatialité et la temporalité. Le fil directeur est celui du sens et des intentions multiples que les volontaires mettent dans ce mot de djihad. C’est une approche qui évite délibérément le théologique et l’idéologique pour s’en tenir au sens que les djihadistes donnent à leur combat. D’autant que, comme le montre Sakhi, ce ne sont ni les études religieuses ni la lecture des textes théoriques mis sur le marché par Al-Qaida ou Daech (le premier en produisant d’ailleurs fort peu) qui les ont motivés : c’est la lecture empathique de la révolte du peuple syrien contre le régime de Bachar al-Assad en 2011. S’il ne fait aucun doute qu’il y ait une continuité dans les réseaux terroristes (de Beghal aux Kouachi et aux tueurs du Bataclan) et qu’une partie de ceux-ci sont allés en Syrie et ont fait allégeance à Daech à partir de 2014, le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 a suscité en Europe une levée de volontaires qui ne s’inscrivent pas dans la tradition du djihad global antérieur (de l’Afghanistan à l’Irak en passant par la Bosnie, le Yémen et la Tchétchénie) et qui sont passés au djihad dans le seul contexte syrien. En effet, on ne constate dans la zone francophone aucune mobilisation massive pour d’autres « djihads », en particulier contre les opérations de guerre de la France au Mali à partir de 2013, pourtant explicitement définies par le gouvernement français comme une lutte contre les terroristes djihadistes, et qui auraient pu mobiliser particulièrement des apprentis djihadistes français. Or ce n’est pas le cas : tous partent en Syrie et cela bien avant (2011) la participation française aux opérations armées contre Daech (2014), aucun ne part au Mali.
Que pensent les jeunes qui partent faire le djihad en Syrie avant 2014 ? Ils partent d’abord, montre Sakhi, pour se battre aux côtés du peuple syrien contre le régime de Bachar al-Assad, qui est l’ennemi par excellence. Ce qui les motive c’est la solidarité et non l’utopie étatique islamiste, la dignité et l’honneur et non l’idéologie ou le parti : en Syrie tout le monde est religieux et tout le monde est laïc, car le combat ne porte pas sur la place de la charia mais sur le renversement d’un régime mortifère. Le passage à la lutte armée en Syrie est une conséquence de la radicalisation du régime, pas de celle de la résistance : il n’y avait plus le choix. Une autre conceptualisation de la violence émergera évidemment avec Daech, qui reprendra une généalogie de la violence comme purification et non résistance. Mais il ne faut jamais perdre de vue cette dimension temporelle : le djihad entre 2011 et 2014 n’est pas « daechien » et il ne le deviendra que pour une minorité des volontaires. Les autres paieront pourtant le prix de l’amalgame, d’autant plus qu’ils auront du mal à s’expliquer tant les mots et les affects ont changé sans qu’eux-mêmes n’aient eu l’impression d’avoir changé.
Ces volontaires rejoignent un espace où tout est djihad : c’est la lutte du bien contre le mal, ce n’est pas un concept juridique ni une notion idéologique. Ils se vivent donc comme de modestes héros, désireux de bien faire. Mais dès leur arrivée, ils se sont trouvés assez rapidement en porte à faux avec l’imagerie qu’ils avaient en tête : les dissensions entre groupes combattants restant obscures à leurs yeux, l’allégeance à l’un ou l’autre est au début simplement une question de hasard, on choisit d’abord le groupe qui vous reçoit sans trop se poser de questions. Il n’y a pas de front clair et net entre djihadistes et baasistes, mais un entrelacs de réseaux d’allégeances fluides et complexes dont la sociologie et la signification échappent complètement aux volontaires francophones.
Mais la montée en puissance de Daech en Syrie change tout : Daech exige de faire un choix et le système exacerbé de violence établi par l’organisation met à mal l’idéalisme des arrivants. Surtout l’intervention occidentale de l’été 2014 inverse d’un seul coup le sens de leur engagement : jusqu’en 2014, ils sont contre Bachar avec le reste du monde, dont la France de François Hollande qui pousse à intervenir contre Damas. Mais à partir de l’intervention occidentale contre Daech en été 2014, ils basculent dans le mauvais camp et passent de la juste lutte du peuple syrien contre la dictature à la complicité avec le djihad global. À ce moment-là, plusieurs djihadistes embrassent sans problème la cause du califat et reformulent leur djihad en termes de lutte contre l’Occident. Les nouveaux volontaires savent ce qu’ils font. Mais ceux qui étaient partis avant l’été 2014, surtout ceux qui sont revenus en Europe avant cette date, voient leur engagement changer rétroactivement de sens. Le retour prend donc une autre dimension. Ils sont suspects, d’autant plus qu’ils ne remettent pas en cause les motivations de leur départ : participer au djihad contre un tyran, soutenir la oumma et trouver une nouvelle dignité de musulman dans leur sacrifice (mais pas dans le suicide).
On ne peut donc analyser la notion de djihad qu’en respectant cette dimension chronologique : le mot est connoté différemment au début du soulèvement et au moment de l’acmé de Daech. Or à ce moment bien des volontaires sont déjà revenus ou bien ont rejoint d’autres organisations, comme Nosra devenu Fatah al-Cham en juillet 2016, après sa rupture avec Al-Qaida, puis Hay'at Tahrir al-Cham en 2017, qui ne rentrent pas dans une logique de djihadisme global et encore moins de terrorisme, tout en défendant la lutte armée.
À cette approche temporelle, s’ajoute dans ce livre une approche originale de la dimension spatiale de la société syrienne. En effet, si la Syrie est un mythe pour les volontaires, sur le terrain il s’agit tout d’abord d’une société civile complexe, avec son anthropologie politique spécifique. Cette société préexistait évidemment à la guerre et la guerre ne la détruit pas. Elle s’y adapte, elle s’organise dans et pour la guerre, mais sans se militariser de manière radicale. Elle se reconstruit en réseaux, enclaves, bouts de territoires, juxtaposition de pouvoirs et de légitimités différentes, anciens notables, nouveaux commandants militaires, familles à la fois rurales et urbaines. La révolte est massive et n’est pas idéologique, la société civile se restructure elle-même en dehors de tout modèle étatique, alors que tant de mouvements de libération nationale du passé dans d’autres régions se sont hâtés de construire un contre-État. C’est ce qui fait la force et la faiblesse de la résistance à Bachar.
L’irruption de Daech va casser cette originalité de la révolte en Syrie. Daech amène deux notions de rupture : la volonté de créer un État hégémonique et la valorisation de la violence. L’espace n’est plus un jeu complexe de réseaux et de groupes qui se superposent sur un même territoire : il faut choisir et pour Daech, tous ceux qui ne se rallient pas à lui sont des traitres. C’est Daech qui décide de la bonne motivation, qui impose le récit du djihad. La violence n’est plus un simple moyen de guerre, elle est l’essence même de la volonté de purification à la fois de soi-même et de la société. La mort n’est plus un risque assumé, elle devient une valeur en soi : les volontaires doivent cocher sur le questionnaire de recrutement le type de mort qu’ils choisissent, du simple martyre à l’attaque suicide.
Le moment Daech a donc détruit un certain discours du djihad comme devoir humanitaire et « service » envers la communauté (voir le livre provocateur de l’historien Faisal Devji, The Terrorist in Search of Humanity, 2019), discours que l’on peut bien sûr écouter avec un certain scepticisme rétrospectif, mais qui était bien celui de milliers de volontaires. Désormais ces volontaires, comme tous ceux qui se sont trompés de combat, ne savent plus comment redonner sens à leur propre passé. Alors il faut un regard extérieur, comme celui de Montassir Sakhi, pour évoquer cette possibilité de faire sens.

