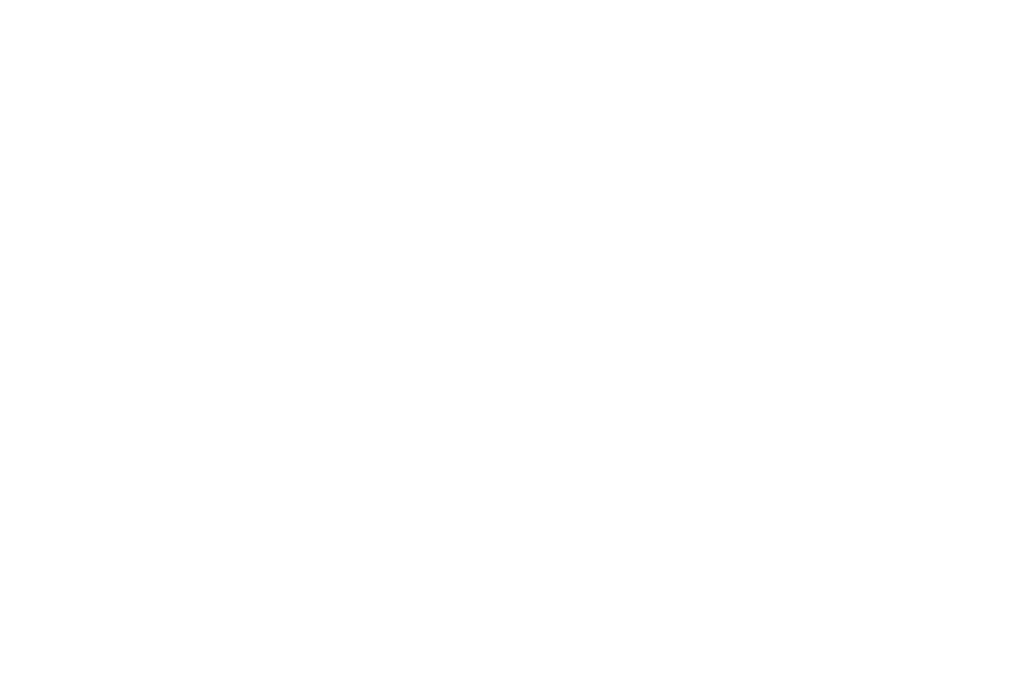
La question syrienne,
ou l'épreuve du panarabisme
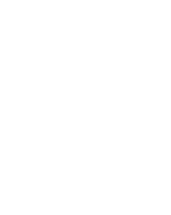
Montassir Sakhi
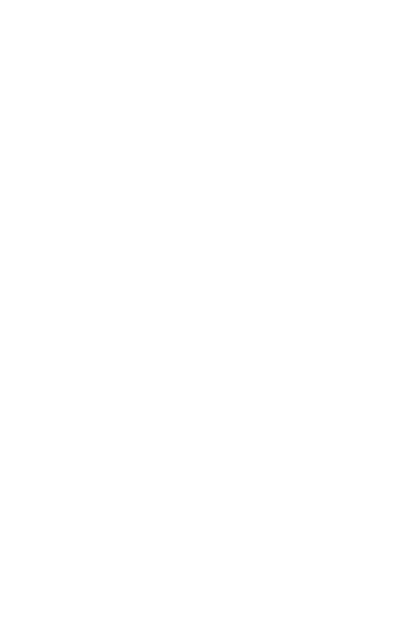
La revue Conditions se flatte de participer à la promotion du livre de rare importance de Montassir Sakhi. La révolution et le djihad (La Découverte, 2023) n'est pas seulement l'un des meilleurs ouvrages traitant de la révolution syrienne et de ses développements successifs. Il est également un modèle de sociologie relationniste, capable de mettre en lien avec une grande finesse la trame historique des révolutions arabes et la situation en Europe de l'immigration postcoloniale et ouvrière. Aussi les quelques bonnes feuilles qui suivent doivent-elles inciter à prendre connaissance de l'ensemble du livre, dont le propos fait oeuvre de salubrité publique en ces temps de crise politique et morale généralisée.
La Syrie divise à travers le monde les mouvements se revendiquant de la gauche. Elle rejoint dans ce sens la situation d’autres causes dans le monde postcolonial comme la Palestine, la question kurde, le Sahara occidental, etc. Dans le monde arabe, les enjeux sont de taille quand il s’agit d’un gouvernement baathiste, comme en Syrie, se présentant à la fois comme ligne de résistance face à Israël, promoteur d’un nationalisme panarabe et allié fidèle de l’Union soviétique puis de son héritier russe.
En 2011 au Maroc, j’ai constaté ces réticences exprimées tant par des jeunes que d’anciens militants socialistes au moment où l’on appelait à manifester devant l’ambassade syrienne contre l’écrasement des manifestations par le régime al-Assad. Les discours négationnistes comme les considérations sur une éventuelle conspiration contre l’« axe de la résistance » (al moumâna‘a) qui serait représenté par la Syrie remontaient à la surface et montraient les divisions du mouvement social. Or, au Maroc comme en Tunisie et dans d’autres pays arabes, ces débats n’existent qu’à la limite des champs militants nationaux structurés par une histoire coloniale et la séquence de la guerre froide. Les discours dissimulant les crimes perpétrés par le régime en Syrie informent ainsi sur le mode relationniste des idéologies adoptées de longue date par une partie des élites arabes. Dans cette conception, le positionnement politique se réalise d’abord au nom d’un « vis-à-vis » et non à partir d’une analyse rigoureuse du réel de la situation, des discours et des pratiques. Les élites qui vivent la situation postcoloniale comme une continuité de la vassalisation de la société croient alors au rôle positif que pourraient jouer d’autres puissances internationales aux discours anti-occidentaux – l’URSS, puis la Russie, apparaissant au premier rang de ces centres de gravité venant concurrencer l’Occident.
De cette histoire et de celle des guerres occidentales dans la région résulte un habitus militant mobilisé par des organisations comme le Baath, dont l’idéologie panarabe a pu convertir l’État en un appareil de pure violence allant jusqu’à briser le seuil de la tolérance permettant de garder une société sous un gouvernement moderne : c’est au nom de la défense de la nation contre l’envahisseur que le Baath s’autorise à détruire la société interne. Cet habitus se nourrit logiquement du cynisme occidental fermant les frontières et s’engageant dans des guerres coloniales continues[i] ; mais l’esprit Baath utilise cet argument pour le traduire en guerre intérieure. Il est pourvoyeur de slogans faisant abstraction du réel et visant à réparer une psychologie collective blessée par la domination et la supériorité occidentale, notamment dans la gestion de la question migratoire et dans l’intervention guerrière. Parmi ces slogans, on retrouve ceux de la lutte « antisioniste » et de la solidarité « panarabe » contre des politiques impériales. Mais le constat en apparence militant convertit le mal subi du fait de l’hégémonie occidentale, par une inversion de la violence, en un code rigide supprimant toute opposition et instaurant la terreur. Avant de voir dans les chapitres suivants les pratiques du Baath dans la Syrie révolutionnaire et la nature de la résistance qui lui a été opposé jusqu’à l’acceptation de la fragmentation de la société, revenons brièvement sur la question « Qu’est-ce que le Baath ? » afin d’élucider comment cet habitus est parvenu à s’implanter, au-delà des organisations panarabes, dans des régions élargies des sociétés arabo-musulmanes et comment ce discours dangereux a trouvé des relais sur une scène globale.
Le panarabisme qui adopte le mot « socialisme » et qui se manifeste dans les partis Baath trouve son point d’ancrage dans les mouvements de décolonisation en région arabophone du monde musulman durant les années 1940 et jusqu’au milieu des années 1960 – bien que l’on trouve les origines de sa pensée chez des élites arabes dominées par l’Empire ottoman tout au long du xixe siècle. Les manifestations partisanes de ce mouvement se retrouvent dans les projets politiques appelés Baath en Syrie et en Irak, ainsi que dans le nassérisme en Égypte et par une présence militante minoritaire dans la plupart des systèmes politiques du monde arabe. La caractéristique essentielle de cette idéologie est en effet que, au-delà de ses propres organisations, elle traverse l’ensemble des courants politiques – socialistes, communistes et islamiques – ayant vu le jour au lendemain des indépendances. Sa pensée réussit, au temps de la constitution nationale nécessaire à la formation des nouveaux États-nations, à proposer un récit partageable à l’ensemble des acteurs postcoloniaux ; récit de construction collective transnationale qui vient se greffer au nationalisme qutri (local et propre à chaque pays arabe). Cette construction répond au sentiment dominant chez les élites des mouvements nationaux guidant les indépendances, selon lequel le nationalisme local serait insuffisant pour s’affirmer face aux anciennes puissances coloniales continuant à exercer leurs hégémonies et à s’organiser en blocs clos tels l’Europe, l’Occident, l’URSS, etc.
Si l’on se fie aux écrits d’intellectuels connus pour avoir pensé, adopté ou intégré les organisations panarabes, on constate que le panarabisme est avant tout un mouvement de pensée « relationniste » : il se fonde en relation avec un interlocuteur principal, à savoir la puissance coloniale perçue comme un bloc homogène du point de vue historique. Dans ce sens, avant la prise de pouvoir en Syrie et en Irak (1963), le panarabisme baathiste se présente comme une révolution nourrie d’un esprit de liberté face à la colonisation. Chez ses premiers penseurs, comme le cofondateur syrien du Baath Michel Aflak (1912-1989), on peut décrypter un hymne d’humanisme messianique sans autre consistance politique que la revendication du pouvoir de la souveraineté et un esprit de corps au-dessus des États-nations. La souveraineté est combinée à une demande d’action politique partisane recélant une forme de pathologie nationaliste inspirée notamment des penseurs du fascisme en Europe :
« Il y a une théorie du vide chez le colonisateur. Il dit que le vide dont souffre notre pays est ce qui a nécessité son remplissage par la colonisation. Je pense qu’il existe en effet un vide, mais ce n’est pas à l’intérieur de notre pays et de notre peuple. Il existe dans cette région du monde qui a travesti et façonné les valeurs au point de tomber dans l’hypocrisie après la contradiction avec les principes revendiqués. […] La civilisation des colonisateurs s’apprête à s’effondrer tant elle pratique l’injustice contre des peuples affaiblis. […] Qui ramènera de la vitalité à ces valeurs vidées en Occident de sens et de vie, si ce n’est ces peuples ayant souffert l’injustice et l’expérience de la douleur[ii] ? »
« Le panarabisme que nous revendiquons est l’amour de toute chose. C’est le même sentiment liant un individu à sa famille, parce que la patrie est une grande maison et la nation une famille élargie. […] Et comme il n’y a pas d’amour sans sacrifice, le panarabisme y appelle également : c’est ainsi qu’il mène vers l’héroïsme. Celui qui fait des sacrifices pour sa nation, défendant sa gloire passée et son avenir heureux, est meilleur que celui qui limite son sacrifice à sa seule personne. […] Et il n’y a pas de crainte que le panarabisme bute sur la religion. Les deux se ressemblent. Le panarabisme, comme la religion, provient de l’intérieur du cœur et de la volonté d’Allah. Ils marchent ensemble et solidaires, notamment quand la religion représente le génie du nationalisme et se concilie avec sa nature[iii]. »
Jusqu’à aujourd’hui, la métaphore de la « maison » et la figure du « sacrifice » pour la « famille » constituent des fondements du discours liberticide par lequel les adeptes du Baath comme al-Assad légitiment les massacres. Dans ce sens, le Baath n’est pas de l’ordre d’une pensée métaphysique et idéophile : il appartient à une pensée anthropologique matérialiste qui convertit le nationalisme en un fascisme prêt à agir par toute forme de violence au nom des structures sacrées dans la société. Il s’agit d’un conservatisme qui, quand il entre en concurrence avec les nouvelles utopies marxistes, islamiques et libérales dans le monde arabe postcolonial, « légitime la domination par des idées » pour reprendre Mannheim[iv]. La domination telle qu’elle s’instaure dans le régime postcolonial est pensée par le conservateur panarabe comme relevant de l’ordre même de la société. En prenant le pouvoir par l’action organisée des coups d’État – il existe toute une pensée des coups d’États dans les théorisations de Michel Aflak –, il s’agit d’administrer la société en faisant de ses idéaux une idéologie fixe. Il n’y a pas de société à réinventer, ni de droits à proposer ni de pouvoirs à suspendre : l’ordre existe déjà dans l’être collectif tel qu’il se décline. Le panarabe « socialiste » propose de mettre en place un gouvernement de répression éloigné de toute utopie critique de l’ordre traditionnel, y compris l’islamisme libéral ou l’islamisme renouant avec l’idée d’un empire déchu. Le panarabisme pensé par Michel Aflak considère le communisme comme un « athéisme » dont il faut se débarrasser et l’islam comme une tradition ancestrale apolitique qu’il faut protéger contre toute forme d’interprétation.
Le panarabisme s’est donc construit en relation avec d’autres récits et discours comme ceux de l’islam politique et du communisme. Mais il ne tire pas seulement sa force de l’organisation de ses leaders et des théorisations de ses penseurs. Sa puissance est assurée dans l’histoire contemporaine du monde arabe par le fait que plusieurs élites et penseurs de différents courants l’ont rencontré à un moment précis des crises politiques. Ces dernières naissent des ingérences étrangères et du retour permanent des puissances traditionnelles en conflit avec le processus de modernisation (tribus, confréries, aristocratie locale, groupes confessionnels, etc.). Le recours au panarabisme s’est révélé utile à la fois pour les leaders de mouvements nationaux de chaque nouvel État arabe indépendant, des penseurs arabes tiersmondistes, des partisans de la tradition islamique, des théoriciens socialistes et communistes et cela pour une finalité précise : renouer le lien avec une tradition pour former un blocus historicus[1]. Ce bloc est pensé par chacun de ces courants comme une tactique révolutionnaire pour d’autres fins, qui diffèrent suivant l’orientation du parti ou du groupe intégrant le panarabisme à son discours. Il est ainsi intégré aux modèles de la société communiste arabe, de l’État-nation libéral, de l’État social-démocrate ou du califat islamique. La rencontre avec le panarabisme s’explique également par la contingence des crises postcoloniales incarnées principalement par la guerre contre Israël – d’où la centralité de la question palestinienne devenue un leitmotiv déterritorialisé et principiel chez les dernières organisations panarabistes comme le Baath syrien : « Palestine la boussole » est le modus operandi de la décision politique et du choix des amis et des ennemis politiques.
Penser avec le paradigme panarabe et faire de la politique oppositionnelle dans le monde arabe en empruntant les mots du Baath a doté ce mouvement d’une légitimité en Syrie et en Irak suite aux coups d’État de 1963. Ce discours souverain s’est renforcé par l’hégémonie du nassérisme et par le soft power exercé par les régimes de Saddam Hussein et d’al-Assad sur les partis socialistes dans le monde arabe après leur accès au pouvoir (respectivement en 1968 et en 1970). La transversalité temporaire du panarabisme au sein de mouvements qui y trouvent conjoncturellement un intérêt explique comment, plusieurs décennies plus tard, la pensée panarabe et la valorisation du régime syrien continuent à caractériser les gauches dans cette région.
Enfin, comment expliquer la centralité de la violence dans le devenir du régime panarabe et son déni de la négociation ? Quand il entre en crise face à d’autres courants politiques, le panarabisme n’a pas d’échappatoire autre que la violence, contrairement à ses concurrents – ainsi, le mouvement socialiste et marxiste trouve dans l’expérience internationale l’espace d’un renouvellement ; tandis que le mouvement islamique, ouvert sur une longue tradition de l’interprétation, trouve la possibilité de la réforme. Mais quand le Baath se déploie en Syrie, les images creuses de sa construction intellectuelle et ses slogans remâchent le constat de l’invasion coloniale – sans dire le réel de ces dispositifs coloniaux – et il devient nationalisme figé, voué à la guerre totale en cas de remise en cause de ses idéaux. C’est pourquoi les usages de la question palestinienne, la menace d’une guerre contre Israël et la revendication de l’appartenance au camp soviétique et russe sont autant d’éléments exploités par le régime baathiste syrien pour garantir son acceptabilité dans les gauches arabes déconcertées par les nouvelles menaces d’invasion coloniale occidentale et israélienne.
Ces rappels des héritages historiques toujours actifs dans le monde arabe et des représentations de la région dominantes dans le monde occidental nous serons utiles pour mieux nous guider dans le déroulement de la révolution et de la guerre en Syrie, objet des chapitres qui suivent.
[i] Montassir Sakhi, « Ce que l’immigration fait aux immigrés », Conditions, n° 1, janvier 2023.
[ii] Michel Aflak, Fî sabîl al ba‘th [Pour le panarabisme], Dar Al Houriya, Bagdad, 1977, p. 51 (ma traduction).
[iii] Ibid., p. 134.
[iv] Karl Mannheim, Idéologie et Utopie [1929], Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2006, p. 188.
La Syrie divise à travers le monde les mouvements se revendiquant de la gauche. Elle rejoint dans ce sens la situation d’autres causes dans le monde postcolonial comme la Palestine, la question kurde, le Sahara occidental, etc. Dans le monde arabe, les enjeux sont de taille quand il s’agit d’un gouvernement baathiste, comme en Syrie, se présentant à la fois comme ligne de résistance face à Israël, promoteur d’un nationalisme panarabe et allié fidèle de l’Union soviétique puis de son héritier russe.
En 2011 au Maroc, j’ai constaté ces réticences exprimées tant par des jeunes que d’anciens militants socialistes au moment où l’on appelait à manifester devant l’ambassade syrienne contre l’écrasement des manifestations par le régime al-Assad. Les discours négationnistes comme les considérations sur une éventuelle conspiration contre l’« axe de la résistance » (al moumâna‘a) qui serait représenté par la Syrie remontaient à la surface et montraient les divisions du mouvement social. Or, au Maroc comme en Tunisie et dans d’autres pays arabes, ces débats n’existent qu’à la limite des champs militants nationaux structurés par une histoire coloniale et la séquence de la guerre froide. Les discours dissimulant les crimes perpétrés par le régime en Syrie informent ainsi sur le mode relationniste des idéologies adoptées de longue date par une partie des élites arabes. Dans cette conception, le positionnement politique se réalise d’abord au nom d’un « vis-à-vis » et non à partir d’une analyse rigoureuse du réel de la situation, des discours et des pratiques. Les élites qui vivent la situation postcoloniale comme une continuité de la vassalisation de la société croient alors au rôle positif que pourraient jouer d’autres puissances internationales aux discours anti-occidentaux – l’URSS, puis la Russie, apparaissant au premier rang de ces centres de gravité venant concurrencer l’Occident.
De cette histoire et de celle des guerres occidentales dans la région résulte un habitus militant mobilisé par des organisations comme le Baath, dont l’idéologie panarabe a pu convertir l’État en un appareil de pure violence allant jusqu’à briser le seuil de la tolérance permettant de garder une société sous un gouvernement moderne : c’est au nom de la défense de la nation contre l’envahisseur que le Baath s’autorise à détruire la société interne. Cet habitus se nourrit logiquement du cynisme occidental fermant les frontières et s’engageant dans des guerres coloniales continues[i] ; mais l’esprit Baath utilise cet argument pour le traduire en guerre intérieure. Il est pourvoyeur de slogans faisant abstraction du réel et visant à réparer une psychologie collective blessée par la domination et la supériorité occidentale, notamment dans la gestion de la question migratoire et dans l’intervention guerrière. Parmi ces slogans, on retrouve ceux de la lutte « antisioniste » et de la solidarité « panarabe » contre des politiques impériales. Mais le constat en apparence militant convertit le mal subi du fait de l’hégémonie occidentale, par une inversion de la violence, en un code rigide supprimant toute opposition et instaurant la terreur. Avant de voir dans les chapitres suivants les pratiques du Baath dans la Syrie révolutionnaire et la nature de la résistance qui lui a été opposé jusqu’à l’acceptation de la fragmentation de la société, revenons brièvement sur la question « Qu’est-ce que le Baath ? » afin d’élucider comment cet habitus est parvenu à s’implanter, au-delà des organisations panarabes, dans des régions élargies des sociétés arabo-musulmanes et comment ce discours dangereux a trouvé des relais sur une scène globale.
Le panarabisme qui adopte le mot « socialisme » et qui se manifeste dans les partis Baath trouve son point d’ancrage dans les mouvements de décolonisation en région arabophone du monde musulman durant les années 1940 et jusqu’au milieu des années 1960 – bien que l’on trouve les origines de sa pensée chez des élites arabes dominées par l’Empire ottoman tout au long du xixe siècle. Les manifestations partisanes de ce mouvement se retrouvent dans les projets politiques appelés Baath en Syrie et en Irak, ainsi que dans le nassérisme en Égypte et par une présence militante minoritaire dans la plupart des systèmes politiques du monde arabe. La caractéristique essentielle de cette idéologie est en effet que, au-delà de ses propres organisations, elle traverse l’ensemble des courants politiques – socialistes, communistes et islamiques – ayant vu le jour au lendemain des indépendances. Sa pensée réussit, au temps de la constitution nationale nécessaire à la formation des nouveaux États-nations, à proposer un récit partageable à l’ensemble des acteurs postcoloniaux ; récit de construction collective transnationale qui vient se greffer au nationalisme qutri (local et propre à chaque pays arabe). Cette construction répond au sentiment dominant chez les élites des mouvements nationaux guidant les indépendances, selon lequel le nationalisme local serait insuffisant pour s’affirmer face aux anciennes puissances coloniales continuant à exercer leurs hégémonies et à s’organiser en blocs clos tels l’Europe, l’Occident, l’URSS, etc.
Si l’on se fie aux écrits d’intellectuels connus pour avoir pensé, adopté ou intégré les organisations panarabes, on constate que le panarabisme est avant tout un mouvement de pensée « relationniste » : il se fonde en relation avec un interlocuteur principal, à savoir la puissance coloniale perçue comme un bloc homogène du point de vue historique. Dans ce sens, avant la prise de pouvoir en Syrie et en Irak (1963), le panarabisme baathiste se présente comme une révolution nourrie d’un esprit de liberté face à la colonisation. Chez ses premiers penseurs, comme le cofondateur syrien du Baath Michel Aflak (1912-1989), on peut décrypter un hymne d’humanisme messianique sans autre consistance politique que la revendication du pouvoir de la souveraineté et un esprit de corps au-dessus des États-nations. La souveraineté est combinée à une demande d’action politique partisane recélant une forme de pathologie nationaliste inspirée notamment des penseurs du fascisme en Europe :
« Il y a une théorie du vide chez le colonisateur. Il dit que le vide dont souffre notre pays est ce qui a nécessité son remplissage par la colonisation. Je pense qu’il existe en effet un vide, mais ce n’est pas à l’intérieur de notre pays et de notre peuple. Il existe dans cette région du monde qui a travesti et façonné les valeurs au point de tomber dans l’hypocrisie après la contradiction avec les principes revendiqués. […] La civilisation des colonisateurs s’apprête à s’effondrer tant elle pratique l’injustice contre des peuples affaiblis. […] Qui ramènera de la vitalité à ces valeurs vidées en Occident de sens et de vie, si ce n’est ces peuples ayant souffert l’injustice et l’expérience de la douleur[ii] ? »
« Le panarabisme que nous revendiquons est l’amour de toute chose. C’est le même sentiment liant un individu à sa famille, parce que la patrie est une grande maison et la nation une famille élargie. […] Et comme il n’y a pas d’amour sans sacrifice, le panarabisme y appelle également : c’est ainsi qu’il mène vers l’héroïsme. Celui qui fait des sacrifices pour sa nation, défendant sa gloire passée et son avenir heureux, est meilleur que celui qui limite son sacrifice à sa seule personne. […] Et il n’y a pas de crainte que le panarabisme bute sur la religion. Les deux se ressemblent. Le panarabisme, comme la religion, provient de l’intérieur du cœur et de la volonté d’Allah. Ils marchent ensemble et solidaires, notamment quand la religion représente le génie du nationalisme et se concilie avec sa nature[iii]. »
Jusqu’à aujourd’hui, la métaphore de la « maison » et la figure du « sacrifice » pour la « famille » constituent des fondements du discours liberticide par lequel les adeptes du Baath comme al-Assad légitiment les massacres. Dans ce sens, le Baath n’est pas de l’ordre d’une pensée métaphysique et idéophile : il appartient à une pensée anthropologique matérialiste qui convertit le nationalisme en un fascisme prêt à agir par toute forme de violence au nom des structures sacrées dans la société. Il s’agit d’un conservatisme qui, quand il entre en concurrence avec les nouvelles utopies marxistes, islamiques et libérales dans le monde arabe postcolonial, « légitime la domination par des idées » pour reprendre Mannheim[iv]. La domination telle qu’elle s’instaure dans le régime postcolonial est pensée par le conservateur panarabe comme relevant de l’ordre même de la société. En prenant le pouvoir par l’action organisée des coups d’État – il existe toute une pensée des coups d’États dans les théorisations de Michel Aflak –, il s’agit d’administrer la société en faisant de ses idéaux une idéologie fixe. Il n’y a pas de société à réinventer, ni de droits à proposer ni de pouvoirs à suspendre : l’ordre existe déjà dans l’être collectif tel qu’il se décline. Le panarabe « socialiste » propose de mettre en place un gouvernement de répression éloigné de toute utopie critique de l’ordre traditionnel, y compris l’islamisme libéral ou l’islamisme renouant avec l’idée d’un empire déchu. Le panarabisme pensé par Michel Aflak considère le communisme comme un « athéisme » dont il faut se débarrasser et l’islam comme une tradition ancestrale apolitique qu’il faut protéger contre toute forme d’interprétation.
Le panarabisme s’est donc construit en relation avec d’autres récits et discours comme ceux de l’islam politique et du communisme. Mais il ne tire pas seulement sa force de l’organisation de ses leaders et des théorisations de ses penseurs. Sa puissance est assurée dans l’histoire contemporaine du monde arabe par le fait que plusieurs élites et penseurs de différents courants l’ont rencontré à un moment précis des crises politiques. Ces dernières naissent des ingérences étrangères et du retour permanent des puissances traditionnelles en conflit avec le processus de modernisation (tribus, confréries, aristocratie locale, groupes confessionnels, etc.). Le recours au panarabisme s’est révélé utile à la fois pour les leaders de mouvements nationaux de chaque nouvel État arabe indépendant, des penseurs arabes tiersmondistes, des partisans de la tradition islamique, des théoriciens socialistes et communistes et cela pour une finalité précise : renouer le lien avec une tradition pour former un blocus historicus[1]. Ce bloc est pensé par chacun de ces courants comme une tactique révolutionnaire pour d’autres fins, qui diffèrent suivant l’orientation du parti ou du groupe intégrant le panarabisme à son discours. Il est ainsi intégré aux modèles de la société communiste arabe, de l’État-nation libéral, de l’État social-démocrate ou du califat islamique. La rencontre avec le panarabisme s’explique également par la contingence des crises postcoloniales incarnées principalement par la guerre contre Israël – d’où la centralité de la question palestinienne devenue un leitmotiv déterritorialisé et principiel chez les dernières organisations panarabistes comme le Baath syrien : « Palestine la boussole » est le modus operandi de la décision politique et du choix des amis et des ennemis politiques.
Penser avec le paradigme panarabe et faire de la politique oppositionnelle dans le monde arabe en empruntant les mots du Baath a doté ce mouvement d’une légitimité en Syrie et en Irak suite aux coups d’État de 1963. Ce discours souverain s’est renforcé par l’hégémonie du nassérisme et par le soft power exercé par les régimes de Saddam Hussein et d’al-Assad sur les partis socialistes dans le monde arabe après leur accès au pouvoir (respectivement en 1968 et en 1970). La transversalité temporaire du panarabisme au sein de mouvements qui y trouvent conjoncturellement un intérêt explique comment, plusieurs décennies plus tard, la pensée panarabe et la valorisation du régime syrien continuent à caractériser les gauches dans cette région.
Enfin, comment expliquer la centralité de la violence dans le devenir du régime panarabe et son déni de la négociation ? Quand il entre en crise face à d’autres courants politiques, le panarabisme n’a pas d’échappatoire autre que la violence, contrairement à ses concurrents – ainsi, le mouvement socialiste et marxiste trouve dans l’expérience internationale l’espace d’un renouvellement ; tandis que le mouvement islamique, ouvert sur une longue tradition de l’interprétation, trouve la possibilité de la réforme. Mais quand le Baath se déploie en Syrie, les images creuses de sa construction intellectuelle et ses slogans remâchent le constat de l’invasion coloniale – sans dire le réel de ces dispositifs coloniaux – et il devient nationalisme figé, voué à la guerre totale en cas de remise en cause de ses idéaux. C’est pourquoi les usages de la question palestinienne, la menace d’une guerre contre Israël et la revendication de l’appartenance au camp soviétique et russe sont autant d’éléments exploités par le régime baathiste syrien pour garantir son acceptabilité dans les gauches arabes déconcertées par les nouvelles menaces d’invasion coloniale occidentale et israélienne.
Ces rappels des héritages historiques toujours actifs dans le monde arabe et des représentations de la région dominantes dans le monde occidental nous serons utiles pour mieux nous guider dans le déroulement de la révolution et de la guerre en Syrie, objet des chapitres qui suivent.
[i] Montassir Sakhi, « Ce que l’immigration fait aux immigrés », Conditions, n° 1, janvier 2023.
[ii] Michel Aflak, Fî sabîl al ba‘th [Pour le panarabisme], Dar Al Houriya, Bagdad, 1977, p. 51 (ma traduction).
[iii] Ibid., p. 134.
[iv] Karl Mannheim, Idéologie et Utopie [1929], Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2006, p. 188.

