Angoisses et espoirs judéo-arabes en Israël-Palestine
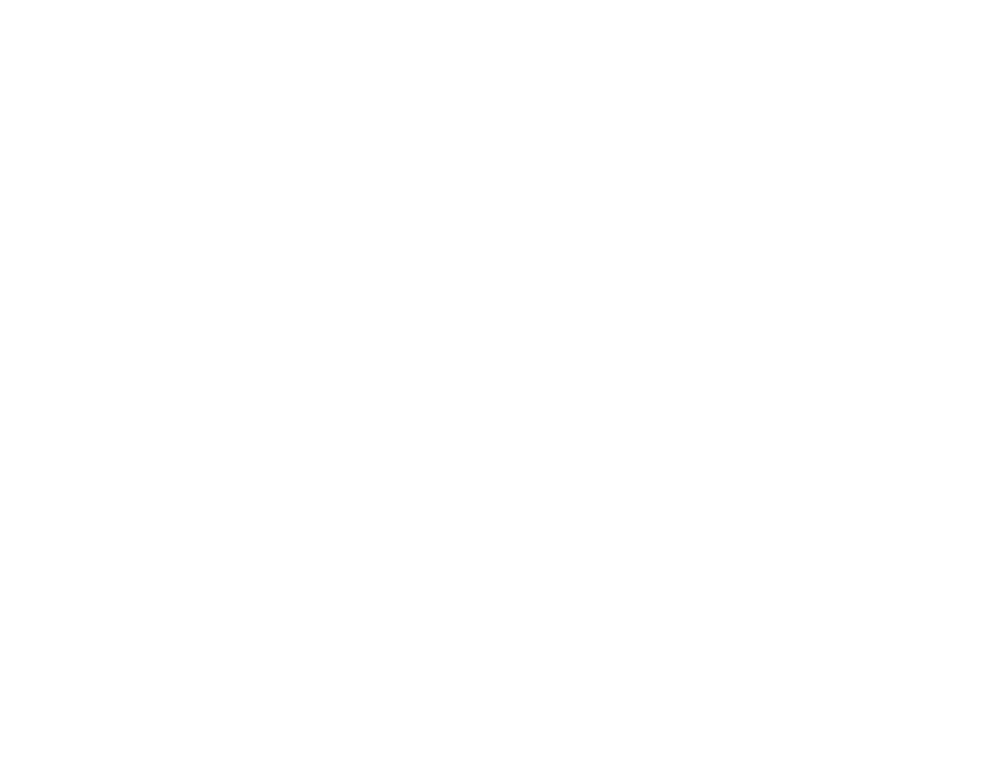
"Quel que soit l’accord qui interviendra dans un avenir proche, qu'il y ait un accord ou pas, l’État d’Israël devra avoir le contrôle de la sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire qui est en contradiction avec l'idée de souveraineté palestinienne. Que faire ? J'ai dit cette vérité à nos amis américains, et j'ai également stoppé la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël : un premier ministre israélien doit être capable de dire « non », même à nos meilleurs amis, et de dire « oui » si c’est possible."
Autrement dit : Il restera à jamais inconcevable de céder la moindre parcelle de « souveraineté » – militaire, et donc de souveraineté tout court – à quelque entité que ce soit qui se trouverait à « l’ouest du Jourdain ». Ces quelques secondes de discours reviennent ni plus ni moins qu’à révéler le jeu de l’État d’Israël depuis 1967 : jamais la « solution à deux États », incantation permanente de tous ses alliés occidentaux depuis un demi-siècle, ne pourra ni ne devra jamais avoir lieu. Et cela non-pas à cause de la mauvaise volonté de l’OLP, de l’activisme criminel du Hamas ou de quelque autre prétexte que ce soit, pas même à cause d’un fantasme territorial biblique. Non. Il n’a tout simplement jamais été envisagé de se retirer de la frontière du Jourdain et du Wadi Araba, pour des raisons stratégiques parfaitement prosaïques. Et ce pilier de la politique sécuritaire israélienne a constitué un point de consensus de tous les décideurs politiques et militaires, depuis la droite religieuse jusqu’à la gauche athée – si l’on excepte quelques gauchistes de salon.
L’illusion à deux États : une histoire stratégique
Dès l’origine, en 1967, rien n’expliquait le besoin du gouvernement laïc de l’État d’Israël d’envahir toute la Cisjordanie. En effet, le Royaume jordanien n’avait aucune chance de retourner la guerre en sa faveur et Hussein II aurait accepté n’importe quelle ligne de cessez-le-feu. D’une certaine manière, même la « reprise » des lieux saints de Jérusalem ou d’Hébron n’était peut-être guère qu’un prétexte sympathique. À ce propos, pendant le quart de siècle qui suit jusqu’aux accords d’Oslo (si l’on excepte la banlieue de Jérusalem-Est annexée illégalement et quelques autres points stratégiques), l’essentiel des colonies furent implantées le long de la « nouvelle » frontière du Jourdain. Le but était de peupler de manière consistante cette zone de sécurité prioritaire.
L’accélération brutale de la colonisation à partir d’Oslo obéit à la même logique. On admet le principe d’un chapelet de protectorats administrés par l’OLP (A et B), muée en « Autorité palestinienne », à la place des anciens « collaborateurs » de l’occupant, comme autant de bantoustans établis sur le modèle sud-africain. En revanche, quel que soit leur degré d’autonomie, le contrôle du territoire (zone C) qui permet de relier le Jourdain nécessite de nouvelles implantations le long des axes stratégiques qui serpentent entre les enclaves A et B.
Aussi pourrions-nous expliquer plus facilement – armés de ce constat - l’apparente impuissance de l’establishment nationaliste – irréligieux – de Tel Aviv à empêcher les colons nationalistes – religieux – à « s’implanter » en « Judée-Samarie ». Les Ashkénazes laïcs des beaux quartiers avaient beau déplorer, auprès de leurs homologues occidentaux de même classe sociale, les origines ou les croyances primitives de ces colons, il fallait bien une population juive-israélienne pour soutenir le quadrillage militaire des collines autour des routes. La seule condition, respectée jusqu’à la toute fin des années 2010, étaient qu’ils n’interfèrent jamais directement avec les indigènes arabes vivant dans les zones A et B que l’armée israélienne a circonscrit comme des « zones rouges » sur la carte. Et pour ce faire, à l’entrée de chacun des ilots de l’archipel de l’OLP, de grands panneaux rouges rappellent que leur franchissement implique un « danger pour votre vie ». Accessoirement, cette signalétique subtile permet d’effrayer les touristes occidentaux qui, juifs ou non-juifs, se croient chez eux en Israël, au cas où le simple fait que l’assurance auto ne les couvre pas en zone rouge n’ai pas suffi pas à refroidir leur ardeur au préalable. Ainsi, il y a toujours eu de la part de Tel Aviv un double jeu consistant à se plaindre devant les Occidentaux d’être victime du fanatisme de la droite religieuse colonialiste, tout en la permettant largement pour des raisons stratégiques in fine compréhensibles depuis la perspective de la doctrine sécuritaire israélienne. Et l’émergence d’officiers supérieurs religieux a simplement ajouté, a posteriori, un vernis de légitimation ethno-nationale à cette politique de sécurité.
Ce discours visait précisément à s’assurer le maintien de cette zone de « sécurité permanente » sans avoir à l’expliciter, sans avoir à dire que jamais l’OLP n’aurait d’État au sens du droit international. Or, si du point de vue de l’État-major israélien, le maintien d’un réseau de bases militaires avec quelques colonies en support suffisait à l’impératif stratégique, cela ne réglait pas le problème de l’intégration de ce territoire au reste d’Israël. Il fallait bien prendre en compte l’existence de cette population indigène. Alors, pour n’avoir jamais besoin de formaliser cette nécessité, pour ne pas être contraint d’annexer officiellement, et être alors forcé par le droit international le plus élémentaire de naturaliser les indigènes, il y avait deux piliers :
- Il suffisait de laisser dire aux Palestiniens – et aux propalestiniens – qu’ils étaient ceux qui s’opposaient à cette annexion, en raison de sentiments patriotiques prioritaires, le droit à l’autodétermination et autres principes phares du XXe siècle. Dès lors, Israël avait beau jeu de se refuser d’imposer un tel changement de nationalité indigne aux indigènes qu’elle administrait en tant que puissance occupante.
- Il fallait ensuite, et surtout, prétendre que la colonisation était subie pour ne jamais avoir à officialiser un régime d’apartheid. Ainsi, l’armée israélienne pouvait maintenir son quadrillage, ses axes vers le Jourdain et le statu quo de l’occupation.
Ce dernier permettait là aussi de se maintenir sans accorder de nouveau droits aux habitants du territoire, à commencer par celui de pouvoir circuler vers et dans l’État occupant, puisqu’ils n’étaient pas en territoire israélien annexé.
La création de l’Autorité palestinienne permettait de déléguer la gestion du quotidien des Palestiniens à une entité politique dépendante, et donc de diminuer les coûts administratifs, ainsi que les contacts humains, et finalement ce qu’il restait de droits pour les occupés. Ce faisant, l’État israélien satisfaisait à son impératif sécuritaire sans jamais avoir besoin de poser officiellement la question de l’annexion de la « Judée-Samarie ». De fait, elle était complètement intégrée au réseau, et on pouvait alors se contenter de reprocher à l’OLP – mais aussi au Hamas à Gaza – de ne pas être en mesure de sécuriser le territoire qui leur était officiellement abandonné pour justifier de continuer à l’occuper.
Gaza : dehors et dedans
Pourtant, l’expérience de Gaza aurait pu (du ?) mettre la puce à l’oreille des Occidentaux. En effet, lorsque la Knesset, à l’initiative d’Ariel Sharon, décide en 2005 l’évacuation des colons qui s’y étaient établi pour les mêmes raisons : un appui humain à la sécurité frontalière par la domination territoriale, c’est parce que le gouvernement calcule qu’il sera préférable de faire de Gaza tout entière une « zone rouge ». Les colons qui avaient eu le malheur de répondre à l’appel lorsqu’on avait eu besoin d’eux pour peupler la zone de sécurité frontalière avec le Sinaï se chargeront de se donner l’image de fanatiques millénaristes « contre la paix », concentrant ainsi sur eux – plutôt que sur l’État israélien – la critique libérale occidentale.
Gaza apparaît donc comme un grand bantoustan, en rouge sur la carte d’Israël, aux côtés de la zone de Jenine, et des enclaves de Ramallah, Tulkarem, Qalqilia, Jéricho et quelques zones rurales autour d’Hébron. Or, qui pouvait croire que Sharon ou quiconque ait jamais pensé qu’une telle évacuation du premier bantoustan complètement autonome ait dû signifier quelque indépendance que ce soit ? Le fait que le Hamas y ait éliminé l’OLP après que celle-ci a voulu lui arracher sa victoire électorale en 2007 n’y compte pour rien d’autre qu’un prétexte rhétorique et fallacieux : les frontières internationales du Sinaï et de la Méditerranée ainsi que l’espace aérien devaient et allaient rester israéliens à jamais.
Emmanuel Macron a fait l’amère expérience le 8 octobre du souverainisme israélien portant sur tout l’espace situé entre la rivière à la mer. En effet, pris d’un de ses élans spontanés mais erratiques, il avait proposé d’adapter la coalition contre l’État islamique en Haute-Mésopotamie contre le Hamas à Gaza. Comme souvent, il n’avait semble-t-il pas su prendre la mesure les réalités géopolitiques que camouflent – si peu ! - les oripeaux des éléments de langage et les impressions de bon sens. Et si, là encore, il s’était laissé berné par son enthousiasme de communicant, c’est parce que la revendication israélienne officieuse et implicite – mais réelle et depuis longtemps éprouvée en pratique – que tout ce qui est autour et au-dessus de Gaza appartient à la puissance occupante, n’avait jamais eu besoin d’être formulée en public. En aucune manière l’État d’Israël n’a jamais envisagé d’être rétrogradé à un tel statut de non-puissance, qu’il serait en position d’accepter ce type de sujétion stratégique de l’espace aérien qu’il occupait, et était donc sien. Une fois cette réalité expliquée au président français, l’Élysée aura eu beau jeu de présenter son rétropédalage comme un humanisme : ne pas bombarder les Gazaouis. Et pourtant, sous l’œil sévère de Bibi, Macron s’est bien au contraire contenté de valider et conforter cette réalité « souveraine ».
L’erreur de Macron révèle simplement le fait que personne, depuis 2005, n’a jamais semblé prendre conscience de ce que la poursuite du statu quo d’Oslo impliquait, et surtout de ce que l’incantation de la « solution à deux États » permettait de renforcer : ni intégration ni indépendance. Les puissances occidentales ont semblé jouer de manière consentante, pour des raisons affectives, stratégiques, électoralistes, une partie de ping-pong avec l’État israélien. En invoquant ainsi 55 ans durant et sans répit la posture d’une « solution à deux États », ils évitaient de jamais poser la simple question de sa faisabilité au regard de l’inflexibilité de la doctrine stratégique et sécuritaire de la puissance occupante, cela évitait à cette dernière d’expliciter ou d’avouer qu’elle en refusait l’éventualité même.
Rattraper 55 ans d’illusion ?
Or, pendant ce demi-siècle d’illusions, deux générations de Palestiniens ont vécu sans presqu’aucuns droits civiques, sociaux, politiques, humains, entretenus dans la perspective d’une impossible accession à la souveraineté, et le fantasme – somme toute moins absurde, on le comprend enfin – d’une reconquête eschatologique et d’une victoire martyrologique.
Pendant cette attente, il était facile de remettre à plus tard l’illusion au prétexte du cauchemar, ce dernier étant pourtant le produit de la première. Pendant ce temps, au nom de la préservation des aspirations légitimes d’un peuple en quête d’un État qui ne pourrait jamais exister, personne, à commencer par les généreux propalestiniens – bien au chaud avec leur passeport européen –, n’ont jamais osé proposer la seule solution à même de rendre leurs droits humains aux Palestiniens de Cisjordanie et Gaza, et qui soit compatible avec les exigences de l’appareil sécuritaire israélien – mais pas avec la préservation ethno-raciale du « caractère juif de l’État d’Israël » : une vraie intégration en bonne et due forme. En effet, celle-ci leur interdirait tout poursuite – cette fois officielle – de l’apartheid au risque d’une mise au ban international et les contraindraient donc à accorder à tous les Palestiniens les droits réservés aux seuls Israéliens. Au milieu des malheurs de la déportation, justifiée par l’impératif militaire, des massacres aveugles au nom de la thèse inhumaine du bouclier humain, et du nettoyage ethnique larvé, peut-être que ce coming out final de Netanyahou devrait être considéré comme la bonne nouvelle.
Mais alors, quelle mouche a piqué Netanyahou pour avouer ainsi ce 19 janvier, en une dizaine de mots à peine, la stratégie d’un demi-siècle ? Pourquoi s’est-il cru obligé, en l’expliquant, de mettre ainsi en péril le maintien du statu quo éternel qui avait permis le contrôle stratégique du territoire sans avoir besoin de donner des droits à ses habitants ? Pourquoi s’est-il ainsi aventuré à dire ce qui, bien que su de tous en Israël, n’est généralement jamais explicité, encore moins devant la presse internationale ?
Tout simplement parce que l’administration démocrate des États-Unis, pour la première fois depuis qu’ils sont devenus la puissance protectrice d’Israël (après 1967 donc), a cessé d’invoquer la solution à deux États, pour enfin la proposer. Les Américains, croient-ils, ont été confrontés à « l’évidence » d’un antagonisme politique ineffaçable qui serait la cause et la conséquence de l’invasion et des crimes du 7 octobre 2023 et de la vengeance aveugle qui se traduit par l’écrasement de Gaza et l’extinction de plusieurs dizaines de milliers d’âmes. Cette précipitation vers la prétention à mettre en application réelle ce qui aurait toujours dû rester une posture révèle aussi l’évidence qu’une partie de l’électorat démocrate, y compris juif américain, n’est pas (plus) prêt à accepter d’être complice de cette machine de destruction lancée sans aucune finalité politique, ni même militaire. Biden et son équipe se sont peut-être naïvement dit qu’il fallait reprendre en 2024 ce que la gauche tiers-mondiste de salon demandait 40 ans plus tôt : « s’ils ne s’aiment pas, aidons-les à divorcer ».
Disons malgré tout que cela arrive peut-être un peu trop tard. En effet, d’une part Trump semble devoir gagner les élections fédérales, et il renouera assurément avec un appui immodéré pour le statu quo, peu importe que le discours officiel israélien ait clairement expliqué qu’aucune « solution à deux États » n’est possible. D’autre part, Netanyahou est aujourd’hui supposé en grande partie responsable voire complice du pourrissement de la situation et du renforcement du Hamas, et tout le monde le voit se débattre pour conserver son poste en dépit des sondages. Dans ces conditions, les Occidentaux peuvent tenter une dernière pirouette en concentrant sur lui seul, et son extrémisme démagogue, la position qu’ils savent pourtant être celle très sérieuse d’Israël depuis 1967.
En tout état de cause, il faut répondre à Biden que l’idée des « deux États » n’avait jamais été inventée pour être une « solution », mais que sa seule application pratique est la création de plusieurs Gazas comme autant de bantoustans, sans même les droits nationaux élémentaires qu’avaient eu les Bantous sud-africains de l’apartheid. Profitons de ce brusque et salutaire jaillissement de vérité depuis la bouche de Netanyahou – dont Haaretz dit bien qu’il est à cours de mensonges dans toutes les langues – pour prendre acte sérieusement de la seule solution légale et humaine dont il n’a jamais été question : un seul État de la mer au Jourdain, lequel existe de facto mais au bénéfice des seuls citoyens israéliens.
Israël, un régime illibéral du Sud
Ce rapport contrarié des discours tenus en interne au discours officiel à destination de l’Occident est bien connu dans les pays ex-colonisés du « Sud » ; mais pourquoi s’étonner de le trouver aussi entre Israël et l’Occident ? Parce que le pays a été fondé par des Européens, qu’il a une économie prospère, un régime représentatif et la bombe nucléaire, tout cela est vrai. Invoquer sans répit « les deux États » imaginaire(s) de la part des plus proches partenaires de celui qui le refusait assurément, reflète la profondeur de ce rapport asymétrique.
Pourtant, la prise de recul critique d’une bonne partie de l’opinion américaine et occidentale en général vis-à-vis d’Israël n’a pas commencé avec les images de Gaza : dès le 7 octobre, la politique de colonisation et les excès des colons, le siège permanent de Gaza, ont été au cœur des débats en Occident. L’absence de solution a cessé d’être un bon moyen d’afficher une posture n’impliquant aucun risque de la mettre en place. Et cette mise en lumière produit l’effet délétère d’une plus grande radicalisation encore de l’opinion israélienne, puisque, victime d’une part d’une agression qu’elle considère injustifiable, celle-ci n’est d’autre part pas reconnue comme telle par les Occidentaux, mais « expliquée ».
Or, cette mutation du rapport à Israël, en particulier par rapport à la situation lors de l’Intifada d’al-Aqsa au début des années 2000, est bien davantage un effet du changement démographique, culturel et social d’Israël, que de celui de l’électorat occidental. Même si, depuis le 7 octobre, proisraéliens et propalestiniens s’obstinent à rejouer la lutte entre Tiers-Monde et Occident, cela ne prend guère que dans ces milieux. Car Israël n’est tout simplement plus une démocratie occidentale, mais un État nationaliste réactionnaire comme le sont la Russie ou l’Inde. Inversement, ce pourrait bien plutôt être la société palestinienne qui, à l’instar de l’ensemble des mondes arabo-musulmans, connait un développement soudain de sécularisme et d’irreligion depuis une décennie, et donc d’aspirations progressistes et libérales.
Israël a manifesté son ancrage dans les régimes illibéraux du prétendu « Sud global » lorsque son gouvernement, soutenu par une large majorité de l’électorat, a décidé d’abolir l’État de droit en même temps que la Cour suprême. Mais il a également très nettement exprimé sa position anti-occidentale en refusant de soutenir l’Ukraine lors de l’agression russe initiée en février 2022. Au quotidien, cette radicalisation s’exprime par l’adoption de la synthèse sioniste religieuse à tous les niveaux de la société. Et pour cause, la géographie biblique demeure le dernier moyen de justifier le contrôle de la frontière du Jourdain.
Désormais, la priorité est en train de se retourner : conserver la frontière du Jourdain pour conserver la Cisjordanie. C’est sans doute ce pourquoi certains pro-Israéliens se croient en situation extrême d’abattre cette dernière carte ethnoreligieuse : « un Juif n’est pas un étranger en Judée ». D’une part, cet argument est lui-même limité par son incohérence historique, il délégitime immédiatement la grande majorité des colons juifs qui n’habitent pas la « Judée » (au sud de Ramallah), mais la « Samarie » (au nord). D’autre part, l’admettre revient à enfoncer un coin majeur du droit international. Si la Judée appartient à Israël à cause de son nom, alors le Rus’ de Kiev appartient à Moscou, mais aussi la Franconie allemande et la Bourgogne transjurane suisse iront aux Français et aux Bourguignons, la Saxe allemande aux Anglo-saxons, le Guangdong (Nam-Viêt) aux Viêt-Nam, le Sind aux Indiens, et toute l’Asie centrale à la Turquie. Un monde régi par un tel culte de l’étymologie nationale est sans rapport avec l’ordre international de droit patiemment construit depuis un siècle et demi.
En revanche, dans ce monde, le retour de bâton religieux-nationaliste est parfaitement normal : les élites israéliennes laïques se sont abritées pendant un siècle derrière l’interdit talmudique de reconstituer le royaume d’Israël en l’absence du Messie. Pourtant, un tel point de théologie n’a rien de biblique, et l’histoire s’accorde avec les messianiques sur un point : rien ne s’oppose à l’idée que les Judéens reconstruisent une troisième fois leur temple. Le conservatisme rabbinique qui prétend le prohiber est lui-même conditionné par des millénaires d’intériorisation et de justification de ce qui était d’abord subi : ce sont les États romains, puis chrétiens qui le prohibent aux Juifs en premier lieu. Ensuite, les conquérants arabes garantissent aux chrétiens le statu quo antérieur, puis les Omeyyades investirent à leur tour l’esplanade. Si les Juifs cessent d’être une minorité politique, et se dotent de leur État souverain, l’interdit de reconstruction du temple est caduc. Si les rabbins changent d’avis – et il fait peu de doute qu’ils changeront d’avis – quelle sera alors la justification théorique pour l’interdire ?
Qui saura leur expliquer pourquoi l’expulsion des habitants de Haifa, Majdal ou Ramla en 1948 et le refus de leur retour en 1949 pourraient être légitimes, mais pas le projet de faire de même à Naplouse, Bethléhem ou Jéricho ?
Pourquoi l’étude des seuls « Palestiniens » favorise les seuls « Israéliens »
Or, de l’autre côté du spectre politique, l’idée d’une solution à deux États est contredite par la réalité sociale et culturelle inextricable des nombreux peuples – bien plus que deux – qui habitent la Palestine historique. Mieux, l’état actuel de radicalisation généralisée n’est qu’un aspect de l’intrication d’une multitude complexe de dynamiques sociales. À ce titre, il faut déplorer l’absence de données sociales, politiques, historiques et mémorielles, cohérentes et comparables, sur l’ensemble des individus et communautés qui peuplent la Palestine historique, et sont donc sujets, d’une manière ou d’une autre, de la souveraineté israélienne.
En effet, il est impossible de comprendre la situation du présent, héritière du passé, et de projeter des solutions d’avenir sans avoir au préalable collecté et confronté ces données, et en avoir proposé et discuté des analyses. C’est de la société politique israélo-palestinienne telle qu’elle existe factuellement aujourd’hui qu’il faut traiter :
Que fait, que pense, que rêve, que subit, que domine… l’ouvrier cisjordanien chez son employeur juif-israélien dans une colonie cisjordanienne, ou à « l’intérieur (dakhil) », dans un kibboutz sioniste, où chez un patron Israélien arabe bien content de son passeport bleu, ou avec des collègues juifs d’origine arabe qui n’ont que leur judéité comme privilège à défendre (infra).
Comment peut-on rester sans aucune étude de ce territoire que, pour parodier le propos prêté à Evliya Chelebi sur l’écureuil anatolien, un arabophone peut traverser de part en part sans jamais avoir besoin d’apprendre l’hébreu ou l’anglais. Il faut prendre de front cette société politique de l’État unique qui ait jamais existé et qui existera jamais sur la terre de Palestine historique. Ce système complexe au point d’être échevelé, multi-dimensionnel, intersectionnel, les mémoires croisées et incompatibles de tous ceux qui la composent, et comment malgré tout elles forment un ordre, et ses différents systèmes de croyances dominants qui, parfois, s’entrechoquent, rien de tout cela ne se dévoile guère à l’œil sagace du chercheur occidental, lorsqu’il est en quête d’une juste cause, orientale et exotique.
Parce que le bon Palestinien est justement le seul à ne pas être électeur en Israël : il n’a donc pratiquement aucun pouvoir de décision sur son propre avenir au sein de l’État unique. En revanche, les trois quarts de la société israélienne, d’origine arabo-palestinienne ou judéo-arabe, elle, est complètement ignorée, subalterne pour les élites ashkénazes israéliennes, et aliène pour les Occidentaux propalestiniens.
Le gentil occidental intellectuel, ou le vertueux bourgeois arabe occidentalisé, projette ses bons sentiments sur le bon Palestinien, tout en étant bien protégé par son passeport rouge, des deux côtés de la « clôture », il contribue à renfermer mentalement son objet d’étude dans son bantoustan physique et moral.
C’est là où le monde de la recherche me semble avoir un rôle à jouer, et que pour l’instant celui-ci est en partie défectueux. Les mobilisations des universitaires contre les dénonciations et inquisitions racistes depuis le 7 octobre sont parfaitement légitimes, mais l’objet de leur expression semble encore une fois biaisé par un fantasme tiers-mondiste d’un autre âge, et ce faisant profondément orientaliste : l’absence de recherche, dans les mêmes laboratoires, les mêmes équipes, les mêmes associations, sur la société israélienne, à commencer par les deux groupes qui, ensemble, forment la majorité votante relative de toute la population de cet État unique : les Arabes de nationalité israélienne (1,6 millions) et les Juifs d’origine arabe (2,5 millions).
Tandis que les chercheurs occidentaux sont pléthore à s’intéresser aux peuples en résistance de Jérusalem, d’Hébron, de Naplouse et de Ramallah, ils sont rares à parcourir les vastes cités de Ludd, Ascalon ou Akka. Tandis que pour rejoindre leur « terrain », ils passent par l’aéroport Ben-Gourion, une navette conduite par un Arabe israélien de Jaffa ou Ramla, et un check-point rempli d’Israélien marocains et yéménites de Beersheva et Ashdod, ils ne se demandent pas comment ces gens vivent, quelles sont les réalités sociales qui les unissent, les opposent, construisent leurs imaginaires, nourrissent leurs engagements politiques, les dynamiques et rapports de forces qui, sur certains plans, compriment leur libre-arbitre ou les poussent dans les bras des racistes, pour échapper au racisme. L’université israélienne est productive, mais ces questions constituent le point aveugle de l’ensemble de la société, et on ne peut donc pas attendre d’elle qu’elle produise sur ces sujets pourtant essentiels ne serait-ce que des données complètes, et encore moins des analyses croisées.
Étudier ceux qui se revendiquent « Palestiniens » parce qu’ils n’ont rien d’autre, dans les seuls territoires occupés dénués de tous droits sociaux et politiques est évidemment essentiel, et il convient bien sûr, en science, de ne pas tout mélanger. Mais ne faire que cela ? Pendant un demi-siècle ? Encore et encore revenir avec la même empathie étudier la même population, sans jamais identifier – ne parlons pas de quantification – les phénomènes sociaux affectant le peuple dominant ?
Comment pouvoir espérer engendrer autre chose qu’une intensification de la binarité théorique, celle qui arrange aussi bien l’oppresseur que ses alliés, celle qui arrange aussi ceux qui peuvent ainsi représenter éternellement l’opprimé : le statu quo diplomatique, affectif et académique de l’illusoire solution à deux États. Cette dichotomie ne cesse d’être reformulée, reproduite, consolidée lorsque le chercheur occidental accepte tacitement le dispositif qui suppose que l’Israélien est un Occidental impérialiste et le Palestinien un indigène du Tiers-monde…
Disons-le autrement, l’absence de toute approche islamophile, panarabiste, tiers-mondiste de la société israélienne est un signe même de l’inféodation des Palestiniens et du Tiers monde, arabe et musulman, à l’Occident, lorsque tout le monde semble s’accorder à décréter qu’Israël est l’Occident. Se focaliser de manière romantique sur la catégorie du Palestinien de Jérusalem et des territoires occupés et ignorer complètement l’illégitime Israël comme s’il n’existait pas, alors qu’on s’y trouve, constitue la manifestation la plus claire de la poursuite d’une projection orientaliste. Puisque les Israéliens ne seraient que des Occidentaux, il n’y aurait rien à étudier, rien à comprendre, rien à apporter au débat, et donc à la construction d’une perspective de paix.
Et cela arrange avant tout ceux qui dominent les champs divers de la société politique israélo-palestinienne, que de le laisser croire à l’Occidental. En effet, la force du récit qui présente les Juifs comme Européens par essence est non seulement d’être partagé par les pro-Israéliens et les pro-Palestiniens, mais surtout de nier les hétérogénéités internes et de permettre aux Israéliens de préserver intacte la fiction d’une judéité ethnique ou nationale. Pourtant, historiquement, à l’instar du « peuple chrétien (populus christianorum) », ou de la « nation (umma) » de l’islam, le « peuple d’Israël (ʿam Ysraʾel) » est un concept purement cultuel. En effet, dans les systèmes humains médiévaux et modernes, la religion consiste avant tout en une organisation légale communautaire et clérical. Or, chaque régime confessionnel n’existe qu’en ce qu’il est inséré et subordonné au cadre impérial et politique, et donc socio-culturel dans lequel il se structure. Il n’y a ainsi rien de plus commun entre un juif germanophone de Lituanie et un juif arabophone du Draa qu’entre un catholique du Pérou et du Congo.
La projection monolithique de la judéité, et son ancrage unilatéral à l’Occident, couvre surtout toute appréhension du communautarisme et des brutales et implacables hiérarchies ethnoculturelles, pour ne pas dire raciales, qui prédominent à l’intérieur de la dimension juive israélienne. Et pourtant, c’est la violence même de ces rapports communautaires internes qui structure et explicite le comportement politique des électeurs, faiseurs d’opinion et acteurs. Dès lors, pour évacuer le rapport d’oppression de ce champ, il suffit de se déporter dans la seule dimension où oppresseur et opprimé sont frères : le « conflit » entre Juifs et Arabes. Ici encore, le fait que Netanyahou s’échine aujourd’hui à répéter à l’envi cette unité nationale, et son essence occidentale, et jusqu’à la nausée, suffit à mettre en évidence que si Israël a bien été fondé par des Européens séculiers et éduqués, ce n’est non seulement plus le cas, mais surtout : tout le monde s’en est rendu compte.
En effet, s’il n’y a historiquement aucune ethnicité juive avant l’Israël moderne, il existe bien une communauté rituelle et légale réunissant tous les juifs sujets de droit dans le cadre du domaine l’Islam (dār al-islām) : pour leur grande majorité arabophone, leur organisation confessionnelle est toujours matérialisée aujourd’hui par un grand rabbinat commun.
L’israélien judéo-arabe : étouffé par la construction nationale, ignoré des chercheurs
Il faudrait évoquer toutes les catégories d’Israéliens arabes, des Galiléens grecs catholiques jusqu’aux bédouins des campements du Néguev, de celui qui sert dans l’armée à celui qui milite à la mosquée contre les sionistes ; de celui qui se marie à une juive et est répudié par sa famille, à celui qui gère un service hospitalier et soigne des juifs, de ceux qui votent en même temps Netanyahou et les Frères musulmans, de ceux qui sont nationalistes palestiniens et de ceux qui préféreraient tout perdre plutôt que leur passeport israélien, de ceux qui, parce qu’ils sont druzes ou circassiens, ont été déclaré non-Arabes, et jouissent de privilèges accrus ; de ceux qui se pensent solidaires des Jérusalémites, et de ceux qui ne savent même pas qu’ils existent. Il y a à leur propos mille thèse et dix mille articles en attente.
Mais nous nous focalisons plutôt ici, trop brièvement, sur le groupe qui pâtit, autant sinon plus que les Arabes israéliens, de l’intérêt moindre des chercheurs israéliens, européens et arabes : les « Mezrahis » – que nous appellerons Judéo-arabes israéliens. Ils forment pourtant la majorité relative de toutes les communautés israélo-palestiniennes. Et ce fait implique qu’ils ont été de plus en plus durant les dernières décennies, et seront amenés à le rester sinon à l’amplifier à l’avenir, les principaux déterminants des choix politiques, des hégémonies idéologiques, et de l’ordre légal de cet État unique. Leur histoire sociale est plus que méconnue : il n’y a pratiquement aucune étude à leur propos dans leurs pays d’origine tandis que leur appartenance en Israël à une catégorie socio-culturelle inférieure – sujette et donc muette – les prive d’une part d’élite intellectuelle pour s’intéresser à eux en tant qu’ancêtres et parents, et les enferme d’autre part dans un maillage étroit de biais académiques qui détournent les chercheurs de la problématique.
Et pourtant, et c’est la raison de notre choix, l’acquisition de connaissances sur leur histoire, leur société et leur système politique et imaginaire est non seulement marginale, mais elle est en danger. Il y a urgence car la génération des arabophones immigrants de 1948 à 1967 est en train de s’éteindre. Bon nombre d’Irakiens, Égyptiens, Syriens et Yéménites des années 1940, et des Marocains et Tunisiens des années 1950 à 1960, pour ne citer que les nationalités principales, sont déjà tous retraités. Les témoins chrétiens et musulmans des pays de départs, voisins amis, ennemis, bourreaux, concurrents, badauds… en sont au même point. Ils vont bientôt emporter avec eux leur culture subalterne, leur sociabilité, leurs rapports multiples aux mondes sociaux israélo-palestiniens, aux pays d’origines. Nous allons perdre le souvenir de leur définition ancienne, et de leur redéfinition en Palestine du sens de l’identité de Juif, ou du tabou de celle d’Arabe. Ainsi, nous sommes au seuil de la perte irrémédiable de toute leur mémoire particulière des causes de leur exode, de tous leurs souvenirs biaisés de la réalité des faits, de toutes les raisons réelles et imaginaires que le récit israélien appose, celui auquel ils abondent et qui les marginalise du même coup. Sans même parler des disciplines que je sais mal, c’est tout une histoire orale qui doit accompagner les rares archives existantes, encore inconnues, sous exploitées ou souvent perdues, qui disparaît à grande vitesse.
Si l’on n’y prête pas garde de toute urgence, la connaissance qu’il restera à arracher sera handicapée par un mélange informe de récits caricaturaux et de memoria officielle, de commémoration déformée d’abysses de silence que nul ne pourra plus combler. Je ne peux guère qu’esquisser quelques-unes des centaines de pistes, sur les milliers de situations, et les milliers de thèses qu’il aurait fallu écrire et qui ne le seront jamais, mais aussi de rappeler toutes celles qu’il reste encore possible de réaliser. Je ne fais ici qu’imaginer ce que pourrait apporter une compréhension un tant soit peu plus riche, plus correcte, plus exhaustive, plus interconnectée, de l’ensemble des champs qui forment le réseau humain de la société israélo-palestinienne, du seul et unique État qui ait jamais été effectif depuis 1967 sur la terre de Palestine, et qui, sauf retournement majeur imprévisible, risque de durer à l’avenir.
Énonçons d’emblée, et au risque de la caricature, la hiérarchie interne aux Juifs israéliens :
- Il y a des Européens blonds aux yeux bleus qui peuvent refaire leur passeport Schengen en deux clics, qui exercent des professions intellectuelles supérieures, votent au centre-gauche, et habite loin des quartiers immigrés et des ghettos des Arabes israéliens.
- Et puis il y a les autres : les juifs non-ouest-Européens, au premier rang desquels les juifs d’origine arabe, appellation qui est elle-même proscrite et remplacée par Mezrahi (= « Orientaux ») – étrange pour des Maghrébins (= « Occidentaux »), lorsque les Ashkenazes (= « Scythes ») viennent vraiment de l’est.
Ce vocabulaire trahit ce que cette hiérarchie instaurée par des Ouest-Européens reproduit de l’ordre mondial. Et cela explique en premier lieu pourquoi presque tous en éludent l’étude. C’est d’ailleurs dans les langues européennes, qui parlent de « Séfarades (= Espagnols) » pour désigner les « Mezrahi », que l’on touche au comble de cette absurdité. Cette expression est complètement fausse car elle désigne des locuteurs du ladino, pas de l’arabe ; et ils furent surtout présents en Italie, dans les Balkans, et incidemment à Jérusalem (car les Juifs palestiniens originels ont été chassés par les Croisés francs). Mais dire « séfarade » permet du même coup de s’imaginer, sans avoir besoin de le formuler, que tous les juifs seraient européens. Et cela renforce l’idée sous-jacente du récit officiel d’Israël : celui d’un pays naturellement occidental.
Ensuite, malgré leur sujétion, et peut-être en partie en raison de celle-ci, leurs deux caractéristiques de « juif » et d’ « arabe » ont été jugées incompatibles car elles renvoyaient aux deux rives hermétiques de deux nationalismes modernes : le sionisme israélien et le panarabisme palestinien. Les arabophones de confession juive ont alors dû se conformer à cette binarité moderne pour définir leur identité, d’autant qu’elle avait logiquement l’attractivité de les agréger à la communauté politique dominante, d’être donc privilégiés par rapport aux Arabes chrétiens et musulmans autochtones, sans parler de ceux des Territoires occupés après 1967.
Ainsi, dans le champ propre à la société politique judéo-israélienne, être Juif « oriental » (ou « espagnol » pour les Européens) était un moyen de rejeter son arabité, d’adopter le nationalisme officiel, mais aussi d’ancrer leur sujétion à l’égard de la communauté des fondateurs laïcs et européens. Ainsi, des millions d’Arabes de confession juive ont été assimilés en tant qu’Israéliens, Européens, Occidentaux, colons et envahisseurs en bloc, et ontologiquement distincts des Palestiniens.
En renouvelant sans cesse ce schéma, les élites « nationales » comme les chercheurs qui ne sortent jamais des territoires occupés (mais habitent quand même à Jérusalem annexée, là où le standing européen prédomine), ou alors qui, étant pro-Israéliens, ne fréquentent que la partie laïque de la communauté judéo-européenne où se recrute la bourgeoisie intellectuelle, et éventuellement quelques Arabes israéliens instruits et polis… ne cessent d’entretenir cette méconnaissance scientifique, et donc d’élargir le fossé politique ; ils ne font que renforcer cette structuration en deux camps binaires.
Et celle-ci consiste justement à jeter l’un contre l’autre les deux groupes judéo-arabe et arabo-palestinien qui, pourtant, avaient – et dans bien des cas conservent – en commun une même langue et une même culture. Ce faisant, en l’absence de toute émergence d’un discours, de toute explicitation de leur condition, de tout récit sur leur passé, leur présent et leur avenir commun, ils sont conditionnés par la défense de leur statut, et par leur situation sociale subalterne dans chacun des champs. Cette soumission est notamment justifiée dans les deux champs par leur prétendue arriération et bigoterie.
Dès lors, tant que personne n’officialise leur confluence par la noblesse d’une recherche ou d’un discours politique écrit, les Judéo-arabes seraient voués à affronter les Palestiniens jusqu’à la mort de tous pour conserver le petit privilège qu’ils sont censés avoir à l’intersection de leurs champs d'existence.
Comment transmettre la langue de l'ennemi ?
La question de la transmission de la langue et de la culture, tout ce qui échappe à la religion stricte, désincarnée tout en étant absolue dans son sens intégraliste contemporain, a été un problème : comment assumer pour la génération née en Israël que la langue de la maison était la langue de l’ennemi ? Comment distinguer l’arabe parlé de l’Arabe ennemi ? Que produit, outre l’acculturation inéluctable, sur les comportements sociaux, une telle agrégation du complexe d’infériorité culturelle, de la faiblesse économique, et de la honte de parler la même langue que ceux qui veulent détruire Israël ? Cela mériterait tant et tant d’enquêtes, de comparaisons et théories pour articuler ces réalités.
Soulignons ici l’obstacle que représente l’asymétrie et le double discours sur la réalité sous-jacente de notre question, et sur l’intensité du besoin de l’étudier :
- D’une part, un champ interne aux judéo-israéliens où toutes ces choses sont absolument sues et dites, à tel point que cela émerge même parfois dans les productions culturelles ou le discours politique (infra), et aussi entre arabophones juifs, musulmans et chrétiens qui en témoignent aussi sans pouvoir l’interpréter ou le théoriser.
- D’autre part, il y a le fait que ce n’est jamais énoncé au dehors, et surtout que la société officielle israélienne se défende, et avec quelle virulence, de cette arabophonie. L’entretien de ce déni asymétrique est un indice très clair que ce mythe est fragile et ne tient qu’à un fil : les privilèges sociaux, civiques et politiques que confère la judéité en droit israélien.
Pour autant, même ignorée superbement par tout l’Occident et tout le discours destiné à l’Occident, y compris dans l’orbite propalestinienne, on a rappelé que cette question chassée par la grande porte ressurgit parfois à mi-mot dans les productions culturelles par la lucarne du grenier. C’est tout le paradoxe d’un État puissant, riche, culturellement jacobin et broyeur, mais libéral dans son rapport à l’individu et à l’expression : il suffit qu’une tout petite élite culturelle émerge de la société judéo-arabe pour qu’elle arrive à exprimer quelques éléments de leur exclusion, de leur marginalisation et de leur lutte sourde ; mais qui reste souvent indétectable pour qui n’est pas concerné.
En ce qui concerne le rapport au pays d’origine : nous ne savons également que très peu. On pourrait présumer que le sentiment d’exil, de ghurba, pourrait être d’autant moins fort que les gens auraient su qu’ils partaient pour toujours ; et qu’ils ont donc, avec une violence assumée et acceptée, décidé de ne rien en exprimer ni n’en transmettre. En effet, cela tranche avec la nostalgie puissante dont les gens témoignent qui pensent partir pour revenir avec un petit pécule, ou lorsqu'ils fuient une invasion militaire en espérant rentrer très vite. Mais il est simplement possible que la nostalgie de ghurba soit au contraire simplement proportionnelle à la capacité matérielle (en termes de transports par exemple), ou à l’espoir idéologique, ou politique, de rentrer. Pour mesurer ces deux hypothèses, encore faudrait-il pouvoir évaluer si cette souffrance objective de l’exil en un monde différent s’exprime chez les judéo-arabes de première génération : au sein des familles ? En dehors ? Est-elle ou non transmise aux enfants ? Consciemment ou non ? Nous n’en savons rien et ne pouvons donc savoir ce que la décision d’un exil sans retour peut provoquer sur la résilience au déracinement de groupes par rapport à la précarité d’un statut de réfugié avec la clef de son ancienne maison accrochée au mur, ou de l’immigré de travail qui rêve de retourner à son champ.
À cela s’articule toute la question de la langue : en effet, pour toute cette génération de judéo-arabes nés avant les années 1940 – ou 1950 pour les Maghrébins –, l’hébreu israélien est forcément resté une langue étrangère. Il faut donc supposer que les échanges en arabe, dans la communauté, avec d’autres judéo-arabes, et aussi avec des Arabes israéliens et des travailleurs palestiniens ont dû être naturels. Il faudrait envisager qu’ils aient pu être recherchés car ils durent soulager des esprits épuisés par l’altérité linguistique de leur quotidien hébraïsant. Et peut-être, on ne le dira jamais assez, ont-ils aussi cherché un peu de sociabilité et – qui sait – de solidarité culturelle et affective : il faut pouvoir l’appréhender. Dès lors, l’étude des échanges linguistiques entre judéo-arabes et Arabes palestiniens est essentielle. Or, un bon moyen de les mesurer, outre de collecter des témoignages de part et d’autre, serait de quantifier sur le plan linguistique la mutation de leurs dialectes, surtout maghrébin, au contact du palestinien, emprunts et déformations grammaticales, qui est la preuve objective de ces interactions.
Elles constituèrent et continuent de constituer une possible échappatoire à la pression culturelle et linguistique propre à un État-nation judéo-israélien étouffant. En effet, s’il y a bien un point commun aux différentes cultures juives européennes et arabes, c’est une potentialité de mobilité et d’internationalisme, et le jeu des échanges entre le dedans et le dehors ; et finalement le fait que l’émancipation contemporaine s’est traduite – ou aurait dû se traduire – par le droit d’entrer et sortir à volonté, individuellement, de la communauté minoritaire à la communauté universelle. Il faut donc poser que ces échanges contre-intuitifs mais naturels, entre judéo-arabes et Palestiniens, furent sans doute un bon moyen de relâcher la pression, de temporiser les frustrations, de canaliser les tensions. Et c'est encore une des nombreuses contributions des Arabo-palestiniens à la société israélienne : un souffle d’air frais dans un espace social cloisonné.
Malgré tout, il faudra toujours rappeler qu’une langue institutionnelle et culturelle dominante, et en l’occurrence l’hébreu, finit le plus souvent par dominer dans les conversations intercommunautaires, comme cela s’observe dans des situations similaires. À cela s’ajoute le fait que l’hébreu israélien est une langue simplifiée et nourrie d’emprunts et de calques arabes, et donc facile à apprendre pour les judéo-arabes comme pour les Arabo-palestiniens. En outre, la question du rapport à la langue classique est aussi un déterminant identitaire puissant : il faudrait savoir quel était l’accessibilité, pour les judéo-arabes des différents pays, avant l’époque coloniale, aux textes moyen-arabe comme ceux de Judah Halévi ou Maimonide. L’enseignait-on en plus de l’hébreu et de l’araméen dans les petites écoles des mellah ruraux et de quartier ? Dans quelle mesure l’arabe classique a-t-il – ou pas du tout – pénétré, en fonction des régions, par rapport à son introduction comme langue classique des christianismes orientaux à l’époque moderne ? Au contraire, a-t-il été supplanté par l’élitisme francophone de l’Alliance israélite, ou seulement concurrencé comme dans la communauté maronite ? Tout cela mériterait d’être étudié par des linguistes, des historiens, des sociologues.
Du Dār al-Islām à l’ordre occidental : une transition méconnue
Il faut des données et des études pour ne serait-ce qu’avoir une chronologie. Car, d’une part, on ne peut pas laisser cultiver la fausse représentation israélienne, et depuis occidentale, et finalement par contamination arabo-musulmane que la situation des années 1930-1960 serait représentative d’un « avant » figé où les juifs étaient opprimés par les musulmans depuis toujours ; d’autre part on ne peut pas continuer de nier ni la sujétion que recouvre le statut de dhimmi, ni ce que le complexe colonial a produit, ajouté au sionisme, pour transformer cette minorité « protégée » en victime de pogroms.
D’emblée, nous manquons d’études sur le monde des juifs dhimmī du Maroc alaouite, dans les beylicats nord-africains, dans l’Égypte post-mamelouke et le Yémen post-rasulide, le Levant et l’Irak ottoman, la Perse safavide à la veille de l’ère coloniale occidentale. Mais ce qui fait encore davantage défaut c’est la transition entre cette situation historique, relative aux études médiévales et modernes, et les études contemporaines, qui ne commencent souvent guère qu’en 1918, voire 1945. Or, c’est exactement pendant ce laps de temps peu couvert que les juifs algériens deviennent Français, pour l’essentiel au départ à leur corps défendant puisqu’ils doivent renoncer au droit talmudique, et que ceux du mellah de Fès se retrouvent les victimes secondaires d’une émeute anti-française en 1912.
Que se passe-t-il entre la fin du monde judéo-islamique, lui-même fruit de bien des évolutions, pressions, agressions, retours en arrière, entrelac complexe de cohabitation, de solidarité, de rivalité et d’inimitié… et celui qui voit un certain nombre de leurs élites s’associer aux puissances impériales et coloniales. On sait que lorsque René Caillé arrive de Tombouctou à Rabat à l’été 1828, sans un sou ni un aliment en poche, ni même une dent pour le croquer, il se croit soulagé en entrant dans le consulat de France, avant de découvrir qu’il s’agit d’un consul honoraire marocain juif, qui n’a que peu d’égards pour lui.
Entre le retournement de leur statut avec l’ordre colonial, et le maintien presqu’imperceptible de leur sujétion au Maroc, pendant qu’ils passent de seigneurs localisés en Bled Siba à celui du seul sultan Moulay Youssef puis Mohammed V, que perçoivent-ils de cette intégration nationale, ceux-là qui en Israël encore conserve une photo du « sultan des Français », devenu par magie une icône du nationalisme arabo-musulman au Maroc. Comment luttent-ils contre les discriminations qui les touchent comme indigènes, tout en cherchant à échapper à leur dhimmitude ?
Comment s’identifient-ils à la nouvelle civilisation dominante et abandonnent-ils déjà peu à peu les référents culturels et intellectuels, sociaux et éthiques de leurs parents ? Comment dans ce contexte-là entendent-ils parler du sionisme ? Comment s’articule la francité, et donc l’européanité des judéo-arabes algériens avec les courants d’idées, et les catastrophes politiques, qui traversent la judéité européenne ? Que produit 1948 sur leur conscience politique, autre que d’avoir subi un déferlement de judéophobie sans précédent ? Comment les indépendances se transforment-elles en péril de tout perdre, y compris la vie, puisque la dhimma n’existe plus pour les ruraux, mais que la francité n'est plus une protection non plus pour les élites urbaines ?
La mythologie israélienne possède déjà une suite de données convaincantes permettant de rétroprojeter un nationalisme juif, transculturel et transnational. Il prendrait racine dans une littérature médiévale et moderne qui est non seulement arrachée à son contexte historique, social et politique, celui où le Dār al-Islām est le centre du monde, mais aussi à son propre substrat humain, le peuple qui parlait cette même langue judéo-arabe. Elle éradique par exemple le souvenir d’un quartier que les Maghrébins avaient constitué après les Croisades autour de la synagogue juive séfarade et de la zaouia musulmane, au pied du mur occidental, au profit de l’idée d’un « quartier juif » sanctuarisé par le découpage britannique. Cette téléologie continue à l’époque contemporaine, agrégeant des mécanismes d’occidentalisation parfaitement comparables à d’autres élites de groupes d’ex-dhimmī comme les Druzes ou les Maronites. Cela incorpore des démarches individuelles ; de naturalisés français qui siégeaient donc en tant que citoyens européens dans les assemblées judéo-européennes ; ou encore de sujets indigènes de l’empire britannique, comme les Irakiens par exemple, qui n’avaient pas de frontière à franchir pour rejoindre la Palestine et y bénéficier du statut privilégié de Juif (européen) du Yishouv.
Pour tous ceux qui prétendent ne pas adhérer au récit israélien, cette ligne de points picorée dans le grand saladier de l’histoire, il ne reste plus qu’à commencer à récolter tout ce qu’il se pourra des autres données, et enfin retisser l’espace en trois dimensions au milieu duquel ce récit se tortille péniblement.
La carence du paradigme politique palestinien : l’autre nakba
Le paradigme nationaliste arabe qui structure la compréhension par les Palestiniens de leur occupation par les Israéliens, et que le petit monde des chercheurs sur la Palestine tend lui aussi à épouser, sinon à conforter, dissone complètement de leur perception quotidienne du réel.
Ils travaillent pour des Arabes israéliens qui ont des droits dont ils ne peuvent même pas rêver, et qui en profitent sur le plan social et économique à leur détriment ; et ils interagissent avec des juifs arabes qui sont eux aussi tout à la fois, pour eux, les pires et les meilleurs. Or, ces deux catégories n’existent pas dans le récit idéologique qui leur est inculqué, et que les chercheurs ne peuvent que reproduire, sans remède, s’ils se contentent de n’étudier que les Palestiniens tout en habitant au milieu de la Jérusalem judéo-arabe, en prenant l’avion à côté des banlieues arabes et judéo-arabes de Tel Aviv.
Pour le nationalisme arabe palestinien réécrit à la sauce de l’anti-impérialisme de gauche du temps de la guerre froide, les Juifs installés en Palestine ne sont que des « sionistes », et ces sionistes sont des envahisseurs européens : de vils impérialistes occidentaux. Leur seul droit donc, serait de repartir « chez eux » en Europe, à l’exception des juifs palestiniens d’antan. Malheureusement, cette catégorie elle-même est complètement théorique puisque, pour des raisons historiques particulières (l’expulsion des juifs par les croisés), outre quelques centaines de familles séfarades de langue ladina venus majoritairement à l’époque ottomane, les juifs palestiniens non sionistes ne regroupent que de rares communautés d’ashkénazes ultra-orthodoxes. Or, aucun des deux groupes ne s’est jamais identifié comme « Palestinien », à la différence des colons sionistes… Lorsque quelques Israéliens judéo-européens du « camp de la paix » tentent de faire prendre conscience aux Palestiniens que ce système idéologique nie l’existence bien réelle de juifs nés en Israël depuis 1948, et qui n'ont rien demandé, n’ont pas de pays de retour et sont souvent mélangés, ils ignorent eux aussi le problème principal.
En effet, le point aveugle de leurs deux systèmes de croyance est que la moitié des Israéliens viennent des pays arabes. Judéo-européens et arabo-palestiniens les connaissent parfaitement dans leur appréhension du réel, mais ils n’ont jamais été autorisés à les intégrer dans le système de pensée qu’écrivent leurs élites, à grand coup de postures confortables. Revenons au schéma palestinien : dans quel pays les judéo-arabes sont-ils sensés repartir ? Cette question a toujours été éludée, et pour cause, la question même de la possibilité, de la faisabilité d’un tel retour n’est pas même imaginée, discutée. Et pour cause, ce dont personne ne traite sérieusement au-delà encore une fois de la posture téléologique juif/arabe et de la rétroprojection de la haine contemporaine sur l’éternité d’un « avant » figé, ne serait-ce qu’en en parlant, c’est : Pourquoi les judéo-arabes sont-ils partis de chez eux dans une proportion qui frise généralement les 100% ? Pourquoi, donc, sont-ils obligés de tous être Juifs avant d’être Arabes, Marocains, Tunisiens, Yéménites, Égyptiens, Irakiens ? Pourquoi, enfin, sont-ils des Israéliens de seconde zone pour leur malheur, et pourquoi malgré tout n’ont-ils que cela et le défendront-ils jusqu’à leur dernier souffle ?
Répétons-le : il y a aussi eu une nakba des judéo-arabes : ils ont été contraints de quitter leur terre, mais ils ont été happés par un autre type de discours nationaliste, qui induit qu’ils ont été considérés non pas comme des « réfugiés », mais comme des « rapatriés ». Pourtant, la place de cet exode dans la psychologie sociale et politique de ce peuple est centrale pour comprendre la situation actuelle.
En Israël, le récit consensuel national consiste à dire que les « Arabes », c’est-à-dire les « musulmans » (et les « chrétiens »), les ont persécutés, et ce de toute éternité, la preuve en étant la haine que leur vouent les Arabo-musulmans aujourd’hui. Ils ont ensuite été « sauvés » - ce qui constitue le leitmotiv sioniste par excellence - par l’État d’Israël. Dès lors, ils ont été rapatriés dans « leur pays de toujours », leur « terre promise » pour adhérer à la communauté nationale juive. Mais entre ce récit et l’imaginaire propre de ces groupes, et les souvenirs réels des individus qui les composent, les mémoires indépendantes de leurs descendants, les affects et interactions contradictoires et croisées, et la réalité factuelle de leurs histoires, il y a un gouffre. Que ne dit-on pas face à un Juif en hébreu qu’on avouera plus facilement en dialecte arabe devant des bédouins au café, ou des collègues palestiniens au marché ou à l’atelier – quitte à déclencher l’hilarité et la complicité – que « les Juifs », c’est-à-dire les Européens, les ont roulés, les ont laissés sous des tentes dans le désert, les ont fait travailler comme des domestiques.
Nous n’avons pas l’embryon d’une histoire de ces évolutions en dehors de quelques thèses localisées, elles ne sont jamais connectées à celle de la majorité musulmane ou chrétienne, et encore moins reliées entre les pays arabo-musulmans. Mais surtout, à nouveau, ce sont les témoignages vivants de ceux qui vécurent ce grand retournement, cette autre nakba des judéo-arabes, et la déportation massive qui l’accompagna, qui vont irrémédiablement nous manquer. Le résultat de cette méconnaissance c’est que deux grands agrégats mythiques de légendes familiales plus ou moins officielles s’affrontent sans jamais communiquer l’une avec l’autre. Le caractère irréconciliable de ces deux mémoires produit deux fictions qui sous-tendent le récit commun :
- l’Arabe, surtout musulman, qui voudrait tuer les Juifs – selon ces derniers.
- le Juif, européen, qui voudrait tuer les Arabes – selon ceux-ci.
C’est normalement à collecter ces données, et ensuite à tisser des liens entre elles que la recherche devrait normalement servir, afin de poser les bases d’autres discours, d’autres récits, ceux qui permettent de s’extraire de la binarité, d’accepter la nature de facto orientale d’Israël, tout en évitant qu’ils s’enfoncent dans le populisme religieux illibéral, et les velléités génocidaires qui s’y associent.
En réciproque, comment en l’absence de ces données, de ces analyses, et des conclusions politiques qu’on devrait en tirer, les Palestiniens pourront-ils jamais intégrer le problème des Judéo-arabes dans leur grille d’analyse ; que cette majorité des Juifs israéliens ne sont pas des Occidentaux privilégiés, qu’ils n’ont aucun autre passeport que l’Israélien, et se battront donc jusqu’au bout pour défendre le seul pays qu’ils ont, au moins tant que les Arabes de leurs pays d’origine n’auront pas compris qu’ils étaient leurs compatriotes ?
Détricoter la judéophobie du nationalisme arabe
Les Juifs des pays arabes sont bel et bien partis parce que le nationalisme arabe a maintenu de front deux approches en fonction de leurs interlocuteurs ; et ces deux approches sont non seulement incompatibles mais produisent des effets contraires :
- Un discours externe et occidentalo-compatible, en langues internationales, qui désignait le Juif sioniste comme un mouvement impérial européen, et donc allogène et forcément dominant : un colonisateur dont la seule perspective morale serait de rentrer « chez lui ».
- un discours interne en arabe qui s’est complu à flatter la judéophobie traditionnelle des habitants des pays arabes en laissant accroire que les « Juifs » étaient collectivement responsables et complices, à tout le moins de ne jamais s’opposer au sionisme, en les assaillant régulièrement moralement et physiquement.
De la même manière que les sionistes laïcs irréligieux ont laissé faire l’imaginaire populaire et religieux pour trouver des candidats à la ʿaliya, les nationalistes arabes ont favorisé la cristallisation de la judéophobie. Il n’y a eu aucun complot de la part des nationalistes arabes que d’avoir provoqué un tel déferlement de persécution à l’égard de leurs compatriotes de religion juive, mais ils ont de facto aidé leurs ennemis judéo-européens à remplir leur pays, et à en légitimer la stature de patrie refuge. Il n’y a là que de la bêtise, de la facilité et l’incapacité à s’abstraire de sa propre judéophobie. Rappelons que les Yéménites, les derniers juifs arabes à avoir été transportés en Israël, dont la génération arabophone est encore relativement jeune, et dont les traditions arabes qui y remontent à l’antiquité sont si présentes, a face à lui au Yémen un groupe houthi ex-royaliste et pseudo-révolutionnaire, réactionnaire voire fascisant, qui brandit sur ses drapeaux : « maudits soient les Juifs » ; alors que Yéménites juifs et musulmans ont vécu côte à côte pendant 1400 ans.
Et cela est bel et bien la responsabilité des élites nationalistes arabes, conservatrices, progressistes ou révolutionnaires, car cette poussée de fièvre judéophobe, alimentée des scories de l’antisémitisme européen, n’est pas apparue toute seule. Les nationalistes laïcs issus de la nahda ottomane savaient très bien distinguer un juif compatriote et un sioniste européen, puisque cette distinction est le fondement du paradigme caduc qui réduit la réalité d’Israël à une simple extension coloniale européenne, celui-là même qui interdit aux propalestiniens de s’intéresser à la société israélienne.
Ensuite, les musulmans non encore acquis aux thèses nationalistes étaient habitués à cohabiter avec des juifs : il y avait un rapport asymétrique traditionnel, mais il ne leur serait jamais venu à l’idée par eux-mêmes que leurs voisins de village ou de quartier étaient responsable d’une entreprise coloniale à l’autre bout du monde. Enfin, les religieux traditionnels comme réformistes savaient que les dhimmī avaient des droits, certes inférieurs à ceux des musulmans, mais éternels et imprescriptibles.
L’explosion de judéophobie qui a conduit à les exclure des nations arabes et à en faire des Israéliens est, en théorie, le produit de plusieurs couches :
- La situation d’infériorité structurelle du dhimmī, qui fut le lot des juifs en Islam, et qui a habitué la population musulmane majoritaire à cultiver mépris et complexe de supériorité, même si les réalités sociales et économiques pouvaient, dans leurs champs respectifs, renverser cette hiérarchie théorique.
- La contamination successive des grandes expulsions européennes du XIIIe-XIVe siècle qui se traduit par exemple au Maghreb par le renfermement dans les quartiers réservés (Mellah), plus tard en répercutant la grande crise de judéophobie espagnole et de radicalité religieuse de 1492, notamment avec l’épisode de l’expulsion des Juifs du Touat.
- La structuration des castes coloniales algériennes, qui agrège à partir de 1870, tant bien que mal, les juifs aux Européens chrétiens en tant que citoyens français de plein droit, tandis que les musulmans sont indigènes par essence, sujets et sans droits.
- Le fait que les dhimmī collaborent avec les puissances consulaires, puis impériales, et enfin en tant qu’agents du colonialisme européen, ce qui permet leurs promotions individuelles, et l’émancipation du collectif, et constituent donc une attaque de la position hiérarchique précédente des musulmans, et le sentiment d’une trahison, d’une mise au service de l’ennemi.
- Le produit de ces deux dernières étapes : la francisation et les naturalisations des dhimmī.
Mais à y regarder de plus près, il n’y a rien qui distingue ici les juifs des chrétiens. Or, les premiers ne sont pas considérés arabes, alors que les seconds sont des Arabes. Tout n’est qu’affaire de récit : il y a donc une responsabilité particulière de ceux qui, pour fédérer leur projet politique nationaliste arabe, ont orienté la colère populaire contre un groupe de dhimmī en particulier, en leur prêtant la responsabilité de l’entreprise sioniste avec laquelle ils n’avaient rien à voir.
Il a donc fallu un travail idéologique pour que cette cohabitation millénaire se transforme en un déferlement de haine et de persécutions. Il a fallu que les nationalistes arabes prétendent que les sionistes étaient des Occidentaux et que cela n’avait rien à voir avec le judaïsme d’une part, et à leurs sujets dans le monde arabo-musulman que l’ennemi était aussi leurs voisins juifs. Et il est puéril et délétère de s’aveugler en niant la contamination de conceptions propres à l’antisémitisme européen à toutes les étapes de l’occidentalisation coloniale et post-coloniale du monde arabo-musulman. La « malédiction aux juifs » du drapeau et du slogan houthi au Nord-Yémen est bel est bien le résultat de cette triste modernité et occidentalisation.
La judéophobie proprement arabo-musulmane n’a guère de rapport avec celle qui prédominait en monde franc et latin avant son tournant révolutionnaire et séculier aux XVIIIe-XIXe siècle et qui découlait d’un antijudaïsme structurel. En Islam, elle n’a aucun fondement théologique, bien au contraire. Cette hostilité repose sur le refus instinctif qu’un musulman puisse se retrouver dans un État dominé par des dhimmī, et cela s’articule, on va le voir, avec l’inversion de la hiérarchie traditionnelle à l’époque coloniale. Et donc, à ce titre, cette répulsion n’aurait théoriquement jamais été différente de celle qui pourrait viser un État libanais dominé par les chrétiens. Or, dans leur cas, les nationalistes arabes ont œuvré à se montrer favorables aux Arabes chrétiens, pour flatter les yeux des Européens, au moment même où ils évinçaient toute possibilité à ce qu’il existe des Arabes juifs. À l’inverse, à leur sujet, ils se sont fait les réceptacles de l’antisémitisme européen.
Ce faisant, pour le malheur des Palestiniens, ils ont employé une méthode qui, avant-guerre et jusqu’à aujourd’hui, traduit souvent l’alliance plus ou moins objective des sionistes en Palestine et des antisémites en Europe… Car celle-ci satisfaisait les uns en remplissant leur pays de Juifs européens, tout en comblant les autres qui voulaient les voir disparaître. Mais en contexte arabo-musulman, à quoi servait cette judéophobie, enrichie d’antisémitisme, si ce n’est à alimenter le processus qu’on prétendait ou croyait vouloir combattre ? En d’autres termes, n’est-il pas un peu paradoxal de se prétendre antisioniste et de contribuer au peuplement juif de la Palestine ?
Après cette faute monumentale, comment instruire les Palestiniens de ce grand exode, de cette déportation des judéo-arabes, organisées par la collaboration de nationalistes arabes plus ou moins intéressés par la prédation de leur capital, et de nationalistes juifs plus ou moins intéressés par l’idée de remplir les bataillons en prévision de la guerre qui finit par être déclenchée « préventivement » en 1967 ? Comment remettre en récit tout ce passé qui, bien qu’orienté voire détourné, réécrit selon les impératifs du présent, n’en est pas moins réel ?
Pendant que les nationalistes arabes revendiquaient une lutte politique contre le sionisme, les juifs de tous les pays arabes ont subi une très nette et brutale montée en puissance de judéophobie, avec son lot de persécutions, de pogroms parfois. Du point de vue des antisémites européens, pousser les Juifs à fuir l’Europe s’est toujours bien marié avec un soutien objectif aux sionistes qui espéraient les faire venir au Moyen-Orient. En revanche, pour les nationalistes arabes, l’imprégnation même de cet antisémitisme est revenu à s’infliger cette immigration. Ainsi, l’importation de cette idéologie revient doublement à empêcher son émancipation. En nourrissant sa judéophobie avec cet antisémitisme, les nationalistes arabo-musulmans contemporains ont servi et continue de servir les antisémites européens en desservant la Palestine. Il faut donc oser affirmer que, ce faisant, ils ne font guère qu’intérioriser une pensée occidentale laquelle implique une haine de soi matérielle et objective.
Ce faisant, ces oppressions et lynchages, cette terreur sourde n’est connue que de deux mémoires complètement antagonistes, un déni d’un côté et une généralisation abusive de l’autre. En tout état de cause, elle a accéléré le départ de millions d’Arabes de confession juive à s’exiler sans espoir de retour. Et sur ce phénomène nous n’avons, répétons-le encore, que si peu de données objectives, et encore moins de confrontations avec des témoignages.
Or, c’est à ce moment que la souffrance et les oppressions, la peur subie, purent être aisément entretenues en rancœur en s’intégrant dans le récit israélien, du peuple juif mondialement et universellement persécuté, prenant enfin son destin en main, de la seule manière possible, en créant un État. Et quoi de mieux pour ce récit que de pouvoir confondre voire remplacer les pogroms russes et polonais et le génocide organisé par les nazis avec les persécutions arabo-nationalistes judéophobes ?
Nationalistes par obligation, les judéo-arabes sont entrés dans une condition socio-culturelle et économique qui les a installés dans la sujétion, voire l’oppression, de la part des « Juifs » au sens des ethno-nationalistes européens. Pourtant, au sein de la dimension juive-israélienne, leur dépendance à ce régime humiliant leur parait une concession nécessaire pour se voir garantir en échange qu’ils seront toujours supérieurs aux indigènes arabes, sur la scène israélo-palestinienne, comme dans la hiérarchie mondiale.
En parallèle, la transformation de cet exil, parfois orchestré comme une déportation, en une exfiltration, et bientôt comme un rapatriement, reposait sur le seul fondement de l’histoire et de la géographique biblique à laquelle le nationalisme juif avait laissé libre cours depuis le départ pour, on l’a dit, séduire l’immigrant judéo-européen religieux ou populaire. Ce faisant, le judéo-arabe devenait israélien à travers son attachement à la terre promise biblique, et, n’ayant plus de pays d’origine où revenir, puisqu’aucune normalisation, et encore moins aucun travail sur le passé judéophobe de leurs pays n’aurait jamais lieu à brève échéance. Prisonnier de cette nouvelle identité nationale exclusivement juive, ils n’en connaissaient d’autre définition que celle de la religion au sens précédemment exposé.
En effet, ils n’ont aucun passif nationaliste qui puisse ne serait-ce qu’être comparé, et encore moins fusionné, avec celui qui se développe en Europe orientale au XIXe siècle. Ce dernier distinguait, sur la fiction de l’ethnie et de la race, le germanophone protestant et catholique (= Allemand) du germanophone juif (= Juif). Or, en arrivant en Palestine – et surtout en Israël après 1948 en ce qui concerne les Maghrébins et les Yéménites, il y a un choc culturel avec ceux qui les avaient « rapatriés » par charité, ou bien « déportés » en collaboration avec les nationalistes arabes. Les juifs arabes seront néanmoins prêts à mourir pour le seul pays qu’ils ont, là où les Juifs européens, même polono-lituaniens, (sauf les Juifs soviétiques donc) peuvent récupérer leur passeport Schengen s’ils ne l’ont pas gardé.
Sans autre patrie qu’Israël, les électeurs judéo-arabes sont la clef pour l’avenir des peuples israélo-palestiniens, et, alors que nous ne savons rien d’eux, que nous ignorons leur passé d’une manière comme de l’autre – avec les « Arabes » comme avec les « Juifs » –, nous constatons qu’ils soutiennent massivement la droite, qui a désormais pour l’essentiel muté en droite religieuse. Dans le discours israélien, les judéo-arabes seraient religieux par définition. Il serait pourtant nécessaire d’envisager enfin à quel point leur positionnement arabophobe est avant tout un mécanisme de distinction, plus ou moins justifié par les persécutions subies dans le pays d’origine, mais qui vise à éviter d’être assimilé à l’allogène non-israélien, ou au citoyen de seconde zone arabe israélien, et de jouir des droits de citoyen israélien juif.
Ensuite, rares sont ceux qui abordent la question de l’origine de ce nationalisme populiste et religieux comme réaction de classe, similaire à bien des phénomènes politiques en Occident comme dans les Suds, où la classe ouvrière et moyenne instruite éduquée ou indigène se cherche des leaders charismatiques pour les libérer de la domination aussi bien symbolique que très matériellement sociale et économique que la classe lettrée leur inflige, ce en raison même de leur prétendue religiosité, marque ultime de leur arriération, alors qu’elle est celle de leur identification nationale – en l’espèce israélienne. Reformulons-le ici : Netanyahou, lui-même issu de l’élite judéo-européenne laïque, et secondairement Ben Gvir, celui-là au moins réellement à leur image, ont réussi à capter à la fois :
- Le nationalisme biblique, le seul qu’ils avaient pu concevoir au terme de leur déportation/rapatriement, et qui s’articule avec le fait qu’ils sont les seuls à n’avoir aucun autre pays potentiel que celui qui n’avait pas été conçu pour eux, mais où ils sont venus pour obéir et servir. Mais d’abord, personne ne semble problématiser le processus de l’intrication entre nationalisme biblique et l’histoire de leur exil sans espoir de retour, dans un pays qui n’était rien d’autre qu’une terre promise biblique. Ici aussi, c’était le produit naturel du double jeu de l’élite judéo-européenne parallèle au double jeu de l’élite nationaliste arabe : fonder un État laïc dont la géographie, et l’attractivité, étaient purement bibliques.
- Le conservatisme religieux, lui-même issu de la reformulation de la norme confessionnelle et cultuelle de départ par l’entremise de catégories judéo-européennes de « laïc » et « religieux » parfaitement orthogonales, car absentes du monde judéo-arabe en monde musulman traditionnel. Il faudra enfin commencer à s’intéresser à la construction de ce paradigme du judéo-arabe religieux, en ce qu’il résulte de la conciliation improbable de notions de judéité inconciliables voire antagonistes, entre juifs du monde arabo-musulman indigène et dominé, et Juifs du monde euro-chrétien sécularisé et racialiste.
Mais avant cela, que savons-nous de l’identification confessionnelle des juifs maghrébins ou ottomans, de leur rapport au sacré, de ce que le mot « religion », profondément latin et romain, et ensuite catholique romain et européen impérial implique comme déformation et redéfinition par rapport à l’ordre légal et confessionnel du Dār al-Islām, monde byzantin-ottoman compris ?
Quel était le sens même de la religion pour cette masse de gens qui furent ainsi transportés – ou déportés – dans l’intérêt convergeant des sionistes de Palestine puis d’Israël, des régimes comme des nationalistes arabes qui y avaient trouvé leur bouc-émissaire à même de fédérer l’opinion musulmane et chrétienne, et des groupes d’élites concurrents qui voulaient leurs parts du capitalisme local ?
À titre d’exemple, le témoignage de Charles de Foucault nous éclaire sur une forme de point de départ du rapport à la religion en situation traditionnelle. En effet, il s’était fait passer pour un Algérois juif afin de justifier un accent et des attitudes françaises, mais surtout, il ne s’est pas contenté de fréquenter quelques capitalistes occidentalisés des grandes villes comme ses contemporains. Non. Il a passé le plus clair de son temps dans les quartiers et villages réservés (mellāḥs) des Marocains juifs du monde rural, notamment du monde qui échappait à l’autorité du sultan (et où chaque communauté juive dépendait d’un protecteur particulier ayant tout pouvoir sur eux) :
"C’est aujourd’hui samedi […] on voudrait se mettre en route, on ne peut pas : on est en voyage, il faut s’arrêter. […] Et il ne faudrait pas qu’on vous surprît à écrire : votre secret serait trahi ; on saurait que vous n’êtes pas Israélite. A-t-on jamais vu au Maroc Juif écrire durant le sabbat ? C’est défendu au même titre que voyager, faire du feu, vendre, compter de l'argent, causer d’affaires, que sais-je encore ? Et tous ces préceptes sont observés, avec quel soin ! Pour les Israélites du Maroc, toute la religion est là : les préceptes de morale, ils les nient ; les dix commandements sont de vieilles histoires bonnes tout au plus pour les enfants ; mais quant aux trois prières quotidiennes, quant aux oraisons à dire avant et après les repas, quant à l’observation du sabbat et des fêtes, rien au monde, je crois, ne les y ferait manquer. Doués d’une foi très vive, ils remplissent scrupuleusement leurs devoirs envers Dieu et se dédommagent sur les créatures."
Autrement dit, l’important pour les judéo-arabes maghrébins était bien davantage l’orthopraxie et les repères identitaires et communautaires. Le rapport au shabbat rappelle par ailleurs celui de leurs compatriotes musulmans au Ramadan, ou des Maltais catholiques avec le carême. Personne, en maintenant ces normes comportementales, ne s’intéressait à l’intégrité et l’intégralité des normes et règles contenues dans les textes sacrés, ou ne prétendait que les histoires qui y étaient contées étaient vraies au sens de la réalité matérielle et historique. L’idée de reprendre la Torah, les Prophètes, le Talmud de manière tatillonne pour en faire des règles philosophiques et morales intangibles ne leur traversait pas l’esprit. Ce rapport littéraliste, radical est bien au contraire le propre de la modernité, laquelle commence en Occident avec la réforme protestante, et connait bientôt une adaptation juive dans les différents mouvements « orthodoxes » dans l’espace de la Pologne-Lituanie ; et il arrive dans le monde musulman avec la réforme salafiste, mais ne s’épanouit guère que durant la période post-coloniale.
Avant 1945, cette religiosité réformée, propre à l’Europe moderne, et qui a atteint la plupart des courants juifs ultra-orthodoxes ashkénazes, notamment ceux qui commencèrent à s’installer en Palestine ottomane, n’avait pas même encore effleuré les juifs arabes. C’est la confrontation avec la modernité qui, comme chez les musulmans, a transformé leur attachement ritualiste d’une part en une relecture moderne de la tradition héritée, et à une association avec le nationalisme d’autre part. Pour les judéo-arabes, il en va de même que pour les musulmano-arabes : ce fondamentalisme rationaliste et pointilleux ne s’empare de l’ensemble de la communauté, au-delà des petits cercles rabbiniques, que durant la période post-coloniale, celle de leur difficile acclimatation en Israël.
Et d’ailleurs, encore aujourd’hui, le radicalisme ultra-orthodoxe est bien plus un phénomène judéo-européen que judéo-arabe. Chez ces derniers prédomine davantage une sympathie pour la prééminence de la religion sur toute chose. Elle implique une certitude réaffirmée de la véracité absolue de tout ce qui est la parole divine, et donc une validation de ses principes les plus contradictoires avec le droit et la moralité du monde contemporain. Ce processus coïncide avec la salafisation qu’ont connue leurs ex-compatriotes musulmans, confrontés au choc des principes de la religion qui les définissait et de l’ordre mondial dans lequel ils évoluaient. Or, comme ces derniers, les vrais salafis qui cherchent à s’affranchir de cette dissonance en adoptant seulement l’ordre religieux sont peu nombreux. Contrairement aux ultra-orthodoxes judéo-européens, leur caractère « religieux » est davantage la capacité à s’accommoder dans leur vie de tous les jours d’un système de valeur contradictoire ; mais cela les amène également à être réceptif intellectuellement, et à abonder socio-politiquement, à toute proposition qui trouvera ses fondements dans les textes sacrés.
En somme, ils ignoraient tout de l’ethno-nationalisme racial inventé en Europe, entre Russie et Prusse, par des juifs assimilés et sécularisés. Le seul critère pour être juif était d’être de confession juive, et cela se traduisait par une orthopraxie que les Juifs européens assimilés, la majorité des sionistes, situèrent dans la catégorie « juif religieux ». En monde yiddish celle-ci s’est traduite très tôt, et continue de prospérer, par des groupes caractérisés comme leurs compatriotes protestants, par le sectarisme et le littéralisme le plus étroit.
Cela étant, il est certain que la judéité des indigènes de confession juive du monde colonial était caractérisée par la religion, l’idée d’une nation juive en dehors de pratiques comme le shabbat n’avait ainsi aucun sens. L’adaptation à la réalité israélienne les a forcés à faire face au choix préétabli entre juif religieux et juif laïc : ils ne pouvaient s’envisager comme laïcs sans se penser apostats, et sans renier leur judéité ; ils sont donc devenus des Juifs religieux. En outre, le fait de fonder des synagogues, écoles et universités de rite oriental constituait un des rares moyens de s’insérer dans le tissu institutionnel israélien, le seul moyen à tout le moins d’être officialisé et reconnu.
En somme, ils furent « rapatriés » (= exilés) de leurs pays pour remplir le pays d’un autre peuple et installés (= cantonnés) « au désert » selon les termes d’un des rares points de convergence mémoriel capable d’émerger. Ils furent alors condamnés sans rémission, au nom de leur « sous-évolution » (= culture arabo-musulmane), à des emplois subalternes et mal rémunérés, et assimilés par essence à une autorité « religieuse » (= non-européenne). Comment une telle mise en ghetto économique, social, culturel aurait-elle pu produire autre chose que de former un bloc électoral réactionnaire ?
L’insurrection politique et culturelle d’une classe aculturée et dominée
Il n’était pas si imprévisible que la population subalterne et dominée ainsi conviée en Israël allait finir par modifier de fond en comble le paradigme sioniste, dont la dissonance ne se maintenait que par le silence des dominés et des subalternes, et utiliser l’outil électoral pour forger un État ethno-confessionnel, destiné à devenir non-occidental, voire anti-occidental, réprouvé par les descendants de ses fondateurs, 30% des votants du pays, et les soutiens de la « diaspora juive ».
Ils étaient donc à bon droit méprisés et méprisables par les Juifs européens évolués qui vivaient dans un monde séculier et prospère, mais s’il y avait une chose qu’ils ne pouvaient pas arborer comme définition, c’était leur arabité.
Bien que parlée avec les judéo-arabes de leurs villes et quartiers, et avec leurs voisins et collègues arabes israéliens, puis après 1967 avec les Palestiniens, cette langue ne devait, ne pouvait pas se traduire comme une attache identitaire – alors même que le pays prétendait l’officialise comme seconde langue. La politique d’assimilation à la française, par l’armée et la langue hébraïque, qui servait déjà de creuset invasif pour les Juifs européens, se traduisait donc par un épistémicide, et par la négation de leur apport culturel et civilisationnel : un peuple entier se mua en lumpenprolétariat sans repères.
Le parti majoritaire de l’élite israélienne de gauche n’avait pour eux aucune affection, ils sont ainsi devenus l’électorat naturel de la droite jusqu’alors minoritaire. Il suffisait de dire qu’on ne méprisait pas la seule chose qu’ils pouvaient revendiquer de leur passé judéo-arabe, de leur pays d’origine, et qui faisait leur judéité et donc leur citoyenneté israélienne : la religion. Or, celle-ci faisait aussi leur citoyenneté de seconde zone.
Au milieu de ces tourments, le parti religieux du Shas fondé par l’Irakien Ovadia Yossef est devenu le canal d’expression le plus inattendu, et le plus unanime pourtant, des judéo-arabes qui décidaient de se situer comme religieux. Puisqu’il fallait rationaliser la torah, et que l’on ne pouvait guère que se promouvoir que par l’étude du talmud, un parti judéo-arabe fut fondé pour pousser dans ce sens sur le plan national et politique. Cette innovation constitua un coup de semonce pour l’élite laïque euro-israélienne. On rappelait récemment dans le documentaire « Israël, le combat des tribus », à quel point le centre-gauche des années 1990 assumait l’union nationale de tous… « sauf le Shas ». Ce dégout pour le radicalisme religieux du Shas rappelle celui des élites occidentalisées du Tiers-Monde pour les partis islamo-conservateurs et salafistes, et une même incapacité à prendre en compte les aspirations des classes moyennes arabes, juives ou musulmanes, d’Israël ou des autres pays arabes.
Cela accéléra encore le déplacement électoral des judéo-arabes vers le Likoud de Netanyahou, qui est finalement devenu leur parti, un peu en imitation de celui que Lieberman avait fondé pour les Judéo-soviétiques, ces derniers ayant, pour toutes les raisons susdites, beaucoup moins de difficultés à préserver leur culture russophone, ou leur situation sociale, dans la société euro-israélienne. Le discours politique du Likoud religieux revenait à énoncer que les Mezrahi étaient juifs, et que leur judéité, religieuse et biblique donc, leur conférait une valeur ontologique supérieure à leurs compatriotes musulmans de l’autre côté de la ligne verte… ou dans le ghetto arabe israélien voisin du leur. Il suffisait de dire que jamais on ne leur prendrait la seule chose qu’ils avaient : le seul pays qui leur restait depuis leur exil contraint.
Ce faisant, comme le montre bien le documentaire militant Hatsarfokaim, les Judéo-maghrébins cumulent à peu près tous les clichés qui, en France, caractérisent les maghrébins musulmans ! Et cela révèle à quel point ces catégories d’exclusion et de discrimination sont des conditionnements politiques, et pas du tout des données ontologiques. Si l’on se donnait la peine d’en faire l’étude comparée approfondie, on découvrirait les mêmes cloisonnements sociaux et économiques, la même annihilation du patrimoine culturel et linguistique, la même exclusion politique, le même enfermement dans la catégorie religieuse indigène…
Tout cela est d’autant plus frappant que ceux de leurs compatriotes qui eurent la possibilité de « choisir la France », c’est-à-dire tous les Algériens qui purent s’y établir de droit, et, la majeure partie de l’élite urbaine tunisienne et marocaine, mais pas seulement, ont pu en deux générations s’agréger à la société intellectuelle et capitaliste française. Or, au sein de mêmes familles de classe moyenne, voire rurale algérienne, ceux de France sont plus souvent médecins, universitaires ou chef d’entreprise, et ceux d’Israël sont plus souvent ouvriers, au chômage ou auto-exploités.
Cela a comme conséquence de produire une catégorie de Judéo-arabes « français », qui peuvent donc participer à la société israélienne en l’intégrant par le haut, avec de l’argent, du capital culturel, et un passeport de sauvetage Schengen. Cela n'a de cesse d'énerver souverainement le petit monde judéo-européen des banlieues cossues de Tel Aviv. Comment des judéo-arabes vulgaires peuvent-ils se prétendre français ? Ce ne sont que des parvenus, des « Fran-rocains = Tsarf-okaïm ». Cela reproduit au sein de la communauté judéo-maghrébine une hiérarchie entre les Français et les Israéliens, qui est elle aussi une reproduction des castes coloniales.
En fait, les Juifs naturalisés français se sont retrouvés dans la situation complexe d’être acceptés par la puissance impériale, puis la métropole, comme des concitoyens de plein droit, et ont dû eux aussi faire l’impasse sur leur patrie, leur culture et leur langue. Cependant, l’intégration ne passait pas par la religion, ce qui leur a permis d’échapper à ces structures, en tout cas pendant un temps. Néanmoins, ils ont continué à porter en eux l’héritage de cette lutte de distinction entre indigènes : entre le juif supposé pro-français, et le musulman supposé anti-français, entre le juif parfois favorisé, et le musulman plus souvent défavorisé. Cette lutte entre populations judéo-maghrébines et musulmane-maghrébines est une des raisons de la manipulation judéophobe des foules, elle s’est donc aussi déportée en France après la décolonisation. Intégrer la francité revenait à se distinguer de l’indigène musulman avec qui, un siècle plus tôt, on partageait infiniment plus qu’avec un Français catholique.
Cela en pousse bon nombre aujourd’hui à se radicaliser et à tomber dans les bras que l’extrême droite antisémite, sioniste par euro-purisme et par arabophobie, leur ouvre depuis toujours… Ils ne sont que l’expression ultime de cette radicalisation de celui qui tout à la fois, ne veut pas déchoir de la caste européenne en France, et ne pas perdre le seul pays où ils pourraient tout de même se protéger en tant que Tsarfokaï : Israël. Les judéo-arabes israéliens, quant à eux, continuent de porter le fardeau du complexe de l’indigène, ce qui peut les conduire parfois à ne pas être aussi hostile ou méfiant à l’égard de l’Européen chrétien ou du christianisme que le Judéo-européen israélien, ou au contraire en transférant leur soumission coloniale envers le Français sur le « Juif » israélo-européen.
Cherchant à se distinguer des musulmans, soumis à l’antisémitisme des colons comme des métropolitains, cumulé au mépris de l’indigène, les Tsarfokaïm ont transféré cela sur la catégorie coloniale israélienne, à l’encontre de la catégorie indigène des Palestiniens, mais ce sont surtout ceux de France qui l’exportent sur Israël, plutôt que l’inverse.
Cela implique qu’en réalité c’est bien plutôt à une exportation continue de conflits judéo-musulmans maghrébins coloniaux et post-coloniaux vers Israël dont il est question, et ce depuis l’émigration des Judéo-arabes des années 1940-1950. Les Tsarfokaim sont en effet la principale communauté à avoir subi l’exode depuis une patrie maghrébine perdue vers la Métropole, sans aucun espoir de retour . Et ils ne cessent désormais de transférer ce « bled » sur Israël, où ils forment des ghettos similaires aux quartiers zmagris du Maroc ou d’Algérie.
Ce faisant, selon les propres déclarations de l’intéressé, les participants voteraient à 90% pour Meyer Habib, le député français de la circonscription de l'étranger incorporant Israël. Ce dernier se prétend proche de Netanyahou, mais son discours et sa personnalité, et son origine socio-culturelle rappelle nettement plus celle de Ben Gvir. Ce faisant, cette communauté tsarfokaïe est à la pointe culturelle et institutionnelle du vote mezrahi nationaliste, religieux et identitaire, puisque les Mezrahi d’Israël, eux, n’ont pas de passeport occidental et continuent de porter en eux le complexe de l’indigène, soumis aux Judéo-européens israéliens, et aux Juifs maghrébins français qui constituent leur ancienne élite renouvelée et radicalisée dans son propre exil.
Sortir par le haut : le post-nationalisme
Les Judéo-arabes n’ont pas de passeports européens ; ils ont été arrachés à leurs pays et en nourrissent une peur primordiale et héritée des persécutions bien réelles qui y furent commises. Cet effroi a été cultivé, renforcé et rationalisé par la certitude que, étant devenus réellement des ennemis de leur anciens compatriotes musulmans, ils étaient définitivement déracinés. Ils n’ont pourtant pas inventé ce pays ni son nationalisme, ils s’y sont greffé comme ils ont pu, après y être venu contraints et forcés, pris en tenaille entre deux propagandes nationalistes.
Ils ont ensuite été « installés » dans les steppes et désert de Beersheva, Ashdod et Ascalon, tout autour des kibboutz verdoyants des « partisans de la paix » judeo-européens. Ils ont été réduits par ceux-là même qui les y ont cantonnés, à la seule identité de Juifs religieux, et parmi ceux-là, de Juifs religieux non-évolués. Dans leurs villes ghettos, depuis leurs positions scolaires et professionnelles subalternes, ils ont muri peu à peu leur vengeance, et la subversion du système étatique et social-libéral qui les avait produits comme tels. Et ils ont commencé à avancer leurs pions à partir des années 1990-2000.
Le Yéménite Yigal Amir, en tuant l’Ukrainien Yitzhak Rabin en 1995 incarne, de façon monstrueuse certes, le premier pas du retournement. Ensuite, en votant de manière de plus en consciente et structurée pour des partis « religieux » communautaires, puis pour des partis nationalistes conservateurs, et enfin pour la coalition du Likoud et du sionisme religieux, les Judéo-arabes se sont émancipés : ils décident désormais de l’avenir politique d’Israël, même si les vestiges de leur sujétion les conduisent à encore l’incarner dans un chef judéo-européen comme Netanyahou.
Et peu importe que cela nous semble la pire des manières de s’émanciper ; voire l’inverse du but recherché. À nous qui sommes finalement si proche de l’élite israélienne de gauche et des propalestiniens dans le champ mondialisé du capital intellectuel et économique, ce n’est pas à nous d’en juger. Tout ce que nous pouvons faire c’est d’expliquer : en commençant par le fait qu’ils sont pour l’essentiel innocents des causes profondes des formes que cette émancipation prend.
Transformés en « Juifs religieux » parce que l’ethno-nationalisme athée n’avait aucun sens pour eux, ils tiennent désormais en main le destin de tous les peuples de l’État unique qui domine la Palestine historique, autour des points suivants :
- Judéité religieuse
- Nationalisme biblique
- Absence de solution de secours
- Abrogation des institutions sionistes laïques oppressives
- Hostilité de principe à tout ce qui est Arabe, à commencer par eux-mêmes.
Ils sont donc les principaux décideurs du sionisme religieux désormais hégémonique. Et pourtant, gageons que lorsque les « Mezrahi » cesseront d’être convaincus que les « Arabes » vont les massacrer à la seconde où ils perdraient leur privilège civique en le partageant avec les Palestiniens, ou bien qu’ils rentreraient dans leur pays d’origine, alors cette fuite en avant pourrait enfin se modérer. Comment leur parler du droit au retour des Palestiniens s’ils n’en ont eux-mêmes pas le choix ? Comment parler de l’égalité des droits de tous sur une même terre s’ils sont déchus de leur citoyenneté au pays de leurs ancêtres ? Autrement dit, s’ils disposaient d’autres cartes en main qu’une judéité radicale et isolée en Israël, comme la simple opportunité de bâtir une maison « au pays », à l’instar de n’importe quel émigré chrétien ou musulman, alors cette étroite construction xénophobe pourrait enfin s'atténuer. Si d’autres possibles existaient, comme c’est le cas pour les judéo-européens qui peuvent décider de partir et revenir à volonté, alors cette respiration permettrait de calmer les angoisses, et de créer des espoirs. Si des portes s’ouvraient pour ceux qui se pensent assiégés, un avenir aura une chance de se dessiner dans le monde israélo-palestinien unique.
Seule la détente pourrait rendre concevable une cohabitation avec leurs cousins musulmans et chrétiens palestiniens au sein de l’État unique du fleuve jusqu’à la mer. Mais le plus nécessaire préalable, et le plus important accompagnement d’une telle perspective de pacification, devra passer par la réconciliation des récits judéo-arabes et arabo-palestiniens, et cela commence par l’étude de leurs réalités, de leurs passés, de leurs mémoires et de leurs imaginaires :
- Contrer le récit d’un ancrage européen (prétendument « judéo-chrétien ») des juifs, lorsque ceux-ci en ont été à peu près expulsés de partout sauf quelques États allemands et la Pologne-Lituanie, et que l’antijudaïsme est un pilier du christianisme clérical, mais pas du tout de l’islam, qu’il est étroitement lié à l’antisémitisme et toujours associé à l’islamophobie (déjà l’affaire du prétendu complot des Juifs de 1321-1323 avec le « roi de Grenade »). En même temps, il ne faudra jamais éluder l’histoire de la sujétion des dhimmī, et de l’impact de plusieurs vagues de renforcement d’oppression structurelle de la population majoritaire sur la population minoritaire, et le fait, enfin, que l’ordre colonial, post-colonial et même sioniste en a factuellement émancipé une partie non-négligeable.
- Contrer le récit d’une prétendue persécution millénaire figée dans un « avant » ahistorique, par l’étude de la complexité chronologique, et géographique, politique et sociale de l’histoire des judéo-arabes du dār al-islām, et sans éluder le tournant répressif, ses fondements socio-culturels et idéologiques, et son évolution contrariée en contexte colonial, et les oppressions et pogroms bien réels qui se sont abattus sur eux.
- Contrer le récit israélien officiel d’un « rapatriement » dans une terre juive, mais sans passer sous silence l’exode subi, et la réalité de cette installation.
- Contrer le récit sioniste religieux du territoire biblique légitime, mais sans nier le droit des gens à vivre là où ils se sont retrouvés au terme de pérégrinations essentiellement subies.
- Contrer le discours post-colonial des Tsarfokaim qui exportent leur distinction et opposition coloniale à l’égard des musulmans maghrébins sur la situation israélienne, en confondant les deux schémas arabophobes involontairement hérités, mais sans méconnaître le fait qu’ils n’ont pas non plus beaucoup de recours que de doubler leur sécurisation, en France et en Israël.
- Contrer le discours méprisant à l’égard des Judéo-arabes, car il est parfaitement symétrique et compatible avec le racisme qui s’attaque aux Arabo-musulmans et permet la poursuite de la sujétion des Palestiniens. Et cela devra se faire sans omettre que les judéo-arabes, surtout dans un contexte ethno-nationaliste religieux, auront forcément une culture bien moins libérale que les premiers fondateurs, et que cette dérive ne doit jamais être acceptable, et toujours combattue, comme ailleurs. Et surtout qu’elle est contraire à l’évolution du monde arabo-musulman voisin, y compris palestinien.
Finalement, il faut absolument désincarcérer la judéophobie qui accompagne l’histoire récente de cette autre nakba : donner des garanties aux Judéo-arabes qui n’ont rien d’autre qu’Israël, et qui sont justement en train de prendre le contrôle électoralement d’un pays où ils jouissent au moins d’un statut supérieur aux Arabes.
En attendant d’avoir des solutions politiques, encore faudra-t-il de toute façon s’ouvrir aux milliers de thèses potentielles qui restent à écrire en étudiant les aspects dont nous avons esquissé une infime portion. Et pour cela, il sera nécessaire d’extraire au forceps cet orientalisme relique qui conduit à ne s’intéresser aux « bons Palestiniens » en ignorant la complexité propre au monde israélien au milieu duquel ils sont. Car se focaliser de la sorte sur la société palestinienne, c’est en fait épouser le récit israélien : « circulez, il n’y a rien à voir, nous sommes des Occidentaux, rien à étudier pour un orientaliste ». Il est devenu suffisamment clair pour tous que ça n’est pas vrai.

