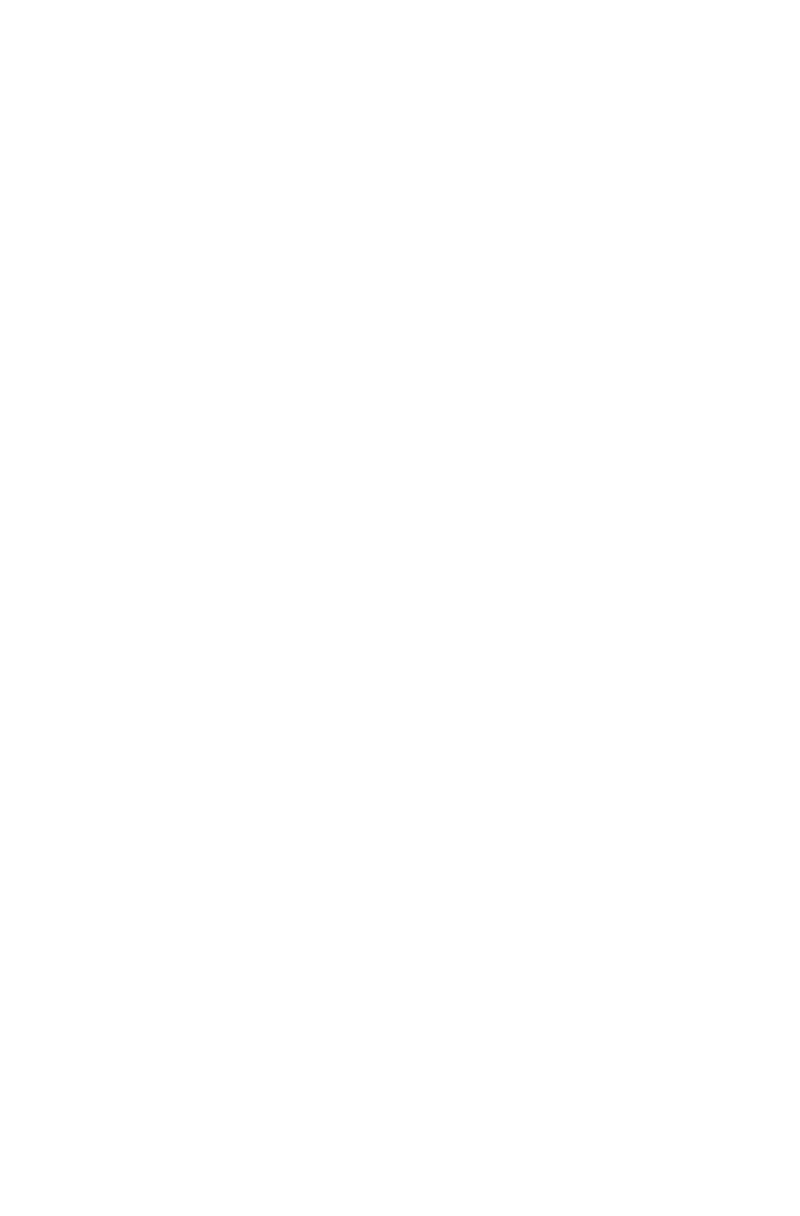Histoire du concept d'islamophobie
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed
Selon certains intellectuels médiatiques parisiens, « islamophobie » est un terme à bannir du vocabulaire français. Un des principaux arguments mobilisés pour justifier cette suppression réside dans l’affirmation selon laquelle le terme aurait été forgé par les « intégristes iraniens » dans les années 1970 soit pour disqualifier les femmes refusant de porter le tchador, soit pour empêcher toute forme de critique de la religion musulmane. C’est ce que soutenaient par exemple, en 2003, les journalistes Caroline Fourest et Fiammetta Venner : « Le mot “islamophobie” a une histoire, qu’il vaut mieux connaître avant de l’utiliser à la légère. Il a été utilisé en 1979, par les mollahs iraniens qui souhaitaient faire passer les femmes qui refusaient de porter le voile pour de “mauvaises musulmanes” en les accusant d’être “islamophobes”. […] En réalité, loin de désigner un quelconque racisme, le mot islamophobie est clairement pensé pour disqualifier ceux qui résistent aux intégristes : à commencer par les féministes et les musulmans libéraux [1]. » La légende s’étant répandue, le « philosophe » Pascal Bruckner la reprit à son compte quelques années plus tard : « Forgé par les intégristes iraniens à la fin des années 1970 pour contrer les féministes américaines, le terme d’“islamophobie”, calqué sur celui de xénophobie, a pour but de faire de l’islam un objet intouchable sous peine d’être accusé de racisme [2]. »
Ces intellectuels médiatiques n’ont aucune preuve à l’appui de leur assertion. Il n’existe pas de réel équivalent à « islamophobie » en persan et en arabe, ce genre de néologisme étant très rare dans les deux langues. Islam harâssi semble être le terme persan pour signifier « hostilité contre l’islam », tandis que eslam setizi signifie « antagonisme à l’islam ». Cependant, il n’existe pas d’adjectif comme « islamophobe » : eslam setiz semble possible, mais n’est pas très utilisé [3]. Deux termes sont utilisés en arabe et forment rarement un mot composé équivalent d’« islamophobie ». On a donc le « classique » ’adâ’al-islâm (« hostilité à l’islam ») et le terme un peu plus savant ruhâb al-islâm (« phobie de l’islam »), mais il semble que ce dernier mot ne soit apparu que dans les années 1990[4]. Mais cette difficulté à trouver des origines persanes ou arabes au terme « islamophobie » réside surtout dans le fait que, loin d’être une invention « orientale », il s’agit en fait d’une invention… française !
Une critique orientaliste de l’orientalisme
Comme le souligne Fernando Bravo Lopez, qui a mené la première étude sur le sujet[5], on doit l’invention du néologisme « islamophobie » et ses premiers usages à un groupe d’« administrateurs-ethnologues [6] » spécialisés dans les études de l’islam ouest-africain ou sénégalais : Alain Quellien, Maurice Delafosse[7] et Paul Marty (a). Au début du xxe siècle, la connaissance de l’islam apparaît comme une nécessité pour les administrateurs coloniaux qui souhaitent préserver la domination impériale sur les populations musulmanes colonisées. La production d’un savoir à prétention scientifique est donc intrinsèquement liée au projet de domination coloniale. Cette volonté de savoir se traduit par la multiplication d’études ethnologiques, souvent denses et érudites, sur l’« islam noir » d’Afrique subsaharienne. En France, le lien entre savoir ethnologue et politique coloniale est illustré par deux éléments : la publication de la prestigieuse revue de la mission scientifique du Maroc, la Revue du monde musulman, et la circulation de ses administrateurs-ethnologues entre l’espace administratif colonial et l’espace académique, notamment au travers de leur passage, comme élèves ou enseignants, dans des lieux de formations tels que l’École coloniale et l’École spéciale des langues orientales (b). Pour ces administrateurs, l’enjeu principal consiste à définir la « bonne » politique coloniale en vue de gagner la confiance des colonisés et une certaine légitimité auprès d’eux. Dans cette perspective, l’islamophobie se décline sous deux acceptions : une islamophobie de gouvernement et une islamophobie savante.
Dans un article de 1910 sur l’état de l’islam en Afrique occidentale française, Delafosse dénonce la composante de l’administration coloniale affichant ouvertement son hostilité à l’encontre de la religion musulmane. « Quoi qu’en disent ceux pour qui l’islamophobie est un principe d’administration indigène, précise-t-il, la France n’a rien de plus à craindre des musulmans en Afrique occidentale que des non-musulmans. […] L’islamophobie n’a donc pas de raison d’être dans l’Afrique occidentale, où l’islamophilie, dans le sens d’une préférence accordée aux musulmans, créerait d’autre part un sentiment de méfiance parmi les populations non musulmanes, qui se trouvent être les plus nombreuses. L’intérêt de la domination européenne, comme aussi l’intérêt bien entendu des indigènes, nous fait donc un devoir de désirer le maintien du statu quo et de garder une neutralité absolue vis-à-vis de tous les cultes [8]. »
L’islamophobie est ainsi définie comme un mode de gouvernement, un traitement différentiel fondé sur un critère religieux, dont la valeur est déconnectée de toutes considérations morales et déterminée au contraire par une politique de domination pragmatique. L’islamophobie s’oppose à l’« islamophilie »,
« préférence accordée aux musulmans », qui n’est pas forcément le mode de gouvernement le plus approprié en Afrique de l’Ouest parce qu’il déboucherait sur l’inimitié de la majorité des colonisés non musulmans. L’islamophobie de gouvernement est par ailleurs associée à ce que Marty appelle l’« islamophobie ambiante [9] », qui ne se restreint pas aux seuls cercles de l’administration coloniale.
Or, pour ces administrateurs-ethnologues, l’islamophobie ambiante s’appuie sur une islamophobie savante. Dans une recension du livre L’Âme d’un peuple africain : les Bambara, de l’abbé Henry (1910), Delafosse dénonce l’« islamophobie féroce [10] » de sa description des coutumes Bambara, mais c’est Quellien qui élabore la critique la plus systématique de l’islamophobie savante. Dans sa thèse de droit sur la « politique musulmane dans l’Afrique occidentale française », soutenue et publiée en 1910, il définit l’islamophobie comme un « préjugé contre l’Islam » : « L’islamophobie – Il y a toujours eu, et il y a encore, un préjugé contre l’Islam répandu chez les peuples de civilisation occidentale et chrétienne. Pour d’aucuns, le musulman est l’ennemi naturel et irréconciliable du chrétien et de l’Européen, l’islamisme est la négation de la civilisation, et la barbarie, la mauvaise foi et la cruauté sont tout ce qu’on peut attendre de mieux des mahométans [11]. »
Or, pour Quellien, « il semble que cette prévention contre l’Islam soit un peu exagérée, le musulman n’est pas l’ennemi né de l’Européen, mais il peut le devenir par suite de circonstances locales et notamment lorsqu’il résiste à la conquête à main armée [12] ». Pour démontrer que le musulman n’est pas l’ennemi de l’Européen, il s’appuie sur les témoignages des « explorateurs » Adolf Overweg et Heinrich Barth, membres d’une expédition scientifique britannique en Afrique (1849) [13], et de Louis-Gustave Binger, officier et administrateur colonial français en Côte d’Ivoire [14], qui ont été « fort bien reçus dans les villes et chez les tribus mahométanes » et n’ont « jamais [été] inquiétés à cause de leur religion » [15]. Quellien considère que l’islam a une « valeur morale incontestable » et qu’il « a partout élevé le sens moral et l’intelligence des peuples qu’il a arrachés au fétichisme et à ses pratiques dégradantes ». Il s’inscrit donc en faux contre l’opinion de l’explorateur-géologue allemand Oskar Lenz qui considère « que l’Islam est l’ennemi de tout progrès et qu’il n’existe que par la force de sa propre inertie qui le laisse inattaquable [16] » ou que « l’Islam veut dire stationnement et barbarie, tandis que le Christianisme représente la civilisation et le progrès [17] ».
Quellien entreprend ensuite de contredire les principaux « reproches » adressés à l’islam (la « guerre sainte », l’esclavage, la polygamie, le fatalisme et le fanatisme) en mobilisant des arguments anti-essentialistes et historiques. Il va même jusqu’à affirmer que l’islam « ne semble pas […] en opposition avec l’idée de la conquête des contrées musulmanes par les puissances européennes [18] » dans la mesure où, selon certains jurisconsultes musulmans, « quand un peuple musulman a résisté à l’invasion des chrétiens, autant et aussi longtemps que ses moyens de résistance le lui ont permis, il peut discontinuer la lutte et accepter la domination des conquérants si ceux-ci garantissent aux musulmans le libre exercice de leur religion et le respect de leurs femmes et de leurs filles [19] ».
C’est dans une perspective analogue de critique de l’orientalisme qu’écrivent Étienne Dinet (1861-1929) et Sliman Ben Ibrahim (1870-1953). Dinet est un artiste peintre issu d’une famille catholique bourgeoise circulant entre la France et l’Algérie, et Ben Ibrahim un musulman d’Algérie religieux et érudit. Ils se sont rencontrés à l’occasion d’une rixe entre Dinet et des juifs d’Algérie (Dinet a été « sauvé » par Ben Ibrahim [20]). Dinet se convertit à l’islam en 1913 et devient un « artiste militant ». Parallèlement à son activité de peintre (il est un des représentants de la peinture orientaliste algérienne [21]), il milite pendant la Première Guerre mondiale pour le rapatriement et l’enterrement des tirailleurs musulmans algériens en Algérie ainsi que pour la construction de la Grande Mosquée de Paris (inaugurée en 1926). Il se situe dans la même ligne que les administrateurs-ethnologues sans pour autant faire partie de l’administration coloniale. Il souhaite vivement l’« union franco-musulmane » et l’égalité entre colons et colonisés (dans le cadre de l’empire), afin d’éviter le séparatisme anticolonialiste et le triomphe du communisme en territoire colonisé. Ce n’est qu’après l’échec des propositions du gouverneur général d’Algérie, Maurice Viollette, visant à accorder une représentation nationale et les droits politiques à une minorité de musulmans algériens, que Dinet désespère de la politique et se réfugie dans l’idée d’un pèlerinage à La Mecque.
Pour Dinet et Ben Ibrahim, l’islamophobie renvoie d’abord aux « orientalistes modernes22 » ayant introduit des « innovations » dans la biographie du Prophète Mohammed. Ainsi,
« l’étude des innovations […] introduites dans l’histoire du Prophète nous a permis de constater que, parfois, elles étaient inspirées par une Islamophobie difficilement conciliable avec la science, et peu digne de notre époque ». Ils dénoncent la « singulière ignorance des mœurs arabes » de ces études et tentent une histoire du Prophète en s’inspirant des écrits d’auteurs musulmans classiques (Ibn Hicham, Ibn Saâd, etc.) et d’un historien moderne, Ali Borhan’ed Dine El Halabi. Dinet et Ben Ibrahim émettent une critique interne à l’orientalisme : l’islamophobie est un préjugé incompatible avec la démarche scientifique.
Par ailleurs, Dinet utilise le terme d’islamophobie comme synonyme d’arabophobie pour désigner et dénoncer certains acteurs politiques et colons d’Algérie. C’est ce qu’il écrit à sa
sœur à deux reprises, en janvier 1929 : « Si ce projet [Viollette] est repoussé, ce sera le triomphe des Arabophobes et du Militarisme devant le monde entier au moment du Centenaire [de la conquête de l’Algérie en 1830], et un fossé creusé pour jamais entre Français et musulmans malgré les protestations d’amour qu’on aura dictées aux Caïds en les couvrant de Légions d’honneur des pieds jusqu’au turban. Si le projet est adopté ce seront des cris de fureur fanatique de la part de tous les politiciens vivant d’arabophobie et cherchant à soulever les Colons… contre leurs vrais intérêts [23]. » Il poursuit son raisonnement en mars de la même année : « Je me demande ce que Viollette pense du discours de Tardieu [contre le projet] à la Commission des réformes en faveur des indigènes pour le Centenaire ? Ici, les Islamophobes sont dans l’enthousiasme car c’est l’enterrement définitif. […] Il ne se doute pas de la réclame qu’il vient de faire au Bolchévisme [24] ! »
À l’issue de leur pèlerinage, Dinet et Ben Ibrahim publient un récit de voyage où ils développent en conclusion les trois éléments qui les ont particulièrement frappés – « la vitalité de la foi musulmane, la puissance formidable de la foi musulmane et la persistance d’une hostilité plus ou moins déguisée de l’Europe contre l’Islam [25] ». Ce dernier élément est la définition qu’ils proposent de l’islamophobie, sachant qu’ils la précisent sous trois dimensions.
Tout d’abord, ils l’inscrivent dans une histoire longue remontant aux Croisades. Selon eux, « malheureusement, l’Europe a des traditions politiques qui datent des Croisades ; elle ne les a pas abandonnées et, si elle est tentée de les oublier, les Islamophobes tels que [William E.] Gladstone [ancien Premier ministre britannique], [Lord] Cromer [consul britannique en Égypte], [Arthur J.] Balfour [ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères britannique], l’archevêque de Canterbury et les missionnaires de toutes confessions, etc., se dressent immédiatement pour l’y ramener [26] ».
Ensuite, l’islamophobie est entendue comme une idéologie de conquête qui devrait logiquement s’effacer à mesure que les résistances armées aux conquêtes coloniales sont brisées : « L’Islamophobie ne pouvant plus rien rapporter devrait donc s’éteindre et disparaître. Si elle persistait, elle prouverait définitivement à toute l’Asie et à toute l’Afrique que l’Europe veut les asservir à un joug de plus en plus tyrannique. […] Si, au contraire, l’Europe s’entendait cordialement avec l’Islam, la paix du monde serait assurée [27]. » L’alliance entre l’Europe et l’islam, définie de manière essentialiste, serait ainsi une « barrière infranchissable » pour la « menace du péril jaune » et du péril communiste.
Enfin, Dinet et Ben Ibrahim proposent une typologie de l’islamophobie, en distinguant l’« islamophobie pseudo-scientifique [28] » et l’« islamophobie cléricale [29] ». Pour illustrer ces deux types d’islamophobie, ils ne donnent qu’un seul exemple : le livre L’Islam de Samuel W. Zwemer, professeur d’histoire des religions à l’université de Princeton, dont la traduction des versets du Coran conduit le lecteur à croire que l’islam est une religion polythéiste… et qui contient un véritable appel à la guerre contre l’islam [30]. Selon eux, « lorsqu’un savant étudie un sujet, il se passionne pour lui et il lui découvre toutes les beautés imaginables [31] » mais « il n’est qu’une seule exception à cette règle, et c’est encore l’Islam qui en est victime. En effet, il existe aujourd’hui un groupe d’Orientalistes qui n’étudient la langue arabe et la religion musulmane que dans le but de les salir et de les dénigrer [32] ». Ces « savants oublieux des principes de la science impartiale » ont « comblé de joie les missionnaires, qui, de leur côté, ont redoublé d’ardeur prosélyte » [33]. Ils poursuivent ainsi leur critique des orientalistes entamée dans L’Orient vu par l’Occident [34], où ils prennent pour cibles les ouvrages du jésuite belge arabisant Henri Lammens et Mohammed et la fin du monde de Paul Casanova, professeur au Collège de France.
Si le terme d’islamophobie est inventé par des Français, il est traduit tardivement en anglais. Quand La Vie de Mohammed de Dinet et Ibrahim paraît en anglais en 1918, le terme d’islamophobie est traduit par l’expression « feelings inimical to Islam [35] » et ne migre pas à ce moment du français vers l’anglais. Il apparaît pour la première fois en anglais en 1924 dans une recension de L’Orient vu par l’Occident, mais l’auteur ne fait que citer Dinet et Ben Ibrahim et ne se réapproprie pas le terme [36]. Il réapparaît en anglais seulement en 1976 sous la plume d’un islamologue dominicain d’Égypte, Georges C. Anawati, qui lui donne une tout autre signification que celle de Dinet et Ben Ibrahim. Selon lui, la tâche de l’orientaliste non musulman est d’autant plus difficile qu’il serait « obligé, sous peine d’être accusé d’islamophobie, d’admirer le Coran en totalité et de se garder de sous-entendre la moindre critique sur la valeur du texte37 ». Le « chantage à l’islamophobie » serait donc un obstacle à l’avancée des connaissances orientalistes.
Une critique postcoloniale de l’orientalisme
Après la Seconde Guerre mondiale, les usages sont dispersés. Le terme « islamophobe » est utilisé en 1951 par l’hispaniste Charles-Vincent Aubrun dans la recension d’un livre sur une chanson navarraise du xVe siècle hostile à l’Espagne musulmane [38]. Il évoque les « sentiments gallophobes et islamophobes » d’une chanson située dans la tradition occidentale-chrétienne de la Chanson de Roland. Le terme semble être souvent utilisé dans le milieu hispaniste médiéviste pour décrire la poésie hostile aux « Maures » [39]. En 1985, l’ethnologue Anne-Marie Duperray évoque l’« islamophobie latente ou déclarée des administrateurs [40] » coloniaux dans sa monographie du peuple Yarse au Burkina-Faso. En 1978, l’historien et islamologue tunisien Hichem Djaït parle d’islamophobie et d’arabophobie pour décrire l’« orientalisme islamophobe » dans L’Europe et l’Islam [41]. Mais son étude de l’orientalisme est sans commune mesure avec la profondeur d’analyse d’Edward W. Said qui, en 1985, compare l’islamophobie à l’antisémitisme (voir chapitre 11) [42]. Selon l’Oxford English Dictionary, la première occurrence apparaît en 1991 dans le journal états-unien Insight. On a vu qu’il n’en est rien mais, en tirant le fil des sources et des citations de l’auteur de cet article, on débouche sur l’interview d’un islamologue russe, Stanislav Prozorov, membre de l’Institut d’études orientales de Saint-Pétersbourg. Il s’agit d’un entretien publié dans le journal de la jeunesse de Leningrad Smena (décembre 1989), reproduit dans Komsomolets Uzbekistana (17 janvier 1990), et réalisé à la suite d’une conférence à Leningrad intitulée « Islam : traditions et innovations ». Prozorov définit l’islamophobie comme une idéologie ayant légitimé la conquête soviétique de l’Asie centrale (campagne du général Budennyi), la répression stalinienne des musulmans et la destruction des mosquées et livres religieux. Si l’islam représente un « danger immédiat » dans l’Asie centrale d’après la chute du Mur du Berlin, ce n’est pas à cause des musulmans mais de la politique soviétique. Selon Prozorov, la guerre d’Afghanistan n’aurait jamais été menée si les leaders soviétiques avaient eu une certaine connaissance de la réalité de la vie des musulmans de ce pays : « Non seulement nous ne connaissons pas les faits élémentaires sur les peuples musul- mans, mais en général toutes les informations relatives à l’histoire, aux traditions et à la culture de l’Islam sont distordues depuis des dizaines d’années par notre dogme idéologique. […] Nulle part l’islamophobie n’est aussi prégnante que parmi les leaders politiques du pays [43]. »
Le temps des mobilisations : de Londres aux Nations unies
Jusqu’ici, les usages du concept d’islamophobie restent cantonnés à la sphère intellectuelle et à la critique de l’orientalisme. À partir des années 1980, apparaît un usage politique de la catégorie d’islamophobie qui ne concerne pas l’hostilité ou le préjugé contre l’islam et les musulmans colonisés, mais désigne des immigrés musulmans vivant sur le territoire européen. Selon le sociologue britannique Chris Allen, la dénonciation d’un racisme spécifiquement antimusulman devient une préoccupation majeure des communautés musulmanes britanniques au début des années 1980, notamment parmi les militants du borough de Brent à Londres [44]. L’apparition de ce « nouveau » racisme s’expliquerait par la conjonction de deux phénomènes : la construction d’une « identité musulmane » (« British Muslims ») parmi les communautés immigrées et le passage d’un racisme « biologique » à un racisme « culturel ».
Ainsi, la première génération de migrants en Grande-Bretagne, venus des Caraïbes, du Pakistan, d’Inde et des autres pays du Commonwealth, s’était d’abord elle-même définie en termes de pays d’appartenance avec une composante religieuse : les communautés musulmanes faisaient partie du collectif Black et des Asians. Mais les musulmans nés en Grande-Bretagne vont s’identifier d’une façon différente de celle de leurs parents. Pour eux, le rôle et la prééminence de leur religion, l’islam, sont devenus de plus en plus importants [45], ce qui favorise l’émergence d’une « conscience musulmane [46] ». On assiste donc à une transformation des modalités d’auto-identification collective, la catégorie « Asian » étant concurrencée puis remplacée par la catégorie « Muslim ».
Par ailleurs, le discours politique sur l’immigration connaît une transformation importante, passant du discours sur la couleur (colour) dans les années 1950-60 à celui de la race et de la blackness dans les années 1970-80 [47]. Selon Robert Miles et Annie Phizacklea, le mouvement antiraciste était une réponse au racisme sous-jacent des lois de contrôle de l’immigration [48]. Selon Tariq Modood, c’est la mise en œuvre du Race Relations Act de 1976 qui a provoqué un consensus autour du terme black et, du coup, son caractère hégémonique excluait les Asians. De nouvelles formes d’auto-identification sont apparues pour briser l’hégémonie de la political blackness, à tel point qu’en 1989 l’identité musulmane serait devenue primordiale.
En effet, les tensions ont peut-être été exacerbées par le Race Relations Act de 1976 dans la mesure où, s’il assure une protection aux groupes raciaux, ni la religion ni la croyance ne sont incluses comme marqueurs légitimes. Ainsi, la législation n’apporte pas de protection juridique aux groupes multiethniques comme les musulmans. Si les musulmans, notamment les Pakistanais et Bangladeshis, sont protégés au regard de leur origine nationale ou de leur appartenance ethnique – tout comme les Blacks, Asians, Sikhs, Juifs, etc. –, l’appartenance religieuse est secondaire dans ce dispositif juridique. Malgré les mobilisations d’organisations musulmanes britanniques visant à étendre le domaine d’application de la loi, le vide juridique persiste et a été exploité par les groupes politiques de droite et d’extrême droite, dont le nouveau discours est parfois qualifié de « nouveau racisme [49] ». Le discours conservateur britannique connaît alors un changement déterminant : il ne porte plus sur les marqueurs traditionnels de la race, mais sur des marqueurs nouveaux, moins protégés juridiquement et fondés sur la différence culturelle et religieuse. Contrairement au racisme « traditionnel », ce discours néoraciste est beaucoup moins explicite : les menaces portent sur la « façon de vivre » britannique (British way of life).
Ainsi, le mouvement antiraciste britannique a échoué à reconnaître non seulement le changement d’auto-identification interne aux communautés musulmanes, mais aussi l’antipathie et l’hostilité grandissante à leur encontre. Dans ce contexte, seule une poignée de militants musulmans reconnaissent et luttent contre l’enracinement d’un phénomène antimusulman distinct (voir chapitre 13). Cette lutte est menée par des organisations comme An-Nisa et des militants comme Fuad Nahdi, un temps directeur des publications MuslimWise et Q News. D’autres groupes discutent du phénomène : UK Action Committee on Islamic Affairs (UKACIA) et le Muslim Council of Britain (MCB). Après l’affaire des Versets sataniques en 1989, au cours de laquelle divers groupes musulmans à travers le monde protestent contre le roman de Salman Rushdie et contre les propos antimusulmans qui se propagent à l’occasion de cette polémique, de plus en plus d’articles apparaissent sur le préjugé antimusulman (MuslimWise, The Muslim Update, Q News), bien que le terme d’islamophobie n’apparaisse pas. La reconnaissance du phénomène et l’identification à la religion musulmane doivent aussi beaucoup à la publication et à la réception du livre de Kalim Siddiqui, The Muslim Manifesto. A Strategy for Survival [50].
C’est dans ce contexte d’affirmation identitaire et de transformation du discours raciste que le terme d’islamophobie commence à être employé en Grande-Bretagne. La première reconnaissance de l’islamophobie par des non-musulmans apparaît dans le rapport du think tank multiculturaliste Runnymede publié en 1994, A Very Light Sleeper. The Persistence and Dangers of Anti-Semitism [51]. Le rapport, qui ne prend pas en compte toutes les autres formes de racisme et se focalise sur l’antisémitisme et l’islamophobie, est le catalyseur ayant permis la création en 1996, par le Runnymede Trust, de la Commission on British Muslims and Islamophobia (CBMI).
En dix ans, l’islamophobie est passée d’un phénomène relevant de l’expérience sociale des musulmans du nord de Londres, à un phénomène global, historique et racial, réinterprété et redéfini par les musulmans et les non-musulmans ainsi que par les universitaires, les acteurs publics et les militants. De ce point de vue, la publication du second rapport Runnymede en 1997, Islamophobia : a Challenge for Us All [52], a non seulement influencé la signification donnée au terme d’islamophobie, mais lui a aussi fourni une reconnaissance publique et politique. C’est le premier ouvrage contemporain à proposer une définition relativement précise et actualisée de l’islamophobie. Bien qu’elle ait suscité de multiples critiques, cette définition a eu beaucoup d’influence dans le monde anglophone et a été reprise par plusieurs chercheurs et par d’autres rapports publics, nationaux comme internationaux.
Au moment de la publication du rapport Runnymede, les organisations musulmanes sont de plus en plus actives, avec par exemple les débuts du MCB et la création du Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) en 2001 visant à lutter spécifiquement contre l’islamophobie. Malgré le succès de ces organisations, leurs stratégies vont être remises en cause par le 11 Septembre. Quelques jours avant les attentats, le FAIR et l’Islamic Human Rights Commission (IHRC) se joignent aux autres ONG de la Conférence contre le racisme de Durban et réussissent à obtenir la reconnaissance formelle de l’existence de l’islamophobie par les Nations unies. Ainsi, le terme d’islamophobie est légitimé au niveau international et devient « évident » politiquement bien que l’ONU n’en fournisse aucune définition précise. De plus, il faut souligner l’existence de la « Déclaration de Copenhague sur l’islamophobie », prononcée à l’issue d’une conférence organisée en 2006 par la chaîne de télévision basée en Grande-Bretagne Islam Channel, l’islamophobie étant définie à cette occasion comme la « diabolisation d’êtres humains en raison de leur foi musulmane ».
Après le 11 Septembre, plusieurs recherches sont entreprises à l’initiative d’institutions dépendant de l’Union européenne (UE), notamment l’European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) qui, en mobilisant quinze pays membres de l’UE, organise le plus large projet de « vigilance » sur l’islamophobie jamais réalisé. Plusieurs rapports sont publiés en 2003, 2005 et 2007 mais, si l’EUMC participe à la légitimation institutionnelle du concept d’islamophobie, il ne propose pas de définition claire.
(a) Ces administrateurs-ethnologues s’inscrivent dans un contexte où le mot « phobie » rencontre un certain succès, suite aux avancées de la psychologie et de la psychanalyse. Selon le Robert, le terme de « phobie » apparaît en 1880 et l’adjectif « phobique » en 1910. « Xénophobe » apparaît en 1906 et son utilisation persiste jusqu’à nos jours, alors qu’« islamophobie » ne fait son entrée dans le même dictionnaire qu’au début des années 2000.
(b) Maurice Delafosse (1870‑1926) débute sa carrière dans l’administration coloniale en tant que commis des Affaires indigènes de 3e classe en Côte d’Ivoire puis, après avoir été consul au Libéria et avoir enseigné à l’École spéciale des langues orientales et à l’École coloniale, est nommé responsable des Affaires civiles du gouvernement de l’Afrique occidentale française (AOF) à Dakar. Alain Quellien est docteur en droit, élève breveté de l’École coloniale, diplômé de l’École spéciale des langues orientales vivantes et rédacteur au ministère des Colonies. Paul Marty (1882‑1938) est né en Algérie et directeur des Affaires indigènes à Rabat de 1912
à 1921.
[1] Caroline Fourest et Fiammetta Venner, « Islamophobie ? », ProChoix, nº 26‑27, 2003 (disponible sur <www.prochoix.org>).
[2] Pascal Bruckner, « L’invention de l’“islamophobie” », Libération, 23 novembre 2010.
[3] Nous remercions Farhad Khosrokhavar pour ces informations.
[4] Nous remercions Yves Gonzalez-Quijano pour ces informations.
[5] Fernando Bravo López, « Towards a definition of Islamophobia : approximations of the early twentieth century », Ethnic and Racial Studies, vol. 34, nº 4, 2011, p. 556‑573.
[6] Hélène Grandhomme, « Connaissance de l’islam et pouvoir colonial. L’exemple de la France au Sénégal, 1936‑1957 », French Colonial History, vol. 10, 2009, p. 171.
[7] Voir Jean-Loup Amselle et Emmanuelle Sibeud (dir.), Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870‑1926), Maisonneuve & Larose, Paris, 1998.
[8] Maurice Delafosse, « L’état actuel de l’Islam dans l’Afrique occidentale française », Revue du monde musulman, vol. XI, nº V, 1910, p. 57. Nous soulignons.
[9] Paul Marty, « L’islam en Guinée », Revue du monde musulman, vol. XXXVI, 1918‑1919, p. 174 : « Il faut reconnaître pourtant que de 1908 à 1911, il y eut dans la région
de Touba quelques motifs susceptibles d’éveiller véritablement les soucis de l’administration, et qui étaient plus objectifs que l’islamophobie ambiante. »
[10] Maurice Delafosse, « L’âme d’un peuple africain : les Bambara » (recension de Joseph Henry, L’Âme d’un peuple africain : les Bambara ; leur vie psychique, éthique, sociale, religieuse, Münster, 1910), Revue des études ethnographiques et sociologiques, tome II, nº 1‑2, 1911, p. 10.
[11] Alain Quellien, La Politique musulmane dans l’Afrique occidentale française, Émile Larose, Paris, 1910, p.. 133. D’après une thèse de doctorat présentée à la faculté de droit de l’université de Paris le 25 mai 1910. C’est nous qui soulignons.
[12] Ibid., p. 135.
[13] James von Richardson, Adolf Overweg, Heinrich Barth et Eduard Vogel, Die Entdeckungsreisen in Nord-und Mittel-Afrika, Carl B. Lorck, Leipzig, 1857 ; Heinrich Barth, Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 à 1855, A. Bohné, Paris, 1860.
[14] Louis-Gustave Binger, Du Niger au Golfe de Guinée, Hachette & Cie, Paris, 1891.
[15] Alain Quellien, op. cit., p. 136.
[16] Cité dans ibid., p. 137.
[17] Oskar Lenz, Timbouctou : voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, tome 1, Paris, Hachette & Cie, 1886, p. 460.
[18] Alain Quellien, op. cit., p. 154.
[19] Ibid.
[20] Voir les biographies de Dinet : Fernand Arnaudiès, Étienne Dinet et El Hadj Sliman Ben Ibrahim, P. & G. Soubiron, Alger, 1933 ; Jeanne Dinet-Rollince, La Vie de E. Dinet, Maisonneuve, Paris, 1938 ; Denise Brahimi, La Vie et l’oeuvre d’Étienne Dinet, A.C.R, Paris, 1984 ; François Pouillon, Les Deux Vies d’Étienne Dinet, peintre en Islam : l’Algérie et l’héritage colonial, Balland, Paris, 1997.
[21] Une de ses peintures est même reproduite dans le célèbre Gabriel Hanoteaux (dir.), Histoire des colonies françaises. Tome 2 : Algérie, Plon, Paris, 1929, p. 384.
[22] Étienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim, La Vie de Mohammed, Prophète d’Allah, L’Édition d’Art H. Piazza, Paris, 1918, p. vii.
[23] Lettre de Dinet à sa soeur, 7 janvier 1929, citée dans Jeanne Dinet- Rollince, op. cit., p. 196.
[24] Lettre de Dinet à sa soeur, 8 mars 1929, citée dans ibid., p. 197.
[25] Nacir Ed Din Étienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim Baâmer, Le Pèlerinage à la maison sacrée d’Allah, Hachette, Paris, 1930, p. 167.
[26] Ibid., p. 173.
[27] Ibid., p. 174‑175.
[28] Ibid., p. 176.
[29] Ibid., p. 183.
[30] Samuel M. Zwemer, L’Islam, son passé, son présent et son avenir, Fédération française des associations chrétiennes d’étudiants, Paris, 1922, [1907], p. 295 : « Il faut conduire l’offensive avec tact et sagesse, mais il faut la pousser vigoureusement. Il faut que de l’Est à l’Ouest, et du Nord au Midi, l’Église mobilise toutes ses forces et les enrôle sous la bannière de son chef… Les champs sanglants de l’Afrique et de l’Asie attendent de nouveaux martyrs ! »
[31] Nacir Ed Din Étienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim Baâmer, Le Pèlerinage…, op. cit., p. 173.
[32] Ibid., p. 174.
[33] Ibid., p. 183.
[34] Étienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim, L’Orient vu de l’Occident, essai critique, H. Piazza, Paris, 1925.
[35] Étienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim, The Life of Mohammed, The Prophet of Allah, Paris Book Club, Paris, 1918.
[36] Stanley A. Cook, « Chronicle. The history of religions », Journal of Theological Studies, nº 25, 1924, p. 101‑109. Voir Fernando Bravo López, Islamofobia y antisemitismo : la construcción discursiva de las amenazas islámica y judía, thèse d’études arabes et islamiques, Université Autonome de Madrid, 2009, p. 62. Cette thèse est parue en livre : En casa ajena. Bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia, Edicions Bellaterra, Barcelone, 2012.
[37] Georges C. Anawati, « Dialogue with Gustave E. von Grynebaum », International Journal of Middle East Studies, vol. 7, nº 1, 1976, p. 124. Voir AbdoolKarim Vakil, « Is the Islam in islamophobia the same as the Islam in anti-Islam. Or, when is it islamophobia time ? », in S. Sayyid et AbdoolKarim Vakil (dir.), Thinking Through Islamophobia. Global Perspectives, Columbia University Press, New York, 2010, p. 41.
[38] Charles-Vincent Aubrun, « Jules Horrent, Roncesvalles. Étude sur le fragment de cantar de gesta conservé à l’Archivo de Navarra (Pampelune) », Bulletin Hispanique, vol. 53, 1951, p. 429.
[39] Bernard Loupias, « Góngora et la Mamora, II », Bulletin Hispanique, vol. 90, nº 3‑4, 1988, p. 346.
[40] Anne-Marie Duperray, « Les Yarse du royaume de Ouagadougou : l’écrit et l’oral », Cahiers d’études africaines, vol. 25, nº 98, 1985, p. 188.
[41] Hichem Djaït, L’Europe et l’Islam, Seuil, Paris, 1978, p. 60‑64.
[42] Edward W. Said, « Orientalism Reconsidered », Cultural Critique, nº 1, 1985, p. 99.
[43] Paul Goble, « Islamic “explosion” possible in Central Asia », Report on the USSR, vol. 2, nº 7, 16 février 1990, p. 22‑23. Ces informations sont reprises dans Mort Rosenblum, « Islam Resurgent Vibrant Faith of Koran Surviving Dying Faith of Communism », The Associated Press, 23 juillet 1990 et Holman Jenkins Jr., «A Dance on Shevardnadze’s Grave », Insight, 4 février 1991.
[44] Chris Allen, Islamophobia, Ashgate, Farnham/Burlington, 2010.
[45] Bhikhu Parekh, « Europe, liberalism and the “Muslim question” », in Tariq Modood, Anna Triandafyllidou et Richard Zapata- Barrero (dir.), Multiculturalism, Muslims and Citizenship, Routledge, Londres, 2006, p. 179‑203.
[46] Nasar Meer, Citizenship, Identity & the Politics of Multiculturalism. The Rise of Muslim Consciousness, Palgrave, Basingstoke, 2010.
[47] John Solomos, Race and Racism in Britain, Palgrave, Basingstoke, 2003.
[48] Robert Miles et Annie Phizacklea, Labour and Racism, Routledge, Londres, 1980.
[49] Martin Barker, The New Racism, Junction Books, Londres, 1981.
[50] Kalim Siddiqui, The Muslim Manifesto. A Strategy for Survival, The Muslim Institute, 1990.
[51] Runnymede Commission on Anti-Semitism, A Very Light Sleeper : the Persistence and Dangers of Anti-Semitism, Runnymede Trust, Londres, 1994.
[52] Runnymede Trust, Commission on British Muslims and Islamophobia, Islamophobia : a Challenge for Us All, Runnymede Trust, Londres, 1997.