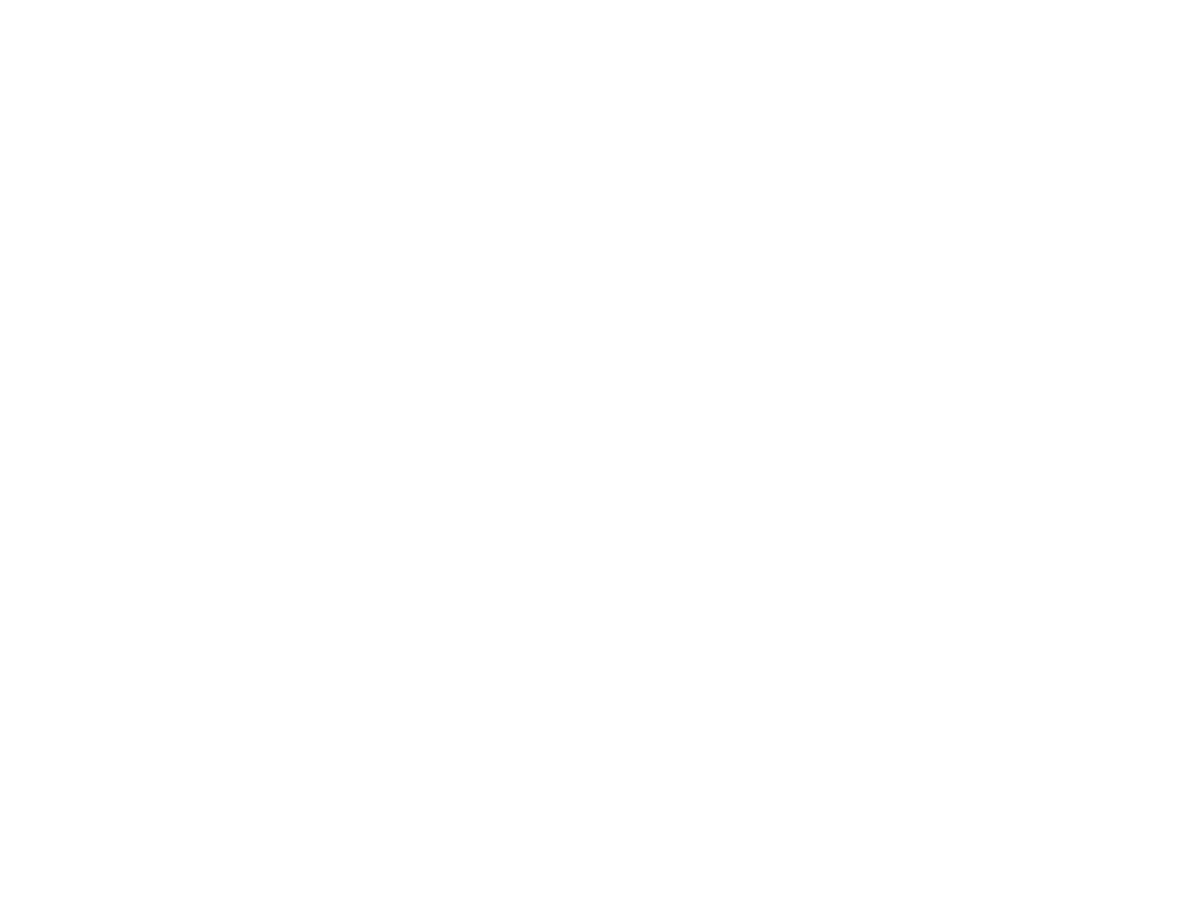
Hatem, ou la mésentente (3)
Elias Lahlou et Hatem Muhammad
La première partie de ce texte a été publiée ici, la seconde ici.
Après un intermède d’un an en Arabie Saoudite où il travaille comme traducteur pour un cabinet majeur de conseil en stratégie – « je n’avais jamais vu ce monde-là de restaurants à plusieurs centaines d’euros, de consultants logeant au Ritz-Hôtel et de chauffeurs privés qui les transportaient partout. Quel changement après le Yémen ! » –, puis un détour par la Palestine et le Maroc, où sa femme s’installe avec leurs enfants dans sa région natale, Hatem rentre en Belgique en 2020. Obtenant un poste d’interprète mis au concours au sein d’un organisme fédéral pour l’accueil des réfugiés, Hatem se réinstalle dans la maison familiale de Schaerbeek. Au sein de l’institution qui l’emploie, il assure d’abord la traduction entre le néerlandais et la variété des dialectes arabes (levantin, yéménite, égyptien et marocain) maitrisés au gré de ses voyages, avant d’étendre ses missions au français.
« C’est là que les problèmes ont commencé » : la traduction vers et depuis le français est le pré-carré d’interprètes libanais maronites qui se font simultanément passeurs entre des mondes réputés étanches l’un à l’autre. La rivalité professionnelle avec Hatem est immédiatement redoublée par le profond différend idéologique que les uns et les autres incarnent : tout à la fois musulman, enfant de l’immigration postcoloniale à Bruxelles et néerlandophone natif, celui-ci propose une interlocution qui n’est guère constituée depuis la prémisse d’une perpétuelle altérité à éclairer.
Ses collègues se plaignent au chef de département qui a embauché Hatem et indiquent être « intimidés par son apparence ». Perplexe, le responsable le fait venir et lui demande ingénument s’il n’est pas « radicalisé ». « Comment répondre à ça ? », s’interroge encore Hatem. Celui-ci, décontenancé, fait valoir les bribes de son existence qui ne correspondent guère au récit d’une trajectoire absolument hétérogène à celles de ses contemporains : « ma sœur est athée, elle travaille dans l’asile aux réfugiés elle aussi, j’ai fait du rap etc. », bredouille-t-il ainsi. Le chef de département opine – rassuré tant par la facilité de la discussion que du fait des avis sur Hatem qu’il a demandés aux officiers de protection ayant l’habitude de travailler avec lui. Mais le même responsable le convoque de nouveau dix jours après leur premier entretien : une lettre de l’Autorité nationale de sécurité l’a informé que Hatem est bel et bien « radicalisé ». Celui-ci doit quitter son emploi, quoique le chef de département lui promette en le congédiant de le réembaucher en cas de renversement de l’avis de sécurité. Un an plus tard, quand Hatem sera lavé de tout soupçon, le responsable de l’organisme fédéral tiendra sa promesse. « Mais après combien de temps ?!», s’exclame Hatem, « tout cela m’a énormément coûté en temps et en énergie et a gravement affecté ma famille qui était si heureuse de mon retour à Bruxelles ».
Au sortir de l’entretien, Hatem n’a cependant idée ni de ce qui lui est reproché – l’ANS, qui a adressé le courrier à son supérieur hiérarchique, n’est qu’une instance de notification – ni de qui – parmi le ministère de la Défense, la police fédérale ou la Sûreté d’État – l’incrimine. Après avoir contacté le Comité I – un organe gouvernemental de contrôle des libertés –, Hatem apprend que le signalement a été effectué par la dernière institution. Accompagné de son avocat, il est invité à se rendre à une salle de lecture où il lui est donné accès à son « dossier » pour consultation. « Même moi, j’ai eu peur de moi-même en lisant ça. C’était présenté d’une manière telle qu’il n’était pas possible de penser que j’étais une personne ordinaire, tout du moins humaine. Mon avocat, un ami de ma mère, n’en revenait pas. Il connaissait mes parents et moi et j’avais cependant l’impression qu’il commençait à douter de moi. J’ai dû lui dire « hey Julien, c’est du mytho tout ça, tu le sais, c’est de moi dont il s’agit ! ». J’étais tellement énervé et j’avais tellement peur qu’il y croit, mais il m’a vite rassuré ».
En accédant au récit que fait la Sûreté d’État de son parcours de vie, Hatem découvre « un film d’horreur ». Le « faisceau de preuves » de l’accusation est constituée par la narration d’une trajectoire oscillant entre la fondation d’un « centre salafiste en Égypte » – avant de mentionner après quelques lignes qu’il s’agissait d’un cours d’arabe –, l’accusation en propagande – Hatem évoquait ainsi dans ses articles « le colonialisme et l’islamophobie » – et la constitution d’une catégorie ad hoc – « salafiste politique ». L’assemblage hétéroclite rend ardue sa réfutation : « comment répondre ? », ne cesse de répéter Hatem, face à ce qui est tout à la fois le troncage – voire une complète invention : « il y avait des mensonges mais les démentir ne réglait rien, le primacy effect joue à plein » – de son parcours et l’énumération d’opinions que lui-même voit comme courantes – « alors que les citations sont déjà dans mes textes, j’ai dû leur montrer que les mêmes idées sont chez Saïd ou Fanon pour les persuader que non, dire que la colonisation avait bouleversé les structures sociales des pays colonisés n’était pas de la propagande djihadiste ou terroriste ». Au faisceau de preuvess’ajoute la culpabilité par association : un jeune britannique converti à l’islam a commis un attentat au Kenya et avait prétendu partir étudier à al-Ibana, le centre que Hatem a fondé au Caire. Mais les services britanniques avaient pourtant précédemment démenti la présence de l’assaillant en Égypte, ce à quoi Hatem ajoute – « même si ce jeune avait été chez nous, ce qui n’était pas le cas, pourquoi ne pas nous avoir prévenu ? On aurait pu être en danger aussi ! ».
Malgré la consultation de son dossier, Hatem ne sait toujours pas d’où provient le signalement à l’origine de l’engrenage. À la suite de l’audition contradictoire – une première a lieu quelques jours après la notification de l’avis de sécurité, la seconde six mois plus tard –, il soupçonne cependant l’action de services de renseignement français mobilisant leurs homologues belges francophones. Sans que cela ne figure au dossier, le magistrat l’interroge ainsi sur un de ses étudiants cairotes dont le frère est incarcéré en France au titre de l’antiterrorisme – donnant ainsi à entrapercevoir la circulation d’informations et de catégories d’entendement entre les deux pays.
Par-delà l’éventuelle source du signalement, l’épistémologie du soupçon qui en est au fondement ne peut aboutir qu’à l’excommunication. Hatem ne doit pas simplement réitérer qu’il n’a commis aucun crime, sa défense est d’abord attachée à la démonstration de sa respectabilité – c’est-à-dire à l’étalage de tout ce qui le rattache au cercle de ses contemporains. Aussi accumule-t-il les lettres de recommandation d’universitaires avec lesquels il a correspondu, de contacts investis dans le champ politique et même d’un officier des services de renseignement à la retraite – un vieil ami de sa famille. Plus surprenant, à l’heure de la pandémie du COVID-19, le magistrat l’interroge sur sa position à l’égard des vaccins. Hatem prend plaisir à répondre que, en plus d’être vacciné lui-même, son travail au sein du centre social dans lequel il avait été engagé à la suite de la perte de son poste d’interprète consistait pour partie à aider des « primo-arrivants » à accéder à la vaccination. Le magistrat, étonné, n’avait pu s’empêcher de sourire – comme définitivement persuadé du caractère honorable de son interlocuteur.
Plus de dix mois après l’informe dénonciation qui lui a valu de perdre son emploi, Hatem est lavé de tout soupçon. Condamné sans procès, il est symétriquement réincorporé – tout du moins de jure – à la société globale sur le fondement exclusif du retrait de la fiche anonyme rédigée par les services de renseignement qui l’ont initialement accusé. La menace est cependant perpétuée : une semaine après avoir été blanchi en Belgique, Hatem reçoit un appel de la police judiciaire française. Celle-ci l’informe qu’après avoir publié un texte critique à l’égard d’un ouvrage du Ministre français de l’intérieur, Hatem est personnellement poursuivi en diffamation par ce dernier.
Le malaise qui persiste est pourtant moins lié à l’engrenage incriminateur qu’à l’impossible interlocution entre Hatem et la totalité collective dont il est issu. L’hérésiologie moderne de la lutte contre la radicalisation[1] est ainsi fondée par l’exclusion de ceux que l’on cible hors de l’ordre des contemporains. Accusé, Hatem a vu son parcours être abstrait de la trame historique qui en a pourtant été le cadre inexpugnable. « J’ai dû leur rappeler que j’avais fait du rap, que mes sœurs étaient profondément irréligieuses, que ma mère était flamande, que tout ce beau monde venait régulièrement me voir en Égypte et au Yémen, j’ai dû rappeler tous les amis de la famille pour qu’ils témoignent en ma faveur. Tout ça pour que les gens se souviennent que je ne suis pas une créature venue d’une lointaine planète ».
Moins qu’une modalité éternelle du « pouvoir », la politique de la mésentente agit comme l’excommunication de la société globale et de ses modes de signification. La vie de Hatem – tenue pour absolument hétérogène à celles de ses contemporains – est ainsi rejetée à l’horizon plus fantasmé que lointain de l’altérité radicale. Élevée au rang de régime exclusif de définition et par suite d’interlocution, la différence fonde un « type déterminé de situation de parole : celle où l’un des interlocuteurs à la fois entend et n’entend pas ce que dit l’autre » (Rancière 1995 : 12).
Il ne s’agit pourtant guère de postuler en réponse la banalité du parcours de Hatem. Celui-ci est mû par une variété d’idéaux politiques et religieux auxquels il n’entend pas renoncer à la faveur de sa réincorporation apparente dans la concorde civile. Hatem n’a ainsi de cesse de rappeler qu’il « respecte la loi » : en sus de l’affirmation de son innocence légale, Hatem fait signe vers son rapport in fine ordinaire au droit comme lieu – un parmi d’autres – où se dépose une normativité collective, celle-ci étant spécifiée par la contrainte punitive à laquelle elle est adossée[2]. Pour autant, si la politique est ainsi « faite de rapports de mondes », leur hiérarchie interne au sein de la société moderne et figurée par la pensée juridique ne résout guère la conflictualité des formes de vie – dont une expression contemporaine est ainsi la lutte contre la radicalisation. Aussi est-il notable que celle-ci, conduite sur le mode extra-judiciaire, c’est-à-dire sans traitement initial par la justice[3], ne spécifie guère la loi – c’est-à-dire le régime de normativité – à laquelle elle s’arrime. Ce qui est ainsi tenu par défaut comme la vie bonne ne s’exprime pas au-delà de la répression opposée à la singularité qui nait au sein de la trame contemporaine en partage[4].
L’hétérogénéité qui demeure au sein des sociétés modernes n’a ainsi rien d’ontologique. [Hatem qui rappelle son inscription]. Mais sa fabrique et son existence parmi nous accentue pourtant la conflictualité. Aussi la criminalisation des formes d’idéation toujours à l’œuvre au sein de la totalité collective doit-elle précisément être envisagée à la lumière de l’évitement qu’elle permet du paradoxe de l’inquiétante différence intime – l’unheimliche de Freud[5]. Hatem dit : « Quand les flics voient un gars comme moi, ils sont déstabilisés. Je sors mon plus beau néerlandais et eux en sont à se demander qui est cet islamiste qui parle flamand aussi bien qu’eux. Mais moi, quand je suis face à eux, j’oublie que je suis Arabe. J’exige exactement ce qu’exige un Belge de souche. Je crois que c’est aussi ça qui m’a poussé dans mes voyages et tout ce que j’ai pu faire. Le fait de n’être qu’à 50% arabe et d’être en partie flamand m’a toujours donné un sentiment de légitimité. Je ne me posais jamais la question de savoir s’il était possible ou non de partir ».
Face à Hatem et à d’autres dont le parcours est similaire, la totalité collective réprime ce qu’elle ne peut envisager, c’est-à-dire que la politique persiste en son sein sous la forme de réponses différenciées à l’équation moderne du rapport entre individu, collectif d’appartenance et société globale[6]. Le dépassement de l’ornière n’est pourtant pas offert par la revendication à la reconnaissance[7] des différences acceptables[8]. Celle-ci, symétrique de la lutte contre la radicalisation à laquelle elle se superpose parfois[9], reproduit l’évitement de la politique consubstantielle à la pluralité des formes de vie – jusqu’à la quête d’utopie dont témoigne le parcours de Hatem – qui naissent au sein d’une même trame contemporaine et sont autant de modes de résolution de problèmes se posant à tous (Jaeggi op.cit.) – la filiation qui peut demeurer, la violence des héritages brisés, la persistance malgré toutdes solidarités collectives etc.
La variété des rapports de l’individu à son collectif d’appartenance – pour Hatem, celui de la famille hétéroclite et d’une enfance à Schaerbeek – puis à la société globale[10] fonde les coordonnées indépassables de la politique au temps de la modernité tardive – dont le propre est de naturaliser trompeusement la fiction de l’individu anomique[11]. S’agissant de Hatem, sa trajectoire, aussi singulière soit-elle, manifeste la variété d’enjeux de l’immigration postcoloniale en Europe : son enquête subjective adopte ainsi les contours de multiples circulations entre le monde arabe et la Belgique, mais la présence de musulmans au sein de la société libérale et séculière – en plus de la multiplicité des rapports constitués historiquement, que Hatem n’a de cesse de rappeler par ses écrits – a depuis longtemps opéré l’enchevêtrement – voire la superposition – de l’Europe et de l’espace de la tradition islamique. Hatem, dans l’exposé de sa trajectoire, établit ainsi un ferme parallèle entre son expérience de la torture en Égypte et l’excommunication vécue en Belgique : malgré la – nette – différence de degré, la permanence de la politique et de sa négation principielle opère par-delà la frontière réputée étanche entre l’Europe et son reste.
La possibilité d’une alternative prend alors forme par un mouvement nécessairement double : d’un côté, par Hatem l’interprète qui raconte de nouveau sa trajectoire et en énonce les enjeux pour tous ; de l’autre, via la mise en lumière de la politique qui persiste au sein des sociétés libérales et séculières. À rebours de la lutte contre la radicalisation, ce mode alternatif pour la discussion politique est ainsi établi par la substitution d’une question au problème que Hatem et d’autres similaires sont tenus pour constituer. La distinction est donnée par Jean-Claude Milner : alors que le problème « appelle une solution », la question est posée par « quelque être parlant à un autre être parlant ». Milner poursuit : « Une réponse peut toujours être pensée comme la réitération de la question, en sorte qu’il peut ne jamais y avoir de réponse suffisante à clore la question. On peut alors soutenir que le propre de la question est de pouvoir demeurer à jamais ouverte et que le propre de la réponse est de ne pas attenter à cette ouverture[12]».
Ni déni ni essentialisme stratégique, l’échange de « questions » est destiné à demeurer ouvert. Il n’est pas interdit de faire l’hypothèse que, en sus de l’interrogation que portent les communautés minoritaires à l’examen de la société globale, un effort est singulièrement requis des majoritaires pour décrire à leur tour la somme nécessairement heurtée de leurs filiations contemporaines.
[1] GUIBET LAFAYE, C., 2017. Dénoncer la radicalisation, reconstruire un ordre moral et politique, Implications philosophiques, 2017.
[2] KARSENTI, B. 2005. La société en personnes - études durkheimiennes, Paris : Economica
[3] Si Hatem n’avait pas fait appel, son fichage comme radicalisé aurait ainsi pu ne jamais être examiné par la justice.
[4] BOUNAGA, A. 2023. “Secular normativity in anti-jihad discourse in France”, in Günther, C. (dir.), Notions of jihad reconsidered, Edinburgh University Press
[5] Lucide, Hatem dit : « je sais que les gens qui me voient ont tout de suite peur. Mais je sais aussi qu’il suffit de me parler pour que cette peur disparaisse d’elle-même ».
[6] KARSENTI, B. 2017. La question juive des Modernes. Philosophie de l’émancipation, Paris : Presses universitaires de France
[7] TAYLOR, C. 1994. Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris : Flammarion
[8] « Car le problème n’est pas de s’entendre entre gens parlant, au propre ou au figuré, des "langues différentes", pas plus que de remédier à des "pannes de langage" par l’invention de langages nouveaux. Il est de savoir si les sujets qui se font compter dans l’interlocution "sont" ou " ne sont pas", s’ils parlent ou s’ils font du bruit. Il est de savoir s’il y a lieu de voir l’objet qu’ils désignent comme l’objet visible du conflit. Il est de savoir si le langage commun dans lequel ils exposent le tort est bien un langage commun. La querelle ne porte pas sur des contenus de langage plus ou moins transparents ou opaques. Elle porte sur la considération des êtres parlants comme tels ». RANCIÈRE, J. 1994. La mésentente, Paris : Galilée, p. 79.
[9] Ainsi en va-t-il du « pas d’amalgame » formulé en France à l’heure du déclanchement de la lutte contre la radicalisation.
[10] GURVITCH, G. 1950. La vocation actuelle de la sociologie, Paris : Presses universitaires de France
[11] Pour un exemple de la thèse libérale de la fin des sociétés, voir TOURAINE, A. 2013. La fin des sociétés, Paris : Seuil
[12] MILNER, J-C. 2003. Les penchants criminels de l'Europe démocratique, Paris : Verdier, pp. 9-10.

