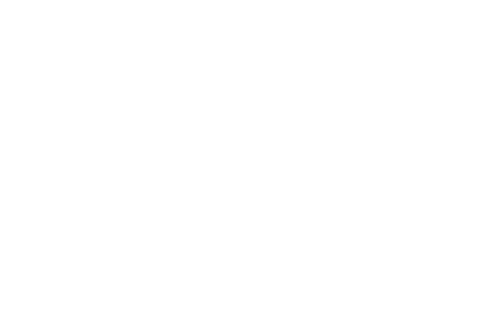
Hatem, ou la mésentente (2)
Elias Lahlou et Hatem Muhammad
La première partie de ce texte a été publiée ici.
L’enfant songe à son père et se tourne vers Dieu
Victor Hugo, Le mariage de Roland
À propos de son départ en Égypte, Hatem se souvient : « C’était une quête d’indépendance. Pour mes lectures, je ne voulais plus passer par les traductions de France ou d’Angleterre qui sont nécessairement limitées. Je n’avais pas le choix à propos des lectures et j’étais obligé de subir le biais du traducteur. Je voulais vraiment maîtriser la langue, y être vraiment, lire par moi-même, découvrir par moi-même le patrimoine arabe. De fait, j’ai découvert plein de livres qui n’existaient pas en français ou en anglais. C’est ce que je voulais, de l’indépendance dans la recherche ». L’installation est pourtant malaisée. Hatem n’a pas d’appui local et loge dans un modeste hôtel à quelques encablures d’al-Azhar : « Je me renseignais comme ça dans la rue, avec le peu d’arabe que j’avais ». C’est au hasard d’une démarche au « mogama’ », sorte de sous-préfecture administrative, que Hatem, muni de son passeport couleur rouge européen, est interpellé par trois Français venus comme lui apprendre l’arabe. Ces « vrais parisiens » – dixit Hatem, qui entend paradoxalement par-là des jeunes issus de banlieue – le renseignent quant à l’école d’arabe qu’ils fréquentent. Hatem finit par emménager à Ain Shems, quartier pauvre du Caire, dans l’appartement qu’il partage avec « les Français » – deux par chambre, six habitants au total. La cohabitation entre enfants de l’immigration arabe en Europe n’est pas toujours commode : près de vingt ans plus tard, Hatem fait récit de l’impression de « dureté » que lui ont parfois laissée ses colocataires. En même temps que tous se redécouvrent « musulmans au sein du monde musulman », les vécus des uns et des autres instruisent, plus que la divergence politico-religieuse, une variété d’ethos que ne résorbe guère le voyage initiatique.
Si de nombreux Européens ou Américains viennent en Égypte au tournant des années 2000, nulle totalité n’efface ainsi les singularités constituées dans la variété des expériences historiques. L’effervescence de l’époque est paradoxale : de nombreux étrangers vont au Caire pour apprendre la langue – et pour une importante partie d’entre eux l’islam – mais il n’est ni structure d’accueil unifiée ni hégémonie parmi les arrivants de l’un ou l’autre courant idéologique. Aussi les débats politiques et religieux sont-ils aussi nombreux que tranchés : la multiplicité des structures d’enseignements et la fluidité des appartenances constituent un riche et mouvant tissu d’échanges parmi les étudiants venus en Égypte. Par-delà les disputationes théologiques ou politiques,chacun des étudiants étrangers conduit l’enquête subjective qui l’amène à telle ou telle école de pensée et d’apprentissage. Hatem lui-même affirme ce motif : « Je voulais aller dans un pays suffisamment grand pour me perdre[1] ». Plusieurs déménagements rythment ainsi sa vie cairote, en sus de l’étude de l’arabe et de la tradition islamique ainsi que de l’enseignement rémunéré du français aux familles bourgeoises de la ville. Bien souvent, Hatem déambule dans les ruelles du vieux Caire, dans les librairies attenantes à al-Azhar où il compulse les ouvrages classiques qui lui donnent le sentiment « d’entrer dans un autre monde ».
Mais Hatem demeure insatisfait par l’offre éducative destinée aux étudiants étrangers. Comme une réminiscence de l’histoire familiale, il fait la rencontre d’un couple d’Afro-Américains convertis à l’islam avec lesquels il nourrit le projet de fonder une structure d’apprentissage de l'arabe à destination des locuteurs adultes. S’appuyant sur sa formation d’interprète et aidé par ses amis, Hatem constitue lui-même les premiers programmes pédagogiques de l’école, obtient l’autorisation officielle du Ministère égyptien de l’éducation et débauche – de dar al-Ulum et d’autres prestigieux instituts traditionnels d’enseignement de la langue – les professeurs. L’école, qui existe encore[2], prend le nom d’al-Ibana[3], en référence à un ouvrage du jurisconsulte médiéval Ibn Battah.
Pour Hatem, la quête du monde musulman est simultanément celle de soi – y compris s’agissant des héritages rompus dans le cours de l’immigration postcoloniale en Europe. Près de vingt années plus tard, Hatem dit la fierté que son installation au Caire – par l’imaginaire qui lui est associé dans le monde arabe : Oum Kalthoum[4], al-Azhar[5], Khan al-Khalili[6] etc. – cause à son père : « « Ma famille est en Palestine, c’est vrai, mais la langue arabe y est faible et il n’y a pas d’institution d’enseignement. Et puis, j’y allais tout le temps depuis tout petit, on connaissait très bien, c’était un tout petit pays. Je voulais découvrir autre chose, une nouvelle partie du monde arabe. Mon père était très en faveur, très content que je sois au Caire, ça le faisait rêver. Il avait voulu nous enseigner l’arabe lorsque mes sœurs et moi étions enfants mais nous n’avons pas été particulièrement réceptifs ». Le père de Hatem lui rend ainsi régulièrement visite, parfois accompagné de l’ensemble de la famille. À travers la tradition héritée et reconstruite via le détour cairote, père et fils refondent leur relation par-delà les heurts de la filiation en contexte minoritaire. Hatem apprend l’arabe, langue que ne lui avait pas transmise son père, tandis que Raheeb, au contact de son fils, commence à prier et s’en va en pèlerinage à la Mecque avec celui-ci. « J’ai radicalisé mon père », sourit Hatem.
Mais l’Égypte du début des années 2000 est projetée au cœur de la « War on Terror »que conduisent les États-Unis à la suite aux attentats du World Trade Center. Il n’est pas rare que, au gré des actualités internationales, la police procède à la détention massive de ceux sur lesquels pèse le soupçon – Hatem dit : « ils prenaient les barbus dans la rue »–, puis les relâche au bout de quelques jours ou semaines. En 2003, au retour de vacances au Bahreïn, Hatem est arrêté à l’aéroport du Caire par la Sûreté d’État et emmené à un centre de détention secret à Hay as-Sabi’:
« Ils m’ont confisqué mon téléphone puis m’ont jeté dans un camion bleu dans lequel ils m’ont menotté. Dès qu’on est arrivé à la prison, les geôliers m’ont jeté par terre à la sortie du bus et ont fait pleuvoir les coups partout sur mon corps et mon visage. C’était très violent ! Ils m’ont ramené dans une toute petite pièce, avec un petit trou qui servait de toilettes et un robinet. La pièce était complètement sombre, à part un grillage qu’ils pouvaient tirer pour regarder. J’avais les yeux bandés, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Il était presque impossible de s’allonger, c’était un cachot parmi une série d’autres dans un long couloir. On entendait les cris des torturés et le bruit de la peau brûlée au contact des câbles électriques. On ne savait jamais s’il faisait jour ou nuit, mais trois fois par jour, ils nous criaient de tendre nos mains menottées et ils y jetaient une sorte de pain mélangé de sable et de riz. Ils nous donnaient aussi des goyaves, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, jusqu’à aujourd’hui, je ne peux plus manger de goyaves. Si j’en sens l’odeur, j’ai la nausée et les souvenirs qui remontent.
Les premiers jours, je n’ai pas été interrogé. Parfois ils venaient dans la cellule et me donnaient des coups. J’étais « numéro 9 ». Ils criaient « numéro 9, assieds-toi » ou « numéro 9, lève-toi ». Ensuite, ils m’ont emmené dans une pièce pour interrogatoire et m’ont menacé avec la machine électrique mais grâce à Dieu ils ne l’ont pas utilisé. Toutes les questions tournaient autour de l’institut qu’on avait fondé, alors que nous avions toutes les autorisations légales et que les Égyptiens savaient parfaitement ce qui s’y passait. Mais ça ne venait pas d’eux, très clairement. Nos professeurs aussi ont subi de graves sévices, un a disparu et n’a plus jamais donné signe de vie. C’était de l’injustice pure, destinée au spectacle et au débat public !
Ils m’ont demandé de donner la liste de tous nos élèves, des centaines, de tête. C’était absurde parce qu’ils avaient tous les noms, on était obligé de déclarer nos élèves à l’inscription. Ce n’était que de l’intimidation, ils me disaient « je veux savoir tout sur toi depuis le jour où tu es né ». Ils me demandaient ce que ma mère et mes sœurs faisaient, le métier de mon père, quand j’avais commencé à prier. Bien plus tard, j’ai appris que ce n’était pas les Égyptiens qui étaient à l’initiative. Ils avaient reçu des listes de nos pays et ils posaient les mêmes questions à tous les ressortissants européens. Les Égyptiens savaient déjà tout sur nous, mais nos pays d’origine leur avaient sous-traité nos interrogatoires.
Un jour, j’ai failli m’asphyxier. La pièce était si petite et fermée que j’avais d’énormes difficultés de respiration. J’ai tapé à la porte de la cellule en haletant et ils ont pris peur, ils m’ont alors laissé dormir sur le sol du couloir. Quand j’étais en cellule, je m’appuyais sur l’inscription de quelqu’un qui avait gravé dans le mur « Tu dois évoquer Dieu », ça m’apaisait beaucoup et ça m’aidait dans mes crises de panique. Très souvent, je me disais que c’était un cauchemar.
Le septième jour, pour une raison que j’ignore, ils se sont mis à paniquer et m’ont de nouveau jeté dans une camionnette qui filait à toute allure vers un autre centre de détention. Bizarrement, dès que je suis arrivé, la première question qu’on m’a posée portait sur les meubles dans mon appartement, s’ils m’appartenaient. Les geôliers m’ont ensuite fait descendre au deuxième ou au troisième sous-sol et m’ont jeté dans une suite de trois petites pièces remplies de barbus. En tout, on devait être environ soixante-dix. Même pour dormir, on se relayait parce qu’il n’y avait pas de place. Certains dormaient, d’autres restaient debout. Les pièces étaient complètement infestées d’insectes. Je me souviens que mes camarades de cellule m’avaient demandé de me présenter puis l’avaient eux-mêmes fait à tour de rôle. Chacun disait : « je suis untel fils d’untel, en prison depuis dix-sept ans par la grâce de Dieu ». Ça m’avait terrorisé, je me disais que je serais aussi là dans vingt ans. Aucun d’entre eux n’avait jamais été jugé ! Toutes les quatre heures, ils appelaient cinq ou six noms pour être interrogés et torturés. J’avais tout le temps des problèmes de respiration, à plusieurs reprises j’ai failli mourir. Une fois, j’ai vraiment pensé décéder, ce sont mes camarades de cellule qui ont commencé à crier que l’étranger que j’étais était sur le point de mourir. Même pas une heure après, ils m’ont relâché au milieu de la rue à deux heures ou trois heures du matin. L’État égyptien, c’est vraiment parmi les pires. Quand tu sors d’une telle injustice, soit tu laisses complètement tomber et tu deviens athée, soit tu te radicalises réellement et tu deviens un ennemi à vie de l’État ».
Hatem est relâché au bout de dix jours, probablement sauvé par ses difficultés respiratoires et sa nationalité belge. Mais le souvenir brûlant de la torture et de l’enfermement persistent. Malgré l’école qu’il a participée à fonder, Hatem ne peut demeurer dans le pays où son corps fut marqué par la cruauté des geôliers. Des années plus tard, à l’heure d’écrire ce texte qui porte pourtant prioritairement sur la suspicion en radicalisation dont il a été victime en Belgique, Hatem tient à ce qu’il soit fait un récit détaillé de la torture subie aux mains de la Sureté d’État égyptienne : « Je veux que les gens comprennent qu’il n’y a pas de différence de nature entre ces États, seulement une pluralité de moyens. L’Égypte était pire que tout, ça ne fait aucun doute, mais la War on Terror n’y a pas commencé et ne s’y est pas finie ».
En quittant le Caire, Hatem ne renonce pourtant guère à la quête intime qui l’y avait mené. En 2004, il va au Yémen, « un pays qui m’a toujours intrigué ». À Sa’ada, dans le Nord du pays, il suit l’un des principaux séminaires religieux du pays, dont les enseignements regroupent plusieurs milliers d’étudiants. Achetant une petite maison en terre cuite dans une vallée où l’on cultive des vignes à zabib[7], il y adopte un mode de vie rustique – « pas d’eau courante, pas d’électricité à part deux heures le matin et deux heures le soir, une petite bonbonne de gaz pour cuisiner ». Si le Caire avait été le lieu d’une effervescence politico-religieuse désordonnée et inscrite dans une métropole elle-même de taille démesurée – Hatem dit « la ville ne dormait jamais –, le Yémen offre en contraste la possibilité d’une existence en partie préservée des vicissitudes de la vie moderne – « deux mondes différents ». Quoique l’afflux d’étudiants étrangers y soit au moins d’égale importance qu’au Caire, ceux-ci s’inscrivent ainsi – avec plus ou moins de succès – dans la multiplicité des structures d’enseignement traditionnelles que fréquentent d’abord les natifs du pays et autres arabophones.
Intégralement dédiée à l’étude, la vie quotidienne est scandée par la succession des enseignements classiques que chacun suit au gré de sa progression[8] : après fajr[9],l’apprentissage par cœur du Coran, puis le tafsîr[10]d’ibn Kathir[11] à la suite de doh’r[12] ; après ‘asr[13], un cours sur Sahih al-Boukhari, d’après le tafsîr de ibn Hajr al-Asqalani[14] ; après maghreb[15], Sahih Muslim[16], selon le tafsîr de l’imam an-Nawawi[17]. Cinq mille personnes – essentiellement des Yéménites, mais aussi des Américains, Britanniques, Indonésiens, Sénégalais etc. – assistent en rangs serrés aux enseignements dispensés dans la mosquée-markez[18] : « tous les jours, le professeur désignait au hasard un étudiant pour réciter tel ou tel hadith ou verset devant toute l’assistance », se souvient Hatem.
Six ans après son arrivée au Yémen, Hatem déménage à Hadramaout – dans un village situé aux confins orientaux du pays. En son sein, Hatem découvre surtout une nouvelle facette de la société qui l’accueille : « des gens d’une générosité inégalable, ils étaient si doux et si profonds que je m’étais juré que je mourrais parmi eux. Je suis tombé amoureux de ce peuple, je les ai aimés de tout mon cœur ». Le faible coût de la vie lui permet de ne travailler que ponctuellement pour des missions d’interprétariat ou de traduction à distance – « parfois je faisais de la traduction de DVD par exemple » – dont la rémunération – établie selon la norme européenne – lui permet en retour de subsister pendant de longues périodes.
Comme à chacune des étapes de son parcours, Hatem ne rompt ni avec sa famille ni avec la société belge – et plus généralement européenne. Il fait ainsi la rencontre virtuelle d’une jeune femme, Française d’origine marocaine, avec laquelle il conçoit le projet de se marier – tout en tenant à lui donner un complet aperçu du mode de vie qu’il a embrassé. Sa mère et ses deux sœurs rendent visite à sa future belle-famille à Courbevoie, avant que Hatem ne revienne à son tour en Europe pour procéder à la cérémonie religieuse – en France – et à celle civile à l’administration communale de Schaerbeek – « une salle magnifique dont le plafond en bois est splendide ». Le couple – dont naissent au fil des années trois enfants – vit dans la modeste demeure de Hatem à Hadramaout. « Mon épouse s’est aussi mise à l’étude. J’étais très fier d’elle, elle est très courageuse », dit Hatem. Leur famille demeurée en Europe les retrouve d’été en été au Yémen ou dans les pays voisins, comme lorsque la mère de Hatem loue une maison à Oman pour de « magnifiques vacances à la mer ».
Par-delà les circulations régulières entre l’Europe et le Moyen-Orient, le lien qui persiste est également de facture politique et intellectuelle. Peu de temps après son arrivée au Yémen, Hatem prend ainsi l’initiative de répondre à deux chercheurs dont il conteste les travaux quant à la tradition islamique. Cet acte – qui est autant celui de la critique que de l’interlocution, puisque Hatem acceptera de rencontrer les universitaires qu'il incrimine– sera fondateur de fréquentes interventions sur la variété des enjeux liés aux communautés musulmanes d’Europe.
Aux côtés de l’étude et de sa vie familiale – toujours marquée par la rusticité des conditions de vie dans le sud du Yémen –, Hatem débute une véritable carrière d’essayiste et de chercheur. Ses articles se succèdent à un rythme soutenu et intéressent un lectorat en majorité musulman – quoique les vieux amis de sa famille, liés à l’extrême-gauche belge ou à la cause palestinienne, suivent également ses travaux. Ses articles s'attachent à la question minoritaire en Europe, l’islamophobie, la période coloniale ou aux luttes pour la libération afro-américaine dont Hatem, fidèle à l’histoire familiale, ne s’est jamais détourné. Au sein de l’espace discursif musulman francophone – à la fois relativement étroit et riche de controverses –, sa production lui vaut d’entrer en discussion avec une variété d’auteurs et d’établir avec ceux-ci les liens ordinairement à l’œuvre dans tout champ de production intellectuelle – soit le spectre de relations allant de la complicité à l’adversité idéologique. Mais les articles qu’écrit Hatem sont le plus souvent mal accueillis parmi ses coreligionnaires français au Yémen : « ils m’ont reproché de répondre, mais pour moi il n’était pas question de sortir du monde. Je ne comprends pas ce qu’il y aurait de moral ou de religieux dans le fait d’abandonner le savoir ou la politique à d’autres, pour ne passer notre temps qu’à commenter et nous gargariser des bisbilles d’aucune utilité. Hélas, il me semble que ceux qui m’attaquaient sur cette base-là faisaient preuve de beaucoup d’immaturité ».
Il est vrai que Hatem retrouve ainsi un motif régulièrement observé tout au long de sa trajectoire : vivant une existence qu’il qualifie comme « à l’écart de tout », il maintient un intérêt de premier ordre pour la politique européenne. Cette distance – entre sa vie pratique et idéelle – n’est guère paradoxale selon lui : engagé dans l’utopie d’une existence autre, Hatem ne renonce pas à la trame longue des enjeux politiques et historiques qui ont marqué son parcours biographique. La somme de ses appartenances persiste ainsi, quoique retirée du monde soit sa vie pratique.
Mais l’éclatement de la violence généralisée rattrape Hatem et sa famille. Après onze ans de vie au Yémen, l’intensification de la guerre civile à laquelle se livrent les Houthis[19] et le gouvernement né de la révolution de 2011 le contraint à quitter le pays. Hatem reçoit un appel paniqué de la consule belge en Arabie Saoudite : « vous êtes les derniers Belges au Yémen, ne voulez-vous pas partir ?! ». La mort dans l’âme, Hatem et sa famille quittent définitivement le Yémen en 2015 : « quand j’y pense maintenant, je me dis que j’étais un fou. Tombé amoureux de ce peuple-là, c’était beaucoup plus que talab al ‘ilm[20], j’étais tombé amoureux de ce monde-là et de ces gens-là. J’ai trouvé une utopie et j’y ai vécu. C’était un peu ça dans le monde du hip-hop, on s’était un peu créé notre propre monde pour être, non pas accepté, mais pour vivre comme on le souhaitait et comme on pensait être. Et maintenant, je suis retourné ici ! ».
(La suite de ce texte est disponible ici.)
[1] Au-delà de la différence religieuse, ce motif est également affirmé par ses sœurs qui voyagent régulièrement, y compris dans la dimension du retour à soi. L’une a ainsi longuement vécu en Palestine.
[2] https://ibaanah.com/
[3] Le sous-titre de l’école est Mastering Arabic with Excellence.
[4] Célèbre cantatrice égyptienne du XXe siècle.
[5] Al-Azhar est une prestigieuse mosquée-université au sein de l’espace de la tradition islamique.
[6] Quartier du Caire qu’a rendu mythique un roman éponyme de Naguib Mahfouz.
[7] En arabe, des raisins secs.
[8] MESICKS, B., 1993. The Calligraphic State. Textual Domination and History in a Muslim Society, Berkeley: University of California Press
[9] Première prière de la journée.
[10] Le terme, classique dans l’espace de la tradition, signifie l’exégèse.
[11] Ibn Kathir (1300-1373) est un célèbre historien et théologien arabe médiéval.
[12] Seconde prière de la journée.
[13] Troisième prière de la journée.
[14] Ibn Hajr al-Asqalani (1372-1449) est un polymathe médiéval.
[15] Quatrième prière de la journée.
[16] Sahih al-Boukhari et Sahih Mouslim sont deux des principaux recueils compilant les récits prophétiques (hadiths).
[17] L’imam an-Nawawi (1233-1277) est un théologien médiéval réputé pour ses travaux sur les récits prophétiques.
[18] En arabe, le centre. Le terme désigne dans ce contexte le centre d’enseignement.
[19] Les Houthis sont une tribu yéménite où a pris forme un mouvement revivaliste chiite de tendance zaydite. Dans le contexte post-2011 au Yémen, ils sont parmi les principaux concurrents pour la prise de pouvoir dans le pays.
[20] En arabe, la quête de la connaissance.

