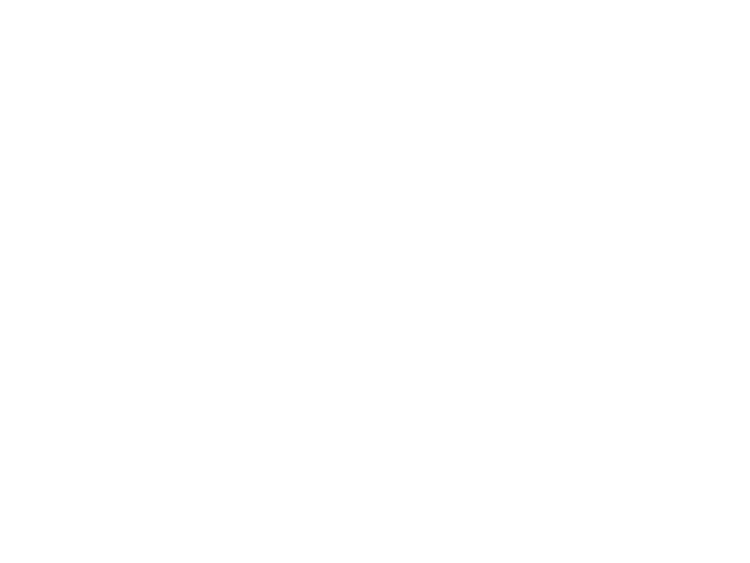
Hatem, ou la mésentente (1)
Elias Lahlou et Hatem Muhammad
« – Sur quoi me méprendrais-je donc ? demanda K.
– C’est sur la justice que tu te méprends, lui dit l’abbé, et il est dit de cette erreur dans les écrits qui précèdent la Loi : Une sentinelle se tient postée devant la Loi ; un homme vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer. Mais la sentinelle lui dit qu’elle ne peut pas le laisser entrer en ce moment. L’homme réfléchit et demande alors s’il pourra entrer plus tard. “C’est possible, dit la sentinelle, mais pas maintenant.” La sentinelle s’efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l’homme se penche pour regarder l’intérieur. La sentinelle, le voyant faire, rit et dit : “Si tu en as tant envie essaie donc d’entrer malgré ma défense. Mais dis-toi bien que je suis puissant. Et je ne suis que la dernière des sentinelles. Tu trouveras à l’entrée de chaque salle des sentinelles, de plus en plus puissantes ; dès la troisième, même moi, je ne peux plus supporter leur vue.” L’homme ne s’était pas attendu à de telles difficultés, il avait pensé que la Loi devait être accessible à tout le monde et en tout temps, mais maintenant, en observant mieux la sentinelle, son manteau de fourrure, son grand nez pointu et sa longue barbe rare et noire à la tartare, il se décide à attendre quand même jusqu’à ce qu’on lui permette d’entrer. »
Le procès, Franz Kafka
La trame narrative du Procès est de rare simplicité : K., probablement calomnié, fait face à la machine judiciaire. Celle-ci est aussi implacable qu’informe, si bien que le personnage principal est lancé sur la trace d’une instruction dont le secret ne lui est jamais révélé. L’étau inextricable se resserre à mesure que, de l’audience initiale de K., menée dans un vague grenier tenant lieu de tribunal, à la paisible exécution nocturne qui clôt le récit, la Loi se fait ainsi fuyante[1].
Fort heureusement, le destin de Hatem, co-auteur de cet article et acteur au cœur du récit qui le fonde, est bien moins funeste. La longue série des accusations énoncées à son encontre a pourtant été lourde de conséquences : perte d’emploi, suspicion infâmante, fragilisation intime et familiale etc. À l’instar du protagoniste du Procès, Hatem a fait face à un engrenage dont rien n’était défini à l’avance. Aujourd’hui encore, alors que l’accusation initiale a été levée, le ministre de l’Intérieur d’un pays voisin a personnellement porté plainte contre lui, au titre de la critique exprimée par Hatem à son encontre.
Car Hatem a été suspecté de radicalisme islamique. Comme K., la notification des charges pesant contre lui fut impromptue : un jour, au travail, son employeur – un organisme fédéral belge au sein duquel Hatem est interprète – lui signifie que son contrat ne peut être renouvelé. L’avis de sécurité, auquel sont astreints l’ensemble des salariés de cette institution publique, fut retourné négatif à la suite d’une note anonyme de la Sûreté d’État. Probablement calomnié par certains de ses collègues, la condamnation de Hatem a de facto été immédiate. Comme K., la lutte pour l’explicitation de l’accusation fut le point de départ d’un long parcours judiciaire qui, à la différence du protagoniste du Procès, a abouti au retrait de l’accusation. Hatem se sait pourtant en sursis : à tout instant, il pourrait être de nouveau signalé et de facto condamné.
L’exclusion de Hatem de son emploi puis sa réintégration un an plus tard ne provoquèrent ni article de presse ni pétition en défense de l’accusé-condamné. Quoique lourde d’effets, l’accusation en radicalisme islamique – et le processus qu’elle induit – est en effet banale : en Belgique, plusieurs dizaines de milliers de signalements ont ainsi été effectués entre 2015 et 2019[2], conduisant à de multiples perquisitions administratives, pertes d’emploi et interdictions de déplacement, en sus de milliers de fermetures d’associations.
Mais si l’ensemble des aboutissements matériels de la lutte contre la radicalisation – le plus souvent conduite sur un mode extra-judiciaire[3] – doivent alimenter le débat quant aux déterminants normatifs de la répression et aux formes qu’elle revêt au sein des sociétés libérales et séculières, le propos au fondement de cet article s’attachera essentiellement à un autre versant de la séquence historique dont il s’agit. Par l’interrogation du parcours de Hatem, il s’agira ainsi d’interroger la politique de la mésentente dont la manifestation essentielle est le travestissement du parcours de vie des radicalisés et leur expulsion hors de la totalité collective et de ses régimes de significations.
Face au soupçon, cette contre-enquête reconstituera autrement la trajectoire biographique de Hatem. Si l’on ne nie guère la singularité politico-religieuse – Hatem est bel et bien mû par une variété d’idéaux et de pratiques afférentes –, il s’agira ainsi de proposer une lecture de son parcours que l’on affirme plus attentive à son inscription dans la société globale. Aux sentinelles bloquant le passage de la compréhension, il faut ainsi opposer le principe de commensurabilité des expériences humaines et de leurs déterminants subjectifs, selon un postulat relationniste inspiré de la sociologie de la connaissance de Karl Mannheim[4].
Le dispositif d’enquête témoigne de cette intention. Le protagoniste principal de l’affaire et l’anthropologue qui le rencontre examinent conjointement les enjeux que la trajectoire du premier manifeste pour tous. En sus de l’usage de citations longues qui introduisent ainsi la parole de Hatem non médiatisée, le propos du texte est strictement tributaire des liens réflexifs opérés par la multiplicité des entretiens – et des débats – conduits entre l’un et l’autre. Cette réflexivité en partage entre l’interprète, qui médite sa trajectoire biographique et la présente régulièrement à divers publics, et l’anthropologue, qui l’interroge à nouveau,a pour fondement la volonté commune d’éprouver la possibilité de la réception des singularités – tant intimes que collectives – parmi le cercle des contemporains.
Une enfance à Schaerbeek
Hatem, l’interprète que l’on ne comprend guère, est né en Belgique d’un père palestinien et d’une mère originaire de Flandre occidentale. Dans ce pays où la question linguistique préside tant aux appartenances collectives, Hatem n’aura ainsi de cesse de se prévaloir de son statut de natif néerlandophone lors de ses interactions avec les autorités, tant celles liées au soupçon en radicalisme islamique que la trame – étirée sur une vie – des contrôles au faciès, des sélections aléatoireslors des passages de frontières ou du tutoiement principiel par les forces de l’ordre[5].
Si l’usage du néerlandais comme contrepoint au stigmate racial peut sembler paradoxal à la lumière d’un nationalisme flamand peu enclin à la sympathie à l’égard de l’immigration postcoloniale en Belgique, celui-ci correspond pourtant fidèlement à l’histoire familiale dont Hatem est l’héritier. Sa mère, Thérèse, étudiante à la KU Leuven en 1967, a ainsi activement pris part à l’important mouvement contestataire qui aboutît à la scission entre l’université flamande et sa partie francophone, appelée à se refonder de manière autonome sous le nom d’Université catholique de Louvain-la-Neuve[6]. À la suite de cette expérience qu’elle décrit comme fondatrice, la jeune femme, désormais diplômée en psychologie, s’installe aux États-Unis. Elle s’y joindra à la lutte pour les droits civiques et participera au soutien des activistes afro-américains poursuivis par la justice américaine.
Dans l’effervescence politique et culturelle des États-Unis d’alors, Thérèse fait la rencontre de Raheeb, qui deviendra rapidement son mari. Palestinien, originaire d’un village montagnard nommé Tamra, son militantisme d’inspiration marxiste-léniniste lui a valu de fréquentes arrestations par les autorités israéliennes, jusqu’à le décider à quitter définitivement le pays en 1967. La scène du départ, hautement cinématographique, est racontée par Hatem : émigrant seul, Raheeb fait ses adieux aux habitants de son village (dont ses parents, sept sœurs et trois frères) descendus de leur montagne pour l’accompagner au port d’Haïfa, d’où il prend le bateau qui le mènera en Amérique après la longue traversée des eaux. Raheeb ne revit sa famille qu’une décennie plus tard, accompagné de Thérèse, lors d’un premier retour au pays natal.
Au début des années 1970, le couple s’installe à Washington et vit de l’emploi de Thérèse comme secrétaire à l’ambassade de Belgique, ainsi que des cours d’arabe que dispense Raheeb. Maintenant une intense activité intellectuelle et politique, l’un et l’autre s’engagent au sein des mouvements pour la libération afro-américaine, dont Hatem parle plusieurs décennies plus tard avec la proximité d’une histoire familiale continuée : « c’était l’époque où tout le monde lisait Fanon, les Afro-Américains savaient ce qui se passait en Palestine ou en Algérie », dit-il en ne cachant guère sa nostalgie.
Hatem ne nait pourtant qu’en 1977, quatre années après le retour de ses parents en Belgique. Deux sœurs suivent alors que la famille s’installe à Schaerbeek, commune parmi les plus pauvres de Bruxelles. Thérèse travaille à l’inspection sociale puis au sein d’une institution fédérale. Raheeb, qui ne parle ni le français ni le néerlandais, a d’abord du mal à trouver un emploi mais finit par travailler à la Fonderie – un musée dédié à l’industrie à Molenbeek. En parallèle, l’activité politique du couple se poursuit : Hatem fait ainsi récit de fréquentes visites au foyer familial des militants du Parti des travailleurs de Belgique et de l’hébergement régulièrement offert aux réfugiés palestiniens de passage à Bruxelles. Aussi l’enfant lit-il précocement les brochures politiques que ses parents ont ramenées d’Amérique, en même temps que la biographie de Malcolm X qui lui fait forte impression.
Il est vrai que la prime jeunesse de Hatem est marquée par la condition postcoloniale en partage parmi les adolescents de son quartier. S’il est l’enfant d’une mère belge, la filiation ne suffit guère à résorber le statut minoritaire dont il fait l’expérience au sein de l’école flamande[7] qu’il est le seul Arabe à fréquenter : « j’ai toujours senti que j’étais différent, on te le rappelle chaque jour », dit Hatem. Deux incidents en particulier affectent une scolarité par ailleurs réussie : d’abord, un grave conflit qui l’oppose à une enseignante niant le malheur palestinien, lui causant trois jours de renvoi disciplinaire, puis un autre, plus violent, où un condisciple le traite de « macaque » – terme que certains Flamands disent en français pour avoir l’assurance d’être compris par ceux à qui ils l’adressent, c’est-à-dire aux « Marocains[8]». À la suite de l’injure, Hatem mobilise ses amis du quartier qui intimident efficacement – mais sans violence – le jeune raciste qui « ne m’a plus regardé dans les yeux de l’année », dit Hatem rieur. Au quartier, il arrive qu’une descente de police conduise à la détention pour quelques heures de l’ensemble des badauds présents : au cours de l’un de ces coups de filet, Hatem se souvient avoir demandé – toujours en néerlandais – son motif au policier en train de l’arrêter. Le jeune homme – alors âgé de 14 ans – ne reçut pour toute réponse qu’une violente gifle.
Par-delà l’expérience réitérée du racisme, la complicité au sein de la bande des drari[9] de Schaerbeek est aussi intense que structurante des parcours de vie, comme souvent en contexte de marginalité protéiforme[10]. Tout au long des entretiens réalisés, il n’est pas rare que Hatem réponde par la description du quartier et de ses sociabilités à une question portant sur sa famille et les transmissions en son sein. Les liens qui se tissent entre adolescents ne correspondent pourtant guère à l’immédiateté d’une « communauté de sang[11] » que l’on a tôt fait de postuler parmi ceux et celles qui partagent des « origines » communes. Si Hatem est l’un des rares au quartier à ne pas être « Marocain », les formes de solidarité à l’œuvre au sein d’une même génération d’enfants d’immigrés sont entièrement fondées par l’expérience positive – c’est-à-dire de part en part agissante – de Bruxelles et de l’époque[12]. Hatem fait ainsi longuement état des activités auxquelles ses amis et lui s’adonnent au tournant des années 1990 : les tags, les « virées » nocturnes durant lesquelles ils graffent en signant « CNN » – pour « Criminels non négligeables », qui deviendra un célèbre groupe de rap bruxellois[13] –, la découverte du hip-hop afro-américain que Hatem, seul à comprendre l’anglais, fait découvrir à son « crew » (en particulier N.W.A, Public Enemy ou The Fugees), les nombreux concerts auxquels ils assistent, etc. Ainsi l’ensemble disparate des pratiques culturelles conçues et éprouvées au sein de la société d’accueil atteste-t-il de l’expérience historique d’une intégration – c’est-à-dire de la pleine inscription dans la trame historique en partage – de facto parachevée.
L’époque est aussi celle du « trafic ». Dans ce quartier « très sale, avec des meurtres, beaucoup de vol et de drogues », certains au sein de la bande s’engagent dans le commerce aussi effréné que dangereux de la revente d’héroïne. Si Hatem n’y prend guère part, la force des liens amicaux lui vaudra une perquisition au domicile familial – à laquelle aucune suite n’est cependant donnée. Hatem comprend pourtant qu’il doit s’éloigner. Au quartier, seuls ses sœurs (l’une deviendra ingénieure civile, l’autre biologiste) et lui-même mènent des études universitaires : « bien souvent, j’avais des examens mais on me proposait une virée ou un concert. Et tu ne peux pas dire non, c’est ton crew ! », dira-t-il trois décennies plus tard.
Aussi part-il pour Anvers où il emménage dans un kot[14] : dans la métropole flamande du Nord, Hatem entame des études d’interprétariat. Lorsqu’il évoque ce qui l’a poussé à choisir cette voie, Hatem expose placidement un motif – la déliaison entre son travail et ce qui s’affirmera de plus en plus comme une quête existentielle – repérable à plusieurs périodes de son existence : « J’ai voulu faire au plus simple. On parlait déjà tellement de langues à la maison et ma vie à côté était bien remplie ». À Anvers, il écrit pour deux importants fanzines musicaux, Rif Raf et Pulp Magazine. Pour l’un comme pour l’autre, Hatem assure la critique d’albums de rap qu’il reçoit à intervalles réguliers, tout en interviewant les artistes de passage en Belgique. Il rencontre ainsi quelques-unes des plus importantes vedettes de la scène internationale de hip-hop : Ice-T, le groupe Wu-Tang Clan[15] et d’autres lui accordent des entretiens exclusifs. Paradoxalement, Hatem explique son délaissement progressif du rap et, concomitamment, son entrée en religion par la déception que lui causent certaines de ces rencontres. Chuck D., l’idole de jeunesse et charismatique leader du très engagé groupe de hip-hop afro-américain Public Enemy, ne l’impressionne guère. Joey Starr, tête d’affiche de Suprême NTM qui jouit alors d’une immense popularité, le surprend par « sa grande arrogance ». Il peut paraître incongru que Hatem rapporte son regain de piété religieuse, ressenti au début de sa vingtaine, au désenchantement à l’égard du mode d’existence qu’il avait si passionnément adopté tout au long de sa première jeunesse. L’apparente contradiction accuse la distinction de nature qui est tenue pour opposer l’engagement dans la tradition islamique et celui au sein d’une pratique culturelle séculière. S’il ne s’agit pas d’en postuler l’équivalence, le rap comme la réaffiliation à la tradition islamique fondent cependant des formes de vie, c’est-à-dire des « nexus de pratiques » qui opèrent comme autant de « résolutions de problèmes[16] ». S’agissant de Hatem, l’échec de l’une aboutit à l’autre : quoique l’activité musicale et l’engagement religieux diffèrent substantiellement, leur mise en rapport est permise par le lieu même où s’opère le passage, c’est-à-dire le parcours de vie de celui qui en fait l’expérience successive.
Mais Hatem ne fait guère état de la césure biographique que l’on impute souvent au passage d’une « conscience » à l’autre. À rebours d’une tendance politico-académique prompte à repérer l’influence – insidieuse ou spectaculaire – « d’entrepreneurs identitaires[17] » sur des acteurs auxquels est déniée toute profondeur subjective, Hatem n’a pas été « converti » par une « offre symbolique[18] » réputée extérieure – ce qui ne veut pas dire que, plus tard, il ne se sentira pas plus proche de l’un ou l’autre courant religieux ou politique. Aussi n’offre-t-il tout au long de l’interlocution nul grand récit de conversion – au-delà de la blague pleine d’à-propos : « je me suis radicalisé, je suis passé du côté obscur de la force ». Hatem indique simplement avoir ouvert la première fois un Coran en sa version franco-arabe dans la chambre du leader de son groupe de musique. Alors que celui-ci travaille sur un « son », Hatem assis sur le lit de son hôte parcourt les premières pages du texte sacré et en ressent une émotion fondatrice.
L’entrée en religion n’est pourtant qu’un tournant relatif. Ainsi Hatem poursuit-il ses études à Anvers, obtenant son premier diplôme d’interprète français-anglais-néerlandais (des années plus tard, il ajoutera l’arabe – en sa version standard et dialectale). Similairement, les profonds liens amicaux qui l’unissent à son « crew » sont maintenus. Il est vrai que le rap comme la réaffiliation à la tradition islamique naissent au sein d’un même tissu collectif, ce dont témoigne la densité des circulations de personnes et d’idéaux entre l’une et l’autre forme de vie. Hatem, faisant le bilan des loyautés de sa jeunesse, saisit ainsi d’un même geste la variété des potentialités subjectives à l’œuvre au sein d’une condition historique partagée : « certains ont percé dans la musique ou les arts, d’autres sont devenus religieux et quelques-uns ont fait de la prison ou sont morts. Cette hétérogénéité m’a toujours étonné : dans les quartiers bourgeois, pendant les réunions d’amis d’enfance, tout le monde partage sa réussite sociale : travail, achats de maison, vacances, à chaque fois selon le même modèle. Avec les miens, il y a tellement de parcours, je suis toujours très heureux d’apprendre qu’un ancien dealer de drogue s’est rangé et a fondé une famille ».
Face au surprenant retour à l’orthopraxie de Hatem et sa barbe grandissante, la réaction parentale est cependant plus difficile. Si tous vont en Palestine chaque été, la famille est « sécularisée[19] » : son père, d’héritage musulman, ne l’a guère transmis à ses enfants et est lui-même peu pratiquant, ses sœurs sont irréligieuses (l’une est athée, l’autre agnostique). Mais la force des solidarités familiales prévient toute rupture : après l’obtention de son diplôme, Hatem vit de nouveau chez ses parents qui suivent ainsi de près ses évolutions. Plus tard, lorsqu’il pérégrinera d’un pays du monde musulman à l’autre, l’ensemble de la famille lui rendra visite à chaque étape.
Aussi la réaffiliation à la tradition islamique manifeste-t-elle une « quête » – terme dont Hatem ne cesse de faire usage – qui, tout en précédant l’entrée en religion, y trouve une expression renouvelée. Celle-ci est pourtant solitaire : Hatem fréquente peu la mosquée du quartier et mène dans sa chambre tant les prières quotidiennes que la lecture passionnée d’ouvrages – classiques ou contemporains – issus de la tradition islamique. De même que le passé n’est pas congédié, la réaffiliation religieuse ne résout guère les doutes qui ne cessent de l’animer : plutôt qu’elle ne l’abolit, la « conversion » porte l’enquête intime à un plan jusque-là insoupçonné[20], si bien que Hatem ressent rapidement le besoin de l’éprouver par l’expérience pratique du monde musulman.
En 2001, il s’installe au Caire.
(La suite de ce texte est disponible ici.)
[1] Dans la lecture poétique qu’il fit du Procès, Gershom Scholem écrit ce qui suit :
« Du cœur de l’anéantissement,
perce un rayon parfois,
mais aucun n’indique la direction
que nous prescrivait la Loi».
SCHOLEM, G. 2000. Aux origines religieuses du judaïsme laïque. De la mystique aux Lumières. Paris : Calmann-Lévy
[2] Nous n’avons pas de chiffres exacts quant au nombre de signalés en Belgique mais un sénateur indique le nombre de 18 500. À titre de comparaison, la France a connu 72 000 signalements entre 2014 et 2019. Voir https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/05/30/31002-20180530ARTFIG00199-attentat-de-liege-la-belgique-est-le-pays-le-plus-touche-par-la-radicalisation-islamiste.php (consulté le 27 mai 2022)
[3] Le plus souvent, le fichage pour radicalisation et ses conséquences ne transitent pas par la justice. Il n’est ainsi examiné par un tribunal qu’en cas d’appel de la personne incriminée.
[4] MANNHEIM, K. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, Paris : Maison Sciences de l’Homme
[5] En Belgique, la loi sur l'emploi des langues en matière administrative oblige l’administration à être accessible à l’ensemble des citoyens selon leur langue maternelle parmi celles officiellement reconnues dans le pays.
[6] Cette séparation des universités flamande et francophone va ainsi jusqu’à la refondation de la ville francophone de Louvain-la-Neuve.
[7] En Belgique, le système scolaire est organisé selon la langue d’appartenance.
[8] L’immigration marocaine est quantitativement l’une des plus importantes – avec celles française ou italienne – de Belgique.
[9] Le terme drari, dont le sens est strictement biographique au sein de l’arabe maghrébin (il signifie les jeunes), a été ressaisie en Belgique selon une forme singulière de romantisme. Par-delà le type social qu’il désigne, il atteste ainsi la force des liens parmi ceux qui partagent une expérience commune. Le terme drari a un symétrique négatif, le flamand. Voir KOLLY, M. 2019. Histoires de travail social, de quartier et d'école. Histoires de drari et de flamands, Louvain-la-Neuve : Éditions Academia
[10] MOHAMMED, M. 2011. La formation des bandes : Entre la famille, l'école et la rue, Paris: Presses Universitaires de France
[11] TÖNNIES, F. 2010 [1887], Communauté et société, Paris : Presses universitaires de France
[12] Le Maroxellois est le terme-valise indiquant ainsi la force de la création culturelle parmi les enfants de l’immigration marocaine en Belgique.
[13] Voir image.
[14] Le kot est un terme belge signifiant une chambre d’étudiant dans une maison partagée.
[15] Voir image.
[16] JAEGGI, R. 2018. Critique of Forms of Life. Cambridge : Harvard University Press
[17] ROUGIER, B. 2020. Les territoires conquis de l’islamisme, Paris : Presses universitaire de France
[18] TRUONG, F. 2018. Loyautés radicales, Paris : La Découverte
[19] Le terme est de Hatem.
[20] MICHEL, P., HEURTIN, J-P. 2021. La conversion et ses convertis, Paris : Politika

