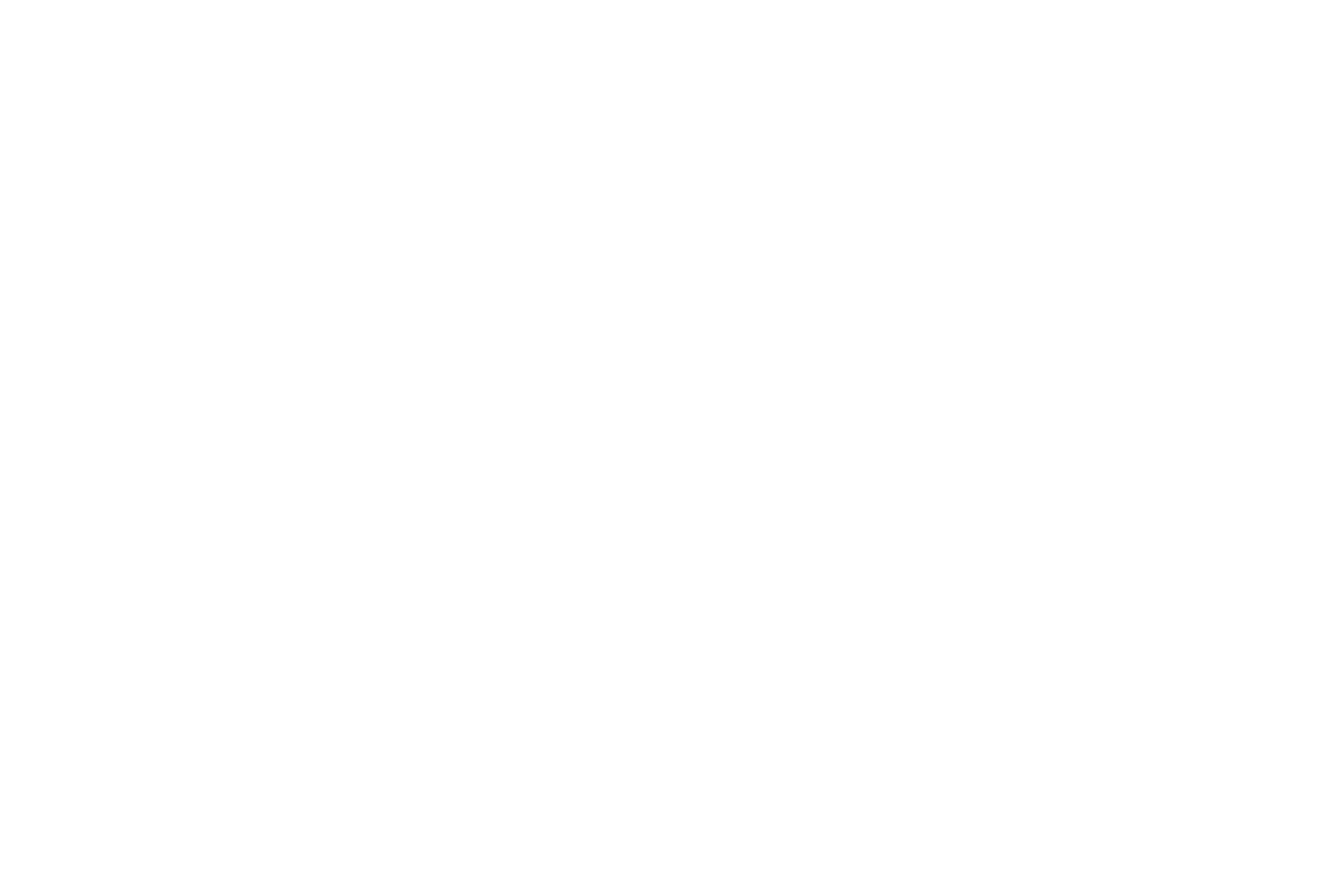
La grammaire d'un fétiche. Maroc, Sahara et retour
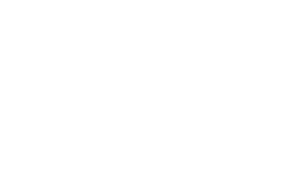
Elias Lahlou
Ce qui suit n’est pas une analyse de la société sahraouie. On ne s’y risquerait pas, n’étant ni spécialiste de la région ni issu des gens qui en peuplent les confins. L’exercice qui a été demandé n’est de toute façon pas celui-là : une invitation a été lancée à l’auteur de ces lignes, en tant qu’il est « intellectuel marocain », à proposer une perspective sur le conflit qui oppose son pays au mouvement indépendantiste sahraoui depuis le départ de la puissance coloniale espagnole en 1975 et la proclamation, un an plus tard, de la République arabe sahraouie démocratique (plus communément désignée sous le nom de Front Polisario). On a alors accepté, moins par esprit de défi que partant du postulat que, aussi peu soit-on lié au Sahara, celui-ci engage cependant tout Marocain. La nature du lien doit pourtant être spécifiée : si l’on a quelque chose à dire en tant que tel, ce ne peut être qu’en creux du nationalisme dont le nom au Maroc est précisément « Sahara ». La qualification parait n’agir ainsi au corps défendant de celui qui écrit ces lignes, dont le propos s’établit nécessairement par le refus de la détestable poussée nationaliste et sa bruyante traque de « l’ennemi » qui contraignent tant l’espace de la discussion au Maroc. Aussi l’interpellation en tant que Marocain doit-elle permettre d’interroger de la faillite des États postcoloniaux à préserver les formes de vie et de solidarité que défait la poussée libérale contemporaine : face à l’individualisme forcené de la « culture de l’opportunité[1] », l’État n’oppose qu’un nationalisme aussi braillard que délié du réel.
Est-il pourtant possible de dire autre chose ? Peut-on fonder un propos qui ne serait pas qu’un maigre contrepoint à ce qui parait tout emporter sur son passage ? On a dit que la question du Sahara engageait l’auteur en tant que Marocain : l’interpellation opère-t-elle cependant autrement qu’en négatif ? Quel sens politique aurait ainsi la quête d’une alternative que l’on voudrait socialiste, c’est-à-dire respectueuse des aspirations à la justice qui ne cessent de traverser le collectif[2] ? Si elle n’y est guère réductible, la question trouve son foyer le plus éclatant au Sahara, c’est-à-dire là où la tension conjointement née de la forme historique prise par l’État postcolonial et de sa contestation est la plus aigüe.
L’illusion historique
On déclame une phrase convenue : « le Sahara est marocain ». Elle est l’offrande sacrifiée à un fétiche collectif : si l’affirmation n’est que rarement suivie de justification – on ne dit pas « le Sahara est marocain parce que … » –, son irruption dans l’espace public est si régulière qu’elle rassérène le réel. Puisque « le Sahara est marocain », l’ordre des choses que le décret sous-tend demeure ainsi soutenable. Quand l’explicitation est néanmoins exigée – aux risques et périls de qui remet en cause une formule tant répétée –, celle-ci semble permise par l’histoire : la marocanité du Sahara est, dit-on, établie par une succession pluriséculaire dont atteste la bay’a – serment d’allégeance traditionnel – de l’une ou l’autre tribu à l’un ou l’autre sultan. Rétablissant alors la continuité par-delà la colonisation et les modes de souveraineté – peu importe que le sultan soit devenu chef d’un État-nation moderne, à la suite d’un processus qui trouve sa racine dans l’occupation européenne –, le décret gagne en profondeur discursive : « le Sahara est marocain » parce qu’il en a toujours été ainsi. Allal el-Fassi, le fondateur du nationalisme marocain, ne considérait-il pas que les droits historiques du sultan s’étendaient jusqu’au fleuve Sénégal ? Il est vrai que le nationalisme anticolonial a puissamment réinvesti la tradition monarchique[3]: face à l’effacement de soi dans le cours de l’occupation européenne, il s’agissait de retrouver la chaleur d’une histoire passée.
Une vérité réputée immuable ne suffit pourtant guère à établir un fétiche, il faut lui adjoindre le récit grandiose d’une conquête collective. Au Maroc, celle-ci se nomme Marche verte : en 1975, le roi Hassan II dépêche ses sujets – armés de corans et du drapeaux nationaux – sur le sol du Sahara récemment évacué par la puissance occupante espagnole. Abdellah Laroui, le grand historien marocain, reconstitue les mots du monarque appelant à réaliser le dessein collectif de la nation : « aujourd’hui, ce n’est pas l’homme, occupant le trône du Maroc, qui vous parle, c’est celui qui symbolise l’État et la tradition royale, qui a prononcé le serment de la bay’a. Le Maroc est en danger, l’heure a sonné de renouveler ce serment. Réincarnant tous les rois du Maroc qui ont honoré leur parole, je prends solennellement l’engagement que, quoi qu’il arrive, quoiqu’il en coûte, je n’accepterai pas que le Maroc soit mutilé. J’ai fait mon choix. A toi, mon cher peuple, de faire le tien[4] ».
Le fétiche s’atteste ainsi en un dessein existentiel qui à son tour est tenu pour fonder la nation – « à toi, mon cher peuple », dit le chef de l’État par la bouche de Laroui. Fictio figura veritatis[5], la Marche verte opère comme une régénération collective après les affres d’une indépendance hautement conflictuelle et dont la mémoire est susceptible de permettre la critique de l’État postcolonial. La commémoration de 1975 prend ainsi le pas sur celle de 1956[6], en même temps que l’unité du corps constitué de la nation est désormais réputée réalisée autour de la « tradition royale ».
À l’évidence, un tel discours ne survit guère à la critique historique que l’on adresse – à raison – à tout nationalisme : l’allégeance de certaines tribus au sultan n’a rien de commun avec la souveraineté territoriale des États modernes, les luttes anticoloniales de la région n’ont pas attendu, tant s’en faut, l’appel à « renouveler le serment » qu’adressa le monarque à son « cher peuple », l’Armée de libération nationale[7] – rare expérience de résistance anticoloniale à l’échelle maghrébine où s’est éprouvée en pratique la solidarité des Sahraouis et des Marocains « de l’intérieur » – fut défaite par l’alliance de l’ancien colonisateur et de l’État marocain nouvellement indépendant, le récit si répété de la Marche verte fait fi de la réalité d’une glorieuse épopée qui a à peine pénétré le territoire réputé conquis avant de se retirer etc.
Mais la tension la plus aiguë est logée dans la réification qu’un tel récit produit nécessairement, tant pour les Sahraouis qui en sont absents que s’agissant de la totalité du « peuple » appelé à faire son choix d’une seule voix. Il est vrai que le nationalisme, en particulier lorsqu’il se superpose si finement à l’étatisme, s’abstrait de la réalité de la société qu’il prétend sublimer. Au profit de l’image fétichisée d’un collectif anhistorique réuni autour de son chef, tant la conflictualité que les formes vécues de solidarité sont niées. En conséquence, l’expérience pratique des acteurs et les constructions collectives qu’ils établissent, soit l’espace nécessaire de toute politique, s’en trouvent durablement oblitérées.
L’illusion grammaticale
Aussi le Sahara vu par l’État postcolonial est-il d’abord la voie privilégiée du gouvernement des Marocains pris dans leur ensemble : la régénération nationale dont la Marche verte est réputée l’expression la plus aboutie trouve ainsi son prolongement dans l’unanimité ordonnée autour de l’autorité du chef de l’État. Le décret – « le Sahara est marocain » – est finalement plus grammatical qu’historique : moins qu’une description, le fétiche est un rappel à l’ordre des choses, celui de la souveraineté de l’État sur ses administrés dont il est attendu l’allégeance inconditionnelle. L’acte est performatif : l’unanimisme attendu est en pratique atteint par l’irruption du fétiche dans l’espace public ou privé, si bien qu’il n’est pas rare de l’entendre déclamé hors tout contexte, sous les atours imposants d’une vérité incontestable.
On lui adjoint pourtant un autre mot d’ordre au fonctionnement similaire : « de Tanger à Lagouira », de la pointe nord du Maroc au village sahraoui le plus reculé, où l’ellipse figure l’étendue de la souveraineté territoriale de l’État marocain. Une fois encore, le lissage discursivement opéré est constitutif du nationalisme si délié du réel : peu importe que Lagouira soit un village déserté à la suite de la guerre et depuis demeuré sous le contrôle effectif de l’État mauritanien ou que Tanger compte en son sein parmi les plus pauvres quartiers du pays, pas plus qu’il n’importe que l’État marocain ait lui-même construit le « mur des sables » divisant le Sahara – d’un côté le territoire sous son autorité militaire et de l’autre celui sous le contrôle du Polisario – et rejetant par-delà la frontière ainsi constituée une partie de sa population, le mot d’ordre ne s’embarrasse guère de fidélité au réel.
Mais l’expression la plus éclatante d’un État effectivement séparé du collectif et de sa réalité est cependant plus récente : elle prend forme dans le conflit qui a récemment opposé le Maroc à l’Espagne autour de l’accueil médical accordé au chef du Polisario – figure par excellence de l’ennemi national. En rétorsion à ce qui fut ainsi vécu comme une grave offense, l’État marocain a brièvement suspendu la surveillance des frontières de Ceuta – enclave espagnole en Afrique du Nord – qu’il assure ordinairement, permettant à plusieurs milliers de Marocains – la plupart enfants ou adolescents – d’aller tenter leur chance dans les rues de l’une ou l’autre ville européenne. Il faut entendre la politique à l’œuvre dans toute sa cynique amplitude : au profit d’une causeérigée en fétiche collectif, il n’est ainsi guère inconcevable de sacrifier une partie de la jeunesse du pays – de surcroît en l’assimilant aux nuisibles que l’on lâche chez un voisin avec lequel l’on est en désaccord. Le paradoxe d’une réaction nationaliste en pratique conduite au détriment de la nation – c’est-à-dire de la communauté des gens qui la constituent – n’est qu’apparent : toute atteinte au fétiche, aussi banale soit-elle – par exemple, les soins médicaux accordés par un tiers au dirigeant ennemi –, génère un contrecoup correspondant à la gravité de la blessure narcissique qui a ainsi été éprouvée.
Congédier le fétiche
On aurait pourtant tort d’accabler l’État marocain en tant que tel. La pathologie nationaliste est intimement liée aux États-nations modernes, tant que la critique historique ou grammaticale est ainsi transposable à chacun d’entre eux. Mais l’entreprise déconstructiviste, en démontrant le caractère arbitraire de toute histoire collective, excède pourtant la nécessaire mise en lumière de l’impasse nationaliste et aboutit à un paradoxe : si toute forme d’auto-connaissance des sociétés modernes est reconduite à la superficialité d’une tradition « inventée », nulle ressource collective n’est alors opposable à la poussée nationaliste. S’agissant du Maroc, l’impasse parait alors d’autant plus réalisée que le nationalisme qui y prospère a pour condition l’offensive libérale qui défait le collectif et les liens qui le traversent. L’intrication du libéralisme et du nationalisme est ainsi fermement établie : l’un efface les formes historiques de solidarité, l’autre projette une image aussi irréelle que fétichisée de la nation.
Aussi s’agit-il de congédier le fétiche autrement que par la négation de toute expérience collective, si bien que l’alternative ne peut alors être que socialiste, c’est-à-dire fondée sur la défense des solidarités et formes de vie en pratique éprouvées. Une telle politique, si elle a ainsi pour indépassables coordonnées épistémologiques la matérialité du réel et l’expérience historique des acteurs, affirme néanmoins que la société est affaire de tous et toutes : la réflexivité collective est ainsi opposée à la pathologie nationaliste et aux mots d’ordre qu’émettent les États séparés.
La politique socialiste est alors seule capable d’opérer le si nécessaire dépassement du nationalisme postcolonial, au Sahara comme au Maroc « de l’intérieur ». Il ne faut pourtant pas commodément mettre à égalité les acteurs : les griefs des Sahraouis à l’égard du Maroc sont aussi graves que légitimes, tant s’agissant des atrocités de la guerre, de la répression continuée, de l’exploitation économique de la région ou de la cooptation – on pourrait également dire corruption – systématique de leurs élites. Aussi s’agit-il de reprendre avec un tragique retard une promesse trahie : El-Ouali Mustapha, ancien militant de l’Union nationale des forces populaires qui finit par fonder le Polisario, avait notoirement essayé de persuader – en particulier par l’envoi d’une lettre-mémorandum en 1973 – différentes figures de la gauche historique marocaine de placer la question sahraouie au cœur de leurs préoccupations. L’échec de sa tentative fut rendu manifeste, par-delà la fondation du Polisario, par le reniement de la gauche marocaine qui se rangea ainsi au nationalisme d’État. On a alors la faiblesse de croire qu’une politique socialiste retrouvée, procédant depuis la réalité des collectifs et de leurs formes de vie, est l’unique voie d’émancipation – au Maroc « de l’intérieur » comme au Sahara.
[1] En arabe, ثقافة الهمزة.
[2] KARSENTI, B. LEMIEUX, C. 2017. Socialisme et sociologie, Paris : Éditions de l’EHESS
[3] LAROUI, A. 1977. Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain: 1830-1912, Paris : Maspero
[4] LAROUI, A. 2005. Le Maroc et Hassan II : un témoignage, Casablanca : Espace culturel arabe, p. 95
[5] KANTOROWICZ, E. 1989 [1957]. Les deux corps du Roi, Paris : Gallimard, p. 213
[6] L’indépendance du Maroc hors Sahara s’est réalisée en 1956.
[7] Sur l’Armée de libération nationale et la contestation à l’œuvre après l’indépendance, voir BENNOUNA, M. 2002. Héros sans gloire. Échec d’une révolution (1963-1973), Casablanca : Tarik Éditions
Est-il pourtant possible de dire autre chose ? Peut-on fonder un propos qui ne serait pas qu’un maigre contrepoint à ce qui parait tout emporter sur son passage ? On a dit que la question du Sahara engageait l’auteur en tant que Marocain : l’interpellation opère-t-elle cependant autrement qu’en négatif ? Quel sens politique aurait ainsi la quête d’une alternative que l’on voudrait socialiste, c’est-à-dire respectueuse des aspirations à la justice qui ne cessent de traverser le collectif[2] ? Si elle n’y est guère réductible, la question trouve son foyer le plus éclatant au Sahara, c’est-à-dire là où la tension conjointement née de la forme historique prise par l’État postcolonial et de sa contestation est la plus aigüe.
L’illusion historique
On déclame une phrase convenue : « le Sahara est marocain ». Elle est l’offrande sacrifiée à un fétiche collectif : si l’affirmation n’est que rarement suivie de justification – on ne dit pas « le Sahara est marocain parce que … » –, son irruption dans l’espace public est si régulière qu’elle rassérène le réel. Puisque « le Sahara est marocain », l’ordre des choses que le décret sous-tend demeure ainsi soutenable. Quand l’explicitation est néanmoins exigée – aux risques et périls de qui remet en cause une formule tant répétée –, celle-ci semble permise par l’histoire : la marocanité du Sahara est, dit-on, établie par une succession pluriséculaire dont atteste la bay’a – serment d’allégeance traditionnel – de l’une ou l’autre tribu à l’un ou l’autre sultan. Rétablissant alors la continuité par-delà la colonisation et les modes de souveraineté – peu importe que le sultan soit devenu chef d’un État-nation moderne, à la suite d’un processus qui trouve sa racine dans l’occupation européenne –, le décret gagne en profondeur discursive : « le Sahara est marocain » parce qu’il en a toujours été ainsi. Allal el-Fassi, le fondateur du nationalisme marocain, ne considérait-il pas que les droits historiques du sultan s’étendaient jusqu’au fleuve Sénégal ? Il est vrai que le nationalisme anticolonial a puissamment réinvesti la tradition monarchique[3]: face à l’effacement de soi dans le cours de l’occupation européenne, il s’agissait de retrouver la chaleur d’une histoire passée.
Une vérité réputée immuable ne suffit pourtant guère à établir un fétiche, il faut lui adjoindre le récit grandiose d’une conquête collective. Au Maroc, celle-ci se nomme Marche verte : en 1975, le roi Hassan II dépêche ses sujets – armés de corans et du drapeaux nationaux – sur le sol du Sahara récemment évacué par la puissance occupante espagnole. Abdellah Laroui, le grand historien marocain, reconstitue les mots du monarque appelant à réaliser le dessein collectif de la nation : « aujourd’hui, ce n’est pas l’homme, occupant le trône du Maroc, qui vous parle, c’est celui qui symbolise l’État et la tradition royale, qui a prononcé le serment de la bay’a. Le Maroc est en danger, l’heure a sonné de renouveler ce serment. Réincarnant tous les rois du Maroc qui ont honoré leur parole, je prends solennellement l’engagement que, quoi qu’il arrive, quoiqu’il en coûte, je n’accepterai pas que le Maroc soit mutilé. J’ai fait mon choix. A toi, mon cher peuple, de faire le tien[4] ».
Le fétiche s’atteste ainsi en un dessein existentiel qui à son tour est tenu pour fonder la nation – « à toi, mon cher peuple », dit le chef de l’État par la bouche de Laroui. Fictio figura veritatis[5], la Marche verte opère comme une régénération collective après les affres d’une indépendance hautement conflictuelle et dont la mémoire est susceptible de permettre la critique de l’État postcolonial. La commémoration de 1975 prend ainsi le pas sur celle de 1956[6], en même temps que l’unité du corps constitué de la nation est désormais réputée réalisée autour de la « tradition royale ».
À l’évidence, un tel discours ne survit guère à la critique historique que l’on adresse – à raison – à tout nationalisme : l’allégeance de certaines tribus au sultan n’a rien de commun avec la souveraineté territoriale des États modernes, les luttes anticoloniales de la région n’ont pas attendu, tant s’en faut, l’appel à « renouveler le serment » qu’adressa le monarque à son « cher peuple », l’Armée de libération nationale[7] – rare expérience de résistance anticoloniale à l’échelle maghrébine où s’est éprouvée en pratique la solidarité des Sahraouis et des Marocains « de l’intérieur » – fut défaite par l’alliance de l’ancien colonisateur et de l’État marocain nouvellement indépendant, le récit si répété de la Marche verte fait fi de la réalité d’une glorieuse épopée qui a à peine pénétré le territoire réputé conquis avant de se retirer etc.
Mais la tension la plus aiguë est logée dans la réification qu’un tel récit produit nécessairement, tant pour les Sahraouis qui en sont absents que s’agissant de la totalité du « peuple » appelé à faire son choix d’une seule voix. Il est vrai que le nationalisme, en particulier lorsqu’il se superpose si finement à l’étatisme, s’abstrait de la réalité de la société qu’il prétend sublimer. Au profit de l’image fétichisée d’un collectif anhistorique réuni autour de son chef, tant la conflictualité que les formes vécues de solidarité sont niées. En conséquence, l’expérience pratique des acteurs et les constructions collectives qu’ils établissent, soit l’espace nécessaire de toute politique, s’en trouvent durablement oblitérées.
L’illusion grammaticale
Aussi le Sahara vu par l’État postcolonial est-il d’abord la voie privilégiée du gouvernement des Marocains pris dans leur ensemble : la régénération nationale dont la Marche verte est réputée l’expression la plus aboutie trouve ainsi son prolongement dans l’unanimité ordonnée autour de l’autorité du chef de l’État. Le décret – « le Sahara est marocain » – est finalement plus grammatical qu’historique : moins qu’une description, le fétiche est un rappel à l’ordre des choses, celui de la souveraineté de l’État sur ses administrés dont il est attendu l’allégeance inconditionnelle. L’acte est performatif : l’unanimisme attendu est en pratique atteint par l’irruption du fétiche dans l’espace public ou privé, si bien qu’il n’est pas rare de l’entendre déclamé hors tout contexte, sous les atours imposants d’une vérité incontestable.
On lui adjoint pourtant un autre mot d’ordre au fonctionnement similaire : « de Tanger à Lagouira », de la pointe nord du Maroc au village sahraoui le plus reculé, où l’ellipse figure l’étendue de la souveraineté territoriale de l’État marocain. Une fois encore, le lissage discursivement opéré est constitutif du nationalisme si délié du réel : peu importe que Lagouira soit un village déserté à la suite de la guerre et depuis demeuré sous le contrôle effectif de l’État mauritanien ou que Tanger compte en son sein parmi les plus pauvres quartiers du pays, pas plus qu’il n’importe que l’État marocain ait lui-même construit le « mur des sables » divisant le Sahara – d’un côté le territoire sous son autorité militaire et de l’autre celui sous le contrôle du Polisario – et rejetant par-delà la frontière ainsi constituée une partie de sa population, le mot d’ordre ne s’embarrasse guère de fidélité au réel.
Mais l’expression la plus éclatante d’un État effectivement séparé du collectif et de sa réalité est cependant plus récente : elle prend forme dans le conflit qui a récemment opposé le Maroc à l’Espagne autour de l’accueil médical accordé au chef du Polisario – figure par excellence de l’ennemi national. En rétorsion à ce qui fut ainsi vécu comme une grave offense, l’État marocain a brièvement suspendu la surveillance des frontières de Ceuta – enclave espagnole en Afrique du Nord – qu’il assure ordinairement, permettant à plusieurs milliers de Marocains – la plupart enfants ou adolescents – d’aller tenter leur chance dans les rues de l’une ou l’autre ville européenne. Il faut entendre la politique à l’œuvre dans toute sa cynique amplitude : au profit d’une causeérigée en fétiche collectif, il n’est ainsi guère inconcevable de sacrifier une partie de la jeunesse du pays – de surcroît en l’assimilant aux nuisibles que l’on lâche chez un voisin avec lequel l’on est en désaccord. Le paradoxe d’une réaction nationaliste en pratique conduite au détriment de la nation – c’est-à-dire de la communauté des gens qui la constituent – n’est qu’apparent : toute atteinte au fétiche, aussi banale soit-elle – par exemple, les soins médicaux accordés par un tiers au dirigeant ennemi –, génère un contrecoup correspondant à la gravité de la blessure narcissique qui a ainsi été éprouvée.
Congédier le fétiche
On aurait pourtant tort d’accabler l’État marocain en tant que tel. La pathologie nationaliste est intimement liée aux États-nations modernes, tant que la critique historique ou grammaticale est ainsi transposable à chacun d’entre eux. Mais l’entreprise déconstructiviste, en démontrant le caractère arbitraire de toute histoire collective, excède pourtant la nécessaire mise en lumière de l’impasse nationaliste et aboutit à un paradoxe : si toute forme d’auto-connaissance des sociétés modernes est reconduite à la superficialité d’une tradition « inventée », nulle ressource collective n’est alors opposable à la poussée nationaliste. S’agissant du Maroc, l’impasse parait alors d’autant plus réalisée que le nationalisme qui y prospère a pour condition l’offensive libérale qui défait le collectif et les liens qui le traversent. L’intrication du libéralisme et du nationalisme est ainsi fermement établie : l’un efface les formes historiques de solidarité, l’autre projette une image aussi irréelle que fétichisée de la nation.
Aussi s’agit-il de congédier le fétiche autrement que par la négation de toute expérience collective, si bien que l’alternative ne peut alors être que socialiste, c’est-à-dire fondée sur la défense des solidarités et formes de vie en pratique éprouvées. Une telle politique, si elle a ainsi pour indépassables coordonnées épistémologiques la matérialité du réel et l’expérience historique des acteurs, affirme néanmoins que la société est affaire de tous et toutes : la réflexivité collective est ainsi opposée à la pathologie nationaliste et aux mots d’ordre qu’émettent les États séparés.
La politique socialiste est alors seule capable d’opérer le si nécessaire dépassement du nationalisme postcolonial, au Sahara comme au Maroc « de l’intérieur ». Il ne faut pourtant pas commodément mettre à égalité les acteurs : les griefs des Sahraouis à l’égard du Maroc sont aussi graves que légitimes, tant s’agissant des atrocités de la guerre, de la répression continuée, de l’exploitation économique de la région ou de la cooptation – on pourrait également dire corruption – systématique de leurs élites. Aussi s’agit-il de reprendre avec un tragique retard une promesse trahie : El-Ouali Mustapha, ancien militant de l’Union nationale des forces populaires qui finit par fonder le Polisario, avait notoirement essayé de persuader – en particulier par l’envoi d’une lettre-mémorandum en 1973 – différentes figures de la gauche historique marocaine de placer la question sahraouie au cœur de leurs préoccupations. L’échec de sa tentative fut rendu manifeste, par-delà la fondation du Polisario, par le reniement de la gauche marocaine qui se rangea ainsi au nationalisme d’État. On a alors la faiblesse de croire qu’une politique socialiste retrouvée, procédant depuis la réalité des collectifs et de leurs formes de vie, est l’unique voie d’émancipation – au Maroc « de l’intérieur » comme au Sahara.
[1] En arabe, ثقافة الهمزة.
[2] KARSENTI, B. LEMIEUX, C. 2017. Socialisme et sociologie, Paris : Éditions de l’EHESS
[3] LAROUI, A. 1977. Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain: 1830-1912, Paris : Maspero
[4] LAROUI, A. 2005. Le Maroc et Hassan II : un témoignage, Casablanca : Espace culturel arabe, p. 95
[5] KANTOROWICZ, E. 1989 [1957]. Les deux corps du Roi, Paris : Gallimard, p. 213
[6] L’indépendance du Maroc hors Sahara s’est réalisée en 1956.
[7] Sur l’Armée de libération nationale et la contestation à l’œuvre après l’indépendance, voir BENNOUNA, M. 2002. Héros sans gloire. Échec d’une révolution (1963-1973), Casablanca : Tarik Éditions

