
Yinka Shonibare CBE RA, Sun Dance Kids, 2023
Empire catholique,
libertés laïques
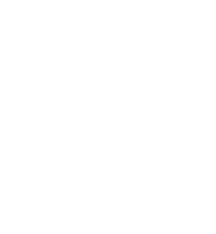
Simon Pierre
En d’autres termes, la loi de 1905 prolonge effectivement la mainmise de l’État sur les cultes.
Dans son article récent pour Orient XXI, Rafik Chekkat cite les travaux de Talal Asad et souligne que la loi de 1905 recèle les germes d’une politique répressive, notamment parce qu’elle préserve les mécanismes, hérités du concordat, de contrôle d’une sphère religieuse délimitée.
Il est exact que cette manière de définir la religio comme un domaine spécial, complémentaire, mais souvent concurrent ou sujet, de la res publica (État) est propre à la construction du catholicisme romain (VIe-IXe siècle). À ce titre, le concept même de religion est presqu’intraduisible dans les langues grecques, hébraïques, syriaques, arabes, persanes. Les usages modernes sont davantage le fruit d’une adaptation à la modernité occidentale, elle-même produit de la chrétienté latine (XIe-XIVe s.) issue de l’empire franc (VIIe-Xe s.). Ajoutons à cela qu’il est exact que, outre de ne pas abolir ce ministère des Cultes, et de le maintenir inféodé à celui de l’Intérieur, la loi de 1905 permet à l’exécutif de conserver la capacité concordataire de définir politiquement et officiellement ce qu’est une association cultuelle. Cette spécificité est ainsi définie par opposition à l’association générique fondée en 1901 par les républicains radicaux sur des principes absolument démocratiques. Ce faisant, l’association cultuelle est sacralisée par rapport à l’association non-cultuelle, et ce sur une définition de l’État. En d’autres termes, la loi de 1905 prolonge effectivement la mainmise de l’État sur les cultes.
Or, il faut même souligner qu’elle permet surtout la poursuite d’une pratique de contrôle et de répression qui fut initiée par l’État à partir du moment où il fut presque continuellement dominé par une majorité républicaine et anticléricale, de 1879 à 1919. Ce faisant, confondre cette pratique active de la laïcité post-concordataire avec celle qui s’emploie aujourd’hui à réprimer les musulmans passe à côté d’un élément essentiel. Ce n’est pas une religion minoritaire et non-autochtone qui était alors ciblée par ce régime de contrôle et de persécution. C’était l’hégémonie de l’Église catholique sur la France comme outil de la dictature, de la monarchie, de la répression des libertés et de la privatisation du progrès au profit d’une infime élite qui était ciblée. C’était son rôle de coagulant de toutes les réactions, comme ennemie jurée de la république et de l’idéal libéral et démocratique issu de la Révolution française qui était ainsi tenu en respect et en sujétion contrainte.
L’émancipation laïque
C’est de cette laïcité combattante que s’inspire le mouvement jeune-turc puis son successeur kémaliste en Turquie en maintenant, voire en renforçant le concordat d’ancien régime. La perpétuation de la religion d’État permet d’une main de contrôler la diffusion idéologique aux masses, tout en se donnant les moyens de réprimer systématiquement toute expression religieuse non-compatible avec les buts du pouvoir. En France comme en Turquie républicaine, c’est essentiellement l’ancienne religion indigène et dominante de l’État d’ancien régime, le christianisme romain dans un cas, l’islam sunnite dans l’autre, qui est ciblée et combattue.
Ce faisant, 1905 reste malheureusement au milieu du gué de la véritable laïcité, c’est-à-dire la stricte séparation entre associations définissant librement leur contenu cultuel, spirituel et idéologique, autonomes de toute immixtion d’un État aveugle à leur contenu, comme il est de rigueur aux États-Unis par exemple. Toutefois, ce maintien du concordat tient avant tout au fait que les républicains de gauche et les radicaux qui détenaient la majorité relative du pouvoir craignait, comme les Kémalistes après eux en Turquie, la puissance d’une Église hégémonique qui deviendrait subitement et complètement indépendante. Ce besoin de contrôle venait de la crainte que son clergé puisse utiliser sa large autorité pour saper en toute liberté les fondamentaux de l’État démocratique. Par conséquent, ce contrôle et cette répression du religieux par le séculier ne concernait plus du tout les religions minoritaires et traditionnellement dominées et sujettes, (protestantes et juives) comme cela avait le cas depuis Bonaparte. Bien au contraire, elles étaient les grandes gagnantes de cette neutralité acquise, même minimale, et de l’affaiblissement de l’instrument idéologique de leur persécution séculaire.
De même, mais pour des raisons strictement inverses, 1905 ne s’appliquait pas non plus aux autres cultes, polythéistes, juifs et musulmans, qui avaient court en dehors de la métropole, dans l’immense et tout jeune empire colonial ; de fait, la loi de séparation ignorait les territoires où ils avaient court. Cela nous invite ici à mettre en évidence le contre-poids dialectique de cet état de fait, lequel est l’autre cause fondamentale du choix, par l’État républicain, de préserver en 1905 une foule d'éléments concordataires comme le ministère des cultes ou le refus de fusionner avec la loi de liberté d'association de 1905. Car l’État français reste fondamentalement chrétien :
Il continue de « reconnaître les cultes » en décidant ce qui est religion et ce qui est association ; il ne laisse par les adhérents définir souverainement leur destination ; il renonce à obliger cette institution médiévale à accepter les fondamentaux associatifs de la démocratie via la souveraineté de l’assemblée générale des adhérents. En effet, l’abrogation du ministère des cultes et du privilège fiscal dont jouit l’association qu’il déclare et reconnaît comme cultuelle aurait facilité le transfert des cotisations vers des secteurs davantage sociaux et progressistes, et ainsi accéléré le processus de sécularisation de la société, voulu par les socialistes et les radicaux. En outre, en cessant de distinguer le cultuel du non-cultuel, l’État aurait pu réellement abolir l’hégémonie de l’Église catholique sur tous les lieux de culte patrimoniaux. Or, l’État républicain continua, en vertu même de la loi de 1905, d’entretenir son fond sur deniers publiques au nom de la préservation du patrimoine, mais sans presque jamais offrir aux autres associations, cultuelles ou non, la jouissance de ces lieux pourtant financés par le budget. Une véritable laïcité aurait supposé que l’ensemble de ces lieux de culte chrétiens financés par l’ensemble du corps politique des contribuables citoyens puisse être alloué à toute association, cultuelle ou non, qui en ferait la demande.
Ces renoncements constituaient alors, avant tout, des concessions à l’autorité de l’Église catholique, dans le but de s’attirer les votes des républicains modérés, et à réduire l’opposition des cléricaux et autres anti-républicains. Si 1905 ne va pas jusqu’au bout, si les associations cultuelles ne peuvent se former librement sans demander une reconnaissance étatique de leur caractère religieux, si ce statut constitue un privilège fiscal, si la religion majoritaire conserve une position hégémonique et détourne légalement les ressources publiques à son seul profit, c’est parce que les républicains radicaux et leurs alliés socialistes voulaient un compromis avec la droite. En même temps on l’a dit, ils croyaient avoir astucieusement négocié du même coup à leur avantage une poursuite de la capacité de contrôle et de régulation de l’Église catholique qui tenait à cœur à la tendance jacobine.
La (non) laïcité aux colonies
Cependant, c’est ici que la politique « cultuelle » de l’État français instaure une distinction entre le traitement de la majorité catholique, privilégiée en tant que citoyen et en tant qu'institution, et les autres religions, a fortiori celles qui ne sont ni juives ni chrétiennes. Ce compromis recelait en fait les germes de toute la contre-offensive réactionnaire du XXe siècle, jusqu’au détournement inattendu du mot même de « laïcité » à son profit au XXIe. Ce consensus mou peut désormais être utilisé comme arme répressive non plus contre la force dominante et réactionnaire de l’Église catholique, mais contre toute expression d’altérité non-catholique : protestante, juive, et aujourd’hui musulmane.
En effet, parmi les raisons de ces délétères concessions de 1905, il y eut aussi la volonté de conserver de bonne relation avec les missionnaires catholique de l’empire et au-delà. En effet, outre que l’État républicain restait foncièrement chrétien, l’Église des colonies faisait avec ce dernier œuvre commune d’européanisation des immenses territoires que seules les armes avaient transformé en marchés captifs de la « métropole ». Ainsi, pour un Européen, qu’il fut ultramontain ou laïcard, le musulman comme l’animiste était un conquis, un sujet, un indigène, c’est-à-dire un « autre ». Non seulement, on l’a dit, les cultes n’y étaient pas du tout concernés par les débats et les lois qui avaient court en métropole, mais surtout, le droit coutumier ou islamique de l’indigène fut utilisé comme le verrou qui lui interdisait d’être considéré comme un Français. Ce n’est pas sur le fondement de la race, mais du statut civique, que l’indigène, c’est-à-dire l’étranger, était « exempté » des lois de la métropole. C’est cette approche impériale qui impliquait que, justement, la loi de séparation n’y fut jamais décrétée ni en Algérie ni dans les colonies africaines ou malgaches. Et c’est cette discrimination qui enfante du racisme structurel antimusulman qui s’exprime aujourd’hui par ce dévoiement de ce que 1905 a omis de trancher. Non seulement les missionnaires catholiques y furent appuyés par l’autorité politique républicaine, mais les musulmans y étaient exclus de l’égalité politique, sur le fondement unanimement considéré comme légitime de leur statut personnel islamique. En effet, pour être naturalisé, il était obligatoire d’adopter le droit civil français, qui n’était rien d’autre qu’un droit civil catholique romain. Il n’avait jamais été refondé (sauf du bout des lèvres avec une autorisation très limitée du divorce) par les républicains même les plus radicaux, mêmes les plus laïcards. À l’inverse, l’indigène qui voulait devenir français devait renoncer à tout son code du mariage et des successions : pour recevoir l’égalité civique, le musulman devait apostasier l’islam… avant 1905, et longtemps après en ce qui concerne les animistes (et à la seule exception du cas particulier des Algériens de religion juive), devenir français impliquait réellement de se convertir au catholicisme.
L’indigène qui conservait sa religion et son statut personnel ne pouvait être français. Ce faisant, que l’islam fût bien davantage une institution légale rationaliste qu’une superstition idéaliste, ce qui aurait du plaire aux laïcards, permit de conserver le statut confessionnel comme un moyen de marque et de justification légale de l’indigénat. À cet effet, le pouvoir républicain et anticlérical de 1893 avait décidé d’utiliser en Algérie ce seul critère religieux pour distinguer l’indigène musulman du citoyen français. Le témoin le plus explicite de cette décision fut le débat sur la naturalisation ou non des immigrés maltais. D’une part, ils étaient locuteurs du dialecte arabe maghrébin, mais, puisque catholiques romains, il fut tranché sans guère de contestation qu’ils jouiraient d’un privilège dont leurs compatriotes musulmans du continent ne pourraient jamais bénéficier. Ainsi, l’Algérien musulman, même sujet de la France depuis 60 ans, régnicole depuis 30 ans, aussi bien que le Tunisien musulman immigré, se voyaient interdire en bloc tout droit politique dans l’État qui l’administrait. A l’inverse, tous les immigrés italiens ou espagnols, même ceux de la dernière vague, furent promus à l’égalité politique avec les métropolitains.
Si l’on devait comparer l’empire français à l’empire romain, cela correspond à la politique d’installation de colons italiens sans rapport avec Rome dans des colonies « de droit latin » au milieu des provinces, c’est-à-dire de territoires occupés dont la population est de statut pérégrin, c’est-à-dire étranger. Si l’on devait comparer l’empire français à l’empire islamique, cela revient au fait que des colons yéménites et berbères furent installés dans des ville-camps avec le statut de l’islam, au cœur d’immenses wilāya à majorité chrétiennes de statut « protégé ». La différence c’est que Rome et l’Islam assumaient et revendiquaient complétement le fait que leur code civil était religieux, et que leur religion définissait leur cité. À l’inverse, ce tracé de 1893 d’une ligne de naturalisation entre chrétien et musulman date certes du concordat, mais sous une implacable autorité républicaine anticléricale de fait.
Cet acte est un des fondements de cette inscription d’un rapport de domination entre cultes européens et cultes indigènes : il permettait de trancher nettement entre citoyens et sujets, entre privilégiés et discriminés, d’officialiser l’asymétrie raciale sous-tendue, mais jamais revendiquée. Ce jour-là fut définie la caste supérieure des Européens d’Algérie, celle qui à terme allait combattre la république pour conserver une mainmise coloniale ainsi façonnée autour du référent catholique. Cqfd. En effet, le processus de naturalisation sur candidature administrative, enclenché depuis les années 1840, devint alors pour les postulants algériens un acte d’abjuration de la religion musulmane, ce qui tarit assez logiquement les demandes, et acheva de consolider la dissociation raciale entre catholique citoyen français et musulman sujet indigène.
Cette situation absurde et paradoxale, cette dissonance d’un même État laïciste en métropole mais catholique absolutiste aux colonies, fut alors pointée du doigt et combattue par le député socialiste sénégalais Blaise Diagne. Constatant qu’en tant que chrétien il avait le droit d’être un citoyen français de plein droit, électeur et élu, mais pas ses voisins et parents de confession musulmane, il lutta pour que la république laïque cesse enfin de distinguer le français de l’indigène sur le fondement de la religion. Or, à part quelques extrémistes visionnaires, la majorité républicaine répugne à abroger le code de la famille napoléonien, fondamentalement catholique romain, pour repenser entièrement l’unité fondamentale de la société à l’aune de paradigmes libéraux et démocratiques. Dès lors, on préfèrera faire comme si on ignorait que, dans ses principes comme dans son application, le code de la république française relève d’un droit chrétien. Par réciproque, le christianisme du citoyen français laïc était bien compris comme une condition de ses droits civiques : l'égalité politique s’acquière par la religion chrétienne. Dans cette configuration, seuls les Juifs d’Algérie, comme déjà au premier Moyen-Âge, retrouvèrent le droit à une exemption de se conformer à la seule confession autorisée au Pays des Francs.
Après douze ans de lutte, Diagne obtint gain de cause et la citoyenneté française fut octroyée aux musulmans des quatre communes françaises du Sénégal. Or, ce progrès, enfin admettre qu’un musulman puisse être français, n’avait été acquis que parce qu’il avait fallu attendre le cœur de la guerre mondiale, en 1917, et le besoin vital pour l’État major d’imposer la conscription à ces administrés musulmans ! Malgré tout, ce coin de l’iniquité entre musulmans et chrétiens avait été enfoncé, et il commença à devenir admissible et concevable, pour les socio-démocrates de 1944-1945, d’instaurer l’égalité politique de tous les ressortissants de l’empire, réformé sous le nom d’Union française.
Et pourtant, cette fois encore, il fallut obtenir l’agrément de la droite : chrétiens démocrates ralliés à la république mais pas forcément à la laïcité, et gaullistes réactionnaires ralliés à la sécularisation mais pas forcément aux idéaux universalistes républicains. Le compromis fut donc encore une fois racialiste : les castes furent rétablies dans l’Union française, mais sous le nouveau nom de premier collège électoral pour les européens et les rares naturalisés, pour la plupart chrétiens, et de second collège pour les indigènes : avec un droit de vote atrophié au point d’être quasi-nul. À nouveau, on prétexta de l’incompatibilité du droit familial coutumier ou musulman avec l’exercice politique de la francité. Pour entrer au premier collège, l’ancienne procédure de naturalisation restait de rigueur, ce qui explique pourquoi les naturalisés non-européens sont généralement chrétiens ou apostats.
Même dans l’espace nord-africain, le candidat à l’accession à l’égalité politique, à la naturalisation au Maroc ou en Tunisie, ou au statut de français de premier collège, était toujours tenu de renoncer au droit musulman, et donc à un certain nombre de règles coraniques sur le mariage et les successions. Cette contrainte impériale violente est évidemment dénoncée par les mouvements indépendantistes, comme celui de Habib Bourguiba, qui avait tenté d'interdire aux naturalisés défunts l'entrée en cimetière musulman, en raison de leur abjuration des lois successorales et matrimoniales coraniques, et donc de l’islam. Malgré tout, après un demi-siècle de lutte et en dépit de l’absence de l’application de la loi de 1905 à toute cette sphère de problématiques, l'idée que l'on peut être français ET musulman finit peu à peu par s’imposer à gauche. Pressée par la défaite de Dien Bien Phu et la perspective de l’indépendance de Tunis et Rabat, une majorité sociale-démocrate reprit les rênes de l’État et promulgua la loi Deferre de 1956.
Ce dispositif abrogeait en trois courts articles un siècle de discrimination confessionnelle : les deux collèges furent abolis et l’égalité politique entre tous les habitants de l'union française fut instaurée. Bien sûr, la question du droit personnel « français » (c’est-à-dire chrétien) d’une part, et musulman et coutumier d’autre part, allait continuer à jouer. Cette fois, les concession à la droite de la coalition fut le maintien d’une discrimination concernant les droits sociaux des français catholiques : la sécurité sociale, le minimum vieillesse et la loi sur le minimum salarial (SMIG) ne devaient pas s’appliquer dans les Territoires d’Outre-Mer (TOM). Cette situation perdure jusqu’aujourd’hui, même au nouveau département de Mayotte dont la population musulmane n’a, pour l’instant, droit qu’à des prestations de moitié, au moins jusqu’à ce qu’elle mette au chômage ses cadis.
Pour autant, l’accession aux droits civiques aurait pu amener les peuples anciennement colonisés à obtenir par leur vote l’extension de l’égalité sociale : cette perspective de partager les fruits de la croissance et du progrès économique et social terrifiait la droite conservatrice, et aussi secrètement l’opinion publique de centre gauche. Cette révolution majeure fut donc avortée dès 1958-1959, avant même qu’une première élection parlementaire de l’Union française pût avoir été conduite. La quatrième république fut renversée par la droite anti-laïque : le nouveau pouvoir, outre de mettre en place des institutions monarchiques et autoritaires, restaura du même coup l’idée d'une adéquation entre catholicisme et francité. L'immense majorité des « musulmans » furent alors renvoyés à la case « étranger », qui n’est, rappelons-le, qu’un autre nom pour « indigène ». Cette disposition se répéta en 1962 lorsque les Algériens musulmans perdirent, comme prix de leur indépendance, les droits civiques si chèrement acquis au terme d’un demi-siècle de lutte politique. Ce retrait parfaitement illégal du droit de cité sur le fondement de la religion (et de la race bien sûr) constitue un précédent intolérable aux principes républicains qui régissent notre code de la nationalité ; pourtant, ils restent largement admis, maintenus sous silence, en cette période d’éruption d’idéaux d’indépendance et de tiers-mondisme.
Revendiquer la laïcité réelle
Si l’on devait comparer cette soudaine confiscation du droit de cité français à l’évolution comparable de l’empire romain vers l’intégration des provinces, ce serait d’imaginer qu’après l’Édit de Caracalla (r. 187-217), naturalisant tous les hommes libres de l’Empire quel que soit leur culte autour de l’an 200, il eût pu être abrogé. Or, même une fois sa dynastie berbéro-syrienne renversée, nul ne revint sur cette décision, et il n’y eut plus jamais aucun empereur d’origine italienne. De même, si l’on devait comparer ce repli racialiste et chrétien-identitaire au stade similaire dans le Dār al-Islām, il faudrait imaginer que les Berbères et les Iraniens convertis en masse au cours du VIIIe siècle, auraient été subitement expulsés des villes islamiques (miṣr-s), rétrogradé au statut de ḏimmī, pour protéger les privilèges de l’élite arabe menacée par la transformation de leur empire en un système universel égalitaire. Non seulement tous les néo-musulmans avaient droit à la ṣadaqa, la sécurité sociale médinoise, mais il s’est passé l’inverse : les premiers ministres et chefs d’État majors devinrent presque systématiquement iraniens, et les descendants de conquérants arabes perdirent leurs privilèges, notamment le droit de toucher la solde de leur aïeul tandis que celle des combattants réels, non-arabes, était moindre. Le repli sur soi culturel des Arabes s’exprime dans la théorie du complot d’une shuʿūbiyya (= « communautarisme ») iranienne prétendument antimusulmane, comme les Romains avaient lancé une cabale contre l’hérésie syrienne d’Héliogabale, le cousin de Caracalla. Mais la différence avec le repli des Européens, c’est que ces deux empires universels, appelés à devenir le point de référence de civilisations humaines et de régime juridiques pour des millénaires, avaient accepté la conséquence nécessaire de cette assomption : l’égalité des individus quel que soit leur origine et donc la chute du groupe ethno-confessionnel fondateur.
Retour en métropole : terre promise des chrétiens d’Algérie et des naturalisés des TOM qui n’y avaient jamais mis les pieds, mais où leurs droits civiques leur furent naturellement préservés, terre d’exil des indigènes du seconds collèges, dénaturalisés en catastrophe en 1959 et 1962, et contraints de se soumettre aux oppressions et discriminations appendues à leur statut d’étranger immigré. Les injustices de la loi de 1905 inachevée persistaient entre le culte privilégié et les cultes juifs et protestants tolérés. Cette sujétion fut donc évidemment exacerbée à l’encontre des immigrants musulmans « étrangers », pour d’autres raisons structurelles ou impensées : à la différence des deux autres cultes bien ancrés en Europe, ces derniers ne disposaient tout simplement d’aucune association cultuelle héritant d’un régime concordataire qui puisse être reconnue par le ministère des Cultes. Or, en même temps, la majorité autoritaire gaulliste-chrétienne démocrate (1958-1981) ne se trouve guère de point de consensus que sur leur refus conjoint d’étendre la laïcité scolaire aux écoles catholiques : elles pourront donc devenir tranquillement des établissements refuge pour les classes sociales privilégiées. Le pouvoir enterre également l’extension du régime de 1905 à l’Alsace et à la Moselle qui étaient allemandes à cette date-là. L’impôt de religion en faveur du culte hégémonique et des deux cultes tolérés continue d’y être perçu par le trésor publique. Ce statu quo permet aujourd’hui de financer, sur deniers publiques, des chaires « d’islamologie »… bien entendu attribuées à des non-musulmans.
Enfin, on n’entendra bien sûr plus jamais parler du vieux projet radical de l'établissement d'une laïcité libérale et intégrale qui aurait pu étendre la loi de 1901 comme fondement unique de toute association, cultuelle ou non. Les conséquences d’un tel abandon de la lutte pour la laïcité s’exprime parfaitement dans l’émotion publique de ces dernières années lorsque, en dépit du bon sens, la réparation de la cathédrale Notre-Dame de Paris est financée à grand frais par des subventions bénéficiant de 90% de réductions d'impôt, sans même envisager que ce monument médiéval puisse être sécularisé pour profiter aux visiteurs, et finalement en reconstruisant à l’identique un toit et une flèche sur le modèle étriqué du cléricalisme néo-gothique de l’époque du concordat du XIXe siècle ! Dans un tel contexte, il aurait été surprenant que la réaction ne s’empare pas, en plus du mot de « république » transformé en culte de l’arbitraire de l’État absolu, de celui de « laïcité », devenu le moyen d’une contre-offensive catholique identitaire.
Dans ces conditions, cet Etat néo-monarchique et néo-catholique se retrouve en situation de désigner ce qui est ou ce qui n'est pas du cultuel, en termes d'association, comme en termes d'expression publique : il continue d'entretenir des églises pour la jouissance exclusive des catholiques, et limite toute expression cultuelle non-contrôlée, c’est-à-dire toutes celles qui ne sont pas concordataires. Avec la loi de 2004, cet État qui n’est plus ni républicain ni laïque se permet de « reconnaître », au mépris de la loi de 1905, ce qui est cultuel et ce qui ne l'est pas, et surtout, dans ses décrets d’application et circulaires afférentes, de demander aux agents du service publique de l’État, théoriquement laïcs et neutres, de détecter ce qui serait « religieux par destination ». Plus personne ne semble désormais en mesure de reconnaître que, en droit strict, ces reliquats cléricaux de la loi de 1905, devenus des outils hégémoniques d'un Etat de fait catholique intégriste, s’opposent au principe constitutionnel de laïcité : la liberté d'association cultuelle, l’indépendance des cultes et surtout, l’absolue neutralité de l’Etat.
Il serait impératif de réinvestir le sens de la laïcité, car la lutte inachevée et désormais dévoyée serait non seulement à l'avantage de tous les cultes (qui ne sont pas l'Eglise catholique), juifs, protestants, musulmans, etc, mais aussi à tous ceux qui préfèrent s'investir personnellement et financièrement dans des initiatives pour un commun non-cultuel et sécularisé, quel que soit leur culture d’origine, leur degré de conscience athée ou irréligieuse ou au contraire leur piété. Tous continuent d’être exclus de la jouissance de lieux de culte entretenus par leurs impôts, mais conservés exclusivement vides et fermés au profit de la seule Église catholique. Tous continuent de ne pas bénéficier des privilèges fiscaux dont jouissent les cultes « reconnus » par le ministère de l’intérieur. Répétons que la « laïcité » restera toujours le strict inversé de ce qu’en disent les réactionnaires et identitaires qui la lancent au visage des opprimés, comme la « république » est l'inverse de ce qu'en font ces mêmes autoritaires étatistes. Le pouvoir hégémonique qui avance ses pions auprès de l’opinion depuis trois décennies se contente d’utiliser les vestiges de l'inachèvement de l'œuvre laïque contre les vrais laïques, et contre la lutte pour l'égalité politique. La lutte pour la laïcité réelle doit reprendre, pour les descendants des musulmans/indigènes/étrangers de France, pour que l’État cesse de définir, anticonstitutionnellement et contre eux, ce qui est du religieux et ce qui ne l'est pas.

