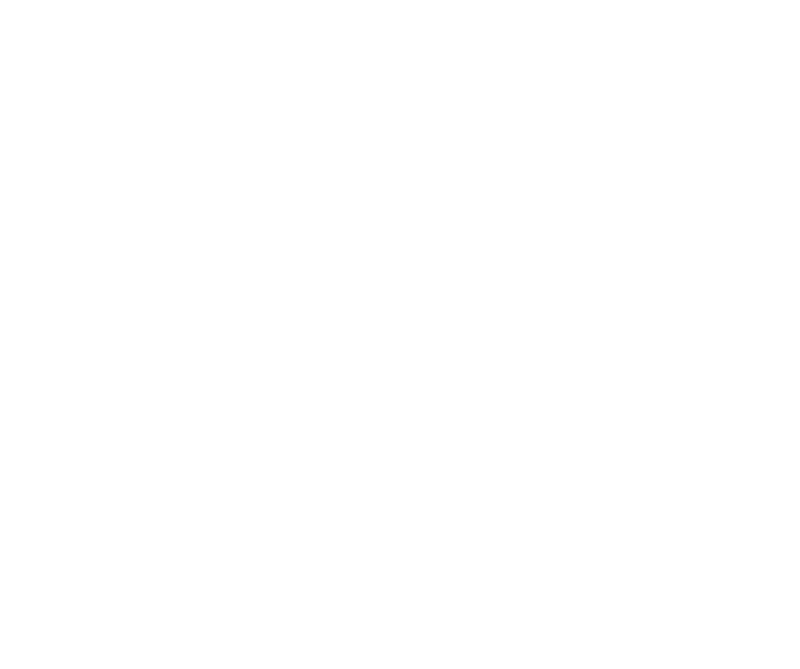
Dia al-Azzawi, Elegy to the Black, 2011
Sur l’île. Après l’attentat de la Ghriba
Cléo Cohen
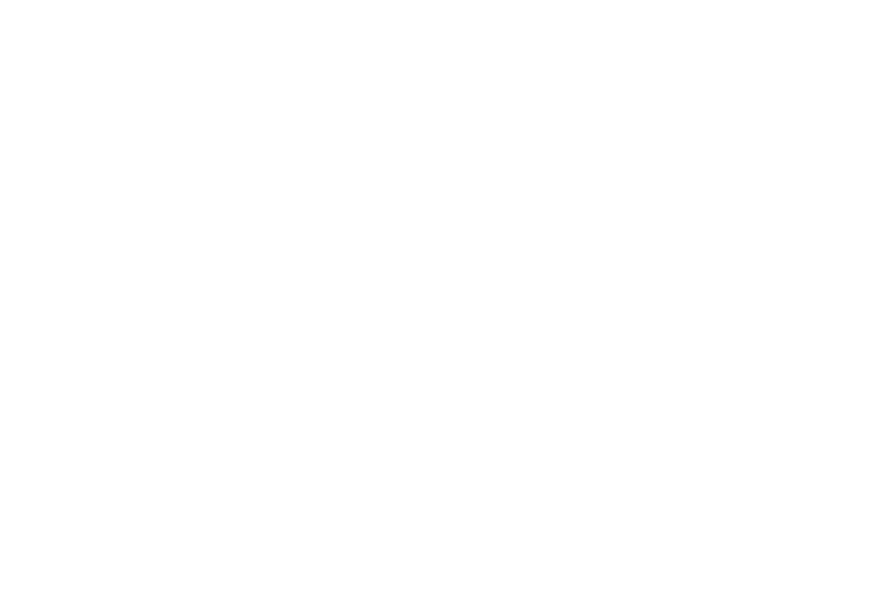
Façade d’une ancienne bâtisse, Hara Sghira, Djerba – Cléo Cohen 2022
Ce texte est originellement paru sur le site de la revue K. Les Juifs, l'Europe, le XXIème siècle. La force du témoignage de Cléo Cohen et l'acuité des questions auxquelles il invite nous a semblé justifier sa republication sur notre site.
Cléo Cohen est réalisatrice. Ses créations traitent de persistance et d'héritages sous tension.
Il me faut écrire.
Sur le sentiment d’irréalité qui a frappé tout ce qui m’entoure jusqu’à ce jour, d’abord : la lumière, les sons, les odeurs, les gens, leurs rires, leurs vies minuscules.
Et la mienne de vie minuscule, d’un coup rendue encore plus insignifiante par ce sentiment de solitude lancinant qui me dévore depuis mon retour de l’île. Parce que la fête avait lieu sur l’île, celle où se trouve cette vieille et célèbre synagogue, que les coups de feu ont retenti sur cette île de la coexistence, et les hurlements aussi, en pleine fête, et que la petite fille tremblante qui pleurait dans mes bras au fond de la petite pièce où l’on s’est terrés comme des rats, ruisselants de peur, ne parlait que l’arabe et pas le français, et pourtant elle allait peut-être mourir aujourd’hui, juive, sur son île, sur sa terre, à Djerba.
Moi, je ne suis tunisienne que par diaspora. Je n’avais pas les mots dans sa langue pour la rassurer. C’est sur l’île que je me suis glacée de l’intérieur, glacée pour longtemps je crois, en voyant le désespoir qui fait qu’on s’étouffe presque à se cacher dans des toilettes minuscules, qu’on se transforme en animal traqué malgré les livres de prières, les yeux fous qui cherchent de tous les côtés des issues, mais des issues il n’y en a pas, si quelqu’un surgit, armé, sur le toit, on est morts. On y pense tous et toutes, hein, à ce moment-là : si quelqu’un entre avec une arme, on est morts.
Et on n’a pas envie de mourir dans cette synagogue, ni dans ce fondouk attenant à ciel ouvert.
Je n’ai pas envie de mourir à presque trente ans, enfermée comme du bétail dans un lieu saint où ont certainement prié mes ancêtres avec ferveur. Moi, qui suis revenue avec tant de joie et de détermination dans le pays de mes grands-parents, revendiquant avec fierté ma judéité, mon arabité, ma tunisianité, toutes ces appartenances, contre les sceptiques, les angoissés, les réacs, les jaloux. Mourir en martyre ne m’intéresse pas. Je regarde autour de moi, tous ces gens, juifs en grande majorité, non-juifs pour d’autres, religieux, laïcs, athées, tous dans la même merde. Tous soumis à cette peur de mourir écrasante, à cette peur qui fait de nous des animaux qui guettent, qui hurlent au moindre bruit, qui paniquent devant la menace de l’arme à feu qui est plus forte que tout. Je me dis que sûrement, si un mec armé débarque et tire sur la foule, ma plus grande chance de m’en sortir sera de me jeter à terre et d’espérer survivre ensevelie sous d’autres cadavres. C’est moche, hein, que cette pensée m’habite.
Alors que je vois mes amis tellement dignes. Je les vois s’occuper des plus faibles, rassurer, mettre des mains sur les épaules, calmer les esprits délirants qui créent des mouvements de panique dévastateurs pour la foule tétanisée. C’est bête mais il n’y a qu’eux qui ont ce courage. Je les regarde. On est tous fous de trouille. On pourrait se tuer entre nous à force de courir, et s’écraser, dans ces vagues non maîtrisées. Je vois mes amis d’une dignité absolue, qui leur donne la force de circuler, de parler, de distribuer de l’eau, même s’ils regardent, eux aussi, partout autour d’eux, sans cesse, inquiets, rongés d’inquiétude. Ils tentent de maîtriser les choses, d’apaiser les esprits agités, les cœurs comprimés par l’angoisse, les ventres tordus de douleur. Si je meurs, ce sera en les admirant follement. Cette pensée-là est plus jolie, et elle m’habite aussi.
J’ai une envie de vomir monstrueuse. Vomir ma peur de mourir. Je me sens à peine respirer. Moi, la peureuse de la famille, je ne suis pas spécialement courageuse, c’est confirmé. Je tremble. Mais je suis juive et fière de l’être. Je porte un nom juif, et une petite étoile de David autour du cou. Et je ne mourrais pas par hasard, si je me fais buter aujourd’hui ; je mourrais parce que je suis juive dans un pèlerinage juif, qu’importent mes croyances, mes combats politiques, mes révoltes, mon passeport français, mon arbre généalogique qui prend racine en Tunisie et en Algérie.
Je mourrais en ayant passé un certain temps à démêler les fils de mon identité. En ayant décidé d’aller vivre en Tunisie, car, après tout, je fais partie de la diaspora tunisienne, et rien ne m’interdit de poser mes valises dans le pays de mes ancêtres. Même pas ma judéité, qui me nourrit, me constitue. Mais je ne veux pas mourir dans une synagogue à Djerba. Je pense à ma famille tellement inquiète de ma vie en Tunisie, à mes amis si fiers de mon choix du retour au pays. Que diront-ils, si je meurs ici dans mon vomi, entourée de mes amis éclatants de dignité ?
Je pense à ma lignée, pour qui l’expérience de l’antisémitisme, la peur de mourir parce que juif, de ne pas être protégé parce que minoritaire, a été constitutive sur des générations et des générations. Je pense au départ de ma famille de Tunis en 1969, et à cette angoisse abyssale qu’on m’a transmise, avec laquelle on m’a bassinée longtemps « tu ne peux pas comprendre que d’un coup, alors que tout allait bien, d’un coup on avait peur, on entendait les slogans anti-juifs, on entendait la foule crier, les vitrines brisées, le feu à la synagogue, on a cru qu’on allait mourir ». J’ai si souvent pensé qu’ils exagéraient. Et aujourd’hui enfermée à la Ghriba et pétrifiée par les coups de feu que j’entends, par la misère sur les visages des gens, dans ce fondouk attenant à la synagogue – elle aussi pleine à craquer de juifs misérables -, je m’en veux.
Ç’aurait pu arriver à Paris où j’ai vécu. C’est la première chose que j’ai dit à mes parents, quand je les ai eus au téléphone le lendemain. Ç’aurait pu arriver à New York, où j’ai vécu aussi. Ç’aurait pu arriver n’importe où. Sauf que moi, la Tunisie, c’est en tant que descendante d’une famille juive tunisienne que je l’ai choisie comme pays d’adoption. Je l’aime comme les miens l’ont aimée pendant des siècles, c’est-à-dire passionnément. Je m’y sens bien. En confiance. Et j’ai passé beaucoup de temps à répéter fièrement, ces dernières années, que contrairement à la France, on ne meurt pas parce qu’on est juif en Tunisie.
Je pense à ces milliers de juifs tunisiens dont, en Tunisie aujourd’hui, on déplore généralement le départ dans les conversations de comptoir : au juste, pourquoi sont-ils partis, on était bien avec eux, on s’est toujours bien entendus, ils manquent au business, hein, mais pourquoi sont-ils partis, me demande-t-on souvent, ou encore, quand est-ce qu’ils sont arrivés, ah bon, depuis toujours, avant les Français, indigènes tu dis, ah oui ? Je pense à cette part foisonnante et enfouie de l’histoire de la Tunisie qu’est sa part juive, qui m’occupe depuis plusieurs années déjà. Je pense à l’inculture généralisée à ce sujet. Je pense au fait qu’il a fallu lutter avec les griffes, les dents, parmi les miens d’abord, pour me réemparer de cette part de mon identité qu’ils avaient laissée tomber. La réinvestir de fierté.
Je pense à ce trou béant que j’essaie, dans mon travail, comme beaucoup d’autres, de combler. À cet effacement qui nous affecte, nous, descendants, profondément, mais aussi et surtout ceux qui sont toujours là et qui ont toujours été là. Qui résistent. Nationaux, tunisiens, juifs. Quelques poignées. Fiers d’être des Tunisiens juifs. À quoi bon tout ce travail, pour rappeler qu’ils font partie intégrante de l’histoire du pays. À quoi bon, quand le discours officiel omettra les mots « juif », « synagogue », « antisémite ». Eux aussi, tous leurs efforts, gommés. Aujourd’hui à la Ghriba, parce que juifs, on est visés, et considérés comme étrangers. Les Tunisiens comme les autres. Ironique dans un lieu saint dont l’appellation rend justement hommage à la Ghriba, « l’étrangère ». Je pense à tous les « marhbè bik » et aux « bienvenue chez toi » qu’on m’a servi depuis que je fréquente le pays. Je pense à la veille, quand dans cette même cour, la foule émue chantait en cœur l’hymne national tunisien. J’ai tellement pas envie de mourir.
L’horreur de l’attentat, c’était l’horreur de l’attente, littéralement, 3h30 de sueurs froides, de tremblements, de gosses qui vomissent et se pissent dessus, de larmes, de supplications tête tournée vers le ciel. 3h30 à imaginer que la mort peut surgir comme ça, injustement, une déflagration et c’en serait fini de ma minuscule vie, de nos minuscules vies. Je pense à notre impuissance terrible. À mon ami aux yeux si tristes, qui dira après coup « on n’avait pas d’arme, on ne sait pas se battre, on n’aurait pas pu se défendre ». Je pense à ceux qui auraient pu nous défendre par les mots, par les prises de position, depuis. Je pense au silence qui a suivi.
D’autres sont morts ce jour-là, tout aussi innocents que moi. Aviel Haddad et Benjamin Haddad. On ne les reverra jamais : ni leurs gestes ni leurs cheveux dans le vent. On n’entendra plus jamais leurs voix. On ne sentira plus jamais leur odeur. Ça ne vous touche pas ? Tant pis. Moi je m’imagine à leur place, gisante sur le bitume. J’imagine mes amis si dignes criblés de balles à leur tour. Leurs corps sans vie. Et je ne peux pas me résoudre à votre manque d’empathie. À votre sentiment qu’après tout, c’est bien mérité. Parce que « des Palestiniens meurent tous les jours sans que personne n’en parle » comme l’a dit le Président Saïed quelques jours après le drame, assumant là publiquement, au nom de l’État qu’il représente, le grossier amalgame. Ce serait donc bien fait, qu’on tue un peu de juifs, puisqu’on tue des Palestiniens. On calcule, on comptabilise, et on s’offusque peu de ces deux morts même si c’est malheureux. Deux vies minuscules. Plus trois vies minuscules de policiers. Abdelmajid Atig, Maher El-Arbi, Kheireddine Lafi. Zéro hommage national. Zéro poignée de main aux familles de victimes. Zéro commémoration. Zéro marche. Zéro veillée. Zéro bougie. Zéro. Ceux d’entre vous qui se réjouissent, qui disent œil pour œil dent pour dent, sachez que le calcul sera infini, que c’est grâce à vous que le sang continuera à couler. Le sang et les larmes.
Je pense au silence de la plupart de mes amis tunisiens, gauchistes, engagés, premiers critiques de l’État et de ses dénis, de ses dérives, épris d’actualité, animés par des colères politiques toujours légitimes. Vous n’êtes pas en colère qu’on tue des juifs devant une synagogue qui a déjà été attaquée par deux fois tragiquement. Je pense à ceux qui étudient l’Afrique du Nord, qui l’aiment, qui en parlent, qui la pensent, l’analysent avec finesse, jour après jour. Ceux qui parlent et écrivent toujours sur les causes qui leur sont chères, et souvent en prenant des risques, et qui là, ne disent rien. Vous, journalistes, activistes, antifascistes. Tous ceux qui, de près ou de loin, pourraient se sentir concernés. Hatta shay. Rien.
Le silence.
Un silence qui traverse la Méditerranée : les antiracistes français, les camarades de lutte, ceux qui décomptent et dénoncent toujours avec force les crimes racistes, qui se taisent. Le silence de la diaspora tunisienne et nord-africaine qui me blesse ; tous ceux qui revendiquent leur arabité, leur nord-africanité, leur attachement au bled, vous, cousines, cousins, qui ne dites rien. Artistes, penseurs, activistes. Vos mots sur la Palestine, toute la semaine qui suit l’attentat à Djerba. Pas un mot sur les cinq morts de Djerba, parce que manifestement se recueillir sur tous ces innocents en même temps est impossible. Ça troublerait la logique interne, cette fois, de pleurer dans l’actualité des juifs et des Palestiniens à égalité dans leur innocence. Je pensais que c’était dépassé, cette idée qu’on ne peut pas être solidaire de victimes juives si des juifs quelque part oppressent. Cette façon de brandir la cause palestinienne comme bouclier pour empêcher de penser l’antisémitisme, de le nommer, de le reconnaître. Comme si ailleurs et en même temps, des musulmans et des chrétiens n’oppressaient pas eux aussi. Comme si l’oppression était le monopole des juifs, ironie de l’histoire, eux qui ont pendant des millénaires erré, dominés, écrasés. Mais puisqu’Israël aujourd’hui, alors pas de pitié pour les juifs du monde entier.
La semaine passe. Les journées se ressemblent, les traumatisés que nous sommes faisons comme on peut, avec les lambeaux de volonté qu’il nous reste, pour tenir debout, ensemble, à Tunis. C’est la colère en vérité qui nous anime. La colère face aux silences douloureux qui s’accompagnent d’un confus brouhaha antisémite dans les médias, sur internet, sur les réseaux sociaux. Les quelques voix tunisiennes qui s’élèvent avec courage pour dire qu’il est intolérable de justifier ou de légitimer la mort de ces juifs innocents feront date dans l’histoire. Celles et ceux qui disent publiquement que c’est du devoir de la majorité musulmane de rendre hommage. De qualifier l’attentat d’antisémite. De condamner. De pleurer ses compatriotes. Je ne vous oublierai pas. On ne vous oubliera pas. Mais vous-mêmes semblez tellement effarés d’être si seuls, que ma peine ne diminue pas.
Je pense à mes ancêtres, pour qui la vie minoritaire s’est toujours accompagnée d’une peur de la mort très forte, qui m’a été transmise névrotiquement. Je pense aux vécus minoritaires en général, accompagnés de petites humiliations, de têtes baissées, de discrétion, de nécessité de se faire tout petit pour se faire aimer, pas menaçant, tout petit, oui, pour être accepté dans sa différence, accepté mais dominé, pour ne pas craindre de mourir à cause de sa différence.
Je pense à mes vieux qui ont quitté la Tunisie de peur d’y risquer leur vie parce que juifs, et à tout l’antisémitisme qu’ils ont affronté en France en arrivant, doublé du véhément racisme anti-arabe dont ils étaient aussi la cible. « Les sauvages », comme les appelait le tenancier du premier hôtel miteux où ils ont vécu un temps à Marseille. Encore et toujours minoritaires. La vie vécue en faisant attention, toujours. Fais attention à toi, ma fille, fais attention à toi.
Avant la création de l’État d’Israël, on trouvait déjà beaucoup de raisons de ne pas aimer les juifs. Après la création de l’État d’Israël, il y a eu Israël. Mais pas que. Chez les chroniqueurs, à la TV, sur Twitter ou à la radio en Tunisie, certains ces dernières années ont parlé de l’odeur caractéristique des juifs. Cette odeur si particulière qui, dès l’enfance, les avait toujours dérangés. D’autres ont évoqué la méfiance que leur ont toujours inspirée les juifs. Leur perfidie légendaire, leur aptitude presque génétique à trahir. D’autres encore leur rapport vicieux à l’argent. Au pouvoir. Et je pourrais continuer indéfiniment.
Bien sûr la vie va revenir. Et bientôt ce sera l’insouciance à nouveau, ou presque. Car une pensée, soyez-en sûrs, ne me quittera pas mes amis : si j’étais morte dans l’attentat de la Ghriba, il y aurait eu beaucoup de silences. Et un grand brouhaha. Il y aurait eu des polémiques sémantiques, des débats, des négociations, des doutes, des commentaires haineux sur internet, des incidents diplomatiques, des chroniqueurs nonchalants, des révisionnistes, de l’indifférence, beaucoup d’indifférence, et quelques courageux qui auraient pris ma dépouille en défense ; mais on ne m’aurait pas pleurée si facilement que ça. On aurait fouillé dans mes réseaux sociaux, dans mes mails, dans mes lettres d’amour, dans mes draps ; et on aurait fini par trouver les preuves qu’après tout, juive comme je suis, je n’étais pas si innocente que ça.
Et continuer à vivre avec cette nouvelle conscience, dont jusque-là j’étais miraculeusement protégée, m’abîme déjà.

