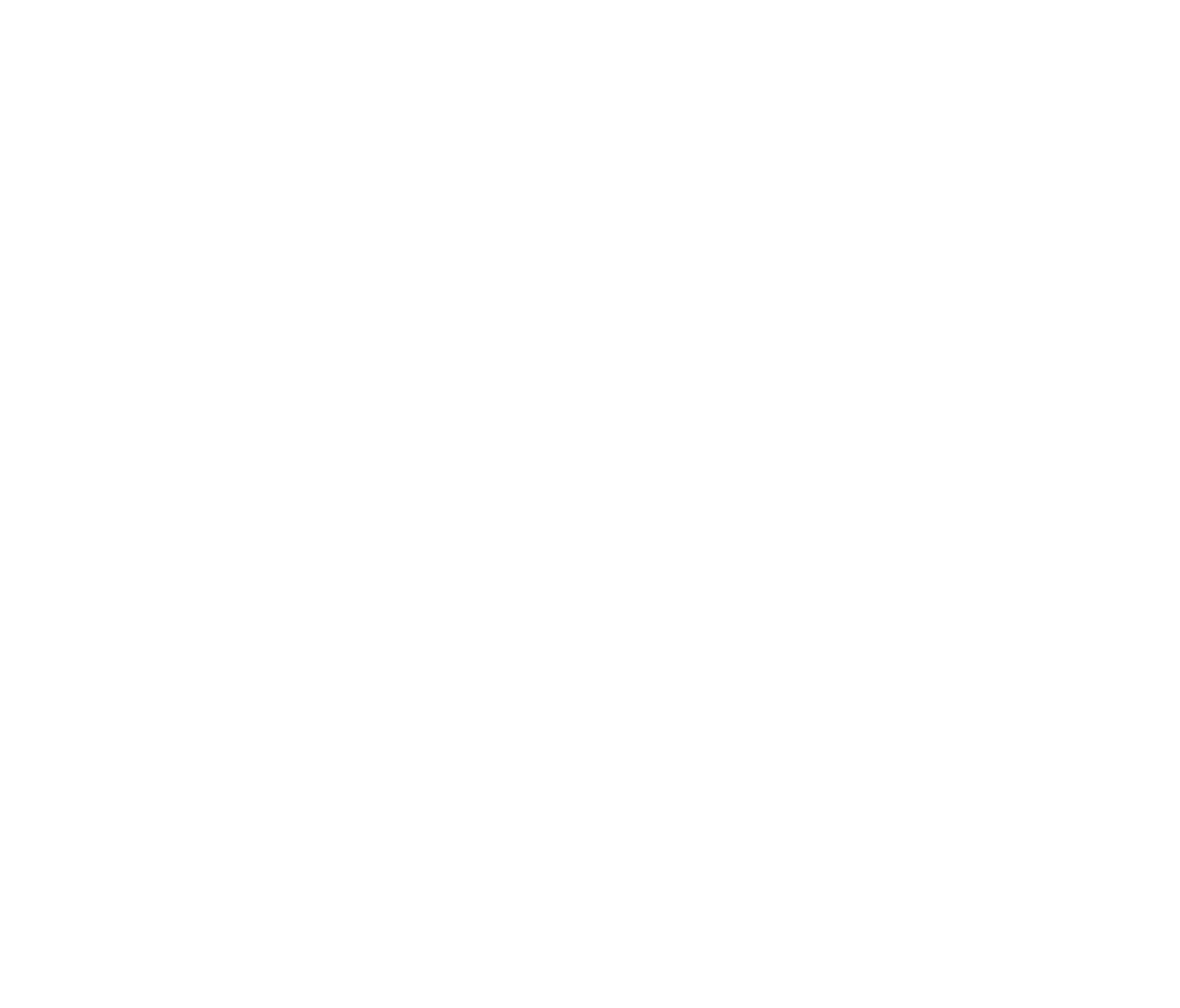
Wura-Natasha Ogunji, Fixed Things and Flying Things, 2019
Le devenir-ennemi des exilés noirs
Enquête politique sur le massacre d’États à la frontière coloniale de Mlilya
Samia Moucharik
L’enquête proposée contribue à la compréhension du massacre effectué conjointement par les polices marocaine et espagnole, sur la frontière coloniale de Mlilya le 24 juin 2022, et qui a provoqué des dizaines de morts, de disparus et d’incarcérés ainsi que des centaines de blessés parmi les cibles de ce massacre : des exilés[1] venus dans leur extrême majorité du Soudan et du Soudan du Sud[2], aspirant à rejoindre l’Europe par précisément cette frontière terrestre. L’enquête se revendique pleinement politique se démarquant, par son approche et ses objectifs, d’enquêtes de nature journalistique ou anthropologique, même si elle peut leur emprunter des éléments de connaissances ou des aspects de méthodes et discuter avec elles.
Cette dimension politique se niche d’abord dans sa visée qui est de saisir avec précision les enjeux profonds – et peut-être souterrains – de ce « massacre d’Etats », cette expression comme son pluriel devant être bien compris. Il ne s’agit pas d’établir cette qualification tant les éléments qui la documentent et l’attestent ont été amplement exposés en nombre et en détails[3], tout comme la complicité active des Etats marocain et espagnol[4]. Le repérage de ces enjeux profonds suppose de porter une attention privilégiée à la production du type de violence mise à l’œuvre à l’occasion de ce massacre dans la mesure où elle révèle, dans un même mouvement, la production étatique de catégories jugées menaçantes à des degrés variables et redevables de cette violence spécifique. Ce faisant, l’intelligibilité de ce massacre ne se circonscrit pas aux seuls enjeux concernant la politique « migratoire » entre le Maroc et l’Union européenne – et parmi ses membres, plus particulièrement l’Espagne –, pour concerner des enjeux relatifs à des processus contemporains qui participent sévèrement aux reconfigurations des Etats impliqués dans les mêmes politiques de violence, à commencer évidemment par celle baptisée « lutte contre l’immigration clandestine ». Cette mise au jour nécessite de considérer le massacre dans sa singularité comme de se focaliser sur l’Etat marocain[5], certes en prenant en compte ses spécificités historiques, sociales et politiques, mais en le considérant tout autant comme exemplaire de ces processus et ces dynamiques affectant bon nombre d’Etats contemporains.
C’est ainsi qu’il faut lire la qualification choisie de « massacre d’Etats ». Ce massacre de Mlilya qui a suscité à juste titre, outre l’effroi, énormément d’indignations[6] et d’interrogations, doit de ce fait être appréhendé comme un événement forçant à penser[7] ce qu’il révèle et actualise, à savoir une bascule repérable par la production d’une nouvelle catégorie d’exilés noirs. En l’occurrence, cette catégorie est érigée en une menace inédite au point d’être soumise à une violence étatique distincte, dans ses formes et dans son intensité, de celle que l’Etat marocain réservait jusque-là aux exilés noirs présents sur son territoire et catégorisés sous le nom de « Subsahariens » ; cette nouvelle catégorie prenant le nom d’une nationalité, « Soudanais ». Celle-ci mérite une attention serrée tant elle permet de mettre au jour un processus en cours qui fait passer les exilés noirs du statut de menace à celui d’ennemi. C’est précisément ce devenir-ennemi que l’analyse se propose d’identifier et d’éclairer. Il me semble que seule une enquête politique est à même de saisir de tels processus en cours en se centrant non seulement sur la question de l’Etat mais plus particulièrement sur sa capacité à penser et à pratiquer la violence. Loin d’être envisagée comme un outil au service de politiques de nature différente ou comme la conséquence du néolibéralisme[8], elle est ici réhabilitée dans son statut d’édificateur, sans cesse reconduit, de l’Etat sur un territoire et face à des catégories de populations distinguées et discriminées selon la violence prodiguée.
Sur tous les continents, ce statut se signale par la policiarisation et la militarisation accrues que connait un grand nombre d’Etats, et qui poursuivent, en la renouvelant éventuellement, la production de menaces et d’ennemis, dans et hors leurs frontières.
Une enquête politique par son matériau et sa méthode d’analyse
Il est évident que la centration sur l’Etat ne garantit pas à elle seule la nature politique de cette enquête, qui se niche, outre dans ses objectifs, tout autant dans son matériau et sa méthode retenus.
Au-delà de son caractère composite, la charge politique du matériau réside pleinement dans son opposition frontale aux discours construits dès les premiers instants par l’Etat marocain – confortés dans les grandes lignes par ceux de l’Etat espagnol. Les trois matériaux utilisés reposent en effet sur des investigations conduites dans les premiers temps si cruciaux[9] pour accéder aux témoignages de rescapés et/ou à des lieux décisifs relatifs au massacre, à sa dissimulation, voire à son effacement.
Le premier matériau est un entretien que j’ai moi-même réalisé avec deux rescapés soudanais cinq jours après le massacre et à quelques centaines de kilomètres de Mlilya. Les deux autres pièces s’inscrivent dans un temps bien plus long que l’urgence qui a présidé à notre rencontre. Il s’agit de deux enquêtes menées par deux journalistes marocains présents dès le premier jour, et de l’enquête militante effectuée au long cours par l’Association Marocaine des Droits de l’Homme Section Nador (AMDH Nador), et qui se révèle la plus déterminante. Séparément et conjointement, les trois investigations établissent incontestablement la qualification de « massacre d’Etats », même si le vocable n’est pas nécessairement utilisé aussi bien par mes interlocuteurs, deux jeunes Soudanais[10], par les journalistes Saïd Elmrabet[11] et Salaheddine Lemaizi[12] dans leurs articles, que par les militants de l’AMDH Nador dans leur rapport rendu publique le 20 juillet[13] ou leurs publications sur leur page facebook – au profit le plus souvent de « drame » ou de « crime ». Des hommes désarmés ont été tués par des policiers engagés dans le cadre de ce qui apparaît comme un dispositif conjoignant différents corps de police et de gendarmerie et usant d’armes et de tactiques plurielles, et cela, non pas tant dans un but de répression que de terreur par une violence déchainée. Celle-ci a été déployée par l’usage intensif de gaz lacrymogène, de bombes fumigènes, d’armes à balles de caoutchouc ainsi que par le tabassage confinant au lynchage, suivi par l’abandon, à une agonie longue de plusieurs heures cruciales, de très nombreux blessés graves. Ainsi, les enquêtes journalistiques et militantes ont réussi à contrarier le monopole mensonger que les autorités marocaines avaient tenté de conserver sur le récit et le sens à donner sur ce qui a lieu le 24 juin 2022. En effet et de manière assez classique, leur stratégie médiatique a reposé sur la dialectique d’une visibilisation et d’une invisibilisation, visant à présenter les exilés soudanais comme redoutablement violents à l’égard de policiers à la fois surpris et respectueux des règles d’engagement face à une attaque organisée contre l’une des frontières terrestres avec l’Espagne. Simplement, il me faut préciser que la publication des premiers éléments tangibles et significatifs des enquêtes indépendantes n’aura pas lieu pendant quelques jours, laissant la prééminence à la version étatique relayée par la presse inféodée au régime. C’est dans ce contexte qu’a lieu ma rencontre avec les deux jeunes rescapés.[14] Le projet initial de cet entretien réalisé à Khouribga[15] qu’ils ont pu rejoindre après avoir été refoulés et dispersés vers des villes lointaines, a été justement de répondre à l’urgence de faire connaître leur version précise du massacre. Cette intention première de l’entretien a donc été abandonnée dès les premiers articles publiés, au profit d’une enquête déprise de cette urgence.
Autre ressort politique majeur de ce matériau d’enquête, cette démarche commune de vérité se paie de difficultés, d’entraves, voire de prises de risques. Saïd Elmrabet et Salaheddine Lemaizi évoquent des pressions policières les empêchant tout particulièrement d’approcher des exilés présumés rescapés aux abords de Mlilya. S’ajoutent à ces considérations circonstancielles, les contraintes explicites ou non qui pèsent sur des journalistes tâchant de travailler à distance du régime.[16] Militant à l’Amdh Nador et principal enquêteur, Omar Naji fait le récit bien détaillé des empêchements qui lui ont été opposés, notamment à l’hôpital de Nador dont l’entrée lui a été interdite. En revanche, sa présence dans un cimetière a permis de mettre fin à une première tentative d’inhumer des morts en catimini dès les premiers jours après le massacre, et en l’absence de toute procédure permettant la moindre identification des hommes morts. Plus largement et pour ne parler que de la situation faite aux exilés, la répression visant l’Amdh Nador est récurrente, avec des précédents comme une garde à vue de Omar Naji en avril 2020 pour des propos jugés calomnieux envers des agents des autorités de la région. Elle s’est poursuivie après la publication du rapport avec l’empêchement d’une réunion et l’interdiction d’une marche aux chandelles le 25 décembre 2022 à Nador[17].
La prise de risques est d’une tout autre nature concernant mes interlocuteurs qui acceptent de rencontrer une Marocaine qui leur est inconnue dans un pays devenu subitement hostile tant la propagande érigeant les dits « Soudanais » en hommes violents est assénée chaque jour dans quasiment tous les médias. Et alors qu’ils sont eux-mêmes encore accablés par les meurtrissures psychiques et physiques du massacre, les leurs comme celles de leurs frères de condition.
Les deux dernières dimensions politiques du matériau découlent quant à elles uniquement du geste de mes interlocuteurs de m’accorder cet entretien ou plutôt de s’en emparer. Il relève tout d’abord d’une éthique confinant à la politique, dans la mesure où il s’agit pour eux de rendre hommage à leurs frères tués et/ou disparus parmi lesquels certains leur étaient connus[18]. Ce faisant, ils leur offrent un tombeau dans l’évocation très précise de ce qui s’est passé juste avant, pendant et juste après le massacre[19]. Il est également politique puisqu’il leur permet de se constituer comme des sujets parlants et pas seulement parlés, y compris dans un témoignage se voulant prioritairement factuel[20]. Dans ces conditions, cette enquête dont l’existence est entièrement initiée et déterminée par cette rencontre, a été placée d’emblée sous le régime de la dette et de la responsabilité.
C’est en un sens circonscrit à l’opposition aux mensonges d’Etat que ce matériau doit être considéré comme politique. Il s’agit d’une garantie à la fois essentielle et minimale à toute enquête sérieuse, et davantage lorsqu’elle ne produit qu’une partie du matériau analysé, comme c’est le cas de celle que je propose. Mais la nature politique de l’enquête, loin de se réduire au recours à ce matériau, réside d’abord dans la méthode avec laquelle il a été travaillé ; ensuite dans les choix de problématisation des résultats de l’analyse obtenus.
La méthode utilisée se revendique politique en un sens assez circonscrit qui ne relève ni de l’idéologie, ni de traditions d’enquêtes militantes[21], tout en s’écartant des méthodes d’investigations journalistiques ou académiques. En effet, elle ne vise ni à produire des connaissances, ni à leur donner du sens à partir de problématisations et/ou théorisations a priori. Elle l’est parce qu’elle cherche à saisir ce que donne à penser l’événement examiné, ce qui peut être nommé son intellectualité[22]. Autrement dit, la méthode vise sa logique en ne présumant rien d’elle, car l’évènement peut correspondre à trois situations. Soit il vient signaler la poursuite d’une logique politique déjà repérée, soit une rupture marquant irrémédiablement un avant et un après, soit une bascule d’une logique à une autre mais sans rupture. Pour ce faire, elle envisage l’événement dans sa singularité en procédant à un certain nombre de suspensions. Elle suspend toute problématisation a priori qui donnerait d’emblée du sens aux éléments relevés comme elle suspend toute recherche d’explications et de causes – immédiates ou lointaines.
Ces suspensions garantissent les conditions de se focaliser sur ce qui a eu lieu et d’examiner les caractéristiques propres de l’événement et les éventuelles manifestations de l’inédit dont il serait porteur[23]. En effet, l’inédit est considéré comme faisant signe vers ce qu’il faut justement penser. En définitive, la méthode se veut politique au sens où elle offre un outil pour saisir des processus politiques contemporains – qu’ils aient lieu du côté des Etats ou des peuples[24]. Avec une modestie qui n’exclut pas la rigueur, elle cherche à se placer en phase du contemporain, mot qui peut sonner pompeux, mais qui signale l’effort et l’exigence de saisir ce que le présent donne à penser dans la mesure où il est traversé d’un faisceau de possibles et de potentialités, qui s’actualisent dans des événements. L’approche par la singularité suppose certes l’absence de problématisation a priori, mais elle ne revendique pour autant nulle ignorance méthodologique. En effet, la distinction de ce qui relève de logiques déjà identifiées ou de logiques nouvelles suppose au préalable un travail de lectures et de familiarisation avec les différentes perspectives problématisant la situation analysée.
En l’occurrence, j’ai abordé le massacre de Mlilya en mettant hors champ la problématique dominante relative à la collaboration de l’Etat marocain à la dite « lutte contre l’immigration clandestine » telle que pensée et pratiquée par l’UE, ainsi que la recherche de ses causes, de facteurs conjoncturels ou de ses objectifs. L’analyse vise précisément à saisir la rationalité étatique à l’œuvre et repérable dans les formes et les intensités de la violence policière prodiguée lors du massacre. Il se trouve que le matériau utilisé, outre ses qualités intrinsèques, se révèle compatible avec la méthode d’analyse adoptée. En effet, les trois enquêtes factuelles autorisent dans des proportions variables l’inscription des informations recueillies dans une temporalité plus élargie grâce à une familiarité ou une connaissance plus pointue des pratiques policières, aussi bien dans la région que dans l’ensemble du pays, à l’endroit des exilés noirs. Mes interlocuteurs les connaissent intimement depuis leur arrivée au Maroc il y a un an à peu près, et concernant celles à Mlilya, depuis des mois à ses abords. Les journalistes peuvent également prétendre à cette connaissance, du fait d’un travail documentant, pour l’un plus spécifiquement la région du Rif, pour l’autre la situation des exilés au Maroc[25]. Mais il est incontestable que les militants de l’Amdh Nador disposent d’une connaissance fine et ancienne de la situation des exilés dans la région, faisant de leurs rapports et de leurs communiqués des sources incontournables de manière générale, et une source prééminente pour cette enquête.
C’est donc à partir du repérage des pratiques policières de la violence que la rationalité de la politique étatique à l’œuvre dans le massacre peut être mise au jour. Ainsi, l’analyse prend-elle comme fil le traitement des corps durant le massacre de ceux que je préfère désormais nommer « exilants »[26] : tant ceux des vivants, des blessés, des morts que des disparus.
Les éléments saillants caractérisant la singularité du massacre
Comme déjà mentionné, le matériau permet d’établir que ce qui a eu lieu mérite bel et bien le qualificatif de « massacre » de façon documentée et concordante et en l’absence de preuves jugées irréfutables tels que des documents écrits et/ou sonores émanant des autorités. Par ailleurs, il le fait autant par les informations qu’il livre que par les doutes, les interrogations et les hypothèses qu’il soulève en toute légitimité et rationalité.
La chronique proposée ici ne vise pas tant le récit détaillé et exhaustif de ce qui a eu lieu que la mise au jour d’éléments saillants plaidant en faveur de la singularité du massacre. Mise en garde préalable, il est difficile d’échapper à une impression rétroactive, suscitée par la lecture du récit, d’être face à une mécanique qui s’est abattue sur les exilants de manière brutale, à la fois maîtrisée et incontrôlée. Cette impression doit pourtant laisser place à l’idée que ce massacre a été précipité par une suite de logiques à la fois immédiates et plus profondes, et par des décisions et des non-décisions effectuées aux différents niveaux de l’Etat ; ils auraient alors pris la forme d’ordres, et peut-être de contre-ordres, qui ont été traduits en actes et en gestes. L’invitation faite au service de l’enquête est de lire la chronique sans rechercher une intention, une préméditation, une planification, même si la tentation est forte. Il ne s’agit bien sûr pas de les écarter définitivement mais de laisser place à l’attention aux pratiques policières inédites qui se sont accumulées durant le massacre.
L’avant-massacre
La chronique du massacre ne commence pas avec lui au matin du 24 juin, mais quelques semaines auparavant avec la multiplication d’attaques policières massives contre le campement où s’est établi le groupe d’exilés noirs visés, celui de près de Selouane, d’existence plus récente et moins connue que celui de Gourougou où (sur)vivent des exilés venus majoritairement de pays francophones. Il réunit des Soudanais du Soudan et du Soudan du sud, des Tchadiens, des Ethiopiens pour citer les nationalités repérées par mes interlocuteurs. Sans doute pour des raisons de temps, ils ont fait remonter ces attaques aux jours précédents, mais grâce à une présence militante constante, l’Amdh Nador date le début de l’entreprise de harcèlement et de répression policiers au mois d’avril en comptabilisant cinq attaques successives. Il est notable que les campements font l’objet régulièrement de telles attaques visant à intimider, à éprouver psychiquement et physiquement avec des violences verbales et corporelles ainsi que des destructions de biens et de nourriture[27]. Mais cette fois-ci, tant mes interlocuteurs, présents aux abords de Mlilya depuis quelques mois, que l’Amdh Nador notent un changement qualificatif dans cette répression avec des techniques inédites : l’engagement de différents corps policiers, d’un hélicoptère, l’emploi de bombes fumigènes nécessairement incendiaires dans une forêt, la présence de responsables de la hiérarchie policière et politique, et le recours à un ultimatum de 24 heures pour quitter le campement. A quoi, il faut ajouter, ce qui serait également inédit, l’interdiction faite aux commerçants de vendre de la nourriture et l’impossibilité d’avoir accès à de l’eau. La criminalisation des activités liées à la vie des exilés est courante, mais ici elle touche à la survie.
Indépendamment de la question de la préméditation, l’ensemble de ces éléments, considérés séparément et davantage ensemble, accrédite la thèse que ce massacre a eu lieu, non pas contre une tentative de passage collective de la frontière coloniale avec l’Espagne, mais à l’occasion d’une tentative de fuite face à cette terreur policière et à l’impossibilité de subvenir aux besoins vitaux. Il me semble que persister à parler de ce massacre comme relevant de la même logique que les massacres précédents, en 2005 et 2014, qui eux ont bien eu lieu lors de tentatives de passage collectives relève d’une lecture tronquée voire erronée. Les « frappes »[28], nom donné aux tentatives de passage, comme me l’ont appris mes interlocuteurs, peuvent éventuellement s’effectuer dans un climat policier plus tendu, mais elles supposent une préparation longue de plusieurs semaines au moins, aussi bien organisationnelle, physique que psychique. Ce jour-là, les 800 personnes dont 4 femmes[29] – selon le décompte de mes interlocuteurs – ont fui, terrorisés, épuisés par le manque de sommeil, d’hydratation, d’alimentation, dépourvus de tout. Mes interlocuteurs racontent bien le départ précipité aux premières heures du matin et qui découle de l’ultimatum couplé aux conditions qui rendent impossible leur présence après des mois passés dans ce camp. A cet égard qui est loin d’être anecdotique, le massacre du 24 juin se distingue des massacres précédents.
La séquence suivante à considérer est précisément cette fuite vers un des points de passage de la frontière de Mlilya, vers le lieu fatidique du fait de ses caractéristiques spatiales qui ont participé du massacre. Mes interlocuteurs ont attiré mon attention sur le trouble né de la facilité avec laquelle les exilés ont rejoint ce lieu. En effet, aucune présence policière n’a été constatée qui aurait pu chercher à les dissuader de continuer à avancer, à les détourner, voire les arrêter. L’Amdh partage ce trouble en rappelant la présence d’une caserne des Forces Auxiliaires, corps policier sous régime militaire et impliqué dans la répression des exilés, peu éloignée du campement. Mes interlocuteurs évoquent la présence tout aussi troublante de nombreux fourgons stationnés le long de la route qu’ils empruntent, vides de toute présence policière, leur donnant la vive impression de servir de guides ou de balises sur le trajet à prendre. Les mots « embuscade », « guet-apens » surgissent immédiatement à l’esprit face à cette succession d’indices, auxquelles d’autres s’ajoutent. La route tracée à la fois par l’absence de policiers et la présence tout au long d’elle de véhicules policiers conduit ces hommes et ces quelques femmes directement au point de passage, baptisé du nom espagnol Bario Chino, qui présente pourtant un certain nombre de caractéristiques dissuadant le choix de ce lieu pour tenter un passage collectif. Il est assez resserré et sert habituellement au passage individuel, principalement de Marocaines faisant transiter des marchandises portées sur leur dos, et qui s’effectue par tourniquet dans le sens contraire, depuis le territoire occupé par l’Espagne. Ce lieu se présente comme un goulet d’étranglement, une souricière pour des centaines d’hommes terrorisés par des semaines de terreur et épuisés par le manque de sommeil et la faim. Outre la destination qui semble avoir été encouragée, il faut noter la présence anticipée et nombreuse de policiers qui attendaient le groupe. Détail loin d’être anecdotique, l’existence d’images filmées par la police de l’arrivée aux abords de la frontière laisse fortement envisager une attente organisée.
Encore une fois, le caractère prémédité du massacre ne doit pas accaparer l’attention et rendre prioritaire son élucidation. En revanche, il est possible d’invoquer l’usage d’un renfort de tactiques et de moyens pour faire « disparaître » ce groupe installé près de la frontière coloniale avec l’Espagne. Ce mot est volontairement choisi sans pour autant laisser entendre qu’il s’est agi de les tuer tous. Le choix n’a clairement pas été de les éloigner de la frontière, ce qui aurait supposé de procéder directement à des « refoulements » soit vers la frontière avec l’Algérie soit à l’intérieur du pays, et cela, même violement. L’hypothèse avancée le plus souvent, explicitement ou implicitement quant à ce choix de les attirer vers la frontière serait de démontrer par la preuve du retour à la collaboration active dans la défense des frontières avec l’Espagne, résultat et gage de l’amélioration des relations entre les deux Etats depuis le mois de mars de la même année. Cette hypothèse avancée par les journalistes et l’Amdh ne peut pas être écartée au titre d’explication circonstancielle, mais elle se désavoue elle-même comme explication principale au regard du massacre, et à l’ampleur de la violence. Autrement dit, elle peut tenir comme un des éléments du déclenchement de la séquence, mais pas à propos de son déroulement.
La séquence qui précède immédiatement le massacre, marquée donc par des attaques inouïes et le guet-apens, doit être connectée aux éléments inédits du massacre lui-même. En cela, les deux séquences font partie du même dispositif à analyser, en dépit encore une fois des incertitudes. Si je nomme cette séquence de la sorte, pour autant, je l’intègre dans le même dispositif « massacre » pour saisir ce qu’il y a à penser. Le massacre n’a pas lieu à l’occasion d’une tentative de franchissement collectif de la frontière, mais d’une opération de terreur conduisant à une fuite. Ainsi, le déploiement policier est nécessairement autre. Par ailleurs, l’objectif apparaît comme celui de faire « disparaître » ce campement ; ce mot ne signifie pas que la décision de tuer le plus grand nombre a été prise, mais que le déploiement n’a pas cherché à éviter un grand nombre de morts et de blessés. Encore une fois, il ne s’agit pas de comprendre cet « avant-massacre » rétrospectivement mais de rapporter ses caractéristiques à celles du massacre pendant son déroulement, dans la mesure où elles prennent du sens dans le même dispositif.
L’administration de la mort et des blessures
La singularité du massacre se signale dès son avant-immédiat mais elle éclate indiscutablement si l’on déroule le fil directeur que l’enquête s’est choisie : le traitement des corps des exilants noirs et donc la violence prodiguée contre eux. Les caractéristiques inédites des formes et de l’intensité de la violence sont d’ailleurs soulignées par mes interlocuteurs, les deux journalistes et l’Amdh-Nador. Coexistant avec des pratiques policières habituelles de répression – aussi bien lors des deux massacres précédents[30] que dans la répression quotidienne – trois procédés administrant la mort ou des blessures méritent d’être analysés. Cette analyse s’effectue dans des conditions qu’il s’agit de bien avoir en tête. Un après, aucune enquête systématique et indépendante n’a été menée[31] qui autoriserait le décompte des morts et des blessés et l’établissement de la nature exacte des blessures. La condamnation d’une telle enquête à ne jamais voir le jour participe pleinement de la mécanique de déshumanisation ou d’infériorisation [32] qui continue à s’exercer sur les rescapés et sur les familles endeuillées. Ces morts ne méritent pas d’être comptés. Autre nombre inconnu, celui des hommes traqués et violentés. Mes interlocuteurs parlent de 800, quand les premières informations évoquaient 2000, puis des nombres plus réduits à 1200 ou 1500. Si je conviens de la difficulté d’un tel décompte, son défaut empêche d’apprécier l’ampleur de la violence en déterminant, même approximativement, la proportion de blessés et de morts.
Trois techniques d’administration de la mort et des blessures méritent notre attention, même si l’une d’entre elles se révèle prééminente, à savoir le tabassage confinant au lynchage, visant particulièrement la tête des hommes. Si ce ciblage n’a pas été (heureusement) systématique, il n’en est pas moins significatif. Il prend sens également en lien avec les deux autres méthodes que sont le recours au gaz lacrymogène dans des proportions intrigantes ainsi que l’abandon des blessés pendant de nombreuses et longues heures sans soins.
Commençons par l’usage du gaz par les policiers marocains et espagnols[33]. Envoyé en volume dans ce lieu exigu, il conduit incontestablement à la mort de beaucoup d’entre eux. Gazés, certains chuteront et/ou se feront écrasés. Ils ont vu des hommes ne pas réussir à boire de l’eau qui leur était tendue ou tout simplement à respirer. Les enquêtes journalistiques comme celle de l’Amdh pointent son usage massif et dangereux dans un tel lieu. Mes interlocuteurs apportent une autre précision sur le gaz lacrymogène, que je n’ai retrouvée dans aucune des lectures faites : le recours à deux types de gaz distinguables par leur couleur. Outre le gaz blanc, ils ont en vu un autre de couleur jaune qui leur apparaissait comme le plus nocif. Même en l’absence de confirmation, ne peut pas être totalement écartée l’idée que ces lieux de violence étatique se prêtent à l’emploi de nouvelles armes et/ou techniques. Si un doute peut être autorisé quant à la volonté de tuer par l’usage de gaz lacrymogène, son usage aussi massif dans un lieu aussi exigu laisse ouvert le doute. Mes interlocuteurs indiquent que des policiers masqués étaient tellement incommodés par le gaz, qu’ils devaient être régulièrement remplacés. Autre indice, Omar Naji, qui réussira à entrer dans la morgue de l’hôpital de Nador quelques instants, pourra voir certains corps ne présentent aucune trace de blessure.
L’autre technique de mise à mort, incontestablement directe cette fois-ci, est le tabassage confinant au lynchage. Les tabassages constituent une pratique habituelle de répression lors des tentatives de franchissements de frontière. Ils répondent immédiatement à l’imposition aux policiers d’un rapport de forces momentanément inversé grâce à la dimension collective des tentatives. Mais comme le rappellent mes interlocuteurs et la documentation existante, ces tabassages visent habituellement les membres inférieurs afin de rendre invalides pendant des semaines voire davantage les exilants noirs.[34] D’ailleurs, les deux rescapés rencontrés étaient accompagnés d’un frère de condition, retenu à Khouribga par une blessure, encore non guérie à la cheville, infligée volontairement par des policiers lors de sa dernière tentative de passage à Mlilya. Mais lors du massacre, les têtes ont été volontairement ciblées[35]. C’est une chose de frapper et de tabasser, c’en est une autre que de viser cette partie du corps. La volonté de tuer est perceptible selon mes interlocuteurs comme ceux rencontrés par les deux journalistes. L’un d’eux reprendra le terme de « tasfyia » en arabe qui signifie élimination ou extermination. Le caractère significatif de ce type de tabassage soulève bien entendu la question des ordres et des consignes, explicites ou implicites, question classique lors de tels crimes massifs d’Etat. Si l’on se place plus précisément du côté des conditions pratiques de l’exécution du massacre, il est nécessaire de s’interroger sur la préparation mentale des policiers. Outre leur participation à la répression quotidienne contre les exilants, sans doute qu’une partie d’entre eux ont collaboré à l’entreprise de terreur précédant le 24 juin ou ont en assurément entendu parler. Même si elle ne peut être résolue sans le recours d’entretiens avec certains de ces policiers, cette question doit figurer dans l’analyse du massacre : qu’est-ce qui a armé les bras de ces policiers marocains[36] ? L’un des ressorts principaux de cette violence policière tient dans l’anti-noirceur. Cette négrophobie policière marocaine relève de logiques historiques et sociales à laquelle s’entremêle la logique propre à cette institution engagée depuis plus de 20 ans dans cette répression quotidienne et multiforme contre les exilants noirs dans la région et dans tout le pays. Résultant donc de l’amalgame et de la sédimentation de discours et de pratiques relatifs à la dite « lutte contre l’immigration illégale », elle use d’une violence pouvant humilier, blesser, mutiler, voire, tuer des hommes noirs. Ces derniers sont en effet réduits à des corps devant être nécessairement soumis à cette violence ou bien fantasmés comme hyperviolents lorsqu’ils sont en groupe.[37] A ce propos, des exilants camerounais rencontrés pendant ce même séjour au Maroc m’avaient raconté l’obsession policière de la recherche de « meneurs » juste après la mise en échec d’une « frappe ». Cette figure hautement criminalisée est repérée notamment par une musculature développée[38], rappelant que les policiers marocains envisagent leurs rapports avec les exilants noirs comme un face-à-face entre deux masculinités. Le massacre vient nous signifier combien les enjeux racistes s’inscrivent dans les corps, bien sûr dans ceux qui doivent être capturés et violentés, mais également dans ceux qui exercent la violence. C’est cette incorporation de l’anti-noirceur qui éclaire le déchainement de violence et sa brutalité. Mais cette volonté acharnée de tuer en visant les têtes indique que cette négrophobie routinière a été contrariée, laissant place à cette violence décuplée et exterminatrice. Indépendamment de l’existence ou non d’ordres précis, il me semble qu’un aspect passé sous silence[39] et qui m’a été mentionné par mes interlocuteurs doit être avancé : des policiers ont prononcé le nom de « kouffar » qui signe une exclusion de la communauté musulmane. « Kouffar » a ainsi accompagné les coups tandis qu’il répondait aux récitations de la Chahada[40] ou de versets coraniques effectuées en guise de protection face à la mort ou à son imminence. Il me semble que cette volonté soulignée de les exterminer trouve ici un de ses ressorts fondamentaux, mais à la condition de préciser que cette exclusion ne vise pas des noirs musulmans africains mais des noirs musulmans arabes[41]. En effet, le partage de la langue arabe – au-delà des variations entre la langue parlée au Soudan et celle au Maroc et du plurilinguisme en vigueur dans les deux pays – distingue aux yeux des policiers marocains les Soudanais des « Subsahariens » qui peuvent être aussi musulmans. Ces derniers ont pu également manifester leur islamité lors de moments d’extrême violence ou de terreur, par des récitations en arabe, en guise de renforts contre la violence mortifère en vue d’atténuer cette violence. Mais concernant les Soudanais, il est à penser que l’effet ait été inversé du fait qu’ils soient arabophones. Sans doute ont-ils parlé en arabe entre eux ou en s’adressant aux policiers. L’anti-noirceur s’est donc vue troublée, non par l’islamité mais par l’arabité manifestée par le partage de la langue. Cette hypothèse est fondée sur le fait historique que la négrophobie marocaine/maghrébine a pu lier la noirceur à l’esclavage sans que cette association ne soit désamorcée par l’appartenance islamique.[42] A cette logique qui innerve la négrophobie contemporaine, il faut ajouter les représentations multiséculaires faisant des musulmans noirs africains des musulmans de « seconde zone » et pas tout à fait aboutis. La négrophobie habituelle s’est donc retrouvée contrariée car ne permettant plus à ces policiers de marquer indiscutablement les frontières entre eux et ces hommes noirs qui leur manifestaient l’appartenance commune à la « civilisation arabo-musulmane ». Face à cette langue qui les rapproche et rappelle que l’arabité n’exclut pas la noirceur et vice-et-versa, les policiers ont dû recréer in situ une nouvelle démarcation au moment même où ils exerçaient la violence sur leurs corps. Le trouble a intensifié la violence de leurs gestes et de leurs propos. Il ne s’est pas agi de les exclure de l’humanité, en les animalisant, mais de la Oumma en vue de se préserver de toute proximité subjective fondée sur des éléments constitutifs de l’appartenance à un groupe. C’est cette démarcation opérée en toute urgence qui permettrait de saisir la violence opérée pendant le massacre, qui ne relève donc pas seulement de sur-violence.
Si je considère centrale cette manière de tuer qui a été vécue et comprise comme une volonté d’éliminer, elle continue à prendre du sens avec l’autre manière d’administrer la mort qu’est l’abandon des blessés pendant des heures au soleil et privés des soins urgents[43]. Les exposer au risque accru de la mort se double du fait de laisser mourir. Certes, cet abandon résulte d’arbitrages rendant prioritaire l’évacuation des survivants-témoins en vue de les arrêter et/ou de les refouler à l’intérieur du pays. Mais il s’agit aussi de saisir la logique d’un tel traitement de déshumanisation tant de ceux qui vont mourir que des blessés de manière moins grave et traumatisés davantage par le calvaire de leurs compagnons mourants. Il se trouve que les images les plus nombreuses concernent ce moment où les policiers surveillent et tabassent les survivants – et peut-être des morts – jetés sur les corps des blessés graves et des morts. A juste titre, Norman Ajari analyse ces images de corps noirs amoncelées aux frontières comme la monstration qu’ils sont catégorisés comme des déchets[44], voués également à être recyclés en images servant à dissuader d’autres exilants à prendre cette route. Si l’on ne peut que convenir de cet usage des images, celles-ci doivent surtout être regardées pour elles-mêmes et pour ce qu’elles montrent. L’entassement, le tabassage et l’abandon à une agonie fatale font partie intégrante du massacre en organisant sa nécro-violence.[45]
Cette dimension politique se niche d’abord dans sa visée qui est de saisir avec précision les enjeux profonds – et peut-être souterrains – de ce « massacre d’Etats », cette expression comme son pluriel devant être bien compris. Il ne s’agit pas d’établir cette qualification tant les éléments qui la documentent et l’attestent ont été amplement exposés en nombre et en détails[3], tout comme la complicité active des Etats marocain et espagnol[4]. Le repérage de ces enjeux profonds suppose de porter une attention privilégiée à la production du type de violence mise à l’œuvre à l’occasion de ce massacre dans la mesure où elle révèle, dans un même mouvement, la production étatique de catégories jugées menaçantes à des degrés variables et redevables de cette violence spécifique. Ce faisant, l’intelligibilité de ce massacre ne se circonscrit pas aux seuls enjeux concernant la politique « migratoire » entre le Maroc et l’Union européenne – et parmi ses membres, plus particulièrement l’Espagne –, pour concerner des enjeux relatifs à des processus contemporains qui participent sévèrement aux reconfigurations des Etats impliqués dans les mêmes politiques de violence, à commencer évidemment par celle baptisée « lutte contre l’immigration clandestine ». Cette mise au jour nécessite de considérer le massacre dans sa singularité comme de se focaliser sur l’Etat marocain[5], certes en prenant en compte ses spécificités historiques, sociales et politiques, mais en le considérant tout autant comme exemplaire de ces processus et ces dynamiques affectant bon nombre d’Etats contemporains.
C’est ainsi qu’il faut lire la qualification choisie de « massacre d’Etats ». Ce massacre de Mlilya qui a suscité à juste titre, outre l’effroi, énormément d’indignations[6] et d’interrogations, doit de ce fait être appréhendé comme un événement forçant à penser[7] ce qu’il révèle et actualise, à savoir une bascule repérable par la production d’une nouvelle catégorie d’exilés noirs. En l’occurrence, cette catégorie est érigée en une menace inédite au point d’être soumise à une violence étatique distincte, dans ses formes et dans son intensité, de celle que l’Etat marocain réservait jusque-là aux exilés noirs présents sur son territoire et catégorisés sous le nom de « Subsahariens » ; cette nouvelle catégorie prenant le nom d’une nationalité, « Soudanais ». Celle-ci mérite une attention serrée tant elle permet de mettre au jour un processus en cours qui fait passer les exilés noirs du statut de menace à celui d’ennemi. C’est précisément ce devenir-ennemi que l’analyse se propose d’identifier et d’éclairer. Il me semble que seule une enquête politique est à même de saisir de tels processus en cours en se centrant non seulement sur la question de l’Etat mais plus particulièrement sur sa capacité à penser et à pratiquer la violence. Loin d’être envisagée comme un outil au service de politiques de nature différente ou comme la conséquence du néolibéralisme[8], elle est ici réhabilitée dans son statut d’édificateur, sans cesse reconduit, de l’Etat sur un territoire et face à des catégories de populations distinguées et discriminées selon la violence prodiguée.
Sur tous les continents, ce statut se signale par la policiarisation et la militarisation accrues que connait un grand nombre d’Etats, et qui poursuivent, en la renouvelant éventuellement, la production de menaces et d’ennemis, dans et hors leurs frontières.
Une enquête politique par son matériau et sa méthode d’analyse
Il est évident que la centration sur l’Etat ne garantit pas à elle seule la nature politique de cette enquête, qui se niche, outre dans ses objectifs, tout autant dans son matériau et sa méthode retenus.
Au-delà de son caractère composite, la charge politique du matériau réside pleinement dans son opposition frontale aux discours construits dès les premiers instants par l’Etat marocain – confortés dans les grandes lignes par ceux de l’Etat espagnol. Les trois matériaux utilisés reposent en effet sur des investigations conduites dans les premiers temps si cruciaux[9] pour accéder aux témoignages de rescapés et/ou à des lieux décisifs relatifs au massacre, à sa dissimulation, voire à son effacement.
Le premier matériau est un entretien que j’ai moi-même réalisé avec deux rescapés soudanais cinq jours après le massacre et à quelques centaines de kilomètres de Mlilya. Les deux autres pièces s’inscrivent dans un temps bien plus long que l’urgence qui a présidé à notre rencontre. Il s’agit de deux enquêtes menées par deux journalistes marocains présents dès le premier jour, et de l’enquête militante effectuée au long cours par l’Association Marocaine des Droits de l’Homme Section Nador (AMDH Nador), et qui se révèle la plus déterminante. Séparément et conjointement, les trois investigations établissent incontestablement la qualification de « massacre d’Etats », même si le vocable n’est pas nécessairement utilisé aussi bien par mes interlocuteurs, deux jeunes Soudanais[10], par les journalistes Saïd Elmrabet[11] et Salaheddine Lemaizi[12] dans leurs articles, que par les militants de l’AMDH Nador dans leur rapport rendu publique le 20 juillet[13] ou leurs publications sur leur page facebook – au profit le plus souvent de « drame » ou de « crime ». Des hommes désarmés ont été tués par des policiers engagés dans le cadre de ce qui apparaît comme un dispositif conjoignant différents corps de police et de gendarmerie et usant d’armes et de tactiques plurielles, et cela, non pas tant dans un but de répression que de terreur par une violence déchainée. Celle-ci a été déployée par l’usage intensif de gaz lacrymogène, de bombes fumigènes, d’armes à balles de caoutchouc ainsi que par le tabassage confinant au lynchage, suivi par l’abandon, à une agonie longue de plusieurs heures cruciales, de très nombreux blessés graves. Ainsi, les enquêtes journalistiques et militantes ont réussi à contrarier le monopole mensonger que les autorités marocaines avaient tenté de conserver sur le récit et le sens à donner sur ce qui a lieu le 24 juin 2022. En effet et de manière assez classique, leur stratégie médiatique a reposé sur la dialectique d’une visibilisation et d’une invisibilisation, visant à présenter les exilés soudanais comme redoutablement violents à l’égard de policiers à la fois surpris et respectueux des règles d’engagement face à une attaque organisée contre l’une des frontières terrestres avec l’Espagne. Simplement, il me faut préciser que la publication des premiers éléments tangibles et significatifs des enquêtes indépendantes n’aura pas lieu pendant quelques jours, laissant la prééminence à la version étatique relayée par la presse inféodée au régime. C’est dans ce contexte qu’a lieu ma rencontre avec les deux jeunes rescapés.[14] Le projet initial de cet entretien réalisé à Khouribga[15] qu’ils ont pu rejoindre après avoir été refoulés et dispersés vers des villes lointaines, a été justement de répondre à l’urgence de faire connaître leur version précise du massacre. Cette intention première de l’entretien a donc été abandonnée dès les premiers articles publiés, au profit d’une enquête déprise de cette urgence.
Autre ressort politique majeur de ce matériau d’enquête, cette démarche commune de vérité se paie de difficultés, d’entraves, voire de prises de risques. Saïd Elmrabet et Salaheddine Lemaizi évoquent des pressions policières les empêchant tout particulièrement d’approcher des exilés présumés rescapés aux abords de Mlilya. S’ajoutent à ces considérations circonstancielles, les contraintes explicites ou non qui pèsent sur des journalistes tâchant de travailler à distance du régime.[16] Militant à l’Amdh Nador et principal enquêteur, Omar Naji fait le récit bien détaillé des empêchements qui lui ont été opposés, notamment à l’hôpital de Nador dont l’entrée lui a été interdite. En revanche, sa présence dans un cimetière a permis de mettre fin à une première tentative d’inhumer des morts en catimini dès les premiers jours après le massacre, et en l’absence de toute procédure permettant la moindre identification des hommes morts. Plus largement et pour ne parler que de la situation faite aux exilés, la répression visant l’Amdh Nador est récurrente, avec des précédents comme une garde à vue de Omar Naji en avril 2020 pour des propos jugés calomnieux envers des agents des autorités de la région. Elle s’est poursuivie après la publication du rapport avec l’empêchement d’une réunion et l’interdiction d’une marche aux chandelles le 25 décembre 2022 à Nador[17].
La prise de risques est d’une tout autre nature concernant mes interlocuteurs qui acceptent de rencontrer une Marocaine qui leur est inconnue dans un pays devenu subitement hostile tant la propagande érigeant les dits « Soudanais » en hommes violents est assénée chaque jour dans quasiment tous les médias. Et alors qu’ils sont eux-mêmes encore accablés par les meurtrissures psychiques et physiques du massacre, les leurs comme celles de leurs frères de condition.
Les deux dernières dimensions politiques du matériau découlent quant à elles uniquement du geste de mes interlocuteurs de m’accorder cet entretien ou plutôt de s’en emparer. Il relève tout d’abord d’une éthique confinant à la politique, dans la mesure où il s’agit pour eux de rendre hommage à leurs frères tués et/ou disparus parmi lesquels certains leur étaient connus[18]. Ce faisant, ils leur offrent un tombeau dans l’évocation très précise de ce qui s’est passé juste avant, pendant et juste après le massacre[19]. Il est également politique puisqu’il leur permet de se constituer comme des sujets parlants et pas seulement parlés, y compris dans un témoignage se voulant prioritairement factuel[20]. Dans ces conditions, cette enquête dont l’existence est entièrement initiée et déterminée par cette rencontre, a été placée d’emblée sous le régime de la dette et de la responsabilité.
C’est en un sens circonscrit à l’opposition aux mensonges d’Etat que ce matériau doit être considéré comme politique. Il s’agit d’une garantie à la fois essentielle et minimale à toute enquête sérieuse, et davantage lorsqu’elle ne produit qu’une partie du matériau analysé, comme c’est le cas de celle que je propose. Mais la nature politique de l’enquête, loin de se réduire au recours à ce matériau, réside d’abord dans la méthode avec laquelle il a été travaillé ; ensuite dans les choix de problématisation des résultats de l’analyse obtenus.
La méthode utilisée se revendique politique en un sens assez circonscrit qui ne relève ni de l’idéologie, ni de traditions d’enquêtes militantes[21], tout en s’écartant des méthodes d’investigations journalistiques ou académiques. En effet, elle ne vise ni à produire des connaissances, ni à leur donner du sens à partir de problématisations et/ou théorisations a priori. Elle l’est parce qu’elle cherche à saisir ce que donne à penser l’événement examiné, ce qui peut être nommé son intellectualité[22]. Autrement dit, la méthode vise sa logique en ne présumant rien d’elle, car l’évènement peut correspondre à trois situations. Soit il vient signaler la poursuite d’une logique politique déjà repérée, soit une rupture marquant irrémédiablement un avant et un après, soit une bascule d’une logique à une autre mais sans rupture. Pour ce faire, elle envisage l’événement dans sa singularité en procédant à un certain nombre de suspensions. Elle suspend toute problématisation a priori qui donnerait d’emblée du sens aux éléments relevés comme elle suspend toute recherche d’explications et de causes – immédiates ou lointaines.
Ces suspensions garantissent les conditions de se focaliser sur ce qui a eu lieu et d’examiner les caractéristiques propres de l’événement et les éventuelles manifestations de l’inédit dont il serait porteur[23]. En effet, l’inédit est considéré comme faisant signe vers ce qu’il faut justement penser. En définitive, la méthode se veut politique au sens où elle offre un outil pour saisir des processus politiques contemporains – qu’ils aient lieu du côté des Etats ou des peuples[24]. Avec une modestie qui n’exclut pas la rigueur, elle cherche à se placer en phase du contemporain, mot qui peut sonner pompeux, mais qui signale l’effort et l’exigence de saisir ce que le présent donne à penser dans la mesure où il est traversé d’un faisceau de possibles et de potentialités, qui s’actualisent dans des événements. L’approche par la singularité suppose certes l’absence de problématisation a priori, mais elle ne revendique pour autant nulle ignorance méthodologique. En effet, la distinction de ce qui relève de logiques déjà identifiées ou de logiques nouvelles suppose au préalable un travail de lectures et de familiarisation avec les différentes perspectives problématisant la situation analysée.
En l’occurrence, j’ai abordé le massacre de Mlilya en mettant hors champ la problématique dominante relative à la collaboration de l’Etat marocain à la dite « lutte contre l’immigration clandestine » telle que pensée et pratiquée par l’UE, ainsi que la recherche de ses causes, de facteurs conjoncturels ou de ses objectifs. L’analyse vise précisément à saisir la rationalité étatique à l’œuvre et repérable dans les formes et les intensités de la violence policière prodiguée lors du massacre. Il se trouve que le matériau utilisé, outre ses qualités intrinsèques, se révèle compatible avec la méthode d’analyse adoptée. En effet, les trois enquêtes factuelles autorisent dans des proportions variables l’inscription des informations recueillies dans une temporalité plus élargie grâce à une familiarité ou une connaissance plus pointue des pratiques policières, aussi bien dans la région que dans l’ensemble du pays, à l’endroit des exilés noirs. Mes interlocuteurs les connaissent intimement depuis leur arrivée au Maroc il y a un an à peu près, et concernant celles à Mlilya, depuis des mois à ses abords. Les journalistes peuvent également prétendre à cette connaissance, du fait d’un travail documentant, pour l’un plus spécifiquement la région du Rif, pour l’autre la situation des exilés au Maroc[25]. Mais il est incontestable que les militants de l’Amdh Nador disposent d’une connaissance fine et ancienne de la situation des exilés dans la région, faisant de leurs rapports et de leurs communiqués des sources incontournables de manière générale, et une source prééminente pour cette enquête.
C’est donc à partir du repérage des pratiques policières de la violence que la rationalité de la politique étatique à l’œuvre dans le massacre peut être mise au jour. Ainsi, l’analyse prend-elle comme fil le traitement des corps durant le massacre de ceux que je préfère désormais nommer « exilants »[26] : tant ceux des vivants, des blessés, des morts que des disparus.
Les éléments saillants caractérisant la singularité du massacre
Comme déjà mentionné, le matériau permet d’établir que ce qui a eu lieu mérite bel et bien le qualificatif de « massacre » de façon documentée et concordante et en l’absence de preuves jugées irréfutables tels que des documents écrits et/ou sonores émanant des autorités. Par ailleurs, il le fait autant par les informations qu’il livre que par les doutes, les interrogations et les hypothèses qu’il soulève en toute légitimité et rationalité.
La chronique proposée ici ne vise pas tant le récit détaillé et exhaustif de ce qui a eu lieu que la mise au jour d’éléments saillants plaidant en faveur de la singularité du massacre. Mise en garde préalable, il est difficile d’échapper à une impression rétroactive, suscitée par la lecture du récit, d’être face à une mécanique qui s’est abattue sur les exilants de manière brutale, à la fois maîtrisée et incontrôlée. Cette impression doit pourtant laisser place à l’idée que ce massacre a été précipité par une suite de logiques à la fois immédiates et plus profondes, et par des décisions et des non-décisions effectuées aux différents niveaux de l’Etat ; ils auraient alors pris la forme d’ordres, et peut-être de contre-ordres, qui ont été traduits en actes et en gestes. L’invitation faite au service de l’enquête est de lire la chronique sans rechercher une intention, une préméditation, une planification, même si la tentation est forte. Il ne s’agit bien sûr pas de les écarter définitivement mais de laisser place à l’attention aux pratiques policières inédites qui se sont accumulées durant le massacre.
L’avant-massacre
La chronique du massacre ne commence pas avec lui au matin du 24 juin, mais quelques semaines auparavant avec la multiplication d’attaques policières massives contre le campement où s’est établi le groupe d’exilés noirs visés, celui de près de Selouane, d’existence plus récente et moins connue que celui de Gourougou où (sur)vivent des exilés venus majoritairement de pays francophones. Il réunit des Soudanais du Soudan et du Soudan du sud, des Tchadiens, des Ethiopiens pour citer les nationalités repérées par mes interlocuteurs. Sans doute pour des raisons de temps, ils ont fait remonter ces attaques aux jours précédents, mais grâce à une présence militante constante, l’Amdh Nador date le début de l’entreprise de harcèlement et de répression policiers au mois d’avril en comptabilisant cinq attaques successives. Il est notable que les campements font l’objet régulièrement de telles attaques visant à intimider, à éprouver psychiquement et physiquement avec des violences verbales et corporelles ainsi que des destructions de biens et de nourriture[27]. Mais cette fois-ci, tant mes interlocuteurs, présents aux abords de Mlilya depuis quelques mois, que l’Amdh Nador notent un changement qualificatif dans cette répression avec des techniques inédites : l’engagement de différents corps policiers, d’un hélicoptère, l’emploi de bombes fumigènes nécessairement incendiaires dans une forêt, la présence de responsables de la hiérarchie policière et politique, et le recours à un ultimatum de 24 heures pour quitter le campement. A quoi, il faut ajouter, ce qui serait également inédit, l’interdiction faite aux commerçants de vendre de la nourriture et l’impossibilité d’avoir accès à de l’eau. La criminalisation des activités liées à la vie des exilés est courante, mais ici elle touche à la survie.
Indépendamment de la question de la préméditation, l’ensemble de ces éléments, considérés séparément et davantage ensemble, accrédite la thèse que ce massacre a eu lieu, non pas contre une tentative de passage collective de la frontière coloniale avec l’Espagne, mais à l’occasion d’une tentative de fuite face à cette terreur policière et à l’impossibilité de subvenir aux besoins vitaux. Il me semble que persister à parler de ce massacre comme relevant de la même logique que les massacres précédents, en 2005 et 2014, qui eux ont bien eu lieu lors de tentatives de passage collectives relève d’une lecture tronquée voire erronée. Les « frappes »[28], nom donné aux tentatives de passage, comme me l’ont appris mes interlocuteurs, peuvent éventuellement s’effectuer dans un climat policier plus tendu, mais elles supposent une préparation longue de plusieurs semaines au moins, aussi bien organisationnelle, physique que psychique. Ce jour-là, les 800 personnes dont 4 femmes[29] – selon le décompte de mes interlocuteurs – ont fui, terrorisés, épuisés par le manque de sommeil, d’hydratation, d’alimentation, dépourvus de tout. Mes interlocuteurs racontent bien le départ précipité aux premières heures du matin et qui découle de l’ultimatum couplé aux conditions qui rendent impossible leur présence après des mois passés dans ce camp. A cet égard qui est loin d’être anecdotique, le massacre du 24 juin se distingue des massacres précédents.
La séquence suivante à considérer est précisément cette fuite vers un des points de passage de la frontière de Mlilya, vers le lieu fatidique du fait de ses caractéristiques spatiales qui ont participé du massacre. Mes interlocuteurs ont attiré mon attention sur le trouble né de la facilité avec laquelle les exilés ont rejoint ce lieu. En effet, aucune présence policière n’a été constatée qui aurait pu chercher à les dissuader de continuer à avancer, à les détourner, voire les arrêter. L’Amdh partage ce trouble en rappelant la présence d’une caserne des Forces Auxiliaires, corps policier sous régime militaire et impliqué dans la répression des exilés, peu éloignée du campement. Mes interlocuteurs évoquent la présence tout aussi troublante de nombreux fourgons stationnés le long de la route qu’ils empruntent, vides de toute présence policière, leur donnant la vive impression de servir de guides ou de balises sur le trajet à prendre. Les mots « embuscade », « guet-apens » surgissent immédiatement à l’esprit face à cette succession d’indices, auxquelles d’autres s’ajoutent. La route tracée à la fois par l’absence de policiers et la présence tout au long d’elle de véhicules policiers conduit ces hommes et ces quelques femmes directement au point de passage, baptisé du nom espagnol Bario Chino, qui présente pourtant un certain nombre de caractéristiques dissuadant le choix de ce lieu pour tenter un passage collectif. Il est assez resserré et sert habituellement au passage individuel, principalement de Marocaines faisant transiter des marchandises portées sur leur dos, et qui s’effectue par tourniquet dans le sens contraire, depuis le territoire occupé par l’Espagne. Ce lieu se présente comme un goulet d’étranglement, une souricière pour des centaines d’hommes terrorisés par des semaines de terreur et épuisés par le manque de sommeil et la faim. Outre la destination qui semble avoir été encouragée, il faut noter la présence anticipée et nombreuse de policiers qui attendaient le groupe. Détail loin d’être anecdotique, l’existence d’images filmées par la police de l’arrivée aux abords de la frontière laisse fortement envisager une attente organisée.
Encore une fois, le caractère prémédité du massacre ne doit pas accaparer l’attention et rendre prioritaire son élucidation. En revanche, il est possible d’invoquer l’usage d’un renfort de tactiques et de moyens pour faire « disparaître » ce groupe installé près de la frontière coloniale avec l’Espagne. Ce mot est volontairement choisi sans pour autant laisser entendre qu’il s’est agi de les tuer tous. Le choix n’a clairement pas été de les éloigner de la frontière, ce qui aurait supposé de procéder directement à des « refoulements » soit vers la frontière avec l’Algérie soit à l’intérieur du pays, et cela, même violement. L’hypothèse avancée le plus souvent, explicitement ou implicitement quant à ce choix de les attirer vers la frontière serait de démontrer par la preuve du retour à la collaboration active dans la défense des frontières avec l’Espagne, résultat et gage de l’amélioration des relations entre les deux Etats depuis le mois de mars de la même année. Cette hypothèse avancée par les journalistes et l’Amdh ne peut pas être écartée au titre d’explication circonstancielle, mais elle se désavoue elle-même comme explication principale au regard du massacre, et à l’ampleur de la violence. Autrement dit, elle peut tenir comme un des éléments du déclenchement de la séquence, mais pas à propos de son déroulement.
La séquence qui précède immédiatement le massacre, marquée donc par des attaques inouïes et le guet-apens, doit être connectée aux éléments inédits du massacre lui-même. En cela, les deux séquences font partie du même dispositif à analyser, en dépit encore une fois des incertitudes. Si je nomme cette séquence de la sorte, pour autant, je l’intègre dans le même dispositif « massacre » pour saisir ce qu’il y a à penser. Le massacre n’a pas lieu à l’occasion d’une tentative de franchissement collectif de la frontière, mais d’une opération de terreur conduisant à une fuite. Ainsi, le déploiement policier est nécessairement autre. Par ailleurs, l’objectif apparaît comme celui de faire « disparaître » ce campement ; ce mot ne signifie pas que la décision de tuer le plus grand nombre a été prise, mais que le déploiement n’a pas cherché à éviter un grand nombre de morts et de blessés. Encore une fois, il ne s’agit pas de comprendre cet « avant-massacre » rétrospectivement mais de rapporter ses caractéristiques à celles du massacre pendant son déroulement, dans la mesure où elles prennent du sens dans le même dispositif.
L’administration de la mort et des blessures
La singularité du massacre se signale dès son avant-immédiat mais elle éclate indiscutablement si l’on déroule le fil directeur que l’enquête s’est choisie : le traitement des corps des exilants noirs et donc la violence prodiguée contre eux. Les caractéristiques inédites des formes et de l’intensité de la violence sont d’ailleurs soulignées par mes interlocuteurs, les deux journalistes et l’Amdh-Nador. Coexistant avec des pratiques policières habituelles de répression – aussi bien lors des deux massacres précédents[30] que dans la répression quotidienne – trois procédés administrant la mort ou des blessures méritent d’être analysés. Cette analyse s’effectue dans des conditions qu’il s’agit de bien avoir en tête. Un après, aucune enquête systématique et indépendante n’a été menée[31] qui autoriserait le décompte des morts et des blessés et l’établissement de la nature exacte des blessures. La condamnation d’une telle enquête à ne jamais voir le jour participe pleinement de la mécanique de déshumanisation ou d’infériorisation [32] qui continue à s’exercer sur les rescapés et sur les familles endeuillées. Ces morts ne méritent pas d’être comptés. Autre nombre inconnu, celui des hommes traqués et violentés. Mes interlocuteurs parlent de 800, quand les premières informations évoquaient 2000, puis des nombres plus réduits à 1200 ou 1500. Si je conviens de la difficulté d’un tel décompte, son défaut empêche d’apprécier l’ampleur de la violence en déterminant, même approximativement, la proportion de blessés et de morts.
Trois techniques d’administration de la mort et des blessures méritent notre attention, même si l’une d’entre elles se révèle prééminente, à savoir le tabassage confinant au lynchage, visant particulièrement la tête des hommes. Si ce ciblage n’a pas été (heureusement) systématique, il n’en est pas moins significatif. Il prend sens également en lien avec les deux autres méthodes que sont le recours au gaz lacrymogène dans des proportions intrigantes ainsi que l’abandon des blessés pendant de nombreuses et longues heures sans soins.
Commençons par l’usage du gaz par les policiers marocains et espagnols[33]. Envoyé en volume dans ce lieu exigu, il conduit incontestablement à la mort de beaucoup d’entre eux. Gazés, certains chuteront et/ou se feront écrasés. Ils ont vu des hommes ne pas réussir à boire de l’eau qui leur était tendue ou tout simplement à respirer. Les enquêtes journalistiques comme celle de l’Amdh pointent son usage massif et dangereux dans un tel lieu. Mes interlocuteurs apportent une autre précision sur le gaz lacrymogène, que je n’ai retrouvée dans aucune des lectures faites : le recours à deux types de gaz distinguables par leur couleur. Outre le gaz blanc, ils ont en vu un autre de couleur jaune qui leur apparaissait comme le plus nocif. Même en l’absence de confirmation, ne peut pas être totalement écartée l’idée que ces lieux de violence étatique se prêtent à l’emploi de nouvelles armes et/ou techniques. Si un doute peut être autorisé quant à la volonté de tuer par l’usage de gaz lacrymogène, son usage aussi massif dans un lieu aussi exigu laisse ouvert le doute. Mes interlocuteurs indiquent que des policiers masqués étaient tellement incommodés par le gaz, qu’ils devaient être régulièrement remplacés. Autre indice, Omar Naji, qui réussira à entrer dans la morgue de l’hôpital de Nador quelques instants, pourra voir certains corps ne présentent aucune trace de blessure.
L’autre technique de mise à mort, incontestablement directe cette fois-ci, est le tabassage confinant au lynchage. Les tabassages constituent une pratique habituelle de répression lors des tentatives de franchissements de frontière. Ils répondent immédiatement à l’imposition aux policiers d’un rapport de forces momentanément inversé grâce à la dimension collective des tentatives. Mais comme le rappellent mes interlocuteurs et la documentation existante, ces tabassages visent habituellement les membres inférieurs afin de rendre invalides pendant des semaines voire davantage les exilants noirs.[34] D’ailleurs, les deux rescapés rencontrés étaient accompagnés d’un frère de condition, retenu à Khouribga par une blessure, encore non guérie à la cheville, infligée volontairement par des policiers lors de sa dernière tentative de passage à Mlilya. Mais lors du massacre, les têtes ont été volontairement ciblées[35]. C’est une chose de frapper et de tabasser, c’en est une autre que de viser cette partie du corps. La volonté de tuer est perceptible selon mes interlocuteurs comme ceux rencontrés par les deux journalistes. L’un d’eux reprendra le terme de « tasfyia » en arabe qui signifie élimination ou extermination. Le caractère significatif de ce type de tabassage soulève bien entendu la question des ordres et des consignes, explicites ou implicites, question classique lors de tels crimes massifs d’Etat. Si l’on se place plus précisément du côté des conditions pratiques de l’exécution du massacre, il est nécessaire de s’interroger sur la préparation mentale des policiers. Outre leur participation à la répression quotidienne contre les exilants, sans doute qu’une partie d’entre eux ont collaboré à l’entreprise de terreur précédant le 24 juin ou ont en assurément entendu parler. Même si elle ne peut être résolue sans le recours d’entretiens avec certains de ces policiers, cette question doit figurer dans l’analyse du massacre : qu’est-ce qui a armé les bras de ces policiers marocains[36] ? L’un des ressorts principaux de cette violence policière tient dans l’anti-noirceur. Cette négrophobie policière marocaine relève de logiques historiques et sociales à laquelle s’entremêle la logique propre à cette institution engagée depuis plus de 20 ans dans cette répression quotidienne et multiforme contre les exilants noirs dans la région et dans tout le pays. Résultant donc de l’amalgame et de la sédimentation de discours et de pratiques relatifs à la dite « lutte contre l’immigration illégale », elle use d’une violence pouvant humilier, blesser, mutiler, voire, tuer des hommes noirs. Ces derniers sont en effet réduits à des corps devant être nécessairement soumis à cette violence ou bien fantasmés comme hyperviolents lorsqu’ils sont en groupe.[37] A ce propos, des exilants camerounais rencontrés pendant ce même séjour au Maroc m’avaient raconté l’obsession policière de la recherche de « meneurs » juste après la mise en échec d’une « frappe ». Cette figure hautement criminalisée est repérée notamment par une musculature développée[38], rappelant que les policiers marocains envisagent leurs rapports avec les exilants noirs comme un face-à-face entre deux masculinités. Le massacre vient nous signifier combien les enjeux racistes s’inscrivent dans les corps, bien sûr dans ceux qui doivent être capturés et violentés, mais également dans ceux qui exercent la violence. C’est cette incorporation de l’anti-noirceur qui éclaire le déchainement de violence et sa brutalité. Mais cette volonté acharnée de tuer en visant les têtes indique que cette négrophobie routinière a été contrariée, laissant place à cette violence décuplée et exterminatrice. Indépendamment de l’existence ou non d’ordres précis, il me semble qu’un aspect passé sous silence[39] et qui m’a été mentionné par mes interlocuteurs doit être avancé : des policiers ont prononcé le nom de « kouffar » qui signe une exclusion de la communauté musulmane. « Kouffar » a ainsi accompagné les coups tandis qu’il répondait aux récitations de la Chahada[40] ou de versets coraniques effectuées en guise de protection face à la mort ou à son imminence. Il me semble que cette volonté soulignée de les exterminer trouve ici un de ses ressorts fondamentaux, mais à la condition de préciser que cette exclusion ne vise pas des noirs musulmans africains mais des noirs musulmans arabes[41]. En effet, le partage de la langue arabe – au-delà des variations entre la langue parlée au Soudan et celle au Maroc et du plurilinguisme en vigueur dans les deux pays – distingue aux yeux des policiers marocains les Soudanais des « Subsahariens » qui peuvent être aussi musulmans. Ces derniers ont pu également manifester leur islamité lors de moments d’extrême violence ou de terreur, par des récitations en arabe, en guise de renforts contre la violence mortifère en vue d’atténuer cette violence. Mais concernant les Soudanais, il est à penser que l’effet ait été inversé du fait qu’ils soient arabophones. Sans doute ont-ils parlé en arabe entre eux ou en s’adressant aux policiers. L’anti-noirceur s’est donc vue troublée, non par l’islamité mais par l’arabité manifestée par le partage de la langue. Cette hypothèse est fondée sur le fait historique que la négrophobie marocaine/maghrébine a pu lier la noirceur à l’esclavage sans que cette association ne soit désamorcée par l’appartenance islamique.[42] A cette logique qui innerve la négrophobie contemporaine, il faut ajouter les représentations multiséculaires faisant des musulmans noirs africains des musulmans de « seconde zone » et pas tout à fait aboutis. La négrophobie habituelle s’est donc retrouvée contrariée car ne permettant plus à ces policiers de marquer indiscutablement les frontières entre eux et ces hommes noirs qui leur manifestaient l’appartenance commune à la « civilisation arabo-musulmane ». Face à cette langue qui les rapproche et rappelle que l’arabité n’exclut pas la noirceur et vice-et-versa, les policiers ont dû recréer in situ une nouvelle démarcation au moment même où ils exerçaient la violence sur leurs corps. Le trouble a intensifié la violence de leurs gestes et de leurs propos. Il ne s’est pas agi de les exclure de l’humanité, en les animalisant, mais de la Oumma en vue de se préserver de toute proximité subjective fondée sur des éléments constitutifs de l’appartenance à un groupe. C’est cette démarcation opérée en toute urgence qui permettrait de saisir la violence opérée pendant le massacre, qui ne relève donc pas seulement de sur-violence.
Si je considère centrale cette manière de tuer qui a été vécue et comprise comme une volonté d’éliminer, elle continue à prendre du sens avec l’autre manière d’administrer la mort qu’est l’abandon des blessés pendant des heures au soleil et privés des soins urgents[43]. Les exposer au risque accru de la mort se double du fait de laisser mourir. Certes, cet abandon résulte d’arbitrages rendant prioritaire l’évacuation des survivants-témoins en vue de les arrêter et/ou de les refouler à l’intérieur du pays. Mais il s’agit aussi de saisir la logique d’un tel traitement de déshumanisation tant de ceux qui vont mourir que des blessés de manière moins grave et traumatisés davantage par le calvaire de leurs compagnons mourants. Il se trouve que les images les plus nombreuses concernent ce moment où les policiers surveillent et tabassent les survivants – et peut-être des morts – jetés sur les corps des blessés graves et des morts. A juste titre, Norman Ajari analyse ces images de corps noirs amoncelées aux frontières comme la monstration qu’ils sont catégorisés comme des déchets[44], voués également à être recyclés en images servant à dissuader d’autres exilants à prendre cette route. Si l’on ne peut que convenir de cet usage des images, celles-ci doivent surtout être regardées pour elles-mêmes et pour ce qu’elles montrent. L’entassement, le tabassage et l’abandon à une agonie fatale font partie intégrante du massacre en organisant sa nécro-violence.[45]

