Talat Qudaih
Journal de la destruction de Gaza
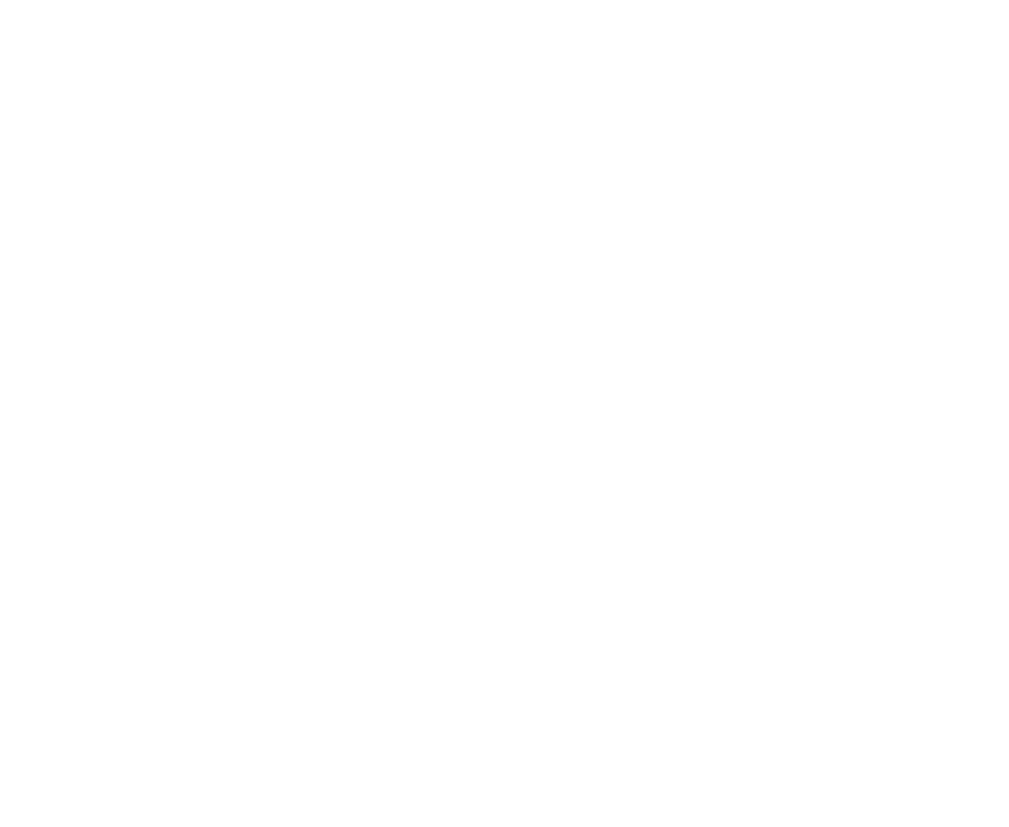
Ce texte a orginellement paru dans New Lines Magazine.
Pourquoi devons-nous retranscrire ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023 ? Faut-il faire la chronique des calamités qui nous ont frappés, semblables à une pluie torrentielle, ces attaques de missiles, de bombes, d'obus et de balles qui ont éteint tant de vies, déchiré en lambeaux tant de corps et porté une ombre définitive sur l'essence de l'enfance et de l'innocence ? Au milieu des débris de corps humains et des torrents de sang, comment puis-je rassembler la détermination nécessaire pour écrire sur toutes ces tragédies ? Depuis la trame débutée le 7 octobre, le monde est stupéfait, assistant à la transformation de Gaza en un charnier, brûlée comme si elle était en proie aux flammes de l'enfer. La communauté internationale observe en temps réel les horreurs de Gaza engloutie par le feu, sa destruction teintée de l'odeur nauséabonde de la chair brûlée, un spectacle abominable de désolation cataclysmique.
Maintenant, au cœur de la dévastation, nous devons demeurer là à voir notre monde s'effondrer autour de nous. Une série d'interrogations angoissantes nous assaille, nous poussant vers le désir de l'oubli : Qu'en est-il de notre subsistance ? De nos rêves ? Ces questions rongent notre être lui-même, à la fois son âme et sa chair, d'une manière jamais rencontrée dans nos précédentes expériences de guerre. Nos esprits sont submergés par un dilemme existentiel : Vers qui nous tourner ? Comment persévérer à travers malgré cette oblitération ? Vers quel vaste vide finirons-nous par nous élever ?
Dès le départ, il était clair pour moi que seuls ceux élus par le destin résisteraient à la tempête de cette guerre. Le matin du 7 octobre, la situation était incertaine. Les bruits de roquettes et d'obus lancés depuis Gaza remplissaient l'air. En cherchant sur internet des informations, je suis tombé sur des témoignages attestant de véhicules de type jeep investissant les implantations israéliennes près de ce qui est communément appelé l'enveloppe de Gaza, ainsi que de groupes prenant le contrôle des distinctifs toits en tuiles des implantations. La confusion régnait. Était-ce là l'œuvre de l'intelligence artificielle ? Il était difficile de croire que l'appareil sécuritaire tant vanté d'Israël, réputé pour sa sophistication technique et ses capacités de surveillance, pouvait être si facilement submergé. Seuls les assaillants connaissaient la vérité sur ce qui se passait.
Mon ami, l'écrivain Nasser Atallah, était alors en Syrie. Il m'a contacté, désireux de comprendre ces développements totalement inattendus. Je lui ai partagé les maigres informations diffusées par les médias ce matin-là : un leader au sein d'une faction palestinienne avait été tué, ce qui aurait déclenché cette réponse (je pensais au volume inhabituel de roquettes tirées). Un média hébreu titrait : "Le Jihad islamique a perdu la tête !" L'hypothèse dominante était que le Jihad islamique palestinien (PIJ) était responsable des attaques de roquettes, et non le Hamas, qui semblait ne pas avoir anticipé une escalade militaire.
J'ai fait le choix de demeurer chez moi, à moins que la situation ne se détériore brutalement. Avec ma famille, nous avons ainsi passé plusieurs nuits à la maison, observant de près les événements en cours. C'était la guerre, mais pas n'importe quelle guerre. Le nombre de morts du côté opposé dépassait le total des victimes de tous les conflits précédents d'Israël, des centaines d'autres étant également capturées. Cette réalité était au-delà de toute compréhension. Les détails de comment et pourquoi cela s'est produit pourraient rester inconnus pendant un long temps.
Rester chez nous, à l'est de Khan Yunis, près de la frontière, commençait de plus en plus à ressembler à un jeu dangereux. Nous avons donc décidé de chercher plus de sécurité ailleurs. Nous avons trouvé refuge dans une bibliothèque, plus précisément dans la bibliothèque de mon ami Nasser. Dès le départ de la guerre, il nous avait gracieusement offert une place au rez-de-chaussée de sa maison. Trouver refuge dans une bibliothèque était une sorte de luxe, qui éveillait en moi le désir naturel d'explorer ses richesses. J'ai découvert les œuvres d'auteurs familiers, comme l'écrivain palestinien Ahmed Zakarneh et ses écrits sur la conscience de la défaite. Y avait-il comme une sorte de prophétisme dans sa contemplation de la guerre, peut-être une sorte d'intuition prémonitoire sur quoi faire quand cela se produit ? Nous sommes restés en place pendant trois jours jusqu'à ce qu'un avertissement des forces d'occupation nous oblige à évacuer les lieux.
Au départ, j'ai pensé aux écoles de l'UNRWA comme refuge, mais, suivant les conseils avisés des uns et des autres de chercher des domiciles séparés pour augmenter les chances de survie de membres de la famille, j'ai choisi de nous disperser entre Bani Suhaila, une ville à l'est de Khan Yunis, et la ville de Khan Yunis elle-même, dans le sud de la bande de Gaza. Au cours du mois suivant ou plus, notre temps a été scandé par de brèves réunions au milieu de séparations prolongées. Certains d'entre nous ont trouvé refuge dans l'école de la ville, tandis que d'autres étaient dans ses rues.
Le question de savoir si un écrivain peut se détacher des turpitudes de la vie en temps de guerre a persisté dans mes pensées, en particulier après une conversation avec le directeur d'une école de l'UNRWA. Il m'a demandé : "Combien de membres de votre famille avez-vous ?" Compte tenu de notre dispersion, je me suis demandé si je devais indiquer le nombre plus petit effectivement avec moi à l'heure de la question ou le plus grand représentant tous les membres de la famille. Cette décision affecterait nos maigres allocations alimentaires journalières. Oh, ai-je oublié de mentionner qu'à ce stade, notre survie dépendait des repas quotidiens fournis ? Alors que la guerre s'intensifiait, la douleur imprégnait notre quotdien et le fardeau de vivre augmentait.
La question persistante du "comment" était devenue une flamme inextinguible, faisant éclater une profonde détresse, laquelle était encore accentuée par les regards interrogateurs de ceux sous ma responsabilité : Comment en sommes-nous arrivés là et quand cela prendra-t-il fin ? En quittant l'école et l'abri, j'ai éprouvé deux types distincts d'angoisse. La première était lié à l'instinct de survie que je voyais à l'œuvre autour de moi, transformant les gens en êtres mus par le désir et prêts à échanger n'importe quoi contre les nécessités les plus élémentaires, une routine quotidienne qui écrase l'âme. La deuxième source d'angoisse provenait de la contemplation de l'avenir, avec la question du "quand" refaisant surface, celle-ci résonnant poignamment avec les larmes des événements passés et en cours.
Une tempête de douleur hantait les méandres de mes pensées. Les gens sont doués pour posséder, même lorsqu'ils ont déjà beaucoup. Les veines de nombreux individus s'étaient raidies à force de porter plusieurs sacs et cartons d'aide, mais aucune quantité n'était jamais suffisante. La cupidité ne fait pas de distinction entre la guerre et la paix.
Les sables mouvants de l'actualité quotidienne nous ont rapidement emmenés de la perspective d'une trêve ou du retour calme à la réalité de la rage de l'occupant, enfonçant implacablement ses baïonnettes dans notre chair. Nous ne recherchions plus de nouvelles cachées et avons commencé à ignorer toute actualité qui ne contenait pas le terme clair et sans équivoque : Cessez-le-feu ! À quoi nous sert l'actualité si elle n'offre pas le moindre soupçon de certitude ?
La guerre prendra fin un jour, et une nouvelle guerre, d'un autre genre, commencera. Une guerre féroce, déclenchée par notre anticipation de retourner chez nous et de trouver un moyen d'y revenir. Au cours de ce voyage, des milliers de questions terrifiantes surgiront comme des mines posées et oubliées, concernant ce qui s'est passé et ses conséquences.
Ensuite, chacun de nous commencera à comprendre l'avenir qui se profile, confronté à un barrage de questions : comment, quand, où, pourquoi, et si ? Ces questions ne resteront pas seules ; au contraire, elles formeront l'alphabet de ce qui était et de ce qui sera.
La cause de la Palestine n'est pas uniquement une question palestinienne, arabe ou islamique ; c'est une question humaine, existentielle. C'est une question universelle, une lutte entre la tyrannie et la quête de liberté contre celle-ci. L'histoire documentera tout ce qui s'est passé, capturant à la fois sa lumière et son ombre. Il faudra seulement du temps pour découvrir comment le 7 octobre est arrivé. Ne supposez pas que ce jour est sans ses complexités, que ce soit dans ses signes, ses prémices ou ses conséquences. Cependant, quoiqu'il en soit, c'est un jour qui a modifié le cours de nos existences.
J'écris, donc je vis toujours.
Nous ruminerons nos dix jours de guerre comme si c'était un melon amer. Le temps a perdu son sens, comme s'il s'agissait de dix ans, et non de 10 jours. L'inondation nous entraîne dans ses spirales et le long de ses courants. La soirée de raids et de bombes a commencé tôt ce soir. Immédiatement après le coucher du soleil, il y a eu des bombardements de maisons et de l'université Al-Aqsa à Khan Yunis. Les maisons sont démolies sur la tête de leurs occupants, et les sirènes des ambulances ne se taisent ni ne se reposent. Leur vitesse est effrayante, la peur est proportionnelle au nombre de morts et de blessés, mais jamais proche de la profondeur de la douleur s'écoulant de nos âmes.
L'exode vers le sud est en cours. Au lit, je me retourne. Le sommeil m'a abandonné depuis le début de cette horreur. Le son des explosions et de la mort secoue la terre et brise le calme des cieux. Les gémissements douloureux du peuple et leurs murmures terrifiés et continus ne vous donnent pas, même pour un instant, la capacité de faire de la nuit le lieu d'un repos apte à surmonter la fatigue du corps et de l'âme. Vous vous réveillez terrifié à l'aube, à moins que la mort ne réussisse à se saisir de vous endormi. Vous vous précipitez pour appeler et vérifier que votre famille est en vie. Certains répondent et certains ne répondent pas, soit parce que le réseau de communication a été coupé, soit parce qu'ils se sont endormis, soit parce que leur téléphone était déchargé. Le matin, je sors. La scène quotidienne est la même, des files d'attente faisant suite à des files d'attente : des files d'attente pour du pain dont la quantité peut à peine combler les besoins vitaux, des files d'attente pour les toilettes, des files d'attente anticipant une bouffée d'électricité pour charger leurs téléphones portables, des files de voitures bondées, et la plus grande file d'attente est la file d'attente d'attente interminable - la file des jours. Une pensée déchire les murs de l'âme : "Cette guerre peut durer des semaines !" Puis une question ressurgit : "Où cela va-t-il nous mener ?"
Nous ne pensons chacun qu'à deux choses : la vie de nos membres de famille et la sécurité de nos maisons, car la perte de l'un ou de l'autre serait une catastrophe et une vie de souffrance. Nous ne savons pas quoi faire, nous ne pouvons attendre.
Hier, ils ont distribué des couvertures légères, ces couvertures de couleur plomb pour lesquelles l'UNRWA est mondialement célèbre. Nous ne voulons plus savoir ce qui se passe. Nous voulons juste nous calmer suffisamment pour dormir, vérifier que ceux que nous aimons sont en vie, faire n'importe quoi d'autre que regarder le ciel de peur qu'une bombe ne tombe soudainement. Nous souhaitons pouvoir dormir et nous sentir absents, pas totalement et en permanence éveillés !
Le sommeil m'a fui la nuit dernière, ne daignant même pas me toucher de son effleurement le plus léger. Les sons des explosions résonnaient à travers l'espace et le temps, avec la ferveur d'avions larguant l'incendie comme si le ciel pleuvait des flammes. Les ambulances, avec leur allure frénétique, déchiraient la surface de la terre, annonçant le désastre toute la nuit. Des scènes de destruction, le vacarme des bombardements et des avions de guerre, des conversations, des cris, des supplications et des efforts pour apporter une aide humanitaire avaient lieu tandis que des avions de guerre survolaient notre dévastation, notre soif, notre faim, notre souffrance et notre humanité même.
Le jour à Gaza pèse lourdement, consigné sur un calendrier d'humanité corrompue. Il commence avec la file d'attente matinale pour une miche de pain, afin de répondre au défi immense d'apaiser la faim d'un enfant en pleine guerre. Comme la liberté et le droit à la vie, le temps perd son essence dans la file d'attente, rendu sans valeur lorsque les tyrans s'en saisissent. Est-il utile d'attendre une demi-journée pour obtenir une demi-miche de pain, qui à son tour ne soutient la vie que pour une demi-journée supplémentaire ? La vie est précieuse, pourtant la mort plane sur nous.
Personnellement, mon souci pour la nourriture s'est estompé. Quand on perd l'enthousiasme pour la vie, la perspective de la mort cesse d'intimider. Quelques biscuits et une tasse de n'importe quelle boisson (café, thé ou autre) suffisent à combler ce besoin. J'ai embrassé une vie d'austérité, me formant au jeûne et à la marche. Je parcours de longues distances à pied, réfléchissant à la situation de Gaza.
Je suis stupéfait par ceux qui peuvent encore sourire au milieu de cette guerre, et je me demande : En souriant, s'entraînent-ils à afficher une expression qu'ils n'arriveraient pas à maîtriser plus tard ? Ou contournent-ils la réalité, l'évitant pour se préparer à un avenir encore plus sombre et plus désolé que notre existence actuelle ?
Trouver la moitié d'une miche de pain après trois ou quatre heures devient un acte héroïque qui exige de rester en file d'attente sans relâche dès l'aube. Si nous sortons vivants de cette guerre, nos attitudes envers le temps et l'attente en seront à jamais changées. Les pertes et les victoires perdent leurs significations et valeurs traditionnelles ; les victoires ne goûtent plus douces à moins qu'elles ne signifient pas la vie et l'abri pour un Gazaoui. La guerre de 2023 a divisé nos vies en un "avant" et un "après", modifiant les équilibres du profit et de la perte, de la valeur et de la non-valeur, à travers le prisme du conflit. La valeur et la signification des choses sont désormais mesurées par notre besoin pour elles, et au milieu de cette guerre brutale, il n'y a pas de besoin plus grand que la quête de vie et de sécurité.
Après avoir ouvert les yeux, vous les frottez, tentant d'éliminer la saleté. Faites attention de ne pas vous moucher trop vigoureusement pour éviter les tensions musculaires ou le risque de maladie. Vous pouvez vous rendre à la salle de bain si nécessaire. Lorsque vous vous lavez à partir d'un seau, il est bon de faire couler un peu d'eau sur vos cheveux - ne vous inquiétez pas de savoir si c'est sain. Envisagez de masser votre visage avec vos mains pour éviter qu'il ne devienne raide et n'accélère la formation des rides. N'est-il pas suffisant que nos cœurs portent les cicatrices du tribut de la guerre ?
À travers ce qu'on appelle le "couloir sûr", lequel permet aux résidents du nord et de la ville de Gaza de traverser vers le sud, les gens avancent en files sous les yeux vigilants des soldats. Des ordres sont donnés à travers des haut-parleurs : Arrêtez, marchez, venez, allez, etc. Soudain, une voix a appelé : "Toi, dans la veste marron, laisse tomber le sac de ton épaule, maintenant !"
Pour la personne interpellée, cela a semblé comme si le monde s'était brutalement renversé. Comment pouvait-il abandonner son sac, contenant toutes ses économies de toute une vie - 50 000 $, l'or de sa femme et de ses filles, et ses documents d'identité ? Pourtant, il n'y avait pas le choix ; c'était soit le sac, soit sa vie. Avec seulement un instants pour réfléchir, il posa son sac, laissant des décennies de ses espoirs derrière lui sur le sol sans se retourner. Ses larmes, ses gémissements silencieux et les cris étouffés et les hurlements de sa femme furent tout ce qui suivit. Il continua son chemin, et avec lui, tout passa. Si seulement les prisonniers dans les geôles de l'occupation savaient la dévastation que Gaza endurerait pour leur liberté. Peut-être, alors, préféreraient-ils leurs chaînes.
Nous sommes rentrés chez nous pendant sept jours pendant la trêve qui a commencé le 24 novembre, ramenant tout ce que nous avions emporté avec nous. Lorsque la trêve a pris fin, nous sommes partis avec très peu, espérant que la situation s'améliorerait après un jour ou deux. Maintenant, après une nuit de bombardements intensifs et d'explosions incessantes, je me demande si nous aurons jamais besoin des bagages que nous avons ramenés. Je comprends la valeur d'un foyer pour ceux qui y habitent. Les foyers occupent un espace en nous tout comme nous les occupons. Mon foyer a une histoire unique. Je l'ai nourri comme on nourrit un enfant. De 2011 jusqu'au début de 2023, il a mûri par mes soins, évoluant en une structure élégante avec une touche magique, remplie des échos de rires et de larmes dans chaque coin. Les foyers portent des histoires et des parfums.
Même les livres que j'avais emportés sont retournés à leur place légitime, dans leur bibliothèque, comme des enfants retrouvant l'étreinte d'une mère. Je suis parti avec seulement des vêtements et quelques ustensiles - les nécessités de base pour survivre.
Ce matin-là, j'étais déterminé à rentrer chez moi par tous les moyens nécessaires, quel qu'en soit le coût. Je n'ai pas hésité. Le manque de farine, de gaz et d'autres articles essentiels rendait la perspective de continuer à vivre dans une école insupportable. Plaçant ma foi en Dieu, au milieu des sifflements continus des bombardements, j'ai choisi de marcher sur les toits plutôt que de monter à vélo. Les routes étaient jonchées de débris des bombardements, un mélange de verre et de pierre. Chaque fois que je rencontrais un morceau d'asphalte, je montais à vélo.
En chemin, j'ai vu des dizaines de personnes transporter leurs affaires, craignant de ne pas pouvoir revenir dans les jours à venir en raison du danger anticipé suite à la menace du ministre de la Défense israélien Yoav Gallant d'entrer dans le sud de Gaza.
Malgré tout, je suis arrivé à Khuzaa intact. La ville semblait déserte, sans vie et oubliée. Je n'ai rencontré que quatre personnes transportant leurs bagages. J'ai continué, le cœur lourd et les larmes aux yeux, jusqu'à ce que j'atteigne enfin chez moi. Ma maison ! Oui, ma maison, es-tu encore debout ? Une vague de soulagement m'a envahi lorsque je l'ai vue debout, digne et intacte. Je l'ai embrassée comme si j'embrassais le visage de ma petite-fille. J'ai rapidement rassemblé ce que je pouvais et j'ai commencé à marcher rapidement, ayant récompensé mon effort par un bain chaud, espérant que la maison résisterait à mon voyage de retour. Mon départ s'est transformé en une course dès que j'ai entendu le sifflement des coups de feu, réalisant que rester était futile.
J'ai marché environ 5 kilomètres, avec le bruit des explosions pour compagnon. J'ai opté pour une route sablonneuse au retour. En chemin, j'ai rencontré des gens emballant leurs affaires et d'autres restant dans leurs maisons. En trouvant un robinet d'eau qui gouttait, je me suis précipité vers lui et j'ai bu à ma soif. Puis, je suis arrivé à la ville de Bani Suhaila à pied, me sentant quelque peu rassuré jusqu'à ce que je remarque des signes de bombardements récents. En demandant, j'ai appris que la zone avait été frappée il y a seulement 15 minutes. Trouvant un magasin ouvrant ses portes, j'ai demandé une bouteille d'eau, j'ai bu et j'ai apaisé ma soif.
Épuisé par les épreuves physiques et émotionnelles, je savais que la tâche devait être accomplie rapidement en raison de la menace constante, car aucun endroit à Gaza n'était sûr. En atteignant la ville de Khan Younès, on m'a immédiatement demandé : "Vendez-vous de la farine ?" J'ai répondu que non et j'ai continué vers ma destination. J'ai laissé tomber mon fardeau matériel mais j'ai gardé le fardeau interne caché. Avec un soupir profond, j'ai crié : "Ô maudite guerre, qu'as-tu fait de nous ?" Cette décision peut sembler insensée et dangereuse, mais les morts craignent-ils la mort ? Ainsi, le choix était fait.
Le voyage a duré environ 9 kilomètres.
Je marche sur une route encombrée de misérables, voyant des femmes pleurer leurs martyrs, leurs vies brisées, et la maternité écrasée par les chars de guerre, tout en étant transportées sur une charrette tirée par un âne qui montre plus de compassion pour notre détresse que les humains. Les larmes ont cessé de couler, réduites au silence par un excès de chagrin, les ravages de la guerre et l'oppression dans ma poitrine qui lutte pour respirer.
Nous sommes défigurés, dispersés ; nos cœurs sont déchirés par la violence et les larmes. Nos êtres intérieurs sont mutilés comme si nous avions perdu une partie de nous-mêmes que nous passerons le reste de notre vie - si nous survivons - à rechercher. Un abîme profond nous entraîne dans l'obscurité, un épais brouillard nous enveloppe, la mort frappe de toutes parts et les lueurs d'espoir s'estompent dans une terre plus accueillante à la vie. Cette terre n'est-elle pas rassasiée de sang versé ? Toute cette dévastation n'était-elle pas suffisante pour elle ? Combien de temps jusqu'à ce que les dés en soient jetés ?
Nous ne comprenons plus rien. Que se déroule-t-il devant nous ? Est-ce la réalité ou simplement une illusion ? Un cauchemar ou une punition ? Nous ne savons plus rien. Tout espoir est perdu. Il ne reste plus rien de digne de la vie dans une terre qui étanche sa soif avec le sang des innocents. Lorsque la mort peut réclamer votre vie à tout moment, tout en vous s'efface. Les questions vous blessent et les réponses vous trahissent. Quand ce cauchemar prendra-t-il fin ? Quand le salut viendra-t-il ?
Un couteau et de la chair peuvent-ils être considérés comme équivalents ? L'interaction entre la viande et le couteau est-elle égale, et la confrontation prolongée entre les deux sert-elle à la fois de métaphore et de réalité ? Un autre chapitre de la mort se déroule dans la guerre frénétique contre Gaza perpétrée par l'occupation israélienne. Soudain, le son d'un haut-parleur monté sur un drone a retenti à travers le quartier scolaire, annonçant : "Celui qui entend cet appel maintenant, partez immédiatement, cet endroit sera complètement détruit !"
Les visages ont exprimé le choc et l'horreur, les corps, les esprits ont tremblé et les yeux se sont remplis de larmes. Une question urgente est apparue pour tous ceux qui ont entendu cette menace mortelle : Où devrions-nous aller maintenant, ô Dieu ? En qui pouvons-nous chercher refuge, ô Seigneur du monde ? La terre s'est rétrécie, les cieux nous ont abandonnés !
L'annonce a suscité des ondes de chaos et de tourment à travers l'UNRWA et les autres écoles gouvernementales, ainsi que dans nos esprits écrasés sous la gravité de cette agression, comme si le jour du jugement était sur nous.
Pères et mères ont crié, nous exhortant à emporter ce qui pourrait nous aider à survivre un peu plus longtemps, à nous donner le temps de supporter l'exode, la faim et tous les tourments qui coulent dans nos veines comme le sang. Dans un élan de terreur pure, les gens se sont précipités pour sortir comme si c'était la fin du monde. Des milliers de personnes déplacées ont inondé les rues, fuyant les conditions infernales et la menace imminente de mort si nous n'échappions pas avec ce qui restait de nos vies - ou faisions face à une mort différée. Le voyage impliquait de passer par trois checkpoints militaires pour atteindre al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès (réputé sûr). Le premier checkpoint était particulièrement intimidant ; alors que j'approchais, il semblait que la saison du pèlerinage à La Mecque était en cours dans cette rue bondée, la traversée se faisait par un étroit passage de 4 mètres entre deux chars. Les enfants criaient, les femmes appelaient à l'aide au milieu de l'horreur, et les soldats lourdement armés faisaient des plaisanteries tout en dirigeant la circulation, exerçant une immense pression psychologique pensée pour épuiser les déplacés. Passer le premier checkpoint a apporté un soulagement momentané à la foule, nous permettant de rassembler ce qui restait de nos âmes et des quelques affaires que nous avions, principalement des couvertures pour se protéger du froid de l'hiver et du désespoir. Deux autres checkpoints, deux autres terreurs attendaient.
En atteignant al-Mawasi, nous avons entrepris un autre voyage de souffrance : la quête d'une tente, ou de tout semblant de refuge, pour protéger nos corps.
En guerre, la lumière électrique devient un luxe, nous nous contentons d'eau, indifférents à sa fraîcheur ou à son caractère salé. L'eau, aussi rare que la justice et l'humanité, devient suffisante pour être partagée entre nous, que ce soit pour étancher la soif, se laver ou faire ses ablutions. Cependant, pour obtenir même une petite quantité d'eau, deux possibilités émergent : vous installez votre tente près d'une source d'eau, généralement un puits d'eau salée (pas tout à fait pure), ou, si vous avez moins de chance, la source d'eau est loin, ce qui conduit à l'épreuve de transporter de l'eau dans un bidon ou un seau. Vous êtes hanté par des souvenirs d'eau abondante, réalisant seulement maintenant la bénédiction que vous teniez pour acquise.
Après avoir installé la tente, vous envisagez le besoin urgent de construire des toilettes rudimentaires - un trou, plusieurs morceaux de bois et un peu de tissu pour couvrir ce qu'on appelle euphémiquement une "salle de bain". Même cela nécessite des fonds, car les prix augmentent impitoyablement, ne montrant aucune considération ou pitié pour notre situation dans cette guerre brutale qui écrase principalement le citoyen ordinaire et vaincu.
Lorsque chacun de nous réfléchit à la situation infernale dans laquelle nous nous trouvons, sans aucune faute de notre part, nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter, de résister et de nous concentrer sur la satisfaction des besoins de base par tous les moyens nécessaires, en nous accrochant à l'espoir de survie.
Envisager la survie devient une expérience elle-même éprouvante, car au-delà de ce que l'esprit peut comprendre. Soudain, le monde se transforme, sans avertissement, en une nouvelle réalité sans caractéristiques discernables - un monde informe, changeant, où la cruauté et le chaos dépassent tout ce qui existe dans l'univers !
"J'ai besoin d'aide."
"Donnez-moi votre carte d'identité et votre carte de rationnement."
Dans l'interaction atténuée avec un employé de l'UNRWA, sans entrer dans les détails, vous vous conformez au processus, remettez votre carte d'identité et votre carte de rationnement, puis attendez.
"J'ai besoin d'aide."
"Donnez-moi votre carte d'identité."
Le fait de demander seulement la carte d'identité (et non la carte de rationnement) suggère que cette personne n'est pas un travailleur de l'UNRWA. Il semble que quelqu'un demande votre identification, mais votre attention n'est pas sur qui ils sont ; c'est sur l'obtention d'une aide... et ainsi, vous attendez.
Vous n'avez pas d'autre choix que de supporter l'attente, qui peut durer des jours. Elle peut être brève ou longue. Si la chance vous sourit, votre patience sera récompensée ; si vous revenez avec peu de résultats, vous vous résignez à la "gloire de l'essai".
Et ainsi de suite.
Contraint, vous lancez une autre tentative... et donc, vous attendez.
Pendant des mois, les habitants de Gaza ont fait face à un déplacement forcé, continu, se mouvant sans cesse d'un endroit à un autre. La seule directive s'agissant d'où aller vient de la page Facebook du coordinateur du gouvernement israélien et des tracts largués par des avions israéliens, n'offrant que des avertissements de catastrophe imminente. Ainsi, des ordres d'évacuation d'une zone à une autre se succèdent sans fin, infligeant un tourment psychologique et physique à ceux qui reçoivent ces tracts en papier, qui tombent comme des désastres miniaturisés sur nos esprits.
Pendant ces mois infernaux, le peuple palestinien de Gaza a enduré les ravages d'une guerre qui a tout nivelé sur son passage. Elle a anéanti les infrastructures de toute sorte, imposé un siège économique, rasé des maisons avec leurs habitants à l'intérieur, et ciblé toutes les formes de centres de santé, psychologiques et culturels, y compris les hôpitaux et les cliniques. Même l'Institut français, neutre dans ce conflit, n'a pas été épargné par la destruction. Cette guerre a été mortelle pour tous les aspects de la vie à Gaza, affectant à la fois les humains et les structures.
Le conflit a causé une détresse immense pour tout le monde, conduisant à une focalisation prédominante sur la survie individuelle - "moi, moi-même et moi" est devenu le mantra. La préoccupation pour les autres a considérablement diminué, et des coutumes peu familières ont émergé parmi notre peuple, toutes pointant vers une focalisation existentielle sur le soi.
En effet, la guerre a ravagé tout, y compris notre moi intérieur, alors que nous luttons pour notre survie personnelle et collective.
La vie est devenue centrée sur l'obtention d'une aide pour satisfaire la faim du peuple. Dans le sud de Gaza, nous nous trouvons dans une situation légèrement meilleure - ou moins désespérée - que nos homologues du nord, où l'occupation israélienne bloque carrément l'entrée de l'aide humanitaire dans les régions septentrionales et la ville de Gaza. Initialement, les largages aériens par des avions jordaniens semblaient presque ridicules ; l'aide tombait du ciel, seulement pour atterrir dans la mer, dans des zones reculées ou même dans des territoires occupés. Ce n'est qu'après des disputes que les colis ont été effectivement réclamés par les gens.
Imaginez, près d'un million de personnes ont faim.
Maintenant, les gens envient ceux qui ont été martyrisés le 8 octobre, car ils ont été épargnés de voir les tueries et la destructions généralisée qui ont a depuis englouti tout Gaza, un Gaza que nous ne reconnaissons guère plus.
La ligne entre le corps et l'âme devient de plus en plus floue. On dit que le corps vieillit tandis que l'âme reste jeune. Que l'on soit d'accord ou non, il est clair que notre ardeur de vivre a été éteinte. L'éclat d'espoir qui nous poussait autrefois à défier la mort et à affirmer notre volonté de vivre malgré tout a disparu.
Je soupçonne que ceux qui survivront à la guerre à Gaza devront abandonner de nombreux aspects familiers de la vie : les désaccords, la proximité, les relations complexes, les aspirations élevées et le fouillis de souvenirs - lieux et moments. Ce n'est pas une critique de l'esprit gazaoui mais le constat que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce qui reste en prévision d'une autre guerre inconnue. Nous devons cultiver une mémoire clairement définie et modeste, exempte de désir, de l'agonie de la perte ou de l'émotion persistante.
Gaston Bachelard a dit un jour : "Nous devenons des arbres lorsque nous n'épuisons pas la terre avec nos voyages." Bien que cela puisse être vrai ailleurs, je préférerais épuiser la terre avec nos voyages pour planter des arbres tout autour plutôt que de les voir incinérés, leur potentiel perdu en vain. Si je survie, je me rappellerai de documenter de manière exhaustive ce qui s'est passé et ce qui se passe. Je ne me reprocherai pas de dépeindre la vérité telle que je l'ai vue, sans fard ni orgueil obscurcissant le souvenir de ces événements.
André Malraux a dit un jour : "Chaque homme ressemble à sa propre douleur." Je souffre maintenant. Je ressens l'atrophie de la mémoire, l'obscurcissement des sens et un cerveau qui semble endurer des chocs électriques quotidiens. Il n'y a pas de description appropriée pour un esprit si torturé. Je ressens la pluie d'automne dans les années de ma vie s'éloigner de plus en plus. L'horizon se rétrécit, me laissant incapable de prévoir un quelconque avenir. L'angoisse de l'encrier vide résonne là où les chambres de l'esprit gémissent, faisant écho aux mots de Mahmoud Darwich : "Rien ne me plaît." Ce sentiment nait en moi alors que je réfléchis à ce qui s'est passé, à ce qui se passe et à ce qui va se passer dans nos vies.
Pourquoi essayer de respirer avec mes poumons quand mon pays repose maintenant sans souffle, pillé par les voleurs de la guerre ? C'est comme si je regardais un film dans un cinéma sombre, interdit de dormir jusqu'à la fin. Quitter le cinéma ne me ramène qu'au point de départ. L'absurdité réside dans le manque de sommeil, dans l'obscurité, avec le film étant mon propre existence.
J'écris avec des lettres qui ondulent d'une blessure, d'un corps traversant des braises ardentes à chaque pas. Les flammes et leur enfer ont consumé ce corps. Toute tentative de manœuvre astucieuse, un saut périlleux peut-être, rend mes doléances risibles en atterrissant sur d'autres braises. Une tumeur cachée alourdit la mémoire sur mon dos, et un gonflement dans mes yeux capture des visions que j'ai honte de raconter. Peut-être, un jour, suggérerai-je d'enlever ce collier de choc pour exprimer l'indicible, peut-être.
Jusque-là, si je survie, je continuerai à polir les bords de la mémoire comme une lanterne, dissipant les ténèbres et laissant derrière moi la coquille d'une voix réduite au silence par le bombardement, une voix qui toussait jusqu'à ce que l'air se clarifie suffisamment pour envelopper quelque forme de vie à nouveau.
Ceci est Gaza, Mesdames et Messieurs.
Maintenant, au cœur de la dévastation, nous devons demeurer là à voir notre monde s'effondrer autour de nous. Une série d'interrogations angoissantes nous assaille, nous poussant vers le désir de l'oubli : Qu'en est-il de notre subsistance ? De nos rêves ? Ces questions rongent notre être lui-même, à la fois son âme et sa chair, d'une manière jamais rencontrée dans nos précédentes expériences de guerre. Nos esprits sont submergés par un dilemme existentiel : Vers qui nous tourner ? Comment persévérer à travers malgré cette oblitération ? Vers quel vaste vide finirons-nous par nous élever ?
Dès le départ, il était clair pour moi que seuls ceux élus par le destin résisteraient à la tempête de cette guerre. Le matin du 7 octobre, la situation était incertaine. Les bruits de roquettes et d'obus lancés depuis Gaza remplissaient l'air. En cherchant sur internet des informations, je suis tombé sur des témoignages attestant de véhicules de type jeep investissant les implantations israéliennes près de ce qui est communément appelé l'enveloppe de Gaza, ainsi que de groupes prenant le contrôle des distinctifs toits en tuiles des implantations. La confusion régnait. Était-ce là l'œuvre de l'intelligence artificielle ? Il était difficile de croire que l'appareil sécuritaire tant vanté d'Israël, réputé pour sa sophistication technique et ses capacités de surveillance, pouvait être si facilement submergé. Seuls les assaillants connaissaient la vérité sur ce qui se passait.
Mon ami, l'écrivain Nasser Atallah, était alors en Syrie. Il m'a contacté, désireux de comprendre ces développements totalement inattendus. Je lui ai partagé les maigres informations diffusées par les médias ce matin-là : un leader au sein d'une faction palestinienne avait été tué, ce qui aurait déclenché cette réponse (je pensais au volume inhabituel de roquettes tirées). Un média hébreu titrait : "Le Jihad islamique a perdu la tête !" L'hypothèse dominante était que le Jihad islamique palestinien (PIJ) était responsable des attaques de roquettes, et non le Hamas, qui semblait ne pas avoir anticipé une escalade militaire.
J'ai fait le choix de demeurer chez moi, à moins que la situation ne se détériore brutalement. Avec ma famille, nous avons ainsi passé plusieurs nuits à la maison, observant de près les événements en cours. C'était la guerre, mais pas n'importe quelle guerre. Le nombre de morts du côté opposé dépassait le total des victimes de tous les conflits précédents d'Israël, des centaines d'autres étant également capturées. Cette réalité était au-delà de toute compréhension. Les détails de comment et pourquoi cela s'est produit pourraient rester inconnus pendant un long temps.
Rester chez nous, à l'est de Khan Yunis, près de la frontière, commençait de plus en plus à ressembler à un jeu dangereux. Nous avons donc décidé de chercher plus de sécurité ailleurs. Nous avons trouvé refuge dans une bibliothèque, plus précisément dans la bibliothèque de mon ami Nasser. Dès le départ de la guerre, il nous avait gracieusement offert une place au rez-de-chaussée de sa maison. Trouver refuge dans une bibliothèque était une sorte de luxe, qui éveillait en moi le désir naturel d'explorer ses richesses. J'ai découvert les œuvres d'auteurs familiers, comme l'écrivain palestinien Ahmed Zakarneh et ses écrits sur la conscience de la défaite. Y avait-il comme une sorte de prophétisme dans sa contemplation de la guerre, peut-être une sorte d'intuition prémonitoire sur quoi faire quand cela se produit ? Nous sommes restés en place pendant trois jours jusqu'à ce qu'un avertissement des forces d'occupation nous oblige à évacuer les lieux.
Au départ, j'ai pensé aux écoles de l'UNRWA comme refuge, mais, suivant les conseils avisés des uns et des autres de chercher des domiciles séparés pour augmenter les chances de survie de membres de la famille, j'ai choisi de nous disperser entre Bani Suhaila, une ville à l'est de Khan Yunis, et la ville de Khan Yunis elle-même, dans le sud de la bande de Gaza. Au cours du mois suivant ou plus, notre temps a été scandé par de brèves réunions au milieu de séparations prolongées. Certains d'entre nous ont trouvé refuge dans l'école de la ville, tandis que d'autres étaient dans ses rues.
Le question de savoir si un écrivain peut se détacher des turpitudes de la vie en temps de guerre a persisté dans mes pensées, en particulier après une conversation avec le directeur d'une école de l'UNRWA. Il m'a demandé : "Combien de membres de votre famille avez-vous ?" Compte tenu de notre dispersion, je me suis demandé si je devais indiquer le nombre plus petit effectivement avec moi à l'heure de la question ou le plus grand représentant tous les membres de la famille. Cette décision affecterait nos maigres allocations alimentaires journalières. Oh, ai-je oublié de mentionner qu'à ce stade, notre survie dépendait des repas quotidiens fournis ? Alors que la guerre s'intensifiait, la douleur imprégnait notre quotdien et le fardeau de vivre augmentait.
La question persistante du "comment" était devenue une flamme inextinguible, faisant éclater une profonde détresse, laquelle était encore accentuée par les regards interrogateurs de ceux sous ma responsabilité : Comment en sommes-nous arrivés là et quand cela prendra-t-il fin ? En quittant l'école et l'abri, j'ai éprouvé deux types distincts d'angoisse. La première était lié à l'instinct de survie que je voyais à l'œuvre autour de moi, transformant les gens en êtres mus par le désir et prêts à échanger n'importe quoi contre les nécessités les plus élémentaires, une routine quotidienne qui écrase l'âme. La deuxième source d'angoisse provenait de la contemplation de l'avenir, avec la question du "quand" refaisant surface, celle-ci résonnant poignamment avec les larmes des événements passés et en cours.
Une tempête de douleur hantait les méandres de mes pensées. Les gens sont doués pour posséder, même lorsqu'ils ont déjà beaucoup. Les veines de nombreux individus s'étaient raidies à force de porter plusieurs sacs et cartons d'aide, mais aucune quantité n'était jamais suffisante. La cupidité ne fait pas de distinction entre la guerre et la paix.
Les sables mouvants de l'actualité quotidienne nous ont rapidement emmenés de la perspective d'une trêve ou du retour calme à la réalité de la rage de l'occupant, enfonçant implacablement ses baïonnettes dans notre chair. Nous ne recherchions plus de nouvelles cachées et avons commencé à ignorer toute actualité qui ne contenait pas le terme clair et sans équivoque : Cessez-le-feu ! À quoi nous sert l'actualité si elle n'offre pas le moindre soupçon de certitude ?
La guerre prendra fin un jour, et une nouvelle guerre, d'un autre genre, commencera. Une guerre féroce, déclenchée par notre anticipation de retourner chez nous et de trouver un moyen d'y revenir. Au cours de ce voyage, des milliers de questions terrifiantes surgiront comme des mines posées et oubliées, concernant ce qui s'est passé et ses conséquences.
Ensuite, chacun de nous commencera à comprendre l'avenir qui se profile, confronté à un barrage de questions : comment, quand, où, pourquoi, et si ? Ces questions ne resteront pas seules ; au contraire, elles formeront l'alphabet de ce qui était et de ce qui sera.
La cause de la Palestine n'est pas uniquement une question palestinienne, arabe ou islamique ; c'est une question humaine, existentielle. C'est une question universelle, une lutte entre la tyrannie et la quête de liberté contre celle-ci. L'histoire documentera tout ce qui s'est passé, capturant à la fois sa lumière et son ombre. Il faudra seulement du temps pour découvrir comment le 7 octobre est arrivé. Ne supposez pas que ce jour est sans ses complexités, que ce soit dans ses signes, ses prémices ou ses conséquences. Cependant, quoiqu'il en soit, c'est un jour qui a modifié le cours de nos existences.
J'écris, donc je vis toujours.
Nous ruminerons nos dix jours de guerre comme si c'était un melon amer. Le temps a perdu son sens, comme s'il s'agissait de dix ans, et non de 10 jours. L'inondation nous entraîne dans ses spirales et le long de ses courants. La soirée de raids et de bombes a commencé tôt ce soir. Immédiatement après le coucher du soleil, il y a eu des bombardements de maisons et de l'université Al-Aqsa à Khan Yunis. Les maisons sont démolies sur la tête de leurs occupants, et les sirènes des ambulances ne se taisent ni ne se reposent. Leur vitesse est effrayante, la peur est proportionnelle au nombre de morts et de blessés, mais jamais proche de la profondeur de la douleur s'écoulant de nos âmes.
L'exode vers le sud est en cours. Au lit, je me retourne. Le sommeil m'a abandonné depuis le début de cette horreur. Le son des explosions et de la mort secoue la terre et brise le calme des cieux. Les gémissements douloureux du peuple et leurs murmures terrifiés et continus ne vous donnent pas, même pour un instant, la capacité de faire de la nuit le lieu d'un repos apte à surmonter la fatigue du corps et de l'âme. Vous vous réveillez terrifié à l'aube, à moins que la mort ne réussisse à se saisir de vous endormi. Vous vous précipitez pour appeler et vérifier que votre famille est en vie. Certains répondent et certains ne répondent pas, soit parce que le réseau de communication a été coupé, soit parce qu'ils se sont endormis, soit parce que leur téléphone était déchargé. Le matin, je sors. La scène quotidienne est la même, des files d'attente faisant suite à des files d'attente : des files d'attente pour du pain dont la quantité peut à peine combler les besoins vitaux, des files d'attente pour les toilettes, des files d'attente anticipant une bouffée d'électricité pour charger leurs téléphones portables, des files de voitures bondées, et la plus grande file d'attente est la file d'attente d'attente interminable - la file des jours. Une pensée déchire les murs de l'âme : "Cette guerre peut durer des semaines !" Puis une question ressurgit : "Où cela va-t-il nous mener ?"
Nous ne pensons chacun qu'à deux choses : la vie de nos membres de famille et la sécurité de nos maisons, car la perte de l'un ou de l'autre serait une catastrophe et une vie de souffrance. Nous ne savons pas quoi faire, nous ne pouvons attendre.
Hier, ils ont distribué des couvertures légères, ces couvertures de couleur plomb pour lesquelles l'UNRWA est mondialement célèbre. Nous ne voulons plus savoir ce qui se passe. Nous voulons juste nous calmer suffisamment pour dormir, vérifier que ceux que nous aimons sont en vie, faire n'importe quoi d'autre que regarder le ciel de peur qu'une bombe ne tombe soudainement. Nous souhaitons pouvoir dormir et nous sentir absents, pas totalement et en permanence éveillés !
Le sommeil m'a fui la nuit dernière, ne daignant même pas me toucher de son effleurement le plus léger. Les sons des explosions résonnaient à travers l'espace et le temps, avec la ferveur d'avions larguant l'incendie comme si le ciel pleuvait des flammes. Les ambulances, avec leur allure frénétique, déchiraient la surface de la terre, annonçant le désastre toute la nuit. Des scènes de destruction, le vacarme des bombardements et des avions de guerre, des conversations, des cris, des supplications et des efforts pour apporter une aide humanitaire avaient lieu tandis que des avions de guerre survolaient notre dévastation, notre soif, notre faim, notre souffrance et notre humanité même.
Le jour à Gaza pèse lourdement, consigné sur un calendrier d'humanité corrompue. Il commence avec la file d'attente matinale pour une miche de pain, afin de répondre au défi immense d'apaiser la faim d'un enfant en pleine guerre. Comme la liberté et le droit à la vie, le temps perd son essence dans la file d'attente, rendu sans valeur lorsque les tyrans s'en saisissent. Est-il utile d'attendre une demi-journée pour obtenir une demi-miche de pain, qui à son tour ne soutient la vie que pour une demi-journée supplémentaire ? La vie est précieuse, pourtant la mort plane sur nous.
Personnellement, mon souci pour la nourriture s'est estompé. Quand on perd l'enthousiasme pour la vie, la perspective de la mort cesse d'intimider. Quelques biscuits et une tasse de n'importe quelle boisson (café, thé ou autre) suffisent à combler ce besoin. J'ai embrassé une vie d'austérité, me formant au jeûne et à la marche. Je parcours de longues distances à pied, réfléchissant à la situation de Gaza.
Je suis stupéfait par ceux qui peuvent encore sourire au milieu de cette guerre, et je me demande : En souriant, s'entraînent-ils à afficher une expression qu'ils n'arriveraient pas à maîtriser plus tard ? Ou contournent-ils la réalité, l'évitant pour se préparer à un avenir encore plus sombre et plus désolé que notre existence actuelle ?
Trouver la moitié d'une miche de pain après trois ou quatre heures devient un acte héroïque qui exige de rester en file d'attente sans relâche dès l'aube. Si nous sortons vivants de cette guerre, nos attitudes envers le temps et l'attente en seront à jamais changées. Les pertes et les victoires perdent leurs significations et valeurs traditionnelles ; les victoires ne goûtent plus douces à moins qu'elles ne signifient pas la vie et l'abri pour un Gazaoui. La guerre de 2023 a divisé nos vies en un "avant" et un "après", modifiant les équilibres du profit et de la perte, de la valeur et de la non-valeur, à travers le prisme du conflit. La valeur et la signification des choses sont désormais mesurées par notre besoin pour elles, et au milieu de cette guerre brutale, il n'y a pas de besoin plus grand que la quête de vie et de sécurité.
Après avoir ouvert les yeux, vous les frottez, tentant d'éliminer la saleté. Faites attention de ne pas vous moucher trop vigoureusement pour éviter les tensions musculaires ou le risque de maladie. Vous pouvez vous rendre à la salle de bain si nécessaire. Lorsque vous vous lavez à partir d'un seau, il est bon de faire couler un peu d'eau sur vos cheveux - ne vous inquiétez pas de savoir si c'est sain. Envisagez de masser votre visage avec vos mains pour éviter qu'il ne devienne raide et n'accélère la formation des rides. N'est-il pas suffisant que nos cœurs portent les cicatrices du tribut de la guerre ?
À travers ce qu'on appelle le "couloir sûr", lequel permet aux résidents du nord et de la ville de Gaza de traverser vers le sud, les gens avancent en files sous les yeux vigilants des soldats. Des ordres sont donnés à travers des haut-parleurs : Arrêtez, marchez, venez, allez, etc. Soudain, une voix a appelé : "Toi, dans la veste marron, laisse tomber le sac de ton épaule, maintenant !"
Pour la personne interpellée, cela a semblé comme si le monde s'était brutalement renversé. Comment pouvait-il abandonner son sac, contenant toutes ses économies de toute une vie - 50 000 $, l'or de sa femme et de ses filles, et ses documents d'identité ? Pourtant, il n'y avait pas le choix ; c'était soit le sac, soit sa vie. Avec seulement un instants pour réfléchir, il posa son sac, laissant des décennies de ses espoirs derrière lui sur le sol sans se retourner. Ses larmes, ses gémissements silencieux et les cris étouffés et les hurlements de sa femme furent tout ce qui suivit. Il continua son chemin, et avec lui, tout passa. Si seulement les prisonniers dans les geôles de l'occupation savaient la dévastation que Gaza endurerait pour leur liberté. Peut-être, alors, préféreraient-ils leurs chaînes.
Nous sommes rentrés chez nous pendant sept jours pendant la trêve qui a commencé le 24 novembre, ramenant tout ce que nous avions emporté avec nous. Lorsque la trêve a pris fin, nous sommes partis avec très peu, espérant que la situation s'améliorerait après un jour ou deux. Maintenant, après une nuit de bombardements intensifs et d'explosions incessantes, je me demande si nous aurons jamais besoin des bagages que nous avons ramenés. Je comprends la valeur d'un foyer pour ceux qui y habitent. Les foyers occupent un espace en nous tout comme nous les occupons. Mon foyer a une histoire unique. Je l'ai nourri comme on nourrit un enfant. De 2011 jusqu'au début de 2023, il a mûri par mes soins, évoluant en une structure élégante avec une touche magique, remplie des échos de rires et de larmes dans chaque coin. Les foyers portent des histoires et des parfums.
Même les livres que j'avais emportés sont retournés à leur place légitime, dans leur bibliothèque, comme des enfants retrouvant l'étreinte d'une mère. Je suis parti avec seulement des vêtements et quelques ustensiles - les nécessités de base pour survivre.
Ce matin-là, j'étais déterminé à rentrer chez moi par tous les moyens nécessaires, quel qu'en soit le coût. Je n'ai pas hésité. Le manque de farine, de gaz et d'autres articles essentiels rendait la perspective de continuer à vivre dans une école insupportable. Plaçant ma foi en Dieu, au milieu des sifflements continus des bombardements, j'ai choisi de marcher sur les toits plutôt que de monter à vélo. Les routes étaient jonchées de débris des bombardements, un mélange de verre et de pierre. Chaque fois que je rencontrais un morceau d'asphalte, je montais à vélo.
En chemin, j'ai vu des dizaines de personnes transporter leurs affaires, craignant de ne pas pouvoir revenir dans les jours à venir en raison du danger anticipé suite à la menace du ministre de la Défense israélien Yoav Gallant d'entrer dans le sud de Gaza.
Malgré tout, je suis arrivé à Khuzaa intact. La ville semblait déserte, sans vie et oubliée. Je n'ai rencontré que quatre personnes transportant leurs bagages. J'ai continué, le cœur lourd et les larmes aux yeux, jusqu'à ce que j'atteigne enfin chez moi. Ma maison ! Oui, ma maison, es-tu encore debout ? Une vague de soulagement m'a envahi lorsque je l'ai vue debout, digne et intacte. Je l'ai embrassée comme si j'embrassais le visage de ma petite-fille. J'ai rapidement rassemblé ce que je pouvais et j'ai commencé à marcher rapidement, ayant récompensé mon effort par un bain chaud, espérant que la maison résisterait à mon voyage de retour. Mon départ s'est transformé en une course dès que j'ai entendu le sifflement des coups de feu, réalisant que rester était futile.
J'ai marché environ 5 kilomètres, avec le bruit des explosions pour compagnon. J'ai opté pour une route sablonneuse au retour. En chemin, j'ai rencontré des gens emballant leurs affaires et d'autres restant dans leurs maisons. En trouvant un robinet d'eau qui gouttait, je me suis précipité vers lui et j'ai bu à ma soif. Puis, je suis arrivé à la ville de Bani Suhaila à pied, me sentant quelque peu rassuré jusqu'à ce que je remarque des signes de bombardements récents. En demandant, j'ai appris que la zone avait été frappée il y a seulement 15 minutes. Trouvant un magasin ouvrant ses portes, j'ai demandé une bouteille d'eau, j'ai bu et j'ai apaisé ma soif.
Épuisé par les épreuves physiques et émotionnelles, je savais que la tâche devait être accomplie rapidement en raison de la menace constante, car aucun endroit à Gaza n'était sûr. En atteignant la ville de Khan Younès, on m'a immédiatement demandé : "Vendez-vous de la farine ?" J'ai répondu que non et j'ai continué vers ma destination. J'ai laissé tomber mon fardeau matériel mais j'ai gardé le fardeau interne caché. Avec un soupir profond, j'ai crié : "Ô maudite guerre, qu'as-tu fait de nous ?" Cette décision peut sembler insensée et dangereuse, mais les morts craignent-ils la mort ? Ainsi, le choix était fait.
Le voyage a duré environ 9 kilomètres.
Je marche sur une route encombrée de misérables, voyant des femmes pleurer leurs martyrs, leurs vies brisées, et la maternité écrasée par les chars de guerre, tout en étant transportées sur une charrette tirée par un âne qui montre plus de compassion pour notre détresse que les humains. Les larmes ont cessé de couler, réduites au silence par un excès de chagrin, les ravages de la guerre et l'oppression dans ma poitrine qui lutte pour respirer.
Nous sommes défigurés, dispersés ; nos cœurs sont déchirés par la violence et les larmes. Nos êtres intérieurs sont mutilés comme si nous avions perdu une partie de nous-mêmes que nous passerons le reste de notre vie - si nous survivons - à rechercher. Un abîme profond nous entraîne dans l'obscurité, un épais brouillard nous enveloppe, la mort frappe de toutes parts et les lueurs d'espoir s'estompent dans une terre plus accueillante à la vie. Cette terre n'est-elle pas rassasiée de sang versé ? Toute cette dévastation n'était-elle pas suffisante pour elle ? Combien de temps jusqu'à ce que les dés en soient jetés ?
Nous ne comprenons plus rien. Que se déroule-t-il devant nous ? Est-ce la réalité ou simplement une illusion ? Un cauchemar ou une punition ? Nous ne savons plus rien. Tout espoir est perdu. Il ne reste plus rien de digne de la vie dans une terre qui étanche sa soif avec le sang des innocents. Lorsque la mort peut réclamer votre vie à tout moment, tout en vous s'efface. Les questions vous blessent et les réponses vous trahissent. Quand ce cauchemar prendra-t-il fin ? Quand le salut viendra-t-il ?
Un couteau et de la chair peuvent-ils être considérés comme équivalents ? L'interaction entre la viande et le couteau est-elle égale, et la confrontation prolongée entre les deux sert-elle à la fois de métaphore et de réalité ? Un autre chapitre de la mort se déroule dans la guerre frénétique contre Gaza perpétrée par l'occupation israélienne. Soudain, le son d'un haut-parleur monté sur un drone a retenti à travers le quartier scolaire, annonçant : "Celui qui entend cet appel maintenant, partez immédiatement, cet endroit sera complètement détruit !"
Les visages ont exprimé le choc et l'horreur, les corps, les esprits ont tremblé et les yeux se sont remplis de larmes. Une question urgente est apparue pour tous ceux qui ont entendu cette menace mortelle : Où devrions-nous aller maintenant, ô Dieu ? En qui pouvons-nous chercher refuge, ô Seigneur du monde ? La terre s'est rétrécie, les cieux nous ont abandonnés !
L'annonce a suscité des ondes de chaos et de tourment à travers l'UNRWA et les autres écoles gouvernementales, ainsi que dans nos esprits écrasés sous la gravité de cette agression, comme si le jour du jugement était sur nous.
Pères et mères ont crié, nous exhortant à emporter ce qui pourrait nous aider à survivre un peu plus longtemps, à nous donner le temps de supporter l'exode, la faim et tous les tourments qui coulent dans nos veines comme le sang. Dans un élan de terreur pure, les gens se sont précipités pour sortir comme si c'était la fin du monde. Des milliers de personnes déplacées ont inondé les rues, fuyant les conditions infernales et la menace imminente de mort si nous n'échappions pas avec ce qui restait de nos vies - ou faisions face à une mort différée. Le voyage impliquait de passer par trois checkpoints militaires pour atteindre al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès (réputé sûr). Le premier checkpoint était particulièrement intimidant ; alors que j'approchais, il semblait que la saison du pèlerinage à La Mecque était en cours dans cette rue bondée, la traversée se faisait par un étroit passage de 4 mètres entre deux chars. Les enfants criaient, les femmes appelaient à l'aide au milieu de l'horreur, et les soldats lourdement armés faisaient des plaisanteries tout en dirigeant la circulation, exerçant une immense pression psychologique pensée pour épuiser les déplacés. Passer le premier checkpoint a apporté un soulagement momentané à la foule, nous permettant de rassembler ce qui restait de nos âmes et des quelques affaires que nous avions, principalement des couvertures pour se protéger du froid de l'hiver et du désespoir. Deux autres checkpoints, deux autres terreurs attendaient.
En atteignant al-Mawasi, nous avons entrepris un autre voyage de souffrance : la quête d'une tente, ou de tout semblant de refuge, pour protéger nos corps.
En guerre, la lumière électrique devient un luxe, nous nous contentons d'eau, indifférents à sa fraîcheur ou à son caractère salé. L'eau, aussi rare que la justice et l'humanité, devient suffisante pour être partagée entre nous, que ce soit pour étancher la soif, se laver ou faire ses ablutions. Cependant, pour obtenir même une petite quantité d'eau, deux possibilités émergent : vous installez votre tente près d'une source d'eau, généralement un puits d'eau salée (pas tout à fait pure), ou, si vous avez moins de chance, la source d'eau est loin, ce qui conduit à l'épreuve de transporter de l'eau dans un bidon ou un seau. Vous êtes hanté par des souvenirs d'eau abondante, réalisant seulement maintenant la bénédiction que vous teniez pour acquise.
Après avoir installé la tente, vous envisagez le besoin urgent de construire des toilettes rudimentaires - un trou, plusieurs morceaux de bois et un peu de tissu pour couvrir ce qu'on appelle euphémiquement une "salle de bain". Même cela nécessite des fonds, car les prix augmentent impitoyablement, ne montrant aucune considération ou pitié pour notre situation dans cette guerre brutale qui écrase principalement le citoyen ordinaire et vaincu.
Lorsque chacun de nous réfléchit à la situation infernale dans laquelle nous nous trouvons, sans aucune faute de notre part, nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter, de résister et de nous concentrer sur la satisfaction des besoins de base par tous les moyens nécessaires, en nous accrochant à l'espoir de survie.
Envisager la survie devient une expérience elle-même éprouvante, car au-delà de ce que l'esprit peut comprendre. Soudain, le monde se transforme, sans avertissement, en une nouvelle réalité sans caractéristiques discernables - un monde informe, changeant, où la cruauté et le chaos dépassent tout ce qui existe dans l'univers !
"J'ai besoin d'aide."
"Donnez-moi votre carte d'identité et votre carte de rationnement."
Dans l'interaction atténuée avec un employé de l'UNRWA, sans entrer dans les détails, vous vous conformez au processus, remettez votre carte d'identité et votre carte de rationnement, puis attendez.
"J'ai besoin d'aide."
"Donnez-moi votre carte d'identité."
Le fait de demander seulement la carte d'identité (et non la carte de rationnement) suggère que cette personne n'est pas un travailleur de l'UNRWA. Il semble que quelqu'un demande votre identification, mais votre attention n'est pas sur qui ils sont ; c'est sur l'obtention d'une aide... et ainsi, vous attendez.
Vous n'avez pas d'autre choix que de supporter l'attente, qui peut durer des jours. Elle peut être brève ou longue. Si la chance vous sourit, votre patience sera récompensée ; si vous revenez avec peu de résultats, vous vous résignez à la "gloire de l'essai".
Et ainsi de suite.
Contraint, vous lancez une autre tentative... et donc, vous attendez.
Pendant des mois, les habitants de Gaza ont fait face à un déplacement forcé, continu, se mouvant sans cesse d'un endroit à un autre. La seule directive s'agissant d'où aller vient de la page Facebook du coordinateur du gouvernement israélien et des tracts largués par des avions israéliens, n'offrant que des avertissements de catastrophe imminente. Ainsi, des ordres d'évacuation d'une zone à une autre se succèdent sans fin, infligeant un tourment psychologique et physique à ceux qui reçoivent ces tracts en papier, qui tombent comme des désastres miniaturisés sur nos esprits.
Pendant ces mois infernaux, le peuple palestinien de Gaza a enduré les ravages d'une guerre qui a tout nivelé sur son passage. Elle a anéanti les infrastructures de toute sorte, imposé un siège économique, rasé des maisons avec leurs habitants à l'intérieur, et ciblé toutes les formes de centres de santé, psychologiques et culturels, y compris les hôpitaux et les cliniques. Même l'Institut français, neutre dans ce conflit, n'a pas été épargné par la destruction. Cette guerre a été mortelle pour tous les aspects de la vie à Gaza, affectant à la fois les humains et les structures.
Le conflit a causé une détresse immense pour tout le monde, conduisant à une focalisation prédominante sur la survie individuelle - "moi, moi-même et moi" est devenu le mantra. La préoccupation pour les autres a considérablement diminué, et des coutumes peu familières ont émergé parmi notre peuple, toutes pointant vers une focalisation existentielle sur le soi.
En effet, la guerre a ravagé tout, y compris notre moi intérieur, alors que nous luttons pour notre survie personnelle et collective.
La vie est devenue centrée sur l'obtention d'une aide pour satisfaire la faim du peuple. Dans le sud de Gaza, nous nous trouvons dans une situation légèrement meilleure - ou moins désespérée - que nos homologues du nord, où l'occupation israélienne bloque carrément l'entrée de l'aide humanitaire dans les régions septentrionales et la ville de Gaza. Initialement, les largages aériens par des avions jordaniens semblaient presque ridicules ; l'aide tombait du ciel, seulement pour atterrir dans la mer, dans des zones reculées ou même dans des territoires occupés. Ce n'est qu'après des disputes que les colis ont été effectivement réclamés par les gens.
Imaginez, près d'un million de personnes ont faim.
Maintenant, les gens envient ceux qui ont été martyrisés le 8 octobre, car ils ont été épargnés de voir les tueries et la destructions généralisée qui ont a depuis englouti tout Gaza, un Gaza que nous ne reconnaissons guère plus.
La ligne entre le corps et l'âme devient de plus en plus floue. On dit que le corps vieillit tandis que l'âme reste jeune. Que l'on soit d'accord ou non, il est clair que notre ardeur de vivre a été éteinte. L'éclat d'espoir qui nous poussait autrefois à défier la mort et à affirmer notre volonté de vivre malgré tout a disparu.
Je soupçonne que ceux qui survivront à la guerre à Gaza devront abandonner de nombreux aspects familiers de la vie : les désaccords, la proximité, les relations complexes, les aspirations élevées et le fouillis de souvenirs - lieux et moments. Ce n'est pas une critique de l'esprit gazaoui mais le constat que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce qui reste en prévision d'une autre guerre inconnue. Nous devons cultiver une mémoire clairement définie et modeste, exempte de désir, de l'agonie de la perte ou de l'émotion persistante.
Gaston Bachelard a dit un jour : "Nous devenons des arbres lorsque nous n'épuisons pas la terre avec nos voyages." Bien que cela puisse être vrai ailleurs, je préférerais épuiser la terre avec nos voyages pour planter des arbres tout autour plutôt que de les voir incinérés, leur potentiel perdu en vain. Si je survie, je me rappellerai de documenter de manière exhaustive ce qui s'est passé et ce qui se passe. Je ne me reprocherai pas de dépeindre la vérité telle que je l'ai vue, sans fard ni orgueil obscurcissant le souvenir de ces événements.
André Malraux a dit un jour : "Chaque homme ressemble à sa propre douleur." Je souffre maintenant. Je ressens l'atrophie de la mémoire, l'obscurcissement des sens et un cerveau qui semble endurer des chocs électriques quotidiens. Il n'y a pas de description appropriée pour un esprit si torturé. Je ressens la pluie d'automne dans les années de ma vie s'éloigner de plus en plus. L'horizon se rétrécit, me laissant incapable de prévoir un quelconque avenir. L'angoisse de l'encrier vide résonne là où les chambres de l'esprit gémissent, faisant écho aux mots de Mahmoud Darwich : "Rien ne me plaît." Ce sentiment nait en moi alors que je réfléchis à ce qui s'est passé, à ce qui se passe et à ce qui va se passer dans nos vies.
Pourquoi essayer de respirer avec mes poumons quand mon pays repose maintenant sans souffle, pillé par les voleurs de la guerre ? C'est comme si je regardais un film dans un cinéma sombre, interdit de dormir jusqu'à la fin. Quitter le cinéma ne me ramène qu'au point de départ. L'absurdité réside dans le manque de sommeil, dans l'obscurité, avec le film étant mon propre existence.
J'écris avec des lettres qui ondulent d'une blessure, d'un corps traversant des braises ardentes à chaque pas. Les flammes et leur enfer ont consumé ce corps. Toute tentative de manœuvre astucieuse, un saut périlleux peut-être, rend mes doléances risibles en atterrissant sur d'autres braises. Une tumeur cachée alourdit la mémoire sur mon dos, et un gonflement dans mes yeux capture des visions que j'ai honte de raconter. Peut-être, un jour, suggérerai-je d'enlever ce collier de choc pour exprimer l'indicible, peut-être.
Jusque-là, si je survie, je continuerai à polir les bords de la mémoire comme une lanterne, dissipant les ténèbres et laissant derrière moi la coquille d'une voix réduite au silence par le bombardement, une voix qui toussait jusqu'à ce que l'air se clarifie suffisamment pour envelopper quelque forme de vie à nouveau.
Ceci est Gaza, Mesdames et Messieurs.

