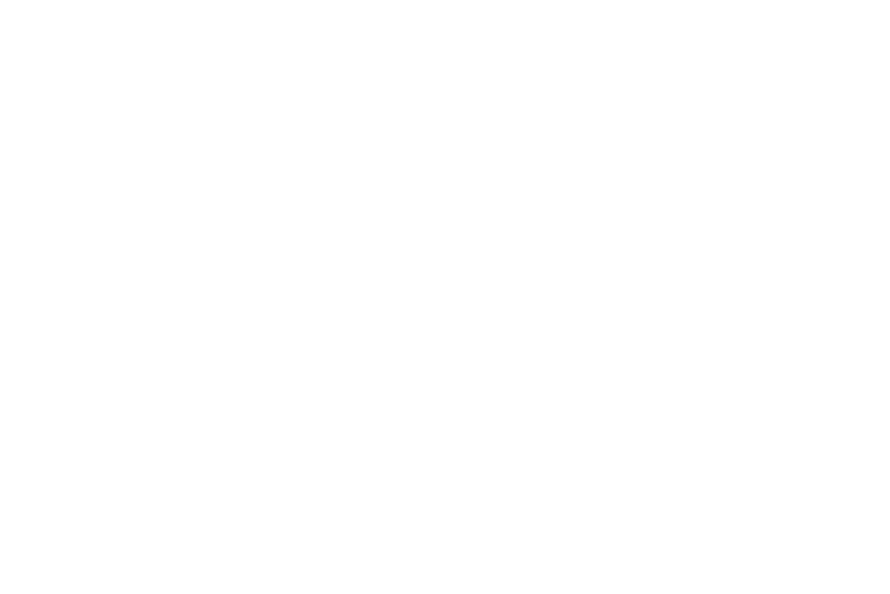
Retour sur la décennie noire
Recension du livre d'Abderrahmane MOUSSAOUI, De la violence en Algérie, Les lois du chaos, Actes Sud, MMSH, 2006
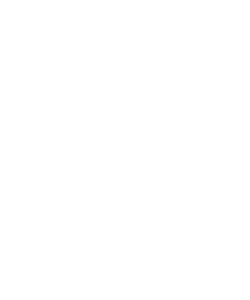
Assia Bensouda
Ce compte-rendu a pour vocation de présenter l’ouvrage D’Abderrahmane Moussaoui, De la violence en Algérie, Les lois du chaos, paru aux éditions Actes Sud en 2006. Ce livre propose une analyse anthropologique de la violence politique qu’a connue l’Algérie durant la période que l’on nomme communément « les années noires » (1990-2000) ; il se distingue en cela des travaux purement historiques et des analyses politiques qui ont été produits sur le sujet. L’auteur se base sur un travail d’enquête de terrain de plusieurs années ainsi que sur les discours produits par les différents acteurs impliqués dans le conflit. Son objectif est d’éclairer les mécanismes qui ont permis la justification du recours à une violence d’une telle ampleur. Abderrahmane Moussaoui est enseignant en anthropologie à l’université de Provence ainsi que chercheur au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et à la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme). Il a longtemps vécu en Algérie où il a enseigné à l’université d’Oran. La question qui traverse tout l’ouvrage est la suivante : Comment une telle violence a-t-elle pu être rendue possible en Algérie pendant une décennie ? Nous nous contenterons ici de résumer la pensée de l’auteur en suivant l’ordre des parties du livre avant de conclure par une brève analyse critique.
Les logiques de l’horreur
Dans cette partie, l’auteur tente de démontrer les « logiques » qui expliquent la volonté de donner la mort et de se donner la mort pour une cause jugée noble. Selon lui, ces logiques sont « sous-tendues par des valeurs éthico-normatives comme l’honneur, le sacrifice, le patriotisme, le martyr » (p.45). Ainsi, elles s’expliquent par le besoin d’appartenance à un groupe et la quête de reconnaissance. La violence ou même la mort deviennent le prix à payer de l’altérité. Dans ce sens, ceux qui sont jugés extérieurs au groupe sont de potentielles « victimes sacrificielles » comme le démontre René Girard dans sa théorie du bouc émissaire. Celles-ci constituent en quelque sorte des « offrandes à Dieu » (p.53), leur mise à mort permet de « purifier » la population en vue de l’instauration ou de la restauration d’un ordre idéalisé. Ce sacrifice permet aux acteurs de gagner la confiance de leurs pairs et de se faire une place au sein du groupe.
Abderrahmane Moussaoui affirme que le capital symbolique est un enjeu fort dans ce conflit. En effet, le code de l’honneur omniprésent dans la société algérienne alimente les logiques de vengeance et la capacité à humilier l’autre, « comme si du déshonneur des uns s’alimentait l’honneur des autres » (p.60). Or, l’honneur est l’enjeu et l’expression de la virilité qui est à mettre en lien avec celle du pouvoir, car « tout détenteur du pouvoir est d’abord un super mâle » (p.110). Ceci explique les pratiques de viol, sodomie, émasculation et autres formes d’humiliation, parfois devant les autres membres de la famille ou du groupe, qui constituent une forme de meurtre symbolique contre tout un segment social. De plus, il défend que la mort et la violence jouent un rôle central dans la légitimation du pouvoir ; en effet, c’est au nom de la guerre de libération que le pouvoir gouverne. A ce titre, la violence possède un rôle symbolique fort dans la société.
La violence : réalités et représentations
L’auteur s’intéresse ici à la représentation de la figure des rebelles des GIA. Ceux-ci sont souvent des « bandits » tel que l’entend E. J. Hobsbawm et des « produits de la marginalité sociale » (p.201). Ils sont à l’origine assez largement soutenus et respectés par la population, d’autant plus qu’ils s’appliquent à justifier religieusement leurs actions militaires. Mustapha Bouyali affirment qu’ils actualisent la figure du mahdi, en cultivant une image de moines guerriers censés restaurer l’islam dans « sa perfection première » (p.205) ; ce faisant ils s’inscrivent dans une longue tradition locale, car d’après Edouard Montet, l’utilisation de cette figure est d’une récurrence soutenue dans l’histoire de tout le Maghreb.
Moussaoui se penche sur le lien entre violence et émotion. Il explique que l’expression de la douleur est socialement codifiée ; en Algérie, celle-ci se traduit par une « manifestation démesurée » chez la femme et une « retenue exemplaire chez l’homme » (p.270). Aussi, parfois le traumatisme a été stimulateur. Certaines femmes d’intellectuels, victimes du terrorisme, se sont engagées dans la politique ou dans le milieu associatif comme c’est le cas Fatima Zohra Flici qui préside l’Organisation Nationale des Victimes du Terrorisme (ONVT). Néanmoins, dans l’ensemble, on constate une négation du trauma, ce qui explique que ce conflit ne porte pas de nom. La logique derrière cette stratégie, parfois inconsciente, est d’affirmer que « le peuple dont je fais partie est nécessairement innocent » (p.285) ; aussi, le responsable ne peut qu’être extérieur, ce qui explique qu’une des grandes théories incrimine exclusivement le pouvoir comme étant à l’origine des massacres de population civile.
La rhétorique de la violence
En temps de conflit, la parole est une arme incontournable. Or, les islamistes produisent un discours qui puise dans une historicité plus profonde encore que ne le fait le pouvoir en place. L’emploi d’un vocable propre au registre des premiers temps de l’islam (baya, sura, amir, tagut, fitna…) dans un registre classique fait de ce discours le véhicule d’un nouvel ordre dans lequel arabisation et islamisation sont d’autant plus mêlés. L’usage de l’arabe classique et d’un vocabulaire ancré dans le patrimoine arabe et dans la symbolique de l’islam est une stratégie que se disputent les différents acteurs. On peut citer à ce titre Abdelaziz Bouteflika qui use de cette rhétorique lorsqu’il menace les islamistes qui refusent de rendre les armes de leur faire goûter sans relâche à « sayf al-Hadjdjaj » (l’épée d’al-Hadjdjaj) (p.313). On constate également la grande place accordée à l’injure, qui vise à porter atteinte à l’honneur de l’adversaire en s’attaquant à sa dignité morale et sociale publiquement.
Dans un second temps, Moussaoui s’intéresse aux rumeurs qui sont, selon lui, très présentes en Algérie durant cette décennie. Celles-ci permettent de « continuer à vivre, à dire et à exister » (p.357). Cependant, d’après F. Nassif Tar Kovacs, elles constituent une forme inconsciente de participation à la guerre qui profite aux belligérants. L’auteur se penche également sur l’usage de la dérision et de l’humour dans un tel contexte, dans une société qui selon ses dires « continue à beaucoup rire » (p.359). Il explique cette dérision comme une « inversion de l’ordre symbolique, […] une transgression réalisatrice du moi » (p.362). Le rire possède donc une fonction vitale, puisqu’il agit comme une illusion du triomphe du moi sur les humiliations qui viennent l’anéantir. Il rassure et aide à domestiquer l’effroyable selon Henri Bergson. De plus, il humanise, car « seul parmi les êtres vivants, l’Homme sait rire » (Aristote). En d’autres termes, le rire est un moyen d’échapper à ce de quoi on rit.
Sortie de violence
Lamine Zeroual, qui préside le pays entre 1994 et 1999, tente de mettre en place une politique dite de rahma (clémence) en faveur des islamistes qui acceptent de se rendre avant de démissionner en 1999. C’est sous le mandat d’Abdelaziz Bouteflika (1999-…) que de réelles négociations, notamment avec les membres de l’AIS, débouchent sur la loi de la concorde civile la même année. Celle-ci vise à mettre en place une politique de rétablissement de l’ordre plus qu’une politique de réconciliation nationale. Cette sortie de crise négociée érige le pouvoir en arbitre d’un conflit entre civils, alors qu’il est l’un des principaux acteurs de ce dernier. Il lui est d’ailleurs reproché de négliger les civils, principales victimes du conflit armé, et de valoriser les acteurs des crimes repentis. En effet, les différentes lois successives ont permis d’amnistier la quasi-totalité d’entre eux qui sont présentés comme des héros et des victimes à la fois, et non comme des bourreaux. Moussaoui affirme à ce titre que « la finalité politique immédiate a été préférée à la thérapie sociale sur le long terme » (p.399). De fait, la justice a été mise de côté en faveur de l’ordre ; or ceci pose des problèmes déontologiques et moraux pour les victimes du terrorisme. Comment pardonner ce qui n’a pas été reconnu ni juridiquement ni socialement ?
Enfin, l’auteur conclut en dressant un bilan des différentes théories avancées pour expliquer la violence qu’a connu l’Algérie durant cette « décennie noire ». Il distingue deux grandes tendances : celle qui tentent de répondre à la question du pourquoi, parmi laquelle il classe ceux qui se fondent sur des raisons philosophiques en s’appuyant sur des thèses évolutionnistes de l’Homme (G. Simmel), d’autres fondant leurs discours sur une approche psychologique, comme J. Dollard qui établit un lien entre agressivité et frustration et d’autres, enfin, se basant sur un discours exclusivement économique (L. Martinez), politique ou même culturel. Abderrahmane Moussaoui critique ces dernières qu’il juge insuffisantes voire aberrantes. Il s’inscrit quant à lui dans une deuxième tendance qui tente de répondre à la question du comment. Selon lui, il faut tenir compte de la dimension symbolique de la violence politique et de sa légitimation. Celle-ci constitue « l’affirmation d’une identité collective estimée plus légitime » (p.427) qu’il met en parallèle à la théorie de la nouvelle communauté imaginée de Benedict Anderson. Il affirme qu’ici c’est l’islam qui est utilisé comme ressource politique et érigé en idéal sacré, différemment par les uns et les autres. Enfin, il explique la difficulté de nommer ce conflit, qui ne constitue pas une guerre dans le sens classique du terme, même si pour certains on peut parler de guerre civile (L. Martinez) ; l’auteur préfère parler d’une guerre d’un genre nouveau au vue de son éthique et de ses règles propres.
L’approche anthropologique du chercheur le distingue des différentes études produites sur la période et en fait une lecture originale et intéressante sur la violence qui a ébranlé l’Algérie entre 1990 et 2000. En effet, la plupart des travaux qui traitent du sujet s’inscrivent dans une approche historique ou politique, Moussaoui affirme même dans l’introduction que « presque tout a été dit sur les raisons politiques qui ont été à l’origine de cette violence » (p.12). Or, ici l’auteur focalise son analyse sur les formes de la violence ainsi que sur les discours des groupes islamiques armés. Ceci lui permet de proposer une explication des mécanismes qui « président à l’explosion de la violence et les logiques qui la nourrissent » (p.20). Aussi, Abderrahmane Moussaoui a longuement vécu en Algérie et connaît parfaitement le terrain ; son travail, basé sur de longues années d’études lui permet de dresser la complexité de la réalité qu’il décrit. Il précise lui-même qu’une telle étude n’a pas été facile au vue de la complexité du sujet, des « méthodes insuffisamment établies » (p.16), et de la proximité qu’il entretient avec son sujet d’étude. Réussir à surmonter la subjectivité face à un sujet aussi délicat (massacre de civils, de femmes, d’enfants, de nourrissons, viols, torture,…) ne doit pas être chose facile, d’ailleurs le doit-il et/ou le peut-il ? Ceci nous renvoie aux limites morales de l’affectivité que développe le chercheur envers son objet d’étude, car comme l’explique B. Bailyn, « expliquer en profondeur et avec sympathie est, au moins implicitement, excuser ». Cette théorie est ceci dit au centre de débats houleux entre chercheurs.

