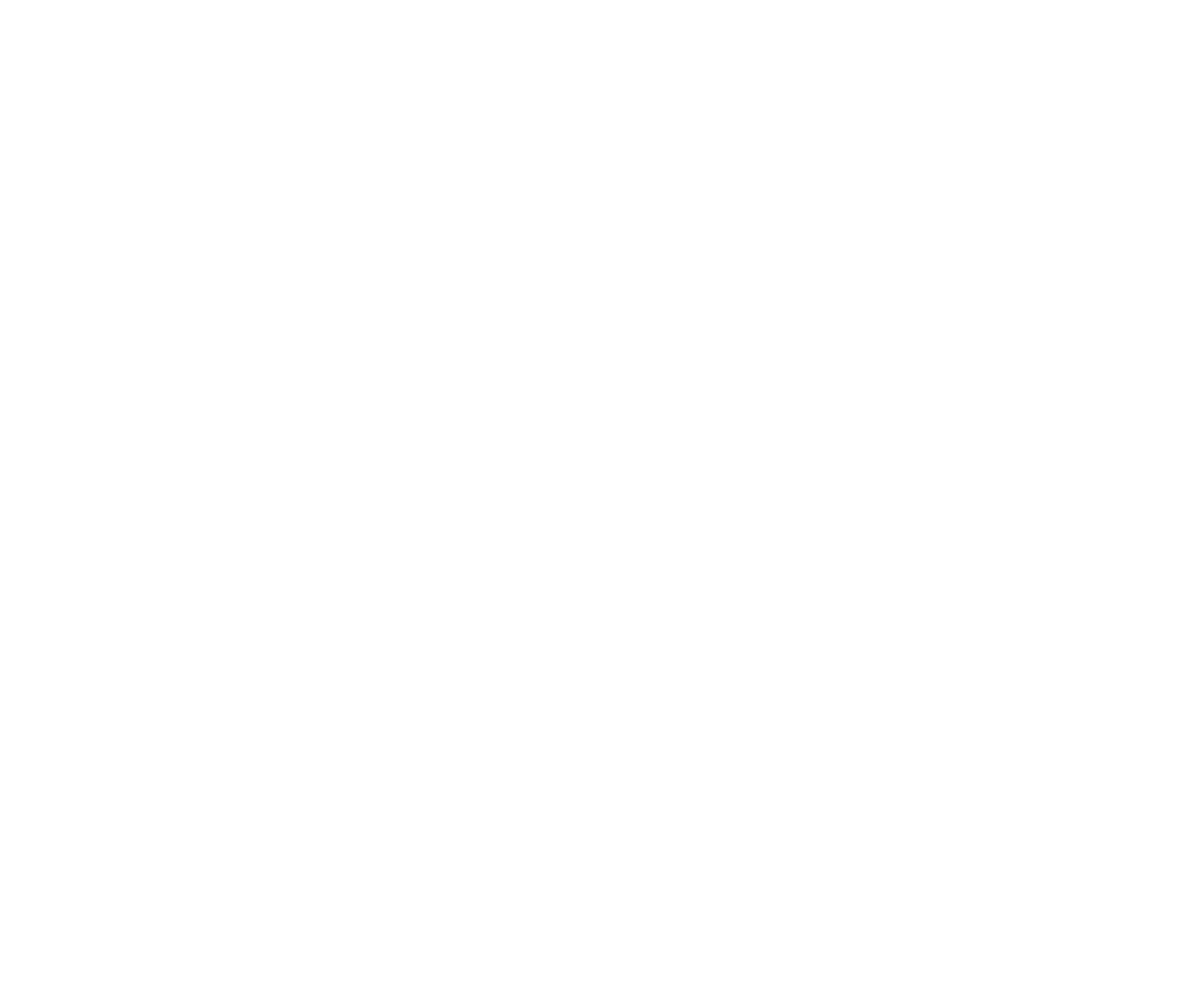
Critique de la critique hypercritique
En réponse à Mohammad Ali Amir-Moezzi
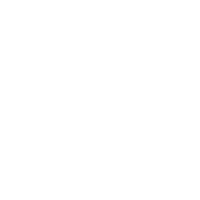
Tarek Sidqi
En réponse à « Pendant les premiers siècles de l’islam, il existait plusieurs versions du Coran »
Commençons par dire que, comme pour l’étude du christianisme ou celle du judaïsme, l’affirmation par une école d’historiens parmi d’autres d’être en droit de définir ce qu’est l’islam est un double tour de passe-passe. En premier lieu, parce qu’une multitude d’écoles historiographiques modernes coexistent et que le courant que forment Guillaume Dye et Mohamed Amir-Moezzi est une exception hypercritique dans le champ historique, inextricablement liée aux développements des études francophones de l’Islam. Il semble qu’une sorte de retard y perdure, tant en amplitude des sources étudiées que s’agissant de l’avancement de la réflexion théorique ou épistémologique. Patricia Crone et Michael Cook, l’un et l’autre têtes de file de l’école hypercritique – et qui avaient défendu le refus d’inclure les sources musulmanes dans l’étude des premiers temps de l’Islam –, ont depuis longtemps admis que leur geste épistémologique avait été trop radical et que la réalité historique incitait à plus de concessions à l’égard des données traditionnelles[1]. En second lieu, l’école hypercritique française contemporaine fait volontairement abstraction des travaux d’éminents chercheurs sur le même objet d’étude – comme Montgomery Watt au Royaume-Uni, Angelika Neuwirth en Allemagne ou François Déroche en France –, ce qui lui permet en retour de s’arroger la position de vulgarisateur voire, puisque le contexte politique s’y prête, de paravent de la science face à l’obscurantisme traditionnaliste. Cette dernière posture offre ainsi au geste savant une autojustification morale et dispense l’historien de la nécessaire confrontation avec ses pairs.
Genèse d’un texte sacré
S’agissant de la question de la rédaction et de la compilation du Coran, le spécialiste français est François Déroche[2]. Son étude, sérieuse et précise, est appuyée sur l’ensemble des connaissances disponibles – tout en étant régulièrement présentée au public par-delà le champ universitaire[3]. François Déroche opère ainsi un retour sur le conflit historique autour de la codification du texte sacré. Abu Bakr, Othman – deux parmi les quatre califes bien guidés – et Abd el-Malik – cinquième calife omeyyade – ont tous mis en place des politiques d’unification du Coran – ce qui suppose mécaniquement que des choix ont été opérés, réalité historique tout à fait admise par la tradition en son versant le plus orthodoxe.
Par-delà la multiplicité des sources et les choix de codex retenus, l’histoire de la canonisation du Coran est consubstantielle du drame fondateur de l’histoire politique de l’Islam – soit la fitna dont les traces perdurent jusqu’à l’époque contemporaine. Le calife omeyyade Abd el-Malik – qui initia l’une des dernières grandes réformes du manuscrit[4] – n’est guère à l’origine de la fitna ; à l’inverse, il en propose une voie de résolution par la stabilisation du texte sacré. Selon ce Moezzi, Abd el-Malik aurait néanmoins transféré sa propre refonte du Coran sur Othman. Cette thèse est fantaisiste tant s’agissant d’historiographie – sitôt que l’on dépasse le champ hypercritique – que d’histoire sociale et politique. Le califat d’Othman étant à l’origine de la dynastie omeyyade, on voit mal pourquoi son lointain successeur aurait ainsi participé à délégitimer le pouvoir dont il était l’héritier – à l’heure de contestations politiques-religieuses multiples et internes à la jeune communauté musulmane. Pourquoi Abd el-Malik aurait dit de son parent – déjà lourdement critiqué par une variété de mouvements musulmans dans le contexte qui suit la fitna – qu’il avait envoyé ses soldats de force auprès d’Abdellah ibn Mas’ud pour brûler la propre compilation effectuée par ce dernier du Coran ? Pourquoi Abd el-Malik aurait-il inventé face à ses contemporains l’intervention de Othman, qui fut parmi les causes de la fitna et de l’assassinat de celui qui est le fondateur réel de la dynastie omeyyade ? À l’inverse, tout indique l’intérêt d’Abd el-Malik d’assoir la légitimité – et la sienne simultanément – d’Othman en passant sous silence les choix opérés par ce dernier quant à la compilation du Coran. Il en témoigne également son revers, c’est-à-dire le potentiel critique – passé et présent – de la mémoire du conflit sociopolitique à l’heure du califat d’Othman, par exemple à travers la geste du singulier compagnon du Prophète Abu Dharr al Ghifari, extrêmement opposé à l’enrichissement des élites du premier Empire musulman et exilé par la force à Al-Rabathah, qui survit dans les récits malgré la contradiction qu’il représente à l’égard du pouvoir califal.
Un nom concentre le lien entre une version pré-canonique du Coran et la réécriture impériale de l’histoire des premiers temps de la communauté musulmane, celui d’Abdellah ibn Mas’ud, tout à la fois compilateur alternatif du texte sacré et opposant précoce au calife bien-guidé Othman ibn ‘Affan. Les érudits le savent, Mohammed Amir-Moezzi le sait, mais l’histoire impériale française n’enseigne que son homologue du passé – et certainement pas celle de la variété de ses opposants bédouins, hébreux ou arabes, lesquels demeurent un impensé notable de l’orientalisme. Il est pourtant surprenant que l’école hypercritique – dont l’objet est à restaurer l’histoire contre la tradition – n’appuie pas plus sur ce point : comme la tradition, l’école hypercritique fait disparaître le combat entre le proto-capitalisme marchant que les Omeyyades[5] représentent et contre lequel s’est élevée la geste prophétique [6]
Pourquoi Moezzi s’attache-t-il dès lors à Abd el-Malik ? La raison en est transparente : la découverte récente de manuscrits datant de cette époque et l’intérêt grandissant du public à leur égard rend de plus en plus impossible les spéculations passées quant aux réécritures tardives du Coran. Contraint de se conformer aux datations au carbone 14 des premiers manuscrits complets du texte sacré[7], lesquels indiquent leur caractère extrêmement précoce, Moezzi choisit un pouvoir reconnu par la tradition – qui devient tout d’un coup une source historique valable – pour permettre la spéculation quant à une réécriture a posteriori du texte sacré de l’islam. L’opération permet tout à la fois de choquer le sunnisme sur le Coran et de se couler dans la vérité traditionnelle, qui affirme bel et bien que plusieurs réformes du texte sacré ont eu lieu durant le califat omeyyade. L’ensemble des recherches démontrent pourtant les très faibles variations du texte, c’est-à-dire un verset sur l’envie, l’ordre des sourates, deux sourates en remplacement des deux dernières sourates du corpus, ainsi que les propositions chiites visant souvent à inclure Ali. Les différentes lectures, y compris celle de Hamza comme survivance de la lecture d’Ibn Mas’ud, confirment le texte. Ce qui aurait été rajouté à l’époque d’Abd el-Malik par le gouverneur de l’Iraq Al Hajjaj ben Youssef et le savant et ascète Hassan al-Basri est les points diacritiques et la séparation des versets.
Histoire sociopolitique du Coran
La thèse de Moezzi est in fine fort simple. Le texte sacré des musulmans est une reprise partielle d’éléments religieux en circulation dans la région. Cette thèse est tout à fait audible. En ce point, la tradition en son versant orthodoxe et son rejet des sources chrétiennes pourtant citées par le Coran est prise en défaut. Toutefois, affirmer sans contexte que « le mot “Coran” lui-même viendrait de qiriyâna, qui désigne un « livre de prières » en syriaque » est une référence aux thèses hautement controversées de Christoph Luxemberg[8] – lesquelles sont reprises sans note critique. Cette approche reprise ad nauseam par l’école hypercritique française est pourtant sérieusement contestée par les travaux historiographiques récents[9].
À l’encontre de la thèse de l’hégémonie syriaque, il faut rappeler que de multiples influences chrétiennes sont présentes dans la péninsule arabique : monophysites, nestoriens, jacobites, ariens, eunomiens, probablement nazaréens et ébionites, dont l’oncle de Khadija – la première épouse du Prophète – qui a traduit l’Évangile en arabe depuis l’hébreu. On devrait également mentionner les références coraniques au manichéisme et au zoroastrisme. Le Coran évoque ainsi toutes les religions présentes à la fin du monde antique. Similairement, à contrepied de la thèse syriaque, une église insuffisamment évoquée s’agissant de son legs à la tradition islamique est celle de l’Église éthiopienne du royaume d’Aksoum, dont l’influence s’étend jusqu’au Yémen et dont le canon et les pratiques rituelles sont remarquablement proches de l’islam[10]. L’importance du ge’ez, quoique souvent mentionnée, est l’objet de trop peu d’études académiques.
Il n’est guère possible d’attribuer arbitrairement le texte coranique à la reprise d’une influence monothéiste exclusive. Surtout, la velléité d’identifier la source originelle de l’islam fait montre d’une rare naïveté épistémologique – une influence est toujours un choix parmi d’autres influences possibles. Elle fait durablement abstraction du contexte sociopolitique de la révélation islamique, tant à la Mecque, où la réaffirmation monothéiste lors de la révélation islamique fait figure de réponse au proto-capitalisme marchant des Quraych[11], lequel avait détruit l’éthique bédouine de la solidarité tribale[12] (à laquelle le Coran fait également référence, qu’à Médine, où le Coran affirme d’emblée opérer une synthèse – certes conflictuelle – entre la variété des monothéismes présents au sein d’un même espace-temps. Aussi la recherche d’une filiation exclusive – dont témoigne l’école Luxemberg-Dye-Moezzi – oblitère-elle la richesse des dynamiques religieuses et politiques qui parcourent la péninsule arabique à l’époque prophétique, comme l’effort de synthèse et de correction opéré dans le Coran, auquel on refuse avec acharnement toute parole propre, toute autonomie ainsi que son originalité. Le Coran n’est pas considéré par ces chercheurs comme une œuvre à part entière, et ce manque ne cesse de justifier les spéculations subséquentes.
Le Coran lui-même n’est pas silencieux quant à ces influences. Lorsque le texte sacré reprend le terme nazaréen – nassara en arabe –, il prend à contrepied les courants majoritaires auxquels il est exposé. Il s’agit donc d’un choix volontaire qui constitue simultanément une prise de position en faveur du judéo-christianisme que l’on dit “hérétique” – lequel est une survivance du christianisme dit primitif, dont il porte le premier nom[13]. Les versets 82-83 de la cinquième sourate, dans un passage affirmant la primauté de la lettre sur le clergé, figurent ainsi ce qui se joue dans cinq siècles de dispute théologico-politique à la suite de laquelle la révélation islamique éclate, le texte sacré affirme des nazaréens que « quand ils entendent ce qui est descendu sur l’Envoyé, tu vois leurs yeux épancher des larmes, tant ils y reconnaissent de vérité, au point de dire : « Notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous parmi les témoins, comment pourrions-nous ne point croire en Dieu et à ce qui nous est venu de Vrai, n’aspirer point à ce que notre Seigneur nous fasse entrer dans le peuple des justifiés ? ».
Les « larmes » des nazaréens – ce mouvement judéo-chrétien qui reconnait Jésus mais continue de pratiquer la Halakha juive – accompagnent la parole divine que transmet le Prophète de l’islam, en y voyant la résolution de siècles d’oppression et de sourdes attentes nervurant le débat entre la loi rituelle et la justice des temps réaffirmée par la critique radicale de Jésus. La tradition islamique fait une impasse évidente sur le sujet, mais l’école syriacisante reconduit cet évitement. L’hypothèse judéo-chrétienne des nazaréens – à laquelle le Coran ne cesse pourtant de se référer comme mouvement religieux précédant l’islam et en préparant la révélation – est durablement occultée des savoirs traditionnels comme orientalistes.
En s’inscrivant dans les pas des nazaréens, le Coran affirme pourtant le potentiel critique de la révélation dont il se fait le porteur. Ce judéo-christianisme occulté de l’historiographie de l’Antiquité tardive[14] est pourtant une base commune aux monothéismes, dans son iconoclasme et désir de justice. Au reste, l’orientalisme français s’inscrit en ce point dans la filiation des grandes idéologies du XIXème siècle, qui y voit une néfaste « morale des esclaves[15] ». Le judéo-christianisme est le grand absent de l’histoire moderne, ce qui donne ainsi toute sa force au rappel de cette filiation par le Coran lui-même. La critique historiographique échoue à repérer la dimension critique à l’œuvre dans l’inscription revendiquée du Coran dans le judéo-christianisme des nazaréens. Au lieu d’en remettre à jour le potentiel critique émoussé par la tradition, l’école hypercritique se contente naïvement de rappeler la filiation.
L'oubli partagé de l'histoire
Sur le Coran lui-même, Moezzi s’arroge le droit exorbitant d’opérer une sélection quant à ce qui en constitue la fraction authentique, c’est-à-dire essentiellement la partie mecquoise. Il s’agit d’attribuer au Prophète de l’islam un rôle purement spirituel, en faisant disparaitre l’aspiration à la justice et à la solidarité qui se concentre dans la révélation islamique, ainsi que la critique portée à l’égard des autres discours religieux. L’opération achève de vider le texte sacré de toute influence sur la vie réelle. L’islam ressaisi par Moezzi est ainsi pure spiritualité, qui n’a aucune vocation à intervenir dans la société. Se plaçant au cœur de la période mecquoise, l’auteur esquive l’essentiel de son contenu, dont la violence des marchands mecquois contre le discours du Prophète qui les interroge dans la sphère publique. À l’heure de la thèse du séparatisme, la correspondance entre le propos de l’historien et celui de l’époque où il évolue est limpide[16].
Les premières sourates sur lesquelles s’appuie Moezzi sont pourtant celles qui affirment le plus nettement l’injustice de la société mecquoise, ce dont témoignent toutes les biographies modernes de la geste prophétique – y compris non apologétiques. Le paiement de la zakât, le partage de la nourriture, la défense des démunis, celle des femmes, le respect des liens de solidarité, qui aboutiront à Médine – ville idéale d’une longue tradition islamique – à l’interdiction de l’usure, tout cela est au cœur du conflit qui oppose Muhammad à l’élite mecquoise. Mais Moezzi n’en a cure : il s’agit de faire du Prophète de l’islam la figure d’un propos spiritualiste, piétiste et désincarné.
Cette oblitération est à nouveau en partage entre la tradition ressaisie par les Omeyades et l’école hypercritique. Lors de la période mecquoise, le puissant clan d’Abu Sufyan ibn Harb et Uqba ibn Abi Mu’ayt, l’un et l’autre prédécesseurs de la dynastie omeyyade – Muawiya est le fils d’Abu Sufyan – est au cœur du conflit qui oppose les premiers musulmans à l’élite des Quraych. Aussi le fait que le thème de la justice soit présent dans le Coran que dans la tradition subséquente semble une conséquence évidente de la prise de pouvoir des Omeyyades – après leur conversion tardive à la nouvelle religion de Muhammad. Une nouvelle fois, les raisons qui poussent Moezzi à ne pas relever ce point aveugle de la tradition sont apparentes. En sus de la volonté patente de dépolitiser l’islam, il s’agit de sauver la tradition post-omeyyade face au Coran. Cette dernière velléité est également apparente dans le rabattement qu’opère Moezzi du djihad aux conquêtes militaires de l’Empire musulman ; dans le Coran, le djihad est pourtant une réponse – proportionnée – à la persécution et à l’injustice, et non le geste d’expansion qu’affirment à l’unisson la tradition omeyyade et Moezzi.
S’il faut conduire la critique de l’écriture de l’histoire, le lien consubstantiel de l’historiographie française et de l’impératif de la laïcité, qui vise à prévenir l’intervention des discours simultanément religieux et critiques dans la vie publique, explique les propositions historiques de l’école hypercritique française, laquelle nie à l’Islam son rôle social de critique des injustices. Cette posture est inscrite dans une longue filiation orientaliste et de science française des religions née à la fin du XIXème siècle – la figure d’Ernest Renan en est caractéristique –, que caractérise son rejet tout à la fois des monothéismes, du socialisme et des Lumières telles qu’entendues par la Révolution française (cadre pourtant toujours proclamé mais constamment remanié de notre République).
L’islamologie française aime les Omeyyades. Une affinité élective parait entre l’Empire musulman en cours de stabilisation et la position laïque qui vise à prévenir tout potentiel critique de la religion – y compris dans ses sources historiques. Elle est réalisée par l’effacement parachevé des aspirations profondes de justice et de solidarité qui accompagnent la révélation islamique. On pourra s’étonner qu’un courant semblant si fortement positiviste dans son approche ne propose que de la spéculation fondée sur elle même, relisant à sa guise et selon sa propre herméneutique les données disponibles. Nous laissons le lecteur estimer à quel point il s’oppose de façon progressiste à la tradition.
[1] Crone, Patricia. “Quraysh and the Roman Army: Making Sense of the Meccan Leather Trade.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 70, no. 1, 2007, pp. 63–88.
[2] Déroche, François. La Voix et le Calame : les chemins de la canonisation du Coran, Paris, Fayard, 2016 ; Déroche, François. Le Coran, une histoire plurielle. Essai sur la formation du texte coranique, Paris, Seuil, 2019.
[3] Voir par exemple https://www.youtube.com/watch?v=HuwRmxzowqw
[4] En ajoutant ainsi les signes diacritiques. Voir Gilliot, Claude. « Origines et fixation du texte coranique », Études, vol. 409, no. 12, 2008, pp. 643-652.
[5] Ceux-ci, longtemps opposés à l’islam, sont la partie la plus riche du clan des Quraych.
[6] https://oumma.com/le-capitalisme-mecquois-et-la-revolution-de-lislam-1-2/ ; Wolf, The Social Organization of Mecca and the Orgins of Islam, et Ibrahim, « Social and Economic Conditons in Pre-Islamic Mecca », International Journal of Middle East Studies, dont le livre, Merchant Capital and Islam, est le fil conducteur de l’article sur Oumma. Voir également http://collectif-attariq.net/wp/hilf-al-fudul/
[7]Sadeghi, B., Goudarzi, M., Ṣan‘ā’ 1 and the Origins of the Qur’ān. Rappelons que l’on parle de mushafs – ouvrage physique – complet possédés par les compagnons, qui manquent de variation significatives hormis celles évoquées plus haut. A ce propos, il aurait pu être intéressant de rappeler l’effort majeur de la première communauté musulmane, qui enseigne à ses membres la lecture et l’écriture. Ainsi, à Dar al-Suffa, annexe de la mosquée de Médine où les compagnons apprennent la récitation du Coran, ils apprennent aussi à l’écrire.
[8] Christoph Luxemberg, philologue amateur chrétien libanais publiant sous pseudonyme, est à l’origine d’une réinterprétation totale du Coran – et notamment de ses passages les plus esotériques – à la lumière de sa source syriaque réputée. Il a reçu un écho globalement favorable au sein de l’école hypercritique (même si Patricia Crone en reconnaissait « l’amateurisme ») et, à l’inverse, très négatif au sein du champ plus large des études du Coran. Voir Herbert Berg, « Islamic Origins and the Qur’an », The Oxford Handbook of Qur'anic Studies, 2020, p. 57.
[9] Pour une lecture érudite des références coraniques aux révélations précédentes, lire :
– Emran El Badawe, “The Qur’an and the Aramaic Gospel Traditions” (Routledge, 2013), la seule introduction vaut bibliographie sur le sujet.
– Holger Zellentin, The Qurʾān’s Legal Culture: The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013), ainsi que ses écrits disponibles en ligne.
– Catherine Pennaccio, Les emprunts à l’hébreu et au judéo-araméen dans le Coran, Collection « Itinéraire poétique, Itinéraire critique », Librairie d’Amérique et d’Orient, Jean Maisonneuve, Paris, 2014.
[10] Le canon éthiopien contient des textes anciens et apocryphes dont le rapport au Coran est manifeste. On peut ainsi mentionner des versions eunomiennes de la Didachè et de la constitution apostoloique, des livres d’Enoch, Esdras et des Jubilés etc. Les pratiques de l’Église éthiopienne témoignent également d’une forte proximité aux pratiques rituelles de l’islam, tant s’agissant des ablutions, des interdits alimentaires que du voile. L’impasse historiographique sur ce sujet est incompréhensible.
[11] Ce monothéisme diffus à la veille de la révélation islamique était déjà iconoclaste comme le montre l’histoire de Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète Muhammad.
[12] En particulier dans la préservation des liens sociaux et familiaux, malgré le rejet monothéiste du culte des ancêtres, également présent dans le Coran. Pour l’importance de l’Islam comme survivance des pratiques bédouines pour les tribus qui rejoignent le mouvement, voir Demichelis, Marco. (2014). Kharijites and Qarmatians: Islamic Pre-Democratic Thought, a Political-Theological Analysis.
[13]Ray Pritz, Nazarene Jewish Christianity: From the End of the New Testament Period Until Its Disappearance in the Fourth Century, Brill Archive, 1988
[14] Voir à ce titre l’ouvrage de Mohammad Abed al-Jabri, Introduction à la lecture du Coran (en arabe, non traduit en français).
[15] Notons que cette condamnation vise tout autant le monothéisme primordial que le socialisme et la pensée des Lumières telle qu’envisagée par la Révolution française. Cette période qui marque durablement les préjugés à l’égard des peuples orientaux – dont Ernest Renan est sans doute l’exemple le plus fameux – est paradoxalement marquée par son opposition au rationalisme. On trouvera une critique magistrale de l’irrationalisme dans l’ouvrage de Lukács, La destruction de la raison. Voir l’excellente recension de Nicolas Tertulien, La destruction de la raison trente ans après. Les auteurs pointés par Lukacs pour leur irrationalisme sont aussi parmi les plus virulents opposants du monothéisme et des restes « judéo-chrétiens » dans notre civilisation, à savoir Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. Toute opposition au monothéisme n’est donc pas rationaliste par essence.
[16] On notera la réception extrêmement élogieuse que réserve un média pamphlétaire d’extrême-droite au Coran des historiens. Les auteurs ne sont pas responsables de la réception de leur propos – d’autant qu’il est probable que cette réception se fasse sans lecture de l’ouvrage –, mais il est néanmoins frappant de constater la correspondance – même à leur corps défendant – entre leur production intellectuelle et l’air du temps dans laquelle elle s’inscrit de facto.
Commençons par dire que, comme pour l’étude du christianisme ou celle du judaïsme, l’affirmation par une école d’historiens parmi d’autres d’être en droit de définir ce qu’est l’islam est un double tour de passe-passe. En premier lieu, parce qu’une multitude d’écoles historiographiques modernes coexistent et que le courant que forment Guillaume Dye et Mohamed Amir-Moezzi est une exception hypercritique dans le champ historique, inextricablement liée aux développements des études francophones de l’Islam. Il semble qu’une sorte de retard y perdure, tant en amplitude des sources étudiées que s’agissant de l’avancement de la réflexion théorique ou épistémologique. Patricia Crone et Michael Cook, l’un et l’autre têtes de file de l’école hypercritique – et qui avaient défendu le refus d’inclure les sources musulmanes dans l’étude des premiers temps de l’Islam –, ont depuis longtemps admis que leur geste épistémologique avait été trop radical et que la réalité historique incitait à plus de concessions à l’égard des données traditionnelles[1]. En second lieu, l’école hypercritique française contemporaine fait volontairement abstraction des travaux d’éminents chercheurs sur le même objet d’étude – comme Montgomery Watt au Royaume-Uni, Angelika Neuwirth en Allemagne ou François Déroche en France –, ce qui lui permet en retour de s’arroger la position de vulgarisateur voire, puisque le contexte politique s’y prête, de paravent de la science face à l’obscurantisme traditionnaliste. Cette dernière posture offre ainsi au geste savant une autojustification morale et dispense l’historien de la nécessaire confrontation avec ses pairs.
Genèse d’un texte sacré
S’agissant de la question de la rédaction et de la compilation du Coran, le spécialiste français est François Déroche[2]. Son étude, sérieuse et précise, est appuyée sur l’ensemble des connaissances disponibles – tout en étant régulièrement présentée au public par-delà le champ universitaire[3]. François Déroche opère ainsi un retour sur le conflit historique autour de la codification du texte sacré. Abu Bakr, Othman – deux parmi les quatre califes bien guidés – et Abd el-Malik – cinquième calife omeyyade – ont tous mis en place des politiques d’unification du Coran – ce qui suppose mécaniquement que des choix ont été opérés, réalité historique tout à fait admise par la tradition en son versant le plus orthodoxe.
Par-delà la multiplicité des sources et les choix de codex retenus, l’histoire de la canonisation du Coran est consubstantielle du drame fondateur de l’histoire politique de l’Islam – soit la fitna dont les traces perdurent jusqu’à l’époque contemporaine. Le calife omeyyade Abd el-Malik – qui initia l’une des dernières grandes réformes du manuscrit[4] – n’est guère à l’origine de la fitna ; à l’inverse, il en propose une voie de résolution par la stabilisation du texte sacré. Selon ce Moezzi, Abd el-Malik aurait néanmoins transféré sa propre refonte du Coran sur Othman. Cette thèse est fantaisiste tant s’agissant d’historiographie – sitôt que l’on dépasse le champ hypercritique – que d’histoire sociale et politique. Le califat d’Othman étant à l’origine de la dynastie omeyyade, on voit mal pourquoi son lointain successeur aurait ainsi participé à délégitimer le pouvoir dont il était l’héritier – à l’heure de contestations politiques-religieuses multiples et internes à la jeune communauté musulmane. Pourquoi Abd el-Malik aurait dit de son parent – déjà lourdement critiqué par une variété de mouvements musulmans dans le contexte qui suit la fitna – qu’il avait envoyé ses soldats de force auprès d’Abdellah ibn Mas’ud pour brûler la propre compilation effectuée par ce dernier du Coran ? Pourquoi Abd el-Malik aurait-il inventé face à ses contemporains l’intervention de Othman, qui fut parmi les causes de la fitna et de l’assassinat de celui qui est le fondateur réel de la dynastie omeyyade ? À l’inverse, tout indique l’intérêt d’Abd el-Malik d’assoir la légitimité – et la sienne simultanément – d’Othman en passant sous silence les choix opérés par ce dernier quant à la compilation du Coran. Il en témoigne également son revers, c’est-à-dire le potentiel critique – passé et présent – de la mémoire du conflit sociopolitique à l’heure du califat d’Othman, par exemple à travers la geste du singulier compagnon du Prophète Abu Dharr al Ghifari, extrêmement opposé à l’enrichissement des élites du premier Empire musulman et exilé par la force à Al-Rabathah, qui survit dans les récits malgré la contradiction qu’il représente à l’égard du pouvoir califal.
Un nom concentre le lien entre une version pré-canonique du Coran et la réécriture impériale de l’histoire des premiers temps de la communauté musulmane, celui d’Abdellah ibn Mas’ud, tout à la fois compilateur alternatif du texte sacré et opposant précoce au calife bien-guidé Othman ibn ‘Affan. Les érudits le savent, Mohammed Amir-Moezzi le sait, mais l’histoire impériale française n’enseigne que son homologue du passé – et certainement pas celle de la variété de ses opposants bédouins, hébreux ou arabes, lesquels demeurent un impensé notable de l’orientalisme. Il est pourtant surprenant que l’école hypercritique – dont l’objet est à restaurer l’histoire contre la tradition – n’appuie pas plus sur ce point : comme la tradition, l’école hypercritique fait disparaître le combat entre le proto-capitalisme marchant que les Omeyyades[5] représentent et contre lequel s’est élevée la geste prophétique [6]
Pourquoi Moezzi s’attache-t-il dès lors à Abd el-Malik ? La raison en est transparente : la découverte récente de manuscrits datant de cette époque et l’intérêt grandissant du public à leur égard rend de plus en plus impossible les spéculations passées quant aux réécritures tardives du Coran. Contraint de se conformer aux datations au carbone 14 des premiers manuscrits complets du texte sacré[7], lesquels indiquent leur caractère extrêmement précoce, Moezzi choisit un pouvoir reconnu par la tradition – qui devient tout d’un coup une source historique valable – pour permettre la spéculation quant à une réécriture a posteriori du texte sacré de l’islam. L’opération permet tout à la fois de choquer le sunnisme sur le Coran et de se couler dans la vérité traditionnelle, qui affirme bel et bien que plusieurs réformes du texte sacré ont eu lieu durant le califat omeyyade. L’ensemble des recherches démontrent pourtant les très faibles variations du texte, c’est-à-dire un verset sur l’envie, l’ordre des sourates, deux sourates en remplacement des deux dernières sourates du corpus, ainsi que les propositions chiites visant souvent à inclure Ali. Les différentes lectures, y compris celle de Hamza comme survivance de la lecture d’Ibn Mas’ud, confirment le texte. Ce qui aurait été rajouté à l’époque d’Abd el-Malik par le gouverneur de l’Iraq Al Hajjaj ben Youssef et le savant et ascète Hassan al-Basri est les points diacritiques et la séparation des versets.
Histoire sociopolitique du Coran
La thèse de Moezzi est in fine fort simple. Le texte sacré des musulmans est une reprise partielle d’éléments religieux en circulation dans la région. Cette thèse est tout à fait audible. En ce point, la tradition en son versant orthodoxe et son rejet des sources chrétiennes pourtant citées par le Coran est prise en défaut. Toutefois, affirmer sans contexte que « le mot “Coran” lui-même viendrait de qiriyâna, qui désigne un « livre de prières » en syriaque » est une référence aux thèses hautement controversées de Christoph Luxemberg[8] – lesquelles sont reprises sans note critique. Cette approche reprise ad nauseam par l’école hypercritique française est pourtant sérieusement contestée par les travaux historiographiques récents[9].
À l’encontre de la thèse de l’hégémonie syriaque, il faut rappeler que de multiples influences chrétiennes sont présentes dans la péninsule arabique : monophysites, nestoriens, jacobites, ariens, eunomiens, probablement nazaréens et ébionites, dont l’oncle de Khadija – la première épouse du Prophète – qui a traduit l’Évangile en arabe depuis l’hébreu. On devrait également mentionner les références coraniques au manichéisme et au zoroastrisme. Le Coran évoque ainsi toutes les religions présentes à la fin du monde antique. Similairement, à contrepied de la thèse syriaque, une église insuffisamment évoquée s’agissant de son legs à la tradition islamique est celle de l’Église éthiopienne du royaume d’Aksoum, dont l’influence s’étend jusqu’au Yémen et dont le canon et les pratiques rituelles sont remarquablement proches de l’islam[10]. L’importance du ge’ez, quoique souvent mentionnée, est l’objet de trop peu d’études académiques.
Il n’est guère possible d’attribuer arbitrairement le texte coranique à la reprise d’une influence monothéiste exclusive. Surtout, la velléité d’identifier la source originelle de l’islam fait montre d’une rare naïveté épistémologique – une influence est toujours un choix parmi d’autres influences possibles. Elle fait durablement abstraction du contexte sociopolitique de la révélation islamique, tant à la Mecque, où la réaffirmation monothéiste lors de la révélation islamique fait figure de réponse au proto-capitalisme marchant des Quraych[11], lequel avait détruit l’éthique bédouine de la solidarité tribale[12] (à laquelle le Coran fait également référence, qu’à Médine, où le Coran affirme d’emblée opérer une synthèse – certes conflictuelle – entre la variété des monothéismes présents au sein d’un même espace-temps. Aussi la recherche d’une filiation exclusive – dont témoigne l’école Luxemberg-Dye-Moezzi – oblitère-elle la richesse des dynamiques religieuses et politiques qui parcourent la péninsule arabique à l’époque prophétique, comme l’effort de synthèse et de correction opéré dans le Coran, auquel on refuse avec acharnement toute parole propre, toute autonomie ainsi que son originalité. Le Coran n’est pas considéré par ces chercheurs comme une œuvre à part entière, et ce manque ne cesse de justifier les spéculations subséquentes.
Le Coran lui-même n’est pas silencieux quant à ces influences. Lorsque le texte sacré reprend le terme nazaréen – nassara en arabe –, il prend à contrepied les courants majoritaires auxquels il est exposé. Il s’agit donc d’un choix volontaire qui constitue simultanément une prise de position en faveur du judéo-christianisme que l’on dit “hérétique” – lequel est une survivance du christianisme dit primitif, dont il porte le premier nom[13]. Les versets 82-83 de la cinquième sourate, dans un passage affirmant la primauté de la lettre sur le clergé, figurent ainsi ce qui se joue dans cinq siècles de dispute théologico-politique à la suite de laquelle la révélation islamique éclate, le texte sacré affirme des nazaréens que « quand ils entendent ce qui est descendu sur l’Envoyé, tu vois leurs yeux épancher des larmes, tant ils y reconnaissent de vérité, au point de dire : « Notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous parmi les témoins, comment pourrions-nous ne point croire en Dieu et à ce qui nous est venu de Vrai, n’aspirer point à ce que notre Seigneur nous fasse entrer dans le peuple des justifiés ? ».
Les « larmes » des nazaréens – ce mouvement judéo-chrétien qui reconnait Jésus mais continue de pratiquer la Halakha juive – accompagnent la parole divine que transmet le Prophète de l’islam, en y voyant la résolution de siècles d’oppression et de sourdes attentes nervurant le débat entre la loi rituelle et la justice des temps réaffirmée par la critique radicale de Jésus. La tradition islamique fait une impasse évidente sur le sujet, mais l’école syriacisante reconduit cet évitement. L’hypothèse judéo-chrétienne des nazaréens – à laquelle le Coran ne cesse pourtant de se référer comme mouvement religieux précédant l’islam et en préparant la révélation – est durablement occultée des savoirs traditionnels comme orientalistes.
En s’inscrivant dans les pas des nazaréens, le Coran affirme pourtant le potentiel critique de la révélation dont il se fait le porteur. Ce judéo-christianisme occulté de l’historiographie de l’Antiquité tardive[14] est pourtant une base commune aux monothéismes, dans son iconoclasme et désir de justice. Au reste, l’orientalisme français s’inscrit en ce point dans la filiation des grandes idéologies du XIXème siècle, qui y voit une néfaste « morale des esclaves[15] ». Le judéo-christianisme est le grand absent de l’histoire moderne, ce qui donne ainsi toute sa force au rappel de cette filiation par le Coran lui-même. La critique historiographique échoue à repérer la dimension critique à l’œuvre dans l’inscription revendiquée du Coran dans le judéo-christianisme des nazaréens. Au lieu d’en remettre à jour le potentiel critique émoussé par la tradition, l’école hypercritique se contente naïvement de rappeler la filiation.
L'oubli partagé de l'histoire
Sur le Coran lui-même, Moezzi s’arroge le droit exorbitant d’opérer une sélection quant à ce qui en constitue la fraction authentique, c’est-à-dire essentiellement la partie mecquoise. Il s’agit d’attribuer au Prophète de l’islam un rôle purement spirituel, en faisant disparaitre l’aspiration à la justice et à la solidarité qui se concentre dans la révélation islamique, ainsi que la critique portée à l’égard des autres discours religieux. L’opération achève de vider le texte sacré de toute influence sur la vie réelle. L’islam ressaisi par Moezzi est ainsi pure spiritualité, qui n’a aucune vocation à intervenir dans la société. Se plaçant au cœur de la période mecquoise, l’auteur esquive l’essentiel de son contenu, dont la violence des marchands mecquois contre le discours du Prophète qui les interroge dans la sphère publique. À l’heure de la thèse du séparatisme, la correspondance entre le propos de l’historien et celui de l’époque où il évolue est limpide[16].
Les premières sourates sur lesquelles s’appuie Moezzi sont pourtant celles qui affirment le plus nettement l’injustice de la société mecquoise, ce dont témoignent toutes les biographies modernes de la geste prophétique – y compris non apologétiques. Le paiement de la zakât, le partage de la nourriture, la défense des démunis, celle des femmes, le respect des liens de solidarité, qui aboutiront à Médine – ville idéale d’une longue tradition islamique – à l’interdiction de l’usure, tout cela est au cœur du conflit qui oppose Muhammad à l’élite mecquoise. Mais Moezzi n’en a cure : il s’agit de faire du Prophète de l’islam la figure d’un propos spiritualiste, piétiste et désincarné.
Cette oblitération est à nouveau en partage entre la tradition ressaisie par les Omeyades et l’école hypercritique. Lors de la période mecquoise, le puissant clan d’Abu Sufyan ibn Harb et Uqba ibn Abi Mu’ayt, l’un et l’autre prédécesseurs de la dynastie omeyyade – Muawiya est le fils d’Abu Sufyan – est au cœur du conflit qui oppose les premiers musulmans à l’élite des Quraych. Aussi le fait que le thème de la justice soit présent dans le Coran que dans la tradition subséquente semble une conséquence évidente de la prise de pouvoir des Omeyyades – après leur conversion tardive à la nouvelle religion de Muhammad. Une nouvelle fois, les raisons qui poussent Moezzi à ne pas relever ce point aveugle de la tradition sont apparentes. En sus de la volonté patente de dépolitiser l’islam, il s’agit de sauver la tradition post-omeyyade face au Coran. Cette dernière velléité est également apparente dans le rabattement qu’opère Moezzi du djihad aux conquêtes militaires de l’Empire musulman ; dans le Coran, le djihad est pourtant une réponse – proportionnée – à la persécution et à l’injustice, et non le geste d’expansion qu’affirment à l’unisson la tradition omeyyade et Moezzi.
S’il faut conduire la critique de l’écriture de l’histoire, le lien consubstantiel de l’historiographie française et de l’impératif de la laïcité, qui vise à prévenir l’intervention des discours simultanément religieux et critiques dans la vie publique, explique les propositions historiques de l’école hypercritique française, laquelle nie à l’Islam son rôle social de critique des injustices. Cette posture est inscrite dans une longue filiation orientaliste et de science française des religions née à la fin du XIXème siècle – la figure d’Ernest Renan en est caractéristique –, que caractérise son rejet tout à la fois des monothéismes, du socialisme et des Lumières telles qu’entendues par la Révolution française (cadre pourtant toujours proclamé mais constamment remanié de notre République).
L’islamologie française aime les Omeyyades. Une affinité élective parait entre l’Empire musulman en cours de stabilisation et la position laïque qui vise à prévenir tout potentiel critique de la religion – y compris dans ses sources historiques. Elle est réalisée par l’effacement parachevé des aspirations profondes de justice et de solidarité qui accompagnent la révélation islamique. On pourra s’étonner qu’un courant semblant si fortement positiviste dans son approche ne propose que de la spéculation fondée sur elle même, relisant à sa guise et selon sa propre herméneutique les données disponibles. Nous laissons le lecteur estimer à quel point il s’oppose de façon progressiste à la tradition.
[1] Crone, Patricia. “Quraysh and the Roman Army: Making Sense of the Meccan Leather Trade.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 70, no. 1, 2007, pp. 63–88.
[2] Déroche, François. La Voix et le Calame : les chemins de la canonisation du Coran, Paris, Fayard, 2016 ; Déroche, François. Le Coran, une histoire plurielle. Essai sur la formation du texte coranique, Paris, Seuil, 2019.
[3] Voir par exemple https://www.youtube.com/watch?v=HuwRmxzowqw
[4] En ajoutant ainsi les signes diacritiques. Voir Gilliot, Claude. « Origines et fixation du texte coranique », Études, vol. 409, no. 12, 2008, pp. 643-652.
[5] Ceux-ci, longtemps opposés à l’islam, sont la partie la plus riche du clan des Quraych.
[6] https://oumma.com/le-capitalisme-mecquois-et-la-revolution-de-lislam-1-2/ ; Wolf, The Social Organization of Mecca and the Orgins of Islam, et Ibrahim, « Social and Economic Conditons in Pre-Islamic Mecca », International Journal of Middle East Studies, dont le livre, Merchant Capital and Islam, est le fil conducteur de l’article sur Oumma. Voir également http://collectif-attariq.net/wp/hilf-al-fudul/
[7]Sadeghi, B., Goudarzi, M., Ṣan‘ā’ 1 and the Origins of the Qur’ān. Rappelons que l’on parle de mushafs – ouvrage physique – complet possédés par les compagnons, qui manquent de variation significatives hormis celles évoquées plus haut. A ce propos, il aurait pu être intéressant de rappeler l’effort majeur de la première communauté musulmane, qui enseigne à ses membres la lecture et l’écriture. Ainsi, à Dar al-Suffa, annexe de la mosquée de Médine où les compagnons apprennent la récitation du Coran, ils apprennent aussi à l’écrire.
[8] Christoph Luxemberg, philologue amateur chrétien libanais publiant sous pseudonyme, est à l’origine d’une réinterprétation totale du Coran – et notamment de ses passages les plus esotériques – à la lumière de sa source syriaque réputée. Il a reçu un écho globalement favorable au sein de l’école hypercritique (même si Patricia Crone en reconnaissait « l’amateurisme ») et, à l’inverse, très négatif au sein du champ plus large des études du Coran. Voir Herbert Berg, « Islamic Origins and the Qur’an », The Oxford Handbook of Qur'anic Studies, 2020, p. 57.
[9] Pour une lecture érudite des références coraniques aux révélations précédentes, lire :
– Emran El Badawe, “The Qur’an and the Aramaic Gospel Traditions” (Routledge, 2013), la seule introduction vaut bibliographie sur le sujet.
– Holger Zellentin, The Qurʾān’s Legal Culture: The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013), ainsi que ses écrits disponibles en ligne.
– Catherine Pennaccio, Les emprunts à l’hébreu et au judéo-araméen dans le Coran, Collection « Itinéraire poétique, Itinéraire critique », Librairie d’Amérique et d’Orient, Jean Maisonneuve, Paris, 2014.
[10] Le canon éthiopien contient des textes anciens et apocryphes dont le rapport au Coran est manifeste. On peut ainsi mentionner des versions eunomiennes de la Didachè et de la constitution apostoloique, des livres d’Enoch, Esdras et des Jubilés etc. Les pratiques de l’Église éthiopienne témoignent également d’une forte proximité aux pratiques rituelles de l’islam, tant s’agissant des ablutions, des interdits alimentaires que du voile. L’impasse historiographique sur ce sujet est incompréhensible.
[11] Ce monothéisme diffus à la veille de la révélation islamique était déjà iconoclaste comme le montre l’histoire de Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète Muhammad.
[12] En particulier dans la préservation des liens sociaux et familiaux, malgré le rejet monothéiste du culte des ancêtres, également présent dans le Coran. Pour l’importance de l’Islam comme survivance des pratiques bédouines pour les tribus qui rejoignent le mouvement, voir Demichelis, Marco. (2014). Kharijites and Qarmatians: Islamic Pre-Democratic Thought, a Political-Theological Analysis.
[13]Ray Pritz, Nazarene Jewish Christianity: From the End of the New Testament Period Until Its Disappearance in the Fourth Century, Brill Archive, 1988
[14] Voir à ce titre l’ouvrage de Mohammad Abed al-Jabri, Introduction à la lecture du Coran (en arabe, non traduit en français).
[15] Notons que cette condamnation vise tout autant le monothéisme primordial que le socialisme et la pensée des Lumières telle qu’envisagée par la Révolution française. Cette période qui marque durablement les préjugés à l’égard des peuples orientaux – dont Ernest Renan est sans doute l’exemple le plus fameux – est paradoxalement marquée par son opposition au rationalisme. On trouvera une critique magistrale de l’irrationalisme dans l’ouvrage de Lukács, La destruction de la raison. Voir l’excellente recension de Nicolas Tertulien, La destruction de la raison trente ans après. Les auteurs pointés par Lukacs pour leur irrationalisme sont aussi parmi les plus virulents opposants du monothéisme et des restes « judéo-chrétiens » dans notre civilisation, à savoir Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. Toute opposition au monothéisme n’est donc pas rationaliste par essence.
[16] On notera la réception extrêmement élogieuse que réserve un média pamphlétaire d’extrême-droite au Coran des historiens. Les auteurs ne sont pas responsables de la réception de leur propos – d’autant qu’il est probable que cette réception se fasse sans lecture de l’ouvrage –, mais il est néanmoins frappant de constater la correspondance – même à leur corps défendant – entre leur production intellectuelle et l’air du temps dans laquelle elle s’inscrit de facto.

