Zahiye Kundos
Commencements, appartenances et anxiétés politiques
The lives of two mob hit men, a boxer, a gangster's wife, and a pair of diner bandits intertwine in four tales of violence and redemption.
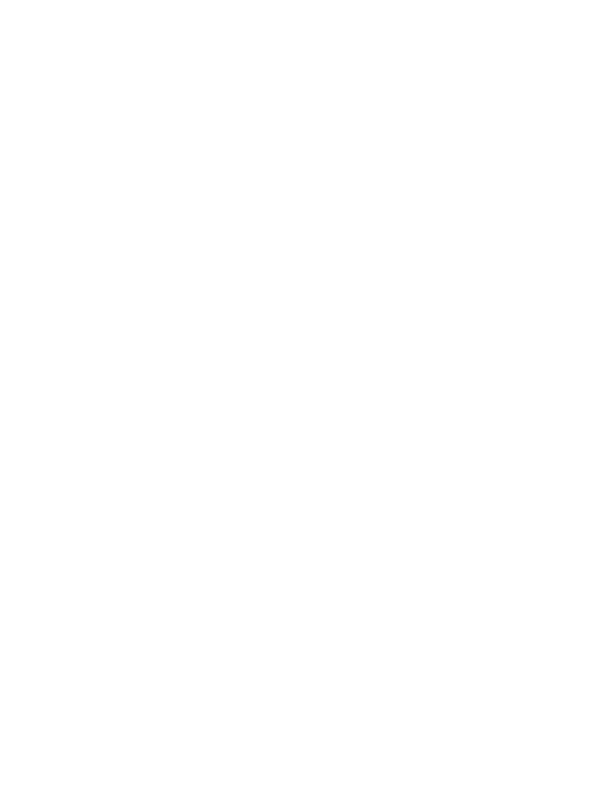
Jusqu'à mon entrée à l'université, j'ai ressenti un sentiment naturel d'appartenance à ma ville natale, Jaffa - ﻳﺎﻓﺎ (Yafa en arabe), et à l'histoire de mon pays, la Palestine ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ (Falastin). Ce sentiment d'appartenance était indissociable de l'expérience de ma vie sous le regard de Dieu. Ville, terre, et Dieu occupaient le même espace et le même temps j'ai vécu une vie théologique. Se rassembler pour la prière du soir avec ma mère, ʿAysheh Abu Dayyeh, mes frères Islam et Muhammad, et mes sœurs Huda et Duʿāʾ - tous en ligne droite derrière la voix priante de mon père, Hassan Kundos - était le rituel quotidien qui nous réunissait tous.
Dans ces réunions familiales consacrées à notre relation avec Dieu, chacun d'entre nous disposait d'un espace personnel où, pendant les derniers instants de la prière, nous nous inclinions et prononcions nos prières privées dans les chuchotements du cœur. En arrière-plan, la télévision égyptienne diffusait en sourdine de la musique classique ou contemporaine, les informations ou un film égyptien auquel on nous disait que nous pourrions revenir après les prières, pour continuer à regarder, les yeux rougis, sans cesser d'exprimer et d'échanger nos pensées. Souvent, nous ne voyions pas la fin du film : c'est à ce moment-là que nous devions vider le salon pour faire de la place aux visiteurs qui passaient furtivement, à tout moment de la journée, pour diriger leurs chuchotements vers mon père.
Dans notre petit appartement du troisième étage du 5, rue Midrash Pinchas, un jeune couple arrivait secrètement, une femme et un homme issus de classes sociales différentes, pour demander à mon père de convaincre leurs parents de la légitimité de leur amour ; une veuve qui avait besoin d'aide pour acheter des livres pour la nouvelle année scolaire de ses enfants ; un trafiquant de drogue - un criminel à l'âme torturée dont la mère défunte ne lui avait pas pardonné sa transgression - à qui mon père demandait maintenant de soutenir la famille de la veuve susmentionnée ; un mari qui s'était disputé avec sa femme et qui avait besoin de conseils sur la manière de l'apaiser - des requêtes quotidiennes de femmes et d'hommes à la recherche d'un cheikh alternatif à ceux des mosquées. Mon père partageait avec ses visiteurs son point de vue religieux, qui correspondait à ce qu'ils venaient entendre : parfois, les voies de Dieu sont mystérieuses et peu claires pour nos yeux ordinaires, mais il voit dans le cœur de chaque personne. Son amour pour ses créatures l'emporte sur l'amour de leur propre mère.
D'autres visiteurs : une travailleuse du sexe, à qui mon père a donné les vingt derniers shekels de notre famille ; un étudiant en philosophie perturbé qui est venu chercher un moyen de réconcilier ce qu'il apprenait à l'université avec les sentiments religieux dans lesquels il avait été élevé ; un ami imam qui est venu pour préparer ses sermons du vendredi à la mosquée ; des amis dans la cinquantaine qui voulaient apprendre à lire et à écrire pour pouvoir consulter le Qurʾān tout seuls ; et une longue série de connaissance qui sont simplement venus prendre une tasse de café et ont discuté avec lui de la politique et de la religion dans le monde arabe et du destin de l'islam.
Les adieux traditionnels et les bénédictions accompagnaient chacun d'entre eux à leur départ, prononcés de sa voix puissante qui faisait trembler les marches de l'ancien bâtiment dans lequel nous vivions. Ces rencontres enlevaient une lourde charge de la poitrine des visiteurs, donnant par la même occasion à mon père avec de nouvelles demandes à remplir. Lorsque le bruit de leurs pas disparaissait dans les méandres de la cage d'escalier, mon père entrait dans la chambre des enfants, le visage doux et radieux, pour déclarer que la voie était libre et que nous pouvions à nouveau nous réunir dans le salon.
Après minuit, lorsque nous étions tous allés nous coucher et que les coups à la porte de notre appartement se faisaient plus rares, il avait l'air le plus heureux. Il s'enfonçait dans son vieux fauteuil en soupirant, le Qurʾān d'un côté, une cruche de café et deux paquets de Rothmans Filter de l'’autre. Ils lui permettraient de tenir jusqu'au bout, alors qu'il commençait à corriger, à affiner et à ajouter des commentaires, des idées et des questions à son petit paquet de documents bien organisés.
Au fil des ans, mon père est devenu publiquement connu comme ustaz Hassan, un professeur d'arabe dans les écoles élémentaires. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a continué d'être l'unique muchtar de la ville, modérant les conflits communautaires. Moi, son aînée, je suis entrée dans l'adolescence et j'ai fait l’épreuve de crises de croyance régulière. Je me suis interrogée sur le sens de la justice divine face au flot constant de personnes défavorisées et misérables qui visitaient notre maison, ou j'ai été scandalisée par le fait que les aspirations et les besoins économiques de ma famille n'étaient pas pris en compte. Si les portes du paradis ne s'ouvraient pas à mes parents, peut-être n'étaient-elles qu'une histoire, une fiction, pour apaiser ceux qui étaient prêts à croire.
J'ai été éduquée dans le système scolaire arabe israélien public, où certains élèves allaient à l'école sans sandwich pour le déjeuner et abandonnaient l'idée d'essayer de déchiffrer l'alphabet arabe lorsqu'ils arrivaient au collège. C'est à ce moment-là qu'a commencé à naître en moi le désir d'entrer en contact avec des lecteurs de lettres arabes mieux lotis socialement. Au milieu des années 1990, les lycéens qui rentraient chez eux se croisaient dans la rue principale de Yafa. Je jetais des coups d'œil envieux aux filles des écoles privées comme le Collège des Frères (franco-catholique) et Tabeetha (Église d'Écosse), captivée par leur grâce et leur confiance en elles-mêmes alors qu'elles déambulaient dans la rue sans gêne aucune, dans leurs jeans Levi's authentiques, leurs chaussures Adidas et Nike, leurs cheveux lisses et clairs tombant abondamment sur leurs épaules ; enchantée par les sons de leur mélange de langues étrangères - le français et l'anglais.
Mes amies et moi, en revanche, avions des cheveux foncés et bouclés que nous ne savions pas arranger de manière flatteuse, alors nous tirions fermement sur notre cuir chevelu. Nos camarades de classe et nous-mêmes portions des vêtements amples pour cacher nos seins d'adolescentes, de faux jeans Levi's et des baskets Reebok. Nous nous précipitions dans la rue et rampions à travers les clôtures pour rentrer chez nous. Le français et l'anglais ne se fondaient pas dans notre jargon yafan, caractéristique de la plaine centrale du pays, qui passe facilement des deux langues locales, l'arabe et l'hébreu, et qui n'a pas d'attrait pour l'étranger. La plus rebelle de mes amies admirait Madonna et s’était teint les cheveux en blond. Mais Madonna n'a pas aidé mon amie à marcher plus gracieusement dans la rue. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir l'intention d'aller à l'université. J'ai réalisé qu'une éducation supérieure pourrait être l'occasion d'arrêter de regarder ces filles élégantes et modernes qui se coiffaient sans peine le matin, et de devenir moderne moi-même.
Au début de la seconde Intifada, en octobre 2000, j'ai commencé mes études de premier cycle à l'Université hébraïque de Jérusalem. Les étudiants palestiniens étaient absents des amphithéâtres et des salles de séminaire. Au lieu de cela, nous nous tenions à l'entrée principale du campus, protestant contre l'utilisation de balles réelles contre les manifestants palestiniens, qui avaient tué treize personnes, toutes des citoyens israéliens. Le visage blanc et pâle de l'une des étudiantes, tenant la photo de son frère adolescent mort, a été gravé dans la conscience de ma génération. Ces années ont été marquées par le bruit des sirènes et les effets des gaz lacrymogènes utilisés contre les manifestants, par les nouvelles sur Al-Qaïda et l'effondrement des tours jumelles à New York, par l'assassinat en 2001 de Rehavam Ze'evi, ministre israélien de la Défense, par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) à l'hôtel Hyatt, juste à côté des résidences étudiantes de l'université, le siège de Yasser ʿArafat à l'adresse Muqataʿa à Ramallah, qui a conduit à sa mort dramatique en 2004. Tels ont autant d'événements qui ont façonné le caractère et l'évolution de la personnalité d'une jeune étudiante palestinienne originaire de Yafa. Ce sont ces événements qui ont façonné le caractère et l'évolution d'un jeune étudiant palestinien de Yafa, ainsi que la propre transformation souvent douloureuse de sa subjectivité.
À l'époque, la plupart des étudiants palestiniens arrivaient d'endroits comme Nazareth, Haïfa, Kufur Qarʿ et Um al-Fahim dans des bus affrétés, et ils étaient rejoints par des étudiants de Yafa et de ses villes voisines, al-Lidd et Ramle, qui arrivaient par les transports publics, au compte-goutte, par leurs propres moyens, comme moi. Les activités culturelles et les relations interpersonnelles, comme l'amitié et l'amour, se sont développées en grande partie autour des opnions et affiliations politiques.
Sur le campus, il semblait y avoir trois groupes nationalistes palestiniens différents, dont l'un m'a semblé devoir être choisi et rejoint. Appelons le premier groupe les nationalistes religieux. Les nationalistes religieux, hommes et femmes, parcouraient les allées du campus aussi vite que possible. On n'entendait pas leur voix à la cafétéria, sur les pelouses ou dans les résidences universitaires. Lorsqu'ils organisaient des événements culturels, ils ne faisaient circuler l'information qu'entre eux. Ils dressaient autour d'eux des murs invisibles mais solides, empêchant de voir ce qui se passait à l'intérieur de leurs assemblés. À mon avis, il n’est pas clair si ces murs étaient choisis consciemment ou s'ils étaient des réactions involontaires. Parfois, il semblait que le manque de visibilité était le résultat d'une faiblesse, intellectuelle ou émotionnelle, le résultat de la difficulté à présenter leur point de vue de manière claire et confidente à la fois au sein de la communauté étudiante palestienne et de la majorité israélo-juive sur le campus. À d'autres moments, il semblait que leur retrait de tout et de tous ceux qui ne leur ressemblaient pas était un mécanisme de défense contre la distance sociale et les critiques qu'ils subissaient de la part d'autres groupes. Et en effet, cette critique qu'ils ressentaient n'était pas le produit de leur imagination la plus intime, une sorte d'illusion paranoïaque. De nombreuses personnes sur le campus ont perçu le nationalisme religieux comme une sorte de mutation que les religieux ont inventée en s'attelant au projet national arabe.
Un deuxième groupe, appelons-le nationalistes conservateurs, était beaucoup plus important que le groupe nationaliste religieux. Ses membres participaient à des manifestations, circulaient librement dans les couloirs des différentes facultés et organisaient des événements musicaux dans les dortoirs. Mais ils étaient passifs, voyant la réalité comme un donné naturel et statique qui ne permettait ni n'exigeait de changement. Loin de l'encadrement familial dans lequel ils sont nés et du regard de la société dans laquelle ils ont été éduqués, beaucoup d'étudiants nationalistes conservateurs, en particulier les jeunes femmes, ont vu un potentiel d'exercice des libertés individuelles. Pour la plupart d'entre eux, ce potentiel n'a pas été exploité. Les femmes avaient tendance à vivre dans le calme pour éviter les aventures indésirables liées à la drogue, à l'alcool et au sexe. L'exercice effectif de ces libertés aurait attiré l'attention et déclenché des rumeurs mettant en péril cette étroite fenêtre d’indépendance à l'université, qui, une fois le diplôme obtenu, se refermerait rapidement avec le retour à la maison et la recherche d'un partenaire.
Un troisième groupe, qu’on pourrait appeler les nationalistes laïques, a adopté des apparences occidentales. Ils me rappelaient les élèves des lycées de Frères et Tabeetha que j'enviais - élégants, occupant avec aisance les espaces communautaires, ne se cachant pas et ne cherchant pas à obtenir la permission des suzerains juifs. Les nationalistes laïques m'ont semblé plus vivants intellectuellement que les autres groupes. J'ai été séduite par l'éclat de leurs yeux qui brillaient d'indépendance et de liberté personnelle, ainsi que par leur engagement et leur détermination à changer la structure générale, sociale, économique et politique dans laquelle ils vivaient. Ils jouaient un rôle de premier plan dans les activités des cellules politiques du campus, participaient régulièrement aux manifestations au poste de contrôle de Qalandia, à l'entrée de Ramallah, et dans les cercles intellectuels radicaux de la ville, et passaient leurs soirées à parler de politique dans les bars. Ils n'étaient pas d'accord entre eux sur une orientation politique unique et se divisaient principalement entre socialistes et libéraux. Cependant, ils partageaient tous une perspective laïque détachée des chaînes de la tradition et ils remettaient en question toutes les normes, en particulier lorsqu'elles étaient religieuses.
C'est ainsi qu'à cette époque de ma vie, alors qu'il me semblait que je me devais d’appartenir à l’un de ces trois groupes, que le choix du groupe national à rejoindre s'est avéré intuitif et immédiat. Entre les étudiants religieux et fantomatiques qui se fermaient au monde, les conservateurs qui adhéraient aux règles toutes faites et n'avaient aucune volonté de changement, et les laïcs qui semblaient audacieux et révolutionnaires, j'ai opté pour ces derniers.
Et l’effet n'a pas tardé à se faire sentir. Pendant les années où je suis devenue une activiste nationaliste laïque sur le campus, les crises de foi que j'avais connues auparavant, à la maison, sont devenues plus fréquentes et ont mis plus de temps à s'estomper. Elles ont également pris un sens différent. Si, jusqu'à l'âge de 19 ans, l’arrière-plan de mes crises spirituelles était social et économique, dans ma nouvelle vie indépendante, elles ont pris des dimensions scientifiques, culturelles et politiques. Les relations jadis symbiotiques, à la fois spatiales et temporelles, entre ce monde terrestre et le royaume de Dieu, sont devenues tendues et marquées par l’inconciliabilité, exigeant une séparation et une dissociation rapides. Des brûlures sont apparues dans mon identité religieuse. La perturbation soudaine de mon rythme cosmique – ressentie en grande partie dans la prière de mon enfance – m'a fait mal aux bras et je me suis sentie soumise à une force que je ne pouvais ni identifier ni nommer et à laquelle je ne pouvais donc ni m'opposer, ni réagir.
Pour comprendre la sécularisation nationale que je me suis imposée, il faut examiner plusieurs configurations sociales d’importance. Pour certains laïcs palestiniens, la laïcité semblait faire partie d'un tissu complexe de relations implicites entre une existence bourgeoise plus laïque et plus aisée et une classe plus religieuse dans le centre et le sud du pays ; entre une classe patriotique éduquée et une classe ouvrière, illettrée et indifférente au sort d’al-watan, la patrie palestinienne ; entre l'esprit de progrès, le libéralisme et le féminisme et l’archaïsme de la tradition religieuse et patriarcale. L'appartenance à Yafa avait des implications claires dans ce contexte. Même si la ville est géographiquement située au centre du pays et est une source de fierté pour les résidents locaux et les réfugiés qui s’y sont dirigés, elle et ses habitants ont subi une provincialisation dans le tissu social intra-palestinien. Dans la conscience palestinienne générale du vingt-et-unième siècle, Yafa était considérée comme un vestige délabré de la société palestinienne, un lieu mal famé où régnaient la pauvreté, la criminalité et la drogue. Reflétant seulement une petite partie de ce qu’est Yaffa, ces perceptions ont engendré des préjugés et du dédain à l'égard de ses habitants, ainsi que des habitants plus pauvres et moins éduqués d'al-Lidd et de Ramle.
Mais la pauvreté, la criminalité et la drogue n'étaient pas une invention. Dans les années 1980, la première décennie de ma vie, les toxicomanes étaient monnaie courante dans les rues, de même que les dealers pour qui le mot ﺳﺠﻦ (sijn), prison, était devenu interchangeable avec le mot ﺩﺍﺭ (dār), maison. Depuis que je suis née - et cela n'a jamais cessé depuis -, je me souviens de tant de mères dont les fils ont été assassinés dans des guerres de gangs locaux. J'ai grandi en voyant des camarades de classe, des enfants ordinaires, calmes et discrets, se transformer en chefs de mafia professionnels. J'ai vu des personnes vivantes se transformer en cadavres, aboutir à l'institut médico-légal voisin et rester trop longtemps à la morgue ; des morts, le temps s'écoulant avec effroi tandis que les mères en deuil attendaient le dernier retour de leur fils à la maison ; l'arrivée des morts récents, enveloppés dans des draps blancs avec de l'ouate pour fermer tous les orifices. J'ai essayé de soutenir une sœur qui devait dire adieu à son frère, et je me souviens du nombre de personnes qu'il a fallu pour tenir son corps agité et frénétique afin que le médecin puisse lui administrer un tranquillisant ; les chuchotements sur les organes volés, prélevés sans l'autorisation des familles ; la longue file de femmes et d'hommes qui attendaient pour déposer un dernier baiser sur les joues froides ; le cercueil qui partait vers le cimetière, porté sur les épaules des hommes ; les femmes qui pleuraient leur propre perte imminente ; j'ai regardé les hommes assis sans rien faire dans la tente des pleureuses, leurs yeux reflétant des pensées de vengeance ; j'ai vu les feux d’artifice jubilatoires provenant des maisons des meurtriers. Et finalement, le muezzin annonçant le nom du défunt, ainsi que son appel à se joindre à la cérémonie funéraire et la récitation du Qurāʾn pour marquer le début de la période de deuil.
Cette partie sanglante de l'histoire de Yafa est réelle. Dans cette ville, le crime est une sorte de langage alternatif. Ce qui ne peut être exprimé par des mots se transforme en un acte violent commis par les mains. La jeune génération enfreint la loi pour ne plus avoir peur de la loi. Il n'y a pas de contradiction entre le fait que ces crimes soient dirigés contre eux-mêmes, contre ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭﻻﺩ (awlad al-balad), les enfants de la terre, la jeune génération, et qu'il s'agisse d'un cri contre la pauvreté, contre la marginalisation sociale, contre l'exclusion et la racisation causées par le régime israélien. Les tragédies grecques classiques, d'Œdipe roi de Sophocle au Médée d'Euripide, sont rejouées dans ces histoires, dans toute la région, dans la vie du Tunisien Muhammad Buʾazizi, qui s'est immolé en guise de protestation, déclenchant des vagues d'indignation massive dans le monde arabe. Le désespoir et l'auto-flagellation, nous le voyons, peuvent être interprété comme un langage d'opposition.
Mais cela ne change rien au fait que la réalité criminelle perpétuée depuis les années 1970 a affaibli les lumières de Yafa, la ville qui, pendant des milliers d'années, a servi de lieu de rencontre entre les civilisations anciennes et, plus récemment, de centre culturel et commercial de la région. D'une part, la tournure tragique du destin des habitants de la ville n'a pas modifié la perception nostalgique des Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et des Yafans qui ont été contraints à l'exil. De l’autre, pour la plupart des Palestiniens vivant sous le régime israélien, le passé de Yafa s'est transformé en un mythe qui ne confère ni honneur ni respect à sa population actuelle. La tragédie de la ville est parfois inconsidérément attribuée à la nature criminelle de ses habitants, les communautés palestiniennes d’autres villes et villages ignorant simplement la réalité sociohistorique et politique de sa configuration singulière. Dans ces autres communautés, il a été possible, à la suite de la Nakba, de maintenir une relative continuité - sur le plan social, économique, culturel et s’agissant des autorités politiques.
Une fille de Yafan qui pénétrait de son propre chef dans l'espace intellectuel et bourgeois, dans ce contexte d’image sociale et corrompue ; une fille qui, en plus d'utiliser la pensée théologique, disons, dans des discussions philosophiques, était forcément associée à un discours et à des pratiques rétrogrades considérés comme faisant obstacle aux aspirations palestiniennes, tant individuelles que collectives, à la libération de l'occupation et à un progrès éclairé. Dans certains cercles palestiniens, on m'a demandé, à moi et aux gens comme moi, de me séculariser. Il ne s'agissait pas d'un appel explicite. La sécularisation-nationalisation s'inscrivait dans un esprit général, ne se limitant pas à une langue, une grammaire ou un projet particulier. Mais elle utilisait des mécanismes tels que la manipulation psychologique et l'exclusion silencieuse, et s'appuyait sur une provincialisation intellectuelle de l'histoire islamique.
L'Islam - non seulement en tant que foi mais aussi en tant que civilisation d’importance - a été rejeté d'emblée par les gardiens du projet de nationalisation laïque. Ils ne considéraient pas la civilisation islamique comme un élément essentiel de l'histoire culturelle, comme une composante précieuse de l'appartenance, de l'identité et de la langue, comme une méthode pour la théorie et la critique. L'amoncellement de destructions et de ruines à la suite de deux guerres mondiales catastrophiques, la mise en évidence, notamment par les travaux d'Edward Said et la recherche postcoloniale dans les contextes israélien et palestinien, des affinités calamiteuses entre les Lumières, l'orientalisme et le colonialisme, n'ont pas, dans l'ensemble, suscité la méfiance. Aucune de ces critiques récentes n'a conduit à reconsidérer le le nationalisme sécularisé comme meilleure solution possible pour un avenir politique et culturel palestinien. Dans mes allées et venues entre la bibliothèque centrale de l'université sur le mont Scopus et la prestigieuse bibliothèque al-Shurūk de Ramallah - deux espaces géographiquement voisins divisés par une barrière nationale et séparés par la fumée et le béton - j'ai découvert le langage séculier-nationaliste qui passe tranquillement entre les deux villes, palestinienne et israélienne, libre et non entravé par les frontières.
C'est tout naturellement que, désireuse de devenir une femme progressiste et libre et espérant réaliser le rêve d'une Palestine libre, j'ai changé mon mode de vie. J'ai eu honte de ma foi en Dieu, j'ai rompu le lien qui unissait mon monde au sien et j'ai caché mon tapis de prière au fond de mon placard à la résidence universitaire. Je me suis séparée de Dieu, déconnectant mon corps de mon âme. La lumière s'est transformée en obscurité et l'obscurité en lumière - j'apparaissais puis disparaissais. Lorsque j'ai revêtu l'habit séculier, mes connaissances dans ma ville natale m'ont accusé de devenir ashkénaze, d'imiter la classe localement la plus privilégiée des Juifs européens. Parmi les Palestiniens conservateurs du campus, j'étais considérée comme une apostat ; dans les cercles laïques, j'étais perçue comme quelqu'un souffrant d'instabilité émotionnelle et comportementale. Mes pairs conservateurs et laïques étaient d'accord pour dire que cette fille devait vivre quelque chose de grave.
La rupture avec la religion s'est accompagnée d'une rupture avec la langue de ma ville. Indépendamment des différences idéologiques, et contrairement à ce à quoi j'étais habituée à Yafa, la plupart des étudiants que j'ai rencontrés sur le campus évitaient de mêler d'autres langues à leur discours. Ils parlaient l'arabe, rien que l'arabe. Cette performance monotone, fluide et riche renforçait ma fierté de l'arabité dans laquelle j'avais été élevée, mais était étrange pour l'oreille plus composite que j'avais développée, étrangère au yafan que je parlais - une troisième langue composée à la fois de l'arabe et de l’hébreu. Dans l'arabe de Jérusalem-Est, Ramallah et Bethléem, l'hébreu n'apparaît pas (à l'exception du vocabulaire utilisé aux points de contrôle militaires).
Dans ces villes palestiniennes, l'arabe n'était pas seulement une langue parlée. Il était manifeste sur les anciens bâtiments encore debout ; ses lettres ornaient les enseignes des ateliers de réparation de pneus, des boulangeries, des épiceries, des écoles, des centres culturels et des cliniques médicales. Sa voix résonnait dans l'air, rendant l'asphalte rugueux. Elle englobe tout. Mon premier contact avec cet arabe public m'a coupé le souffle. J'ai eu l'impression qu'un organe manquant, dont j'ignorais l'existence, était restitué à mon corps.
Selon certains Palestiniens, le langage des Yafans reflète un état d'esprit confus, ne crise d'identité permanente. Elle révèle la rupture du sentiment national et de l'appartenance de ses locuteurs. Certains affirment qu'elle témoigne d'une assimilation dans les rangs de la majorité israélo-sioniste, montrant même que nous sommes devenus une cinquième colonne au service des forces de l'occupation. Des jugements forts, extrêmes et sans pitié. Coupable de trahison. J’étais blessée, mais j’ai su en tirer les bonnes leçons. J'ai ouvert les yeux sur le danger d'extinction qui menaçait la langue arabe. J'ai compris à quel point il était essentiel de la préserver et j’ai répondu à l’appel, de mon plein gré, à me convertir à l'arabe pur. J'ai détaché l'arabe de l'hébreu avec lequel il s'était mélangé - un détachement qui, politiquement et culturellement, semblait approprié et juste. J'ai nettoyé ma bouche et j'ai adopté avec bonheur des mots en arabe dialectal que je ne connaissais jusqu'alors qu'en arabe littéraire, ou en hébreu.
Tout comme lorsque j'ai cessé de converser avec Dieu, ma conversion linguistique a laissé des traces. Lors de mes fréquentes visites de fin de semaine dans ma ville natale, ma nouvelle langue me valait parfois des points bonus : des patriotes locaux éduqués me tapaient dans le dos, étonnés de cette réussite impressionnante qu'ils étaient les seuls à pouvoir apprécier. Mais le prix à payer était parfois élevé. Pour une grande partie de la classe ouvrière et des petits commerçants, je suis devenu une étrangère lorsqu'ils ont cessé de m'identifier comme une locale à cause de l'hébreu qui avait disparu de mon arabe. Mon arabe pur me rendait plus palestinienne, mais, d'une certaine manière, moins yafane. Cette affaiblissement de mon identité locale yafane - qui m'a complètement surprise - a eu des implications importantes. Elle m'a permis d'oser reconsidérer le fil intuitif qui lie si mécaniquement l'appartenance collective et la langue pure, c'est-à-dire de poser des questions sur l'une des hypothèses les plus fondamentales du nationalisme en général et du nationalisme palestinien en particulier. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque j'ai nettoyé les taches de mes vêtements et que j'ai libéré de l'espace en moi pour comprendre les besoins quotidiens des gens, les besoins quotidiens de mes gens, que j'ai commencé à y réfléchir, à ma langue, à mon moi endommagé. D'abord, on nettoie l’impureté, puis on y réfléchit.
Repenser les relations enchevêtrées entre l'identité, l'objet d'appartenance et la langue m’a conduite à une nouvelle réflexion autour de la Nakba. J'ai commencé à me demander si le récit monolithique de la Nakba ne brouillait pas en fait les nuances et les parcours multiples des nombreuses Nakbas vécues par des gens différents dans toute la Palestine ; que tout cela avait eu tendance à former très rapidement un récit unique et fermé plutôt que de rester ouvert à une richesse d'histoires, d'événements et d’aspirations. De nombreuses rivières se jettent dans la grande mer, et elles ne serpentent pas dans les mêmes tours et détours.
La mienne est la troisième génération de la Nakba à Yafa, héritière naturelle d'un arbre qui s'est détaché de ses racines, laissant derrière lui un trou béant dans le sol. Les familles. Les commerçants. Les travailleurs. Les intellectuels. Le bruit a disparu et a laissé un vide. Le vide s'est rempli de blessures, et les blessures sont devenues tradition. Elles traversent le corps vivant, une croûte qui ne se referme pas, pour ne pas oublier. Il faut rester proche de la terre. Nous devons rester. Mais rester n'est pas facile. Et la mémoire n'est pas une scène romantique. Les plaies vivantes sont laides et s'enlaidissent avec le temps, de génération en génération, remplies de pus et dégageant la puanteur de la mort. Les morts ont besoin d'être enterrés, mais ces morts-là ne peuvent pas être enterrés. Et c'est dans le trou béant, révélé une fois les arbres coupés de leurs racines, que sont nés nos parents. Les poitrines auxquelles ils se sont accrochés n'ont pas produit de lait. Ils ont ouvert les yeux sur la poussière.
Et nous, ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻴﻞ (Gil al-mustakbal al-falastini), la génération de l’avenir palestinien, avons ouvert les yeux sur les Israéliens. Dans les hôpitaux, chez le coiffeur, dans les écoles, au centre communautaire, dans les parcs et chez l'épicier de la rue. Nous avons entendu leur hébreu et l'avons intégré à notre langue. Mais l'hébreu que nous parlons n'est pas celui de l'État israélien et il est différent de celui des Israéliens juifs. C'est, en quelque sorte, l'hébreu des Palestiniens. Il a une grammaire arabe, des erreurs d'écriture et d'orthographe, des connotations locales. Le yafan n'est ni de l'arabe pur, ni de l'hébreu correct. C'est précisément en cela qu'il sert de preuve orale de l'effacement de la population locale. Il marque la rupture coloniale en exposant le lien étroit entre la (non-)souveraineté culturelle et la (non-)souveraineté politique. Il démontre comment l'hébreu du souverain étrangle, écrase et exclut l'arabe, alors que de nombreux Yafans ont du mal à terminer ne serait-ce qu'une phrase en arabe sans recourir à l'hébreu pour exprimer un souhait, formuler une idée ou décrire un objet. Mais il remet également en question l'hébreu moderne en tant que langue monolithique du peuple juif, repousse ses limites et lui rappelle, littéralement, sa longue histoire de compagnonnage avec la civilisation arabe et islamique.
La langue de Yafa reflète également l'expérience de vie des Yafans aux côtés des Israéliens, qui a conduit les deux peuples à accepter non seulement qu'ils vivent au cœur du conflit, mais qu'ils peuvent en quelque sorte le gérer en fonction de leurs besoins et de leurs désirs propres. Le pouvoir de la routine, l’'instinct de la routine, est ce qui dirige le rythme de la vie dans les relations entre les deux groupes nationaux de la ville, et cela nécessite le déplacement des aiguilles de l'horloge vers l'avant ou vers l'arrière en fonction des développements en temps réel.
Naturellement, les fréquents bombardements de Gaza font reculer les mains, perturbent cette routine et la rendent plus difficile. Les destins de Gaza et de Yafa sont liés, car de nombreuses familles yafanaises, dont la mienne, vivent dans les camps de réfugiés de Gaza depuis qu'elles ont été contraintes à l'exil en 1948. Chaque bombardement de Gaza signifie un bombardement de Yafa, chaque soupir de soulagement des Gazaouis réjouit le cœur des Yafans.
La langue hybride des habitants palestiniens de la ville ne soulève pas seulement de nombreuses questions sur le lien entre une langue pure et le patriotisme, elle est également capable de bouleverser la logique. En raison de la Nakba particulière de Yafa - l'existence d'une minorité indigène qui a continué à vivre sur ses terres, détachée de son passé et incapable de s'associer au mode de vie des autres villages et villes palestiniens - la survie même de la langue arabe en tant que langue principale des jeunes de Yafa devrait à tout le moins susciter l'admiration. Elle est même honorable.
La langue yafan n'est certainement pas le simple produit du niveau notoirement bas de l'enseignement de l'arabe dans le médiocre système d'éducation publique arabe d'Israël. Outre le contexte susmentionné, la symbiose avec l'hébreu, la langue de la puissance dominante, peut être le résultat d'un choix inconscient de la part de la deuxième génération pour survivre au bouleversement de leur destin national au niveau de la langue également. En effet, ceux qui sont restés dans la ville avaient deux options : arracher la langue à ses racines, comme la plupart des habitants, ou la sauver, au prix d'un rattachement à la langue la plus forte, l'hébreu. L'histoire montre que nos parents, ces mêmes enfants qui sont nés dans le vide, et nous après eux, ont choisi de survivre. Ainsi, plutôt que de considérer la troisième langue, le yafan, comme un symbole d'assimilation à l'identité de l'autre, dont la langue domine la vôtre et la contrôle, j'en suis venue à la considérer comme une autre construction de l'identité, de l'évidence du libre choix à la nécessité sociale de la survie. De la sorte, le langage de Yafa ne reflète plus le rôle de victime mais devient une expression active de protestation, un corps qui tend la main sous les ruines de l'histoire.
En ce sens, si le régime israélien devait reconsidérer ses fondements et remplacer l'idéologie sioniste par une autre, basée sur l'appartenance commune à la terre et la justice pour les Palestiniens et les Juifs, alors la conversation en cours entre l'arabe et l'hébreu, plutôt que de simplement refléter la rupture induite par le colonialisme moderne, pourrait également servir à indiquer un avenir postcolonial. La réparation pour les deux nations ou la destruction des deux, ainsi que de leurs langues. Après tout, il n'y a pas de troisième option.
Aujourd'hui, malgré sa distance géographique au reste de la population palestinienne vivant sous le régime israélien, vous trouverez à Yafa des fractures qui parcourent toute la société palestinienne et bien au-delà, des fractures aussi profondes que le silence qui les entoure, entre ceux qui souscrivent à une vision du monde nationaliste religieuse et ceux qui choisissent une vision nationaliste laïque.
Une manifestation de cette tension peut être observée dans les foires du livre annuelles de Yafa. Lorsque les foires sont organisées par la partie religieuse, vous trouverez exposées les grandes exégèses canoniques du Qurʿan et la littérature des Hadiths, des manuels enseignant aux jeunes comment être de pieux musulmans, des livres illustrés pour enfants montrant la vie des prophètes, et des livres d'histoire, éventuellement une poignée de livres sur la philosophie islamique, dont tous s'accordent à dire qu'ils n'encouragent pas les doutes sur Dieu. En général, vous ne trouverez pas de fiction sur ces étals, qu'ils soient locaux ou transnationaux, car la littérature tend à être considérée comme une représentation séculière de la vie.
Un visiteur de la foire annuelle du livre organisée par un groupe laïc trouvera, en revanche, une multitude d'ouvrages sur l'histoire, la philosophie, des livres pédagogiques pour enfants, ainsi que de longues tables où s’empilent des livres de fiction. On y trouve rarement des livres sur l'histoire, la science, la politique ou l'économie islamiques, bien qu'il soit possible d'y trouver des livres critiquant la religion. Dans les deux foires, on trouvera invariablement quelques exemplaires d'ouvrages de développement personnel bon marché. Mais ces foires du livre annuelles peuvent être considérées comme un moyen sophistiqué et indirect de communication entre les deux populations, chacune essayant de prouver son raffinement culturel à elle-même et à l'autre, tout en renforçant son idéologie et sa routine quotidienne contre l'influence de l'autre.
Cette distance apparemment énorme et ce désaccord insoluble entre ces groupes ont des implications considérables pour le peuple palestinien dans son ensemble et deviennent particulièrement flagrantes lorsque Yafa organise des événements politiques. Les manifestations et les journées de commémoration à Yafa expriment le ressentiment local contre l'hostilité d'Israël à l'égard de la population palestinienne de la ville, avec ses tentatives incessantes de la déposséder de plus en plus de ce qui lui reste (par exemple, en transformant un ancien cimetière musulman en abri pour les pauvres ou une mosquée en musée). En même temps, ces événements collectifs nourrissent la compétition interne pour savoir qui est le plus patriote et le plus éclairé.
Lors de ces événements politiques, le groupe religieux, qui est toujours, sans exception, dirigé par un homme, clame "Allahu Akbar" et "Que la religion retrouve son aura perdue". Le sous-texte de ces slogans est que l'occupation israélienne est la preuve de la déviance de la société palestinienne par rapport à la religion et le message est qu'un retour à la religion apportera la libération (et le pardon de Dieu). Ces mots sont des insultes dirigées contre les parties laïques de la société, les rendant responsables de la situation calamiteuse. Pendant que cette manifestation se poursuit, son pendant laïque, souvent dirigé par une femme, commence ou se termine par l'hymne national palestinien, et les appels fréquents à la ﺣﺮﻳﺔ , la liberté, alternent entre des slogans pour l’émancipation de la terre et l'émancipation des femmes, avec un clin d'œil clair en direction du camp des hommes traditionnels, suggérant leur responsabilité historique dans la subjugation des femmes et ce que cela implique quant au destin et à la conquête de la terre.
Lorsque les deux groupes de manifestants se croiseront, les yeux de la femme laïque seront pleins de mépris à l'égard de l'homme religieux "arriéré" qui, en retour, dira silencieusement qu'elle est "dévergondée". Peut-être qu'une autre femme participant à la manifestation laïque relatera tranquillement que les agressions sexuelles qu'elle ne subit pas si rarement ne viennent pas de ces hommes religieux, mais plutôt de ces mêmes révolutionnaires laïques qui se tiennent juste derrière elle lors des manifestations et appellent à la liberté jour et nuit.
En général, cependant, les manifestations seront organisées à des jours différents et, si elles ont lieu le même jour et à la même heure, les groupes essaieront de maintenir une distance physique. Un groupe peut marcher derrière l'autre en veillant à ce que ni les mots ni les orateurs ne se mélangent. Paradoxalement, le souci mutuel de ne pas déranger l'autre facilite grandement la tâche de la police israélienne, qui peut alors disperser la foule pour "trouble à l'ordre public". Ce drame illustre de la manière la plus claire et la plus douloureuse qui soit que la question séculaire - qui sommes-nous, les Palestiniens ? - n'a pas été sérieusement traitée. Tant que les responsables religieux ne permettront pas que le texte religieux soit lu ici et maintenant, et tant qu'ils ne réaliseront pas la signification du verset "Il n'y a pas de contrainte en matière de foi", une telle réflexion ne pourra tout simplement pas avoir lieu. Une réflexion sérieuse sur l'identité des Palestiniens ne pourra avoir lieu tant que les dirigeants nationalistes laïques penseront que la tradition peut et doit être enterrée, que l'existence de longue date du religieux et du théologique dans l'appartenance sociale du peuple palestinien ne doit pas jouer un rôle significatif dans la planification de notre avenir.
De même que le "nous" théologique n'est exclusif à aucun groupe mais constitue un espace ouvert au mouvement et à l'interprétation, de même le "nous" moderne change de formes et de nuances parmi ceux qui sont religieux. Une jeune fille portant un short et des cheveux en bataille peut jeûner pendant le mois de Ramadan avec une grande sincérité, tout comme une jeune fille indépendante portant un voile peut nager dans l'océan et découvrir ses trésors. Le meilleur de l'homme, y compris la foi sincère en Dieu, n'est visible que pour Dieu, alors que le monde est ouvert à tous. Nous ferions mieux de nous abstenir d'interférer avec ce qui appartient à Dieu et de commencer, au contraire, à assumer la responsabilité de nos propres actions, que ce soit en tant qu'individus ou en tant que groupes sociaux.
Parce que nous tardons à assumer la responsabilité de la situation des villes palestiniennes du centre, nos mains sont tachées de sang. Oui, le temps est venu de se référer à ces villes dans les termes de leur propre géographie plutôt qu'en tant que "villes mixtes", comme elles sont largement connues, ce qui les maintient en marge de la conscience palestinienne. La criminalité s'est déjà étendue à d'autres régions. Et tandis que les camps laïques et religieux se tiennent par la gorge, ne reconnaissant pas la politique qui les divise en groupes éclatés, ne reconnaissant pas les nombreuses choses qui les maintiennent ensemble, les Palestiniens ne sont pas en mesure de faire face à leurs problèmes ensemble, le sang de nos jeunes femmes et de nos jeunes hommes continuera à se répandre dans les brèches béantes créées par la Nakba - jusqu'à ce que la tragédie devienne une comédie dépourvue de sens, sans ordre ni logique.
Dans ces réunions familiales consacrées à notre relation avec Dieu, chacun d'entre nous disposait d'un espace personnel où, pendant les derniers instants de la prière, nous nous inclinions et prononcions nos prières privées dans les chuchotements du cœur. En arrière-plan, la télévision égyptienne diffusait en sourdine de la musique classique ou contemporaine, les informations ou un film égyptien auquel on nous disait que nous pourrions revenir après les prières, pour continuer à regarder, les yeux rougis, sans cesser d'exprimer et d'échanger nos pensées. Souvent, nous ne voyions pas la fin du film : c'est à ce moment-là que nous devions vider le salon pour faire de la place aux visiteurs qui passaient furtivement, à tout moment de la journée, pour diriger leurs chuchotements vers mon père.
Dans notre petit appartement du troisième étage du 5, rue Midrash Pinchas, un jeune couple arrivait secrètement, une femme et un homme issus de classes sociales différentes, pour demander à mon père de convaincre leurs parents de la légitimité de leur amour ; une veuve qui avait besoin d'aide pour acheter des livres pour la nouvelle année scolaire de ses enfants ; un trafiquant de drogue - un criminel à l'âme torturée dont la mère défunte ne lui avait pas pardonné sa transgression - à qui mon père demandait maintenant de soutenir la famille de la veuve susmentionnée ; un mari qui s'était disputé avec sa femme et qui avait besoin de conseils sur la manière de l'apaiser - des requêtes quotidiennes de femmes et d'hommes à la recherche d'un cheikh alternatif à ceux des mosquées. Mon père partageait avec ses visiteurs son point de vue religieux, qui correspondait à ce qu'ils venaient entendre : parfois, les voies de Dieu sont mystérieuses et peu claires pour nos yeux ordinaires, mais il voit dans le cœur de chaque personne. Son amour pour ses créatures l'emporte sur l'amour de leur propre mère.
D'autres visiteurs : une travailleuse du sexe, à qui mon père a donné les vingt derniers shekels de notre famille ; un étudiant en philosophie perturbé qui est venu chercher un moyen de réconcilier ce qu'il apprenait à l'université avec les sentiments religieux dans lesquels il avait été élevé ; un ami imam qui est venu pour préparer ses sermons du vendredi à la mosquée ; des amis dans la cinquantaine qui voulaient apprendre à lire et à écrire pour pouvoir consulter le Qurʾān tout seuls ; et une longue série de connaissance qui sont simplement venus prendre une tasse de café et ont discuté avec lui de la politique et de la religion dans le monde arabe et du destin de l'islam.
Les adieux traditionnels et les bénédictions accompagnaient chacun d'entre eux à leur départ, prononcés de sa voix puissante qui faisait trembler les marches de l'ancien bâtiment dans lequel nous vivions. Ces rencontres enlevaient une lourde charge de la poitrine des visiteurs, donnant par la même occasion à mon père avec de nouvelles demandes à remplir. Lorsque le bruit de leurs pas disparaissait dans les méandres de la cage d'escalier, mon père entrait dans la chambre des enfants, le visage doux et radieux, pour déclarer que la voie était libre et que nous pouvions à nouveau nous réunir dans le salon.
Après minuit, lorsque nous étions tous allés nous coucher et que les coups à la porte de notre appartement se faisaient plus rares, il avait l'air le plus heureux. Il s'enfonçait dans son vieux fauteuil en soupirant, le Qurʾān d'un côté, une cruche de café et deux paquets de Rothmans Filter de l'’autre. Ils lui permettraient de tenir jusqu'au bout, alors qu'il commençait à corriger, à affiner et à ajouter des commentaires, des idées et des questions à son petit paquet de documents bien organisés.
Au fil des ans, mon père est devenu publiquement connu comme ustaz Hassan, un professeur d'arabe dans les écoles élémentaires. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a continué d'être l'unique muchtar de la ville, modérant les conflits communautaires. Moi, son aînée, je suis entrée dans l'adolescence et j'ai fait l’épreuve de crises de croyance régulière. Je me suis interrogée sur le sens de la justice divine face au flot constant de personnes défavorisées et misérables qui visitaient notre maison, ou j'ai été scandalisée par le fait que les aspirations et les besoins économiques de ma famille n'étaient pas pris en compte. Si les portes du paradis ne s'ouvraient pas à mes parents, peut-être n'étaient-elles qu'une histoire, une fiction, pour apaiser ceux qui étaient prêts à croire.
J'ai été éduquée dans le système scolaire arabe israélien public, où certains élèves allaient à l'école sans sandwich pour le déjeuner et abandonnaient l'idée d'essayer de déchiffrer l'alphabet arabe lorsqu'ils arrivaient au collège. C'est à ce moment-là qu'a commencé à naître en moi le désir d'entrer en contact avec des lecteurs de lettres arabes mieux lotis socialement. Au milieu des années 1990, les lycéens qui rentraient chez eux se croisaient dans la rue principale de Yafa. Je jetais des coups d'œil envieux aux filles des écoles privées comme le Collège des Frères (franco-catholique) et Tabeetha (Église d'Écosse), captivée par leur grâce et leur confiance en elles-mêmes alors qu'elles déambulaient dans la rue sans gêne aucune, dans leurs jeans Levi's authentiques, leurs chaussures Adidas et Nike, leurs cheveux lisses et clairs tombant abondamment sur leurs épaules ; enchantée par les sons de leur mélange de langues étrangères - le français et l'anglais.
Mes amies et moi, en revanche, avions des cheveux foncés et bouclés que nous ne savions pas arranger de manière flatteuse, alors nous tirions fermement sur notre cuir chevelu. Nos camarades de classe et nous-mêmes portions des vêtements amples pour cacher nos seins d'adolescentes, de faux jeans Levi's et des baskets Reebok. Nous nous précipitions dans la rue et rampions à travers les clôtures pour rentrer chez nous. Le français et l'anglais ne se fondaient pas dans notre jargon yafan, caractéristique de la plaine centrale du pays, qui passe facilement des deux langues locales, l'arabe et l'hébreu, et qui n'a pas d'attrait pour l'étranger. La plus rebelle de mes amies admirait Madonna et s’était teint les cheveux en blond. Mais Madonna n'a pas aidé mon amie à marcher plus gracieusement dans la rue. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir l'intention d'aller à l'université. J'ai réalisé qu'une éducation supérieure pourrait être l'occasion d'arrêter de regarder ces filles élégantes et modernes qui se coiffaient sans peine le matin, et de devenir moderne moi-même.
Au début de la seconde Intifada, en octobre 2000, j'ai commencé mes études de premier cycle à l'Université hébraïque de Jérusalem. Les étudiants palestiniens étaient absents des amphithéâtres et des salles de séminaire. Au lieu de cela, nous nous tenions à l'entrée principale du campus, protestant contre l'utilisation de balles réelles contre les manifestants palestiniens, qui avaient tué treize personnes, toutes des citoyens israéliens. Le visage blanc et pâle de l'une des étudiantes, tenant la photo de son frère adolescent mort, a été gravé dans la conscience de ma génération. Ces années ont été marquées par le bruit des sirènes et les effets des gaz lacrymogènes utilisés contre les manifestants, par les nouvelles sur Al-Qaïda et l'effondrement des tours jumelles à New York, par l'assassinat en 2001 de Rehavam Ze'evi, ministre israélien de la Défense, par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) à l'hôtel Hyatt, juste à côté des résidences étudiantes de l'université, le siège de Yasser ʿArafat à l'adresse Muqataʿa à Ramallah, qui a conduit à sa mort dramatique en 2004. Tels ont autant d'événements qui ont façonné le caractère et l'évolution de la personnalité d'une jeune étudiante palestinienne originaire de Yafa. Ce sont ces événements qui ont façonné le caractère et l'évolution d'un jeune étudiant palestinien de Yafa, ainsi que la propre transformation souvent douloureuse de sa subjectivité.
À l'époque, la plupart des étudiants palestiniens arrivaient d'endroits comme Nazareth, Haïfa, Kufur Qarʿ et Um al-Fahim dans des bus affrétés, et ils étaient rejoints par des étudiants de Yafa et de ses villes voisines, al-Lidd et Ramle, qui arrivaient par les transports publics, au compte-goutte, par leurs propres moyens, comme moi. Les activités culturelles et les relations interpersonnelles, comme l'amitié et l'amour, se sont développées en grande partie autour des opnions et affiliations politiques.
Sur le campus, il semblait y avoir trois groupes nationalistes palestiniens différents, dont l'un m'a semblé devoir être choisi et rejoint. Appelons le premier groupe les nationalistes religieux. Les nationalistes religieux, hommes et femmes, parcouraient les allées du campus aussi vite que possible. On n'entendait pas leur voix à la cafétéria, sur les pelouses ou dans les résidences universitaires. Lorsqu'ils organisaient des événements culturels, ils ne faisaient circuler l'information qu'entre eux. Ils dressaient autour d'eux des murs invisibles mais solides, empêchant de voir ce qui se passait à l'intérieur de leurs assemblés. À mon avis, il n’est pas clair si ces murs étaient choisis consciemment ou s'ils étaient des réactions involontaires. Parfois, il semblait que le manque de visibilité était le résultat d'une faiblesse, intellectuelle ou émotionnelle, le résultat de la difficulté à présenter leur point de vue de manière claire et confidente à la fois au sein de la communauté étudiante palestienne et de la majorité israélo-juive sur le campus. À d'autres moments, il semblait que leur retrait de tout et de tous ceux qui ne leur ressemblaient pas était un mécanisme de défense contre la distance sociale et les critiques qu'ils subissaient de la part d'autres groupes. Et en effet, cette critique qu'ils ressentaient n'était pas le produit de leur imagination la plus intime, une sorte d'illusion paranoïaque. De nombreuses personnes sur le campus ont perçu le nationalisme religieux comme une sorte de mutation que les religieux ont inventée en s'attelant au projet national arabe.
Un deuxième groupe, appelons-le nationalistes conservateurs, était beaucoup plus important que le groupe nationaliste religieux. Ses membres participaient à des manifestations, circulaient librement dans les couloirs des différentes facultés et organisaient des événements musicaux dans les dortoirs. Mais ils étaient passifs, voyant la réalité comme un donné naturel et statique qui ne permettait ni n'exigeait de changement. Loin de l'encadrement familial dans lequel ils sont nés et du regard de la société dans laquelle ils ont été éduqués, beaucoup d'étudiants nationalistes conservateurs, en particulier les jeunes femmes, ont vu un potentiel d'exercice des libertés individuelles. Pour la plupart d'entre eux, ce potentiel n'a pas été exploité. Les femmes avaient tendance à vivre dans le calme pour éviter les aventures indésirables liées à la drogue, à l'alcool et au sexe. L'exercice effectif de ces libertés aurait attiré l'attention et déclenché des rumeurs mettant en péril cette étroite fenêtre d’indépendance à l'université, qui, une fois le diplôme obtenu, se refermerait rapidement avec le retour à la maison et la recherche d'un partenaire.
Un troisième groupe, qu’on pourrait appeler les nationalistes laïques, a adopté des apparences occidentales. Ils me rappelaient les élèves des lycées de Frères et Tabeetha que j'enviais - élégants, occupant avec aisance les espaces communautaires, ne se cachant pas et ne cherchant pas à obtenir la permission des suzerains juifs. Les nationalistes laïques m'ont semblé plus vivants intellectuellement que les autres groupes. J'ai été séduite par l'éclat de leurs yeux qui brillaient d'indépendance et de liberté personnelle, ainsi que par leur engagement et leur détermination à changer la structure générale, sociale, économique et politique dans laquelle ils vivaient. Ils jouaient un rôle de premier plan dans les activités des cellules politiques du campus, participaient régulièrement aux manifestations au poste de contrôle de Qalandia, à l'entrée de Ramallah, et dans les cercles intellectuels radicaux de la ville, et passaient leurs soirées à parler de politique dans les bars. Ils n'étaient pas d'accord entre eux sur une orientation politique unique et se divisaient principalement entre socialistes et libéraux. Cependant, ils partageaient tous une perspective laïque détachée des chaînes de la tradition et ils remettaient en question toutes les normes, en particulier lorsqu'elles étaient religieuses.
C'est ainsi qu'à cette époque de ma vie, alors qu'il me semblait que je me devais d’appartenir à l’un de ces trois groupes, que le choix du groupe national à rejoindre s'est avéré intuitif et immédiat. Entre les étudiants religieux et fantomatiques qui se fermaient au monde, les conservateurs qui adhéraient aux règles toutes faites et n'avaient aucune volonté de changement, et les laïcs qui semblaient audacieux et révolutionnaires, j'ai opté pour ces derniers.
Et l’effet n'a pas tardé à se faire sentir. Pendant les années où je suis devenue une activiste nationaliste laïque sur le campus, les crises de foi que j'avais connues auparavant, à la maison, sont devenues plus fréquentes et ont mis plus de temps à s'estomper. Elles ont également pris un sens différent. Si, jusqu'à l'âge de 19 ans, l’arrière-plan de mes crises spirituelles était social et économique, dans ma nouvelle vie indépendante, elles ont pris des dimensions scientifiques, culturelles et politiques. Les relations jadis symbiotiques, à la fois spatiales et temporelles, entre ce monde terrestre et le royaume de Dieu, sont devenues tendues et marquées par l’inconciliabilité, exigeant une séparation et une dissociation rapides. Des brûlures sont apparues dans mon identité religieuse. La perturbation soudaine de mon rythme cosmique – ressentie en grande partie dans la prière de mon enfance – m'a fait mal aux bras et je me suis sentie soumise à une force que je ne pouvais ni identifier ni nommer et à laquelle je ne pouvais donc ni m'opposer, ni réagir.
Pour comprendre la sécularisation nationale que je me suis imposée, il faut examiner plusieurs configurations sociales d’importance. Pour certains laïcs palestiniens, la laïcité semblait faire partie d'un tissu complexe de relations implicites entre une existence bourgeoise plus laïque et plus aisée et une classe plus religieuse dans le centre et le sud du pays ; entre une classe patriotique éduquée et une classe ouvrière, illettrée et indifférente au sort d’al-watan, la patrie palestinienne ; entre l'esprit de progrès, le libéralisme et le féminisme et l’archaïsme de la tradition religieuse et patriarcale. L'appartenance à Yafa avait des implications claires dans ce contexte. Même si la ville est géographiquement située au centre du pays et est une source de fierté pour les résidents locaux et les réfugiés qui s’y sont dirigés, elle et ses habitants ont subi une provincialisation dans le tissu social intra-palestinien. Dans la conscience palestinienne générale du vingt-et-unième siècle, Yafa était considérée comme un vestige délabré de la société palestinienne, un lieu mal famé où régnaient la pauvreté, la criminalité et la drogue. Reflétant seulement une petite partie de ce qu’est Yaffa, ces perceptions ont engendré des préjugés et du dédain à l'égard de ses habitants, ainsi que des habitants plus pauvres et moins éduqués d'al-Lidd et de Ramle.
Mais la pauvreté, la criminalité et la drogue n'étaient pas une invention. Dans les années 1980, la première décennie de ma vie, les toxicomanes étaient monnaie courante dans les rues, de même que les dealers pour qui le mot ﺳﺠﻦ (sijn), prison, était devenu interchangeable avec le mot ﺩﺍﺭ (dār), maison. Depuis que je suis née - et cela n'a jamais cessé depuis -, je me souviens de tant de mères dont les fils ont été assassinés dans des guerres de gangs locaux. J'ai grandi en voyant des camarades de classe, des enfants ordinaires, calmes et discrets, se transformer en chefs de mafia professionnels. J'ai vu des personnes vivantes se transformer en cadavres, aboutir à l'institut médico-légal voisin et rester trop longtemps à la morgue ; des morts, le temps s'écoulant avec effroi tandis que les mères en deuil attendaient le dernier retour de leur fils à la maison ; l'arrivée des morts récents, enveloppés dans des draps blancs avec de l'ouate pour fermer tous les orifices. J'ai essayé de soutenir une sœur qui devait dire adieu à son frère, et je me souviens du nombre de personnes qu'il a fallu pour tenir son corps agité et frénétique afin que le médecin puisse lui administrer un tranquillisant ; les chuchotements sur les organes volés, prélevés sans l'autorisation des familles ; la longue file de femmes et d'hommes qui attendaient pour déposer un dernier baiser sur les joues froides ; le cercueil qui partait vers le cimetière, porté sur les épaules des hommes ; les femmes qui pleuraient leur propre perte imminente ; j'ai regardé les hommes assis sans rien faire dans la tente des pleureuses, leurs yeux reflétant des pensées de vengeance ; j'ai vu les feux d’artifice jubilatoires provenant des maisons des meurtriers. Et finalement, le muezzin annonçant le nom du défunt, ainsi que son appel à se joindre à la cérémonie funéraire et la récitation du Qurāʾn pour marquer le début de la période de deuil.
Cette partie sanglante de l'histoire de Yafa est réelle. Dans cette ville, le crime est une sorte de langage alternatif. Ce qui ne peut être exprimé par des mots se transforme en un acte violent commis par les mains. La jeune génération enfreint la loi pour ne plus avoir peur de la loi. Il n'y a pas de contradiction entre le fait que ces crimes soient dirigés contre eux-mêmes, contre ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭﻻﺩ (awlad al-balad), les enfants de la terre, la jeune génération, et qu'il s'agisse d'un cri contre la pauvreté, contre la marginalisation sociale, contre l'exclusion et la racisation causées par le régime israélien. Les tragédies grecques classiques, d'Œdipe roi de Sophocle au Médée d'Euripide, sont rejouées dans ces histoires, dans toute la région, dans la vie du Tunisien Muhammad Buʾazizi, qui s'est immolé en guise de protestation, déclenchant des vagues d'indignation massive dans le monde arabe. Le désespoir et l'auto-flagellation, nous le voyons, peuvent être interprété comme un langage d'opposition.
Mais cela ne change rien au fait que la réalité criminelle perpétuée depuis les années 1970 a affaibli les lumières de Yafa, la ville qui, pendant des milliers d'années, a servi de lieu de rencontre entre les civilisations anciennes et, plus récemment, de centre culturel et commercial de la région. D'une part, la tournure tragique du destin des habitants de la ville n'a pas modifié la perception nostalgique des Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et des Yafans qui ont été contraints à l'exil. De l’autre, pour la plupart des Palestiniens vivant sous le régime israélien, le passé de Yafa s'est transformé en un mythe qui ne confère ni honneur ni respect à sa population actuelle. La tragédie de la ville est parfois inconsidérément attribuée à la nature criminelle de ses habitants, les communautés palestiniennes d’autres villes et villages ignorant simplement la réalité sociohistorique et politique de sa configuration singulière. Dans ces autres communautés, il a été possible, à la suite de la Nakba, de maintenir une relative continuité - sur le plan social, économique, culturel et s’agissant des autorités politiques.
Une fille de Yafan qui pénétrait de son propre chef dans l'espace intellectuel et bourgeois, dans ce contexte d’image sociale et corrompue ; une fille qui, en plus d'utiliser la pensée théologique, disons, dans des discussions philosophiques, était forcément associée à un discours et à des pratiques rétrogrades considérés comme faisant obstacle aux aspirations palestiniennes, tant individuelles que collectives, à la libération de l'occupation et à un progrès éclairé. Dans certains cercles palestiniens, on m'a demandé, à moi et aux gens comme moi, de me séculariser. Il ne s'agissait pas d'un appel explicite. La sécularisation-nationalisation s'inscrivait dans un esprit général, ne se limitant pas à une langue, une grammaire ou un projet particulier. Mais elle utilisait des mécanismes tels que la manipulation psychologique et l'exclusion silencieuse, et s'appuyait sur une provincialisation intellectuelle de l'histoire islamique.
L'Islam - non seulement en tant que foi mais aussi en tant que civilisation d’importance - a été rejeté d'emblée par les gardiens du projet de nationalisation laïque. Ils ne considéraient pas la civilisation islamique comme un élément essentiel de l'histoire culturelle, comme une composante précieuse de l'appartenance, de l'identité et de la langue, comme une méthode pour la théorie et la critique. L'amoncellement de destructions et de ruines à la suite de deux guerres mondiales catastrophiques, la mise en évidence, notamment par les travaux d'Edward Said et la recherche postcoloniale dans les contextes israélien et palestinien, des affinités calamiteuses entre les Lumières, l'orientalisme et le colonialisme, n'ont pas, dans l'ensemble, suscité la méfiance. Aucune de ces critiques récentes n'a conduit à reconsidérer le le nationalisme sécularisé comme meilleure solution possible pour un avenir politique et culturel palestinien. Dans mes allées et venues entre la bibliothèque centrale de l'université sur le mont Scopus et la prestigieuse bibliothèque al-Shurūk de Ramallah - deux espaces géographiquement voisins divisés par une barrière nationale et séparés par la fumée et le béton - j'ai découvert le langage séculier-nationaliste qui passe tranquillement entre les deux villes, palestinienne et israélienne, libre et non entravé par les frontières.
C'est tout naturellement que, désireuse de devenir une femme progressiste et libre et espérant réaliser le rêve d'une Palestine libre, j'ai changé mon mode de vie. J'ai eu honte de ma foi en Dieu, j'ai rompu le lien qui unissait mon monde au sien et j'ai caché mon tapis de prière au fond de mon placard à la résidence universitaire. Je me suis séparée de Dieu, déconnectant mon corps de mon âme. La lumière s'est transformée en obscurité et l'obscurité en lumière - j'apparaissais puis disparaissais. Lorsque j'ai revêtu l'habit séculier, mes connaissances dans ma ville natale m'ont accusé de devenir ashkénaze, d'imiter la classe localement la plus privilégiée des Juifs européens. Parmi les Palestiniens conservateurs du campus, j'étais considérée comme une apostat ; dans les cercles laïques, j'étais perçue comme quelqu'un souffrant d'instabilité émotionnelle et comportementale. Mes pairs conservateurs et laïques étaient d'accord pour dire que cette fille devait vivre quelque chose de grave.
La rupture avec la religion s'est accompagnée d'une rupture avec la langue de ma ville. Indépendamment des différences idéologiques, et contrairement à ce à quoi j'étais habituée à Yafa, la plupart des étudiants que j'ai rencontrés sur le campus évitaient de mêler d'autres langues à leur discours. Ils parlaient l'arabe, rien que l'arabe. Cette performance monotone, fluide et riche renforçait ma fierté de l'arabité dans laquelle j'avais été élevée, mais était étrange pour l'oreille plus composite que j'avais développée, étrangère au yafan que je parlais - une troisième langue composée à la fois de l'arabe et de l’hébreu. Dans l'arabe de Jérusalem-Est, Ramallah et Bethléem, l'hébreu n'apparaît pas (à l'exception du vocabulaire utilisé aux points de contrôle militaires).
Dans ces villes palestiniennes, l'arabe n'était pas seulement une langue parlée. Il était manifeste sur les anciens bâtiments encore debout ; ses lettres ornaient les enseignes des ateliers de réparation de pneus, des boulangeries, des épiceries, des écoles, des centres culturels et des cliniques médicales. Sa voix résonnait dans l'air, rendant l'asphalte rugueux. Elle englobe tout. Mon premier contact avec cet arabe public m'a coupé le souffle. J'ai eu l'impression qu'un organe manquant, dont j'ignorais l'existence, était restitué à mon corps.
Selon certains Palestiniens, le langage des Yafans reflète un état d'esprit confus, ne crise d'identité permanente. Elle révèle la rupture du sentiment national et de l'appartenance de ses locuteurs. Certains affirment qu'elle témoigne d'une assimilation dans les rangs de la majorité israélo-sioniste, montrant même que nous sommes devenus une cinquième colonne au service des forces de l'occupation. Des jugements forts, extrêmes et sans pitié. Coupable de trahison. J’étais blessée, mais j’ai su en tirer les bonnes leçons. J'ai ouvert les yeux sur le danger d'extinction qui menaçait la langue arabe. J'ai compris à quel point il était essentiel de la préserver et j’ai répondu à l’appel, de mon plein gré, à me convertir à l'arabe pur. J'ai détaché l'arabe de l'hébreu avec lequel il s'était mélangé - un détachement qui, politiquement et culturellement, semblait approprié et juste. J'ai nettoyé ma bouche et j'ai adopté avec bonheur des mots en arabe dialectal que je ne connaissais jusqu'alors qu'en arabe littéraire, ou en hébreu.
Tout comme lorsque j'ai cessé de converser avec Dieu, ma conversion linguistique a laissé des traces. Lors de mes fréquentes visites de fin de semaine dans ma ville natale, ma nouvelle langue me valait parfois des points bonus : des patriotes locaux éduqués me tapaient dans le dos, étonnés de cette réussite impressionnante qu'ils étaient les seuls à pouvoir apprécier. Mais le prix à payer était parfois élevé. Pour une grande partie de la classe ouvrière et des petits commerçants, je suis devenu une étrangère lorsqu'ils ont cessé de m'identifier comme une locale à cause de l'hébreu qui avait disparu de mon arabe. Mon arabe pur me rendait plus palestinienne, mais, d'une certaine manière, moins yafane. Cette affaiblissement de mon identité locale yafane - qui m'a complètement surprise - a eu des implications importantes. Elle m'a permis d'oser reconsidérer le fil intuitif qui lie si mécaniquement l'appartenance collective et la langue pure, c'est-à-dire de poser des questions sur l'une des hypothèses les plus fondamentales du nationalisme en général et du nationalisme palestinien en particulier. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque j'ai nettoyé les taches de mes vêtements et que j'ai libéré de l'espace en moi pour comprendre les besoins quotidiens des gens, les besoins quotidiens de mes gens, que j'ai commencé à y réfléchir, à ma langue, à mon moi endommagé. D'abord, on nettoie l’impureté, puis on y réfléchit.
Repenser les relations enchevêtrées entre l'identité, l'objet d'appartenance et la langue m’a conduite à une nouvelle réflexion autour de la Nakba. J'ai commencé à me demander si le récit monolithique de la Nakba ne brouillait pas en fait les nuances et les parcours multiples des nombreuses Nakbas vécues par des gens différents dans toute la Palestine ; que tout cela avait eu tendance à former très rapidement un récit unique et fermé plutôt que de rester ouvert à une richesse d'histoires, d'événements et d’aspirations. De nombreuses rivières se jettent dans la grande mer, et elles ne serpentent pas dans les mêmes tours et détours.
La mienne est la troisième génération de la Nakba à Yafa, héritière naturelle d'un arbre qui s'est détaché de ses racines, laissant derrière lui un trou béant dans le sol. Les familles. Les commerçants. Les travailleurs. Les intellectuels. Le bruit a disparu et a laissé un vide. Le vide s'est rempli de blessures, et les blessures sont devenues tradition. Elles traversent le corps vivant, une croûte qui ne se referme pas, pour ne pas oublier. Il faut rester proche de la terre. Nous devons rester. Mais rester n'est pas facile. Et la mémoire n'est pas une scène romantique. Les plaies vivantes sont laides et s'enlaidissent avec le temps, de génération en génération, remplies de pus et dégageant la puanteur de la mort. Les morts ont besoin d'être enterrés, mais ces morts-là ne peuvent pas être enterrés. Et c'est dans le trou béant, révélé une fois les arbres coupés de leurs racines, que sont nés nos parents. Les poitrines auxquelles ils se sont accrochés n'ont pas produit de lait. Ils ont ouvert les yeux sur la poussière.
Et nous, ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻴﻞ (Gil al-mustakbal al-falastini), la génération de l’avenir palestinien, avons ouvert les yeux sur les Israéliens. Dans les hôpitaux, chez le coiffeur, dans les écoles, au centre communautaire, dans les parcs et chez l'épicier de la rue. Nous avons entendu leur hébreu et l'avons intégré à notre langue. Mais l'hébreu que nous parlons n'est pas celui de l'État israélien et il est différent de celui des Israéliens juifs. C'est, en quelque sorte, l'hébreu des Palestiniens. Il a une grammaire arabe, des erreurs d'écriture et d'orthographe, des connotations locales. Le yafan n'est ni de l'arabe pur, ni de l'hébreu correct. C'est précisément en cela qu'il sert de preuve orale de l'effacement de la population locale. Il marque la rupture coloniale en exposant le lien étroit entre la (non-)souveraineté culturelle et la (non-)souveraineté politique. Il démontre comment l'hébreu du souverain étrangle, écrase et exclut l'arabe, alors que de nombreux Yafans ont du mal à terminer ne serait-ce qu'une phrase en arabe sans recourir à l'hébreu pour exprimer un souhait, formuler une idée ou décrire un objet. Mais il remet également en question l'hébreu moderne en tant que langue monolithique du peuple juif, repousse ses limites et lui rappelle, littéralement, sa longue histoire de compagnonnage avec la civilisation arabe et islamique.
La langue de Yafa reflète également l'expérience de vie des Yafans aux côtés des Israéliens, qui a conduit les deux peuples à accepter non seulement qu'ils vivent au cœur du conflit, mais qu'ils peuvent en quelque sorte le gérer en fonction de leurs besoins et de leurs désirs propres. Le pouvoir de la routine, l’'instinct de la routine, est ce qui dirige le rythme de la vie dans les relations entre les deux groupes nationaux de la ville, et cela nécessite le déplacement des aiguilles de l'horloge vers l'avant ou vers l'arrière en fonction des développements en temps réel.
Naturellement, les fréquents bombardements de Gaza font reculer les mains, perturbent cette routine et la rendent plus difficile. Les destins de Gaza et de Yafa sont liés, car de nombreuses familles yafanaises, dont la mienne, vivent dans les camps de réfugiés de Gaza depuis qu'elles ont été contraintes à l'exil en 1948. Chaque bombardement de Gaza signifie un bombardement de Yafa, chaque soupir de soulagement des Gazaouis réjouit le cœur des Yafans.
La langue hybride des habitants palestiniens de la ville ne soulève pas seulement de nombreuses questions sur le lien entre une langue pure et le patriotisme, elle est également capable de bouleverser la logique. En raison de la Nakba particulière de Yafa - l'existence d'une minorité indigène qui a continué à vivre sur ses terres, détachée de son passé et incapable de s'associer au mode de vie des autres villages et villes palestiniens - la survie même de la langue arabe en tant que langue principale des jeunes de Yafa devrait à tout le moins susciter l'admiration. Elle est même honorable.
La langue yafan n'est certainement pas le simple produit du niveau notoirement bas de l'enseignement de l'arabe dans le médiocre système d'éducation publique arabe d'Israël. Outre le contexte susmentionné, la symbiose avec l'hébreu, la langue de la puissance dominante, peut être le résultat d'un choix inconscient de la part de la deuxième génération pour survivre au bouleversement de leur destin national au niveau de la langue également. En effet, ceux qui sont restés dans la ville avaient deux options : arracher la langue à ses racines, comme la plupart des habitants, ou la sauver, au prix d'un rattachement à la langue la plus forte, l'hébreu. L'histoire montre que nos parents, ces mêmes enfants qui sont nés dans le vide, et nous après eux, ont choisi de survivre. Ainsi, plutôt que de considérer la troisième langue, le yafan, comme un symbole d'assimilation à l'identité de l'autre, dont la langue domine la vôtre et la contrôle, j'en suis venue à la considérer comme une autre construction de l'identité, de l'évidence du libre choix à la nécessité sociale de la survie. De la sorte, le langage de Yafa ne reflète plus le rôle de victime mais devient une expression active de protestation, un corps qui tend la main sous les ruines de l'histoire.
En ce sens, si le régime israélien devait reconsidérer ses fondements et remplacer l'idéologie sioniste par une autre, basée sur l'appartenance commune à la terre et la justice pour les Palestiniens et les Juifs, alors la conversation en cours entre l'arabe et l'hébreu, plutôt que de simplement refléter la rupture induite par le colonialisme moderne, pourrait également servir à indiquer un avenir postcolonial. La réparation pour les deux nations ou la destruction des deux, ainsi que de leurs langues. Après tout, il n'y a pas de troisième option.
Aujourd'hui, malgré sa distance géographique au reste de la population palestinienne vivant sous le régime israélien, vous trouverez à Yafa des fractures qui parcourent toute la société palestinienne et bien au-delà, des fractures aussi profondes que le silence qui les entoure, entre ceux qui souscrivent à une vision du monde nationaliste religieuse et ceux qui choisissent une vision nationaliste laïque.
Une manifestation de cette tension peut être observée dans les foires du livre annuelles de Yafa. Lorsque les foires sont organisées par la partie religieuse, vous trouverez exposées les grandes exégèses canoniques du Qurʿan et la littérature des Hadiths, des manuels enseignant aux jeunes comment être de pieux musulmans, des livres illustrés pour enfants montrant la vie des prophètes, et des livres d'histoire, éventuellement une poignée de livres sur la philosophie islamique, dont tous s'accordent à dire qu'ils n'encouragent pas les doutes sur Dieu. En général, vous ne trouverez pas de fiction sur ces étals, qu'ils soient locaux ou transnationaux, car la littérature tend à être considérée comme une représentation séculière de la vie.
Un visiteur de la foire annuelle du livre organisée par un groupe laïc trouvera, en revanche, une multitude d'ouvrages sur l'histoire, la philosophie, des livres pédagogiques pour enfants, ainsi que de longues tables où s’empilent des livres de fiction. On y trouve rarement des livres sur l'histoire, la science, la politique ou l'économie islamiques, bien qu'il soit possible d'y trouver des livres critiquant la religion. Dans les deux foires, on trouvera invariablement quelques exemplaires d'ouvrages de développement personnel bon marché. Mais ces foires du livre annuelles peuvent être considérées comme un moyen sophistiqué et indirect de communication entre les deux populations, chacune essayant de prouver son raffinement culturel à elle-même et à l'autre, tout en renforçant son idéologie et sa routine quotidienne contre l'influence de l'autre.
Cette distance apparemment énorme et ce désaccord insoluble entre ces groupes ont des implications considérables pour le peuple palestinien dans son ensemble et deviennent particulièrement flagrantes lorsque Yafa organise des événements politiques. Les manifestations et les journées de commémoration à Yafa expriment le ressentiment local contre l'hostilité d'Israël à l'égard de la population palestinienne de la ville, avec ses tentatives incessantes de la déposséder de plus en plus de ce qui lui reste (par exemple, en transformant un ancien cimetière musulman en abri pour les pauvres ou une mosquée en musée). En même temps, ces événements collectifs nourrissent la compétition interne pour savoir qui est le plus patriote et le plus éclairé.
Lors de ces événements politiques, le groupe religieux, qui est toujours, sans exception, dirigé par un homme, clame "Allahu Akbar" et "Que la religion retrouve son aura perdue". Le sous-texte de ces slogans est que l'occupation israélienne est la preuve de la déviance de la société palestinienne par rapport à la religion et le message est qu'un retour à la religion apportera la libération (et le pardon de Dieu). Ces mots sont des insultes dirigées contre les parties laïques de la société, les rendant responsables de la situation calamiteuse. Pendant que cette manifestation se poursuit, son pendant laïque, souvent dirigé par une femme, commence ou se termine par l'hymne national palestinien, et les appels fréquents à la ﺣﺮﻳﺔ , la liberté, alternent entre des slogans pour l’émancipation de la terre et l'émancipation des femmes, avec un clin d'œil clair en direction du camp des hommes traditionnels, suggérant leur responsabilité historique dans la subjugation des femmes et ce que cela implique quant au destin et à la conquête de la terre.
Lorsque les deux groupes de manifestants se croiseront, les yeux de la femme laïque seront pleins de mépris à l'égard de l'homme religieux "arriéré" qui, en retour, dira silencieusement qu'elle est "dévergondée". Peut-être qu'une autre femme participant à la manifestation laïque relatera tranquillement que les agressions sexuelles qu'elle ne subit pas si rarement ne viennent pas de ces hommes religieux, mais plutôt de ces mêmes révolutionnaires laïques qui se tiennent juste derrière elle lors des manifestations et appellent à la liberté jour et nuit.
En général, cependant, les manifestations seront organisées à des jours différents et, si elles ont lieu le même jour et à la même heure, les groupes essaieront de maintenir une distance physique. Un groupe peut marcher derrière l'autre en veillant à ce que ni les mots ni les orateurs ne se mélangent. Paradoxalement, le souci mutuel de ne pas déranger l'autre facilite grandement la tâche de la police israélienne, qui peut alors disperser la foule pour "trouble à l'ordre public". Ce drame illustre de la manière la plus claire et la plus douloureuse qui soit que la question séculaire - qui sommes-nous, les Palestiniens ? - n'a pas été sérieusement traitée. Tant que les responsables religieux ne permettront pas que le texte religieux soit lu ici et maintenant, et tant qu'ils ne réaliseront pas la signification du verset "Il n'y a pas de contrainte en matière de foi", une telle réflexion ne pourra tout simplement pas avoir lieu. Une réflexion sérieuse sur l'identité des Palestiniens ne pourra avoir lieu tant que les dirigeants nationalistes laïques penseront que la tradition peut et doit être enterrée, que l'existence de longue date du religieux et du théologique dans l'appartenance sociale du peuple palestinien ne doit pas jouer un rôle significatif dans la planification de notre avenir.
De même que le "nous" théologique n'est exclusif à aucun groupe mais constitue un espace ouvert au mouvement et à l'interprétation, de même le "nous" moderne change de formes et de nuances parmi ceux qui sont religieux. Une jeune fille portant un short et des cheveux en bataille peut jeûner pendant le mois de Ramadan avec une grande sincérité, tout comme une jeune fille indépendante portant un voile peut nager dans l'océan et découvrir ses trésors. Le meilleur de l'homme, y compris la foi sincère en Dieu, n'est visible que pour Dieu, alors que le monde est ouvert à tous. Nous ferions mieux de nous abstenir d'interférer avec ce qui appartient à Dieu et de commencer, au contraire, à assumer la responsabilité de nos propres actions, que ce soit en tant qu'individus ou en tant que groupes sociaux.
Parce que nous tardons à assumer la responsabilité de la situation des villes palestiniennes du centre, nos mains sont tachées de sang. Oui, le temps est venu de se référer à ces villes dans les termes de leur propre géographie plutôt qu'en tant que "villes mixtes", comme elles sont largement connues, ce qui les maintient en marge de la conscience palestinienne. La criminalité s'est déjà étendue à d'autres régions. Et tandis que les camps laïques et religieux se tiennent par la gorge, ne reconnaissant pas la politique qui les divise en groupes éclatés, ne reconnaissant pas les nombreuses choses qui les maintiennent ensemble, les Palestiniens ne sont pas en mesure de faire face à leurs problèmes ensemble, le sang de nos jeunes femmes et de nos jeunes hommes continuera à se répandre dans les brèches béantes créées par la Nakba - jusqu'à ce que la tragédie devienne une comédie dépourvue de sens, sans ordre ni logique.

