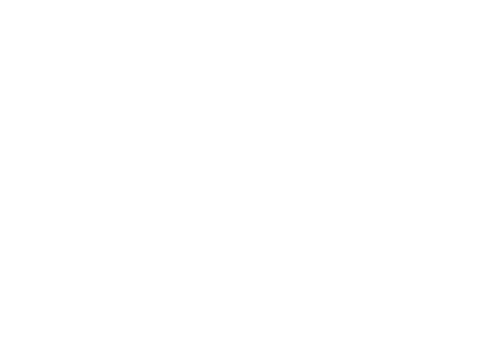
L'illustration utilisée est la couverture d'un album du groupe de musique belgo-marocain Ahl al Hijra (Les gens de l'exil).
Ce que l'immigration fait aux immigrés
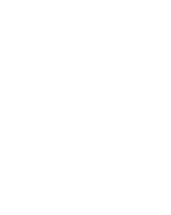
Montassir Sakhi
Cet article part d’une hypothèse initiale : en Europe, les débats tant profanes qu’académiques quant aux identités culturelles et religieuses dans l’espace de l’immigration postcoloniale ignorent systématiquement les problèmes vécus et les alternatives politiques proposées par les primo-arrivants. L’emphase collective sur l’immigration postcoloniale comme groupe social – en lien avec ce qui émerge comme la « question des banlieues » et que redouble le « problème musulman – a paradoxalement mené à un désintérêt de plus en plus marqué pour les migrants. Ceux-ci ont ainsi été amenés à constituer le reliquat de la communauté qui s’est établie en cité, tant en pratique que s’agissant du débat public.
Les étudiants et les néo-travailleurs immigrés auxquels s’intéresse cet article sont issus de pays du Maghreb dont est également originaire une importante partie de la communauté qui s’est reconstituée en banlieue au cours des dernières décennies. Cependant, tant l’hétérogénéité des expériences et des aspirations que la somme des non-dits et des malentendus historiques ne permettent que rarement l’intercompréhension. Bien souvent, les étudiants ou néo-travailleurs maghrébins vivent des situations d’anomie sociale, réticents ou incapables de rencontrer « la communauté », c’est-à-dire le groupe social constitué par les Français d’origine maghrébine issus de l’immigration postcoloniale et ouvrière en cité. En retour, ceux-ci n’incluent que rarement les immigrés plus récents dans leurs luttes et – plus généralement – dans leur compréhension de la société française.
Il s’agit ainsi d’interroger à nouveau frais l’expérience singulière de migrants marocains arrivés en France au cours des dernières années – en visant à comprendre les transformations de leur réflexivité, sur la société de départ comme sur celle d’arrivée. Loin de tout sociologisme indexant les pratiques et les pensées des gens aux structures et aux classements figés, il est question de comprendre l’immigration dite choisie à la suite du passage à une société post-industrielle[1]. Cette immigration « hors cité » est le plus souvent caractérisée par une forte individualisation – laquelle est constitutive des modes de participation à la société globale par ceux et celles qui en font l’expérience.
Au cours de l’enquête qui fonde mon propos, une vingtaine d’entretiens et d'observations longitudinales ont été conduits avec des immigrés marocains primo-arrivants résidant à Paris et sa banlieue proche. Tous – à une exception près – appartiennent à une immigration post-industrielle et post-Printemps arabe. Ces immigrés sont détenteurs de capitaux scolaires élevés et rencontrent lors de leur installation en Europe des difficultés majeures avec l’administration préfectorale – notamment à la fin de leur scolarité, à l'heure d’obtenir la carte de résidence qui leur permettrait de travailler. Plus généralement, la somme des souffrances liées aux interdictions de circulation et aux contraintes bureaucratiques pour des populations d’étudiants et de travailleurs isolés fonde une expérience singulière, qui communique ainsi largement avec leurs visions politiques. L’article qui suit – conçu comme une juxtaposition de cas – expose les récits de vie de certains parmi eux.
« Je connaissais les problèmes de la France, mais je ne m’attendais pas à ce qu’on m’enlève les papiers »
Achraf est aujourd’hui doctorant en biologie dans une université d’une grande ville de l’est de France. En 2014, alors âgé de 28 ans, il est arrivé en France pour faire des études. Ce Marocain fervent passionné de culture française reconnait que son arrivée en France était « plus pour y vivre définitivement que pour faire des études ». Il ajoute, « avant mon arrivée, j’avais le corps au pays, mais le cœur en France ».
J’ai rencontré Achraf lors des grandes manifestations du Mouvement du 20 février – c’est-à-dire le versant marocain de la séquence historique des révolutions arabes[2]. Fraîchement diplômé d’une licence scientifique, il avait fait face à l’absence des classes de master en arabe à l’université marocaine – ce qui revient en pratique à la fermeture de celle-ci aux candidats issus des classes populaires. La similarité de nos origines sociales s’est traduite par un positionnement en partage à l’heure des révolutions arabes ; nous nous y sommes tous deux engagés en y portant la problématique de la justice sociale. Achraf avait cependant la particularité – il est vrai commune au sein de l’espace militant du Mouvement du 20 février – de croire en la possibilité d’une alternative libérale – qu’il repérait ainsi dans la pratique démocratique des États européens. Sa francophilie était ainsi d’essence politique : la France, patrie des droits de l’Homme et de la révolution, était pour lui une puissante boussole morale et politique.
Plus tard, quand je me suis installé à Paris en 2012, le lien a persisté. Souhaitant immigrer à son tour en France, il a dû travailler en double journée pour rassembler la somme de 8500 euros requise par Campus France[3]-t-. Pendant trois années, Achraf a ainsi travaillé au sein d’une société française d’agroalimentaire récemment installée au Maroc. Malgré l’obtention d’une inscription à l’université française sur dossier, il a toutefois été recalé par deux fois par les services consulaires. Ce n’est qu’au bout de la troisième tentative qu’il obtient le visa "étudiant". Aussi, à mesure que s'accumulent les difficultés administratives, son sentiment envers la réalité « France » s'avère-t-il de plus en plus ambivalent : « Je peux comprendre qu’ils ne donnent pas le visa à tout le monde, mais dans mon cas qu’est-ce qui explique ce refus ? Le consulat ne donne aucun justificatif. Pourtant, j’ai trimé et rassemblé toutes les conditions. Je parle couramment français, j’ai une acceptation de plusieurs universités. Je ne comprends pas ce refus qui a duré plus de deux ans ».
En 2013, Achraf s’installe enfin en France. La difficulté d’une arrivée en France d’emblée heurtée est redoublée et – considérablement – approfondie lors des sept années suivantes. Il valide pourtant ses études, obtient son master et trouve un emploi au sein d’une agence de communication. Mais, fin 2014, à l’expiration de son visa obtenu de haute lutte, la carte de séjour qui lui permettrait de demeurer sur le territoire français lui est déniée. La préfecture de police de Paris lui indique ainsi que sa demande est refusée pour « absence de motifs de séjour ». Un mois après ce premier cataclysme dans sa vie, Achraf reçoit une OQTF – en même temps qu’une assignation à résidence indiquant que la police peut se présenter à tout moment à son domicile pour procéder à son expulsion. Sans papiers, Achraf perd son travail, son salaire et son allocation logement. Quand je l’ai rencontré après qu’il ait reçu l’OQTF, il n’était plus que l’ombre de lui-même. Le choc avait été si fracassant que tout son corps s’était comme gonflé. Je l’ai accompagné d’abord dans son hospitalisation et ensuite dans le long processus du recours judiciaire qui dure sept années. A l’issue de cette période et après inscription en doctorat, il obtient des papiers d’une durée inférieure à un an mais renouvelable.
Les entretiens réalisés avec Achraf sont postérieurs à cette longue phase faite de mélancolie et de persécution administrative. Chemin faisant, ses idées s’assombrissent et témoignent d’une défiance de plus en plus nette à l’égard des institutions politiques et de la possibilité d’une coexistence possible avec « les Français », que cela soit en France ou au Maroc s’il est amené à retourner par force dans son pays d’origine. L’interlocution avec Achraf prenant la forme d’échanges d’arguments au milieu du récit qu’il expose, l’absence de distance et le fait d’avoir partagé avec lui – comme avec d’autres personnes devenant des ami-e-s – les étapes de la lutte pour les papiers font que l’objectivation ethnographique se transforme en un témoignage vif sur un vécu par essence collectif :
« Comment veux-tu que je les regarde les français après toute cette histoire ? J’essaye bien sûr de faire la part des choses ; dire que la préfecture ce n’est pas tous les Français, que la justice, la police et les politiciens ne sont pas à l’image des gens qu’on rencontre. Mais quelque part, toute l’image que j’avais pendant des années au Maroc s’est effondrée aujourd’hui. Cela fait plus de sept ans que je n’ai pas la possibilité de rentrer chez moi, je vis clandestin avec la peur au ventre. Sans emploi et sans possibilité de payer le loyer. Maintenant que je viens d’avoir une carte de séjour je me retrouve poursuivi par la justice pour 30.000 euros de loyer non-payé, etc. ».
La condition de subalternité, imposée par la préfecture, condamne Achraf à la perte de ses propriétés tant matérielles que symboliques. Perdre son travail et son logement à la suite de la reformulation liberticide du droit est ainsi vécu comme une forme de déchéance imposée à soi. Le discours de l’assimilation et de l’intégration[4], qui ont longtemps été sans cesse martelés aux immigrés dans la sphère du débat politique, se heurte à la réalité des politiques migratoires telles que l’OQTF, les courts délais de validité des titres de séjour, la nécessité de son renouvellement permanent exposant l’immigré à une surveillance systématique, les refus des visas des ascendants et descendants des migrants installés depuis longue date (voire les parents et familles des naturalisés et binationaux), les longues files d’attente devant les préfectures ou l’absence de créneaux pour des rendez-vous de renouvellement ou de demande, etc. Chacune de ces situations mérite à elle seule un développement propre. Elles sont toutes expérimentées par Achraf. Vivre avec « la peur au ventre » dans cette situation de persécution administrative signifie la suite logique de la politique migratoire répressive guettant les migrants des anciennes colonies, c’est-à-dire ceux contraints par le système sélectif des visas :
« Pendant ces sept années et jusqu’à aujourd’hui tout tourne chez moi autour de la police : quand est-ce que je serai arrêté ? Est-ce qu’on m’emmènera au centre de rétention ? Est-ce que je serai refoulé directement du territoire ? A ces questions s’ajoutent d’autres encore plus angoissantes : et si un de mes parents vient à décéder ? D’ailleurs cette question du décès tourmente les dizaines de gens que j’ai rencontré et qui sont dans la même situation que moi… tu sais, à force, on ne finit par trainer qu’entre des gens n’ayant pas de papiers, c’est la seule manière pour s’entraider, trouver du travail au black, chercher des avocats qui t’enfoncent pas trop ou des asso qui peuvent aider. Plusieurs de ces amis que tu connais d’ailleurs ont perdu leurs grands-parents et parfois une mère ou un père sans pouvoir se rendre au pays pour l’enterrement ».
Empêcher la circulation va de pair avec l’indexation des droits fondamentaux (comme l’accès au travail et au logement) à la régularité des documents de séjour. Les personnes déchus du titre de séjour relèvent de ces groupes hétérogènes mais partageant l’invisibilité car situés entre l’immigration clandestine et l’immigration de l’installation (par le biais du regroupement familial ou le contrat de travail dans certains cas). Force est de constater que les conversions et transformations des idées collectives dans les milieux des migrants ne sont pas propres aux seuls groupes confrontés aux conditions d’installation difficiles, comme le cas des immigrés ouvriers et de leurs enfants. Les immigrés portés en Europe par l’élan d’un choix intellectuel, celui fondé sur des représentations culturelles variées (mode de vie occidental, libertés individuelles, liberté de pratique religieuse, etc.) trouvent dans le traitement sécuritaire préfectoral le fondement d’une expérience de répression collective qui ouvrent sur des nouveaux possibles politiques de contestation et de refus de l’hégémonie postcoloniale.
Ces immigrés, jusqu’alors fervents défenseurs du modèle occidental, découvrent qu’ils sont cantonnés dans une altérité extrême et indexée aux décisions arbitraires des politiques préfectorales. Celles-ci sont vécues comme une forme de racisme à travers la menace permantente de l'exclusion que fait planer une administration kafkaïenne. Aussi le « mensonge migratoire[5] » cède-t-il place à une pléthore d’attitudes critiques – voire contestataires : en creux, repli sur soi, perte de confiance dans les institutions étatiques, etc. De manière active, pour ceux et celles disposant du plus de capitaux culturels, l’expérience de l’exclusion administrative nourrit la requalification postcoloniale de la société française – ce qui aboutit en retour tant à la possibilité d'un néo-nationalisme anticolonial avec ses variants contemporains les plus violents.
« Je connaissais les problèmes de la France, mais je ne m’attendais pas à ce qu’on m’enlève les papiers. Avant de venir, je connaissais le problème des banlieues, j’écoutais le Rap et regardais des films comme « La haine ». Mais je ne croyais pas que l’État bafoue facilement des droits alors qu’on est dans les règles. Je ne savais pas qu’il peut sans raison détruire des vies. Je me disais que les problèmes des banlieues c’est compliqué, que c’était une mauvaise gestion d’une histoire de l’immigration. Mais maintenant je sais comment l’administration peut détruire les immigrés avant même qu’ils ne s’installent avec leurs enfants.
Avec ça, j’ai compris que je n’ai aucun autre pays hormis mon pays. Je le défendrai malgré tout. Malgré que c’est à cause de là-bas que je me suis retrouvé à mendier des papiers ici. Au moins là-bas personne ne te dit que t’es pas marocain. Ici, t’es pas chez toi. Les papiers te le rappellent tous les jours. Si je reviens chez moi un jour, quand ils finiront par me refouler d'ici, je ne raterai aucune occasion pour dire ma haine à la France. Je ne veux plus qu’ils aient leurs marchés et sociétés privées chez moi, je ne veux plus qu’ils continuent à venir sans visas et s’installer comme si le pays était une ferme et une colonie. Si c’est comme ça, il faut alors de l’égalité dans le traitement et dans l’inhospitalité ».
« C’est comme si on nous volait notre vie » !
Sami et Réda appartiennent à cette même catégorie introduite plus haut : celle d’immigrés tout à la fois hautement dotés en capital scolaire et incessamment renvoyés à la figure de « l’étranger ». Dans la matrice des récentes politiques publiques françaises, ils appartiennent de plein droit à « l’immigration choisie » plutôt que celle considérée comme « subie ». Les deux ont obtenu la nationalité française récemment ; cependant, cette sorte de consécration fantasmée ne met guère fin au sentiment d’injustice quant au traitement que leur réserve la société d’accueil. Celui-ci prend forme tant par le vécu du racisme en France – qui conduit l’un et l’autre à pointer l’inégalité de traitement qui leur est réservé au travail, pour la recherche de logement et plus généralement dans la variété des interaction sociales – que le refus systématique des autorisations de visite à leurs proches demeurés au Maroc.
Sami est ingénieur dans une grande entreprise des télécommunications. Formé au Maroc, il émigre en France après avoir été recruté par « un chasseur de têtes » venu chercher des ingénieurs à la sortie de leur formation. Il obtient la nationalité en 2021 après avoir travaillé dix années en France. Aujourd’hui il s’engage dans les campagnes électorales de la gauche en parallèle de son activisme auprès d’associations de lutte contre l’islamophobie.
« Après l’éblouissement lors de l’arrivée, j’ai compris qu’il fallait se tenir à carreau, avoir ses papiers, demander la nationalité et attendre sans trop faire de bruit. Après plusieurs années de travail, j’ai compris qu’on nous rappellera toujours à l’ordre nous les étrangers. C’est comme si on nous vole notre vie. T’as la préfecture et t’as ensuite les gens qui te dictent comment tu dois être et ce que tu dois faire. Le travail, payer les impôts et passer toute ta vie ici ne leur suffit pas (…).
Au travail, j’ai toujours eu des remarques comme « ici on ne fait pas ça » ou « ici, ce n'est pas comme chez vous ». Même quand j’ai obtenu la nationalité. Mais à la limite ce n’est pas ce qui me chagrine le plus. Ce n’est pas non plus le fait que jamais des étrangers comme moi n’ont eu accès à des postes de direction dans le travail. C’est surtout ma famille qui me chagrine le plus (…).
Évoquant son travail, Sami fait aussi référence dans son récit à la thèse de doctorat qu’il passe alors qu’il est en entreprise. Après six années de préparation de thèse, il souhaite postuler à un poste à l’université. L’espoir est rapidement dissipé : son supérieur hiérarchique au sein de l’entreprise où il travaille lui indique la difficulté constituée pour un immigré récemment naturalisé d’être recruté au sein du champ académique. En miroir, Sami comprend rapidement que « tu dois vraiment être blanc pour pouvoir enseigner, un Français blanc ». Il rajoute : « C’est moins une question de compétence qu’une question de langue, de manière d’être. J’ai demandé la qualification du CNU [nécessaire à l'obtention de postes de titulaires à l'université] à plusieurs reprises sans jamais l’avoir et sans aucune justification. En attendant, on nous prend nous les étrangers pour faire assistant d’enseignement et dispenser des TD, mais dans toute notre faculté il n’y a pas un seul prof titulaire qui soit un étranger ».
Mais le sentiment d’être face un plafond de verre demeurant infranchissable ne trouve pas son fondement dans la seule expérience du monde de travail. Celle-ci n’agit que comme la continuation d’un rappel à l’ordre qui trouve son lieu fondamental au sein de la vie sociale et familiale. La distanciation forcée avec les proches demeurés au Maroc – lesquels sont en pratique interdits de visite et de séjour en France – agit ainsi comme conditions première de l’expérience du racisme en France.
« Tu sais ce que c’est que le racisme dans mon cas et celui de plusieurs autres que je connais, c’est de ne pas pouvoir voir tes parents et tes proches près de toi à cause de cette merde de visa. Je suis maintenant naturalisé, ce qui ne veut pas dire être français car il y a toujours une différence même dans les formulaires qu'on nous demande de remplir pour chaque tâche administrative. Mais le pire c’est que tu te sens légitimement français, sans pour autant avoir le droit de rattacher ta famille à toi, à cause des frontières tracées par ce pays avec les autres pays pauvres comme le nôtre. Imagine, je suis français, j’ai des enfants français, je travaille et quand mes parents au Maroc ont fait la demande de visa pour venir voir leurs petits-enfants français, le consulat leur a refusé ça. Et cela à trois reprises. Maintenant, ma famille déteste le nom même de la France. Va leur expliquer que non ce ne sont pas tous les Français, que c’est l’administration qui est raciste (…). Nous avons tout déposé au consulat. Toutes les garanties, et nous avons payé trois fois tout type de frais. Mes parents sont retraités et ont une bonne condition économique. Dans la loi, être grand-parent d’un français tu as le droit de venir leur rendre visite, mais cette loi est bafouée. Des fois, je dis que cette nationalité ne me sert à rien. Elle m’a juste séparé de ma famille. Je connais plusieurs amis dans ce cas. On a obtenu la nationalité mais pour nous ce n’est qu’un document qui nous éloigne encore plus d’ici et de là-bas »
Que signifie une nationalité obtenue quand les visas séparent les enfants des parents et les grands-parents des petits-enfants ? Quel sens prend la transmission en un tel contexte ? Et, surtout, quels messages sont ainsi renvoyés aux enfants nés en France quant à la valeur des leurs ? Ces piétinements des droits qui concernent si intimement la vie elle-même, ne donnent pas chez les nouveaux immigrés économiques une simple soumission par opportunisme économique mais à l’inverse un sentiment accru de responsabilité. C’est ainsi que Sami s’engage dans des collectifs de lutte pour les régularisations des sans-papiers ainsi que dans des réseaux de défense des droits culturels et cultuels des musulmans.
« J’ai rejoint la marche pour la dignité en 2015 au moment où j’ai compris que je ne suis pas un citoyen reconnu à part entière malgré ma naturalisation. C’est contre les politiques des visas qui nous coupent de nos familles et contre les violances et lois qui s’attaquent à nos cultures dans ce pays que je me bats aujourd’hui ».
Réda, la réponse à la guerre des frontières par le néonationalisme
Mais cette forme de politique contestataire n’est pas la seule à être motivée par les lois hostiles à l’égard des immigrés – y compris les naturalisés d'entre eux. Par-delà le cas extrême d’attentats conduits par certains immigrés le plus souvent éloignés de toute radicalité religieuse mais ayant été confrontés aux dispositifs répressifs migratoires[6], d’autres réactions prennent forme par la dénonciation de l’Occident perçu comme hypocrite et indigne.
Réda, par exemple, réagit au refus de visa opposé à ses parents par une forme de néonationalisme marocain. Nous nous sommes connus en 2012 ; depuis lors, je n’ai eu de cesse d’observer les mutations de sa pensée politique. Comme s’agissant des cas précédents, l’éblouissement initial quant au développement économique et technique, aux formes civilisationnelles spécifiques à l’Occident et aux droits sociaux laisse la place à une critique acerbe découlant de la violence des dispositifs frontaliers.
« Mes parents avaient mis tous leurs économies dans l’école privée des ingénieurs au Maroc afin que je puisse avoir un diplôme. J’ai d’abord entamé un travail dans une société privée française installée à Marrakech. Les conditions de travail n’étaient pas terribles. Autant venir alors travailler en France. Je me suis marié à une Française et j’ai rapidement eu un contrat de travail indéterminé et me suis installé à Paris en 2008. Depuis, j’ai eu trois enfants. De 2008 à 2020 je devais chaque année renouveler mon titre de séjour ! Parfois je suis resté plusieurs mois sans papiers malgré mon CDI, mes enfants et le mariage. J’ai vécu les files d’attente interminables, je me suis levé à 3h du matin pour aller en préfecture, j’ai galéré pendant des jours et des mois pour trouver des créneaux disponibles sur des sites qui ne fonctionnent pas. Vous connaissez bien ces conditions. Mais le point de rupture avec la France c’est quand le consulat a refusé à plusieurs reprises de donner le visa à mes parents au Maroc. La France nous prend pour des esclaves. On doit travailler ici mais on a pas le droit d’accueillir nos parents. La misère du consulat c’est que tu n’as personne avec qui parler. Ils ont mis une société intermédiaire, qui te vole autant d’argent que le consulat, pour t’informer de la réponse. Quand tu veux rencontrer un responsable français là-bas, tu n’as que les murs. (…)
Après mon expérience ici, je sais mieux ce que c’est-que l’Europe et comment elle traite les migrants. Mais quand je veux retourner dans mon pays, je sais également que n’importe quel petit Français peut t’asservir là-bas aussi. Ils ont le plein pouvoir chez nous aussi, dans le marché de l’emploi. Je ne peux pas accepter de retourner chez moi et voir des directeurs européens nous asservir là-bas. Et surtout voir des européens aussi misérables soient-ils rentrer dans mon pays, moyennant leur simple passeport voire une simple carte d’identité. Sans aucune restriction alors que nous, nos parents, nos familles, même quand nous sommes naturalisés, n’ont pas le droit de venir. (…)
Je veux que mon pays lève la tête. Au moins comme l’Algérie qui a mis des visas aux Français et autres européens. Une politique pareille, contre ceux qui ferment la porte comme si on veut venir les piller ».
Au fil des années, Réda réaffirme ainsi l’idéal politique – et largement imaginaire – que représente le Maroc comme État-nation. Cette reconstruction a posteriori est tributaire tant de l’inscription en France dans des mouvances conspirationnistes expliquant le malheur migratoire par l’action de groupes occultes que d’un soutien de plus en plus affirmé à une forme d’anti-impérialisme de facture géopolitique – c’est-à-dire fondée sur l’affrontement de blocs conçus comme stables et étanches les uns aux autres. Cet engagement croissant trouve un écho de plus en plus puissant sur les réseaux sociaux – où une variété de groupes politiques au propos néonationalistes affirment la nécessité d’une politique de puissance menée par l’État marocain. Ces structures militantes – le plus souvent virtuelles – sont adossées à une requalification – voire d’une réinvention[7] racialisante des identités collectives au sein des sociétés d’origine.
S’agissant de Réda, le vécu migratoire s’y trouve comme sublimé. La réalité ordinaire des vexations opposées par la préfecture à ceux et celles qui s’installent en France est requalifiée en lutte géopolitique et millénaire entre nations concurrentes. Le néonationalisme agit ainsi comme une forme de surcompensation – où l’exclusion administrative est contrebalancée par la revendication identitaire ou, plus justement, contre-identitaire. Quoique tributaire de dynamiques politiques qui excèdent l’espace de l’immigration, la revendication néo-nationaliste est pourtant déliée pour les immigrés qui la portent de la possibilité d’une vie en pratique vécue au sein des sociétés d’origine. Réda est ainsi « marié à une Française », père d’enfants français et détenant un emploi qu’il ne peut quitter. L’impuissance extrême d’une exclusion intime – c’est-à-dire opérée par l’intime que représente la société d’accueil où la vie se déroule de facto – est ainsi consubstantielle du fantasme d’une appartenance autre – laquelle, manquant de toute attestation pratique, est réifiée sitôt énoncée.
« Ici, j’ai tout fait pour m’assimiler, mais on ne m’a jamais accepté »
« À l’époque, l’Europe était accessible sans besoin de visa. Mais il était difficile d’avoir un passeport au Maroc. Quand j’ai eu des contacts moyennant de l’argent à la wilaya (préfecture) de Casablanca, j’ai eu mon passeport. C’était un signe de liberté. J’ai voyagé dans plusieurs pays pour travailler mais j’ai décidé de rester en France dès 1972. Or, il n’y avait pas de stabilité des papiers. On entendait déjà qu’il va y avoir la fermeture des frontières et l'établissement du visa. Donc je ne pouvais pas revenir voir mes enfants au Maroc sans me dire que les frontières vont se fermer. A l’époque j’étais divorcée. Seul un nouveau mariage en France pouvait me régulariser ma situation. Quand je pense aux jeunes maghrébins qui galèrent ici sans papiers et qui n’ont aucun autre moyen que le mariage pour les avoir, je me dis que la situation n’a fait que s’empirer entre 1970 et 2021. Moi aussi j’ai accepté un mariage malgré moi, pour pouvoir continuer à travailler et ramener mes enfants restés au Maroc. J’ai subi les coups du mari pendant des années, et sa violence ne faisait que s’empirer à mon égard et contre mes enfants. Il fallait que je patiente jusqu’à avoir les papiers. Parce que même si j’avais réussi à ramener mes enfants par visa et les avoir inscrits à l’école alors qu’ils étaient sans papiers. J’étais engagée comme femme de ménage chez plusieurs familles, mais j’ai quand même dû attendre six années avant ma régularisation. Ensuite, c’est le goutte-à-goutte de l’administration et la longue galère des renouvellements. C’était pendant les années 1980 et 1990. Mais quand j’ai eu ma carte de séjour de 10 ans, mes proches me disaient qu’il faut demander la nationalité. J’ai refusé. Jamais je ne demanderai leur nationalité. A l’époque c’était mal vu de la demander leur nationalité. Je comprends que c’est pour réduire la galère des guichets, mais pour nous c’était ‘îb [une chose à la fois anormale et immorale]. Nous naissons marocains et nous mourrons marocains. (…).
Ici, j’ai pourtant tout fait pour m’assimiler, mais on ne m’a jamais accepté. J’ai bataillé pour ne jamais sortir du centre-ville de Lyon vers la banlieue. Je me suis levé pendant des années à 4h du matin pour aller faire le ménage avec mon fils de 12 ans dans les bureaux des sociétés. Je l’emmenais ensuite à l’école à 8h30 pour retourner au sein des maisons des familles continuer un travail qui termine tard le soir. C’était pour payer un loyer à Lyon-centre, la scolarité des enfants et un mari qui profite de ma situation de précarité des papiers. (…) La dernière fois, et à l’âge de 65 ans, j’ai dû attendre deux ans pour avoir ma carte de 10 renouvelée. J’ai cru qu’ils allaient me l’enlever. Pendant deux ans j’ai vécu avec des récépissés sans pouvoir sortir vers mon pays. (…).
Je ne te raconterais jamais assez des remarques que j’ai eues depuis que j’ai commencé à mettre un foulard sur ma tête, pourtant c’est un foulard léger qui laisse entrevoir mes cheveux. Quand un agent de Pôle Emploi m’a envoyé faire une formation à l’âge de 60 ans, un homme m’a reçu à la porte de sa boite : « Ne t’approche pas plus que ça ! Va enlever ce fichu avant de venir ». J’ai eu peur. Je n’ai jamais pu dire quoique ce soit. Plusieurs fois, devant des magasins, je me suis fait viré avec mes petits-enfants. La dernière fois, à peine j’ai mis les pieds dans un magasin « sortez madame, on ne vend plus rien, sortez on va fermer ». Dans mon travail, j’enlève le voile bien sûr, alors même qu’il s’agit de faire du ménage chez des familles. Mais malgré ça, j’ai toujours eu des remarques sur la religion, les musulmans, les immigrés ».
Ce que soulèvent les mots des immigrés confrontés à la violence des dispositifs de l’accueil prolonge les souffrances déjà vécues par la génération précédente de l'immigration postcoloniale. Les questions liées aux cartes de séjours, auxquelles vient s’ajouter le sentiment de l’exclusion par le refus de visa aux familles, y compris les parents et dans plusieurs cas les enfants, le durcissement des frontières et la précarisation des droits, font ainsi peser sur des immigrés pleinement insérés dans la société par le travail et la famille une menace aussi insidieuse qu’expérimentée par l’ensemble des « âges de l’émigration » (voir Sayad1977). Le retour sur la condition d’une grand-mère immigrée – mais demeurée hors cité – peut illustrer comment les politiques frontalières et migratoires impactent de manière continue la vie des immigrés, quelles que soient les périodes de leur installation dans le pays d’accueil, et cela tant les politiques à l’œuvre distinguent entre immigrés et nationaux.
Le dernier témoignage est celui de Mme Hamdaoui, qui est membre de ma famille. La restitution de sa trajectoire se fonde sur les souvenirs des retours lors des vacances d’été au Maroc – lesquels attendus par toute la famille élargie, en prévision des cadeaux que notre tante ne manquait pas de rassembler pour nous tout au long de l’année. Chaque période estivale voit ainsi sa voiture – augmentée d’une remorque – s’élancer suffisamment chargée pour n’oublier personne des familles de chacun des ses six frères et sœurs. Chaque maison reçoit au moins un sac garni d’habits, jouets, parfums, confiseries de Paris et d’autres souvenirs qui impriment à jamais la mémoire d'une France lointaine et inatteignable. Encore aujourd’hui, les cousins rencontrés peuvent témoigner de l’odeur du linge lavé à la « lessive de France ».
Mais ces doux souvenirs d’enfance doivent rapidement laisser place à leur envers, c’est-à-dire la réalité de la trajectoire de Mme Hamdaoui – redécouverte à la suite de ma propre immigration en France. Alors que nous partageons désormais des situations a priori similaires, le voile enchanté du mensonge migratoire est définitivement rompu. « La France a beaucoup changé » ne cesse de dire ma tante, comme pour protéger malgré tout le vestige glorieux d’une vie brisée par les années de dur labeur et d’exclusion. Mécanisme de défense contre le désespoir, la désillusion répétée depuis son installation au début des années 1970 fait appel à ces images de prospérité mélangées à la chaleur de l’été et des rassemblements familiaux au Maroc.
La réalité de sa vie en France est pourtant tout autre. Condamnée à la subalternité aussi bien pratique – ce que figure l’exploitation économique dont elle fait l’objet – que symbolique – attestée par la possibilité permanente de l’incident raciste –, le quotidien de Mme Hamdaoui est ainsi entièrement tendu vers la parenthèse représentée par ce qui est conçu comme le but paradoxal de l’émigration-immigration – soit le retour même éphémère au pays qui a été quitté. Cet écart de plus en plus marqué entre l’épreuve endurée et sa justification conduit ainsi à un véritable écartèlement subjectif. À l’heure d’un bilan biographique, la somme des vexations quotidiennes l’emporte très largement sur la contrepartie des sacrifices acceptés (l’émigration, le travail domestique, l’installation dans le centre de Lyon pour donner le maximum de chances à ses enfants etc.).
Force est pourtant de constater la faiblesse des pratiques contestataires des immigrés de cette génération précédente de l’immigration demeurée « hors cité ». Cette situation contribue à inscrire dans la perception publique la passivité des travailleurs migrants en provenance des couches populaires. Le plus souvent vus comme un danger ou comme des victimes, ils sont ainsi décrits par un énoncé largement partagé par la sociologie : « raser les murs ». Celui-ci ne prend pourtant en compte ni la pensée et les pratiques diverses des acteurs – y compris quand ceux-ci sont réputés à l’écart de toute pratique militante – ni les conditions structurelles qui les condamnent au silence. Mme Hamdaoui fait bel et bien état d’une tendance à l’invisibilité au sein d’une société qui ne cesse de la rejeter, acceptant ainsi l’éloignement de tout ce qui a rapport avec l’espace public et la politique nationale ou encore une tendance à accepter le bafouement des droits dans le travail et dans la vie privée. Il ne s’agit pourtant guère d’un calcul économique ; la perte des papiers et la nécessité de « se régulariser » était – et demeure – une épée suspendue au-dessus des immigrés avant même l’installation d’un système des visas et les formes de sélection « choisie ».
Conclusion
Que faire des réalités des immigrés qui n’appartiennent guère à « la communauté » qui s’est refondée en cité ? Cette problématique – déjà ardue – est redoublée par la distinction entre les formes culturelles et politiques qui prennent forme en l’un et l’autre cas. La situation d’anomie sociale de l’immigration « hors cité » (qu’elle soit à hauts capitaux scolaires ou non) produit des modes de participation au contemporain en radicale disjonction. Hypothèse est pourtant faite que l’explicitation tant des différences que des possibilités communes est cependant nécessaire à la construction d’alternatives politiques et sociales capables de répondre aux fracturations qu’induisent les politiques migratoires – et celles qui les prolongent s’agissant des enfants d’immigrés.
[1] Sylvain Lazarus. « Anthropologie ouvrière et enquêtes d'usine : état des lieux et problématique », Ethnologie française, vol. 31, no. 3, 2001, pp. 389-400.
[2] Montassir Sakhi & Hamza Esmili, « Comprendre et agir, pour une nouvelle lutte sociale », Revue Contretemps, Mai 2015
[3] Hugo Bréant et Hicham Jamid. « "Bienvenue en France"... aux riches étudiants étrangers », Plein droit, vol. 123, no. 4, 2019, pp. 11-14.
[4] Abdellali Hajjat, Les frontières de l’« identité nationale ». L’injonction à l’assimilation en France métropolitaine et coloniale, Paris, La Découverte, 2012
[5] Ce concept est forgé par Abdelmalek Sayad pour désigner un pan des discours des immigrés des anciennes colonies confrontés à la double contrainte : celle de la société d’origine soumise dominée par la puissance coloniale et celle de la société d’accueil où la réussite est corrélée aux efforts de l’intégration. Abdelmalek Sayad, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Le Seuil, 1999.
[6] Sur les attentats-suicides perpétrés par des migrants irréguliers passés par des centres de rétention, voir Wael Garnaoui, “Harga et désir d’Occident au temps du Jihad – Frontières et subjectivités migrantes des jeunes tunisiens”, thèse de doctorat en psychanalyse, (Dir) Thamy Ayouch, Paris Diderot, 2021.
[7] Un article à venir dans Conditions portera plus spécifiquement sur le mouvement moorish.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.

