
What al-Niffari said to Abdullah ? Dia al-Azzawi (1983)
La tempête du progrès.
Sur le développement, à partir d’un Projet àLahraouiyine
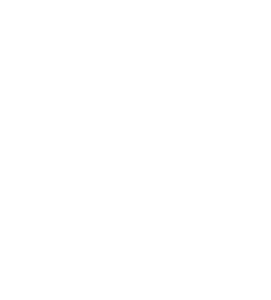
Hamza Esmili
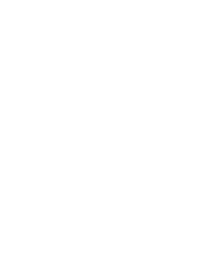
Paul Klee, Angelus Novus, 1920
Il existe un tableau de Klee qui s’intitule «Angelus Novus». Il représente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.
Walter Benjamin Sur le concept d’histoire, Thèse IX
Walter Benjamin Sur le concept d’histoire, Thèse IX
Ce texte, non publié auparavant, a été rédigé en 2018.
Partant de l’identification de la catégorie du développement à la « tempête que nous appelons le progrès », on se propose d’opérer un retour critique sur la thèse du retard. On le sait, dans le cas du monde arabo-islamique (Saïd 1978 [2005]), celle-ci relève aussi bien de la caractérisation historique (le déclin consécutif à l’âge d’or) que de la détermination économique par le décollage à venir - suivant la bien-connue théorie évolutionniste des étapes du développement (Rostow 1960). Aussi, si les études historiques contemporaines tendent à mettre en cause la thèse du déclin civilisationnel (Dallal 2018), on s’attache dans ce qui suit à la seconde partie de la définition du développement : celle qui, prenant appui sur l’analyse économique, indique un horizon d’attente global – aussi bien sur le plan subjectif que national.
Plus avant, s’agissant de ce dont le développementest le nom, on se propose de porter le regard sur le passage du « mauvais » au « bon » État. « Être développé » est alors moins un inéluctable processus historique (la « chaîne d’évènements » de Benjamin) qu’une forme de vie (Wittgenstein 2004 [1953]) caractérisée par le surcroît d’inscription dans l’ordre libéral et étatique. Dès lors, à l’appui de l’identification du développement à une forme de vie, il s’agira de prendre appui sur une enquête conduite dans le quartier de relogement de Lahraouiyine, en périphérie de Casablanca. Elle retrace le cas d’un développement qui, quoique « raté »[1], parvient néanmoins à rendre accessibles à la gestion territoriale d’État (Foucault 2004) les populations bidonvilloises (Esmili 2016).
Forme de vie et critique
Qu’est-ce qu’une forme de vie ? Sitôt formulée, la question se double d’une seconde, plus pressante : quelle est « notre » forme de vie ? Arrêtons-nous un instant au premier volet du problème, celui de la définition des formes de vie. Une des principales[2] occurrences de la notion nous vient de Wittgenstein, pour qui celle-ci est consubstantielle au langage – ce dernier est ainsi le « tourbillon de l’organisme que Wittgenstein appelle formes de vie » (Cavell 1969 p. 52). Autrement dit, la notion est ainsi moins culturelle ou sociale que biologique : la forme de vie (au singulier) est, selon Wittgenstein, le donné indépassable de l’expérience humaine (Laugier 2008).
Pour autant, c’est moins à l’auteur des Recherches philosophiques qu’à Theodor W. Adorno que l’on emprunte la notion. Dans Minima Moralia (dont le sous-titre est ainsi Réflexions sur la vie mutilée) ce dernier identifie le capitalisme à une forme de vie où « la vie ne vit pas ». Plus avant, Adorno propose une caractérisation du capitalisme fondée sur la phénoménologie du quotidien : c’est « l’amour fanatique des voitures » (MM, § 91), la « technicisation » (MM, § 19) ou, plus généralement, la formalisation et le détachement à l’égard de l’expérience vécue (MM, § 38) qui indiquent les contours de la critique ainsi formulée. On le voit alors, dans l’acception que lui donne Adorno, la notion de formes de vie est large : elle vise à mettre en lumière les « les puissances objectives qui déterminent l’existence individuelle jusque dans ses replis les plus secrets » (Adorno op.cit. p9), articulant ainsi la structuration de l’espace social à l’expérience intime du monde. Autrement dit, s’il n’est pas donné congé à l’analyse matérialiste, il s’agit bien du capitalisme en tant que mode d’aliénation du sujet, dans une visée éthique explicite (Jaeggi 2005), qui est ainsi rendu disponible à la critique. Rahel Jaeggi indique ainsi que « pour ceux qui, depuis Marx et avec lui, ont une vision critique de la société, le capitalisme n’apparaît pas seulement comme une société irrationnelle reposant sur l’exploitation, mais aussi comme une forme de vie qui, à bien des égards, est ratée. En critiquant l’aliénation, le jeune Marx s’attaque non seulement à la répartition de la richesse sociale qui va avec le mode de production capitaliste, mais également à la manière dont les individus qui mènent leur vie dans un cadre capitaliste se rapportent à eux-mêmes et au monde » (Jaeggi op.cit.).
La tâche est donc double : il s’agit tout d’abord de repérer ce qui, dans la séquence historique contemporaine, relève de la forme de vie par défaut, c’est-à-dire telle que celle-ci est configurée, tant sur le plan des subjectivités que sur celui du collectif, dans le cours des mécanismes du gouvernement moderne ; puis, identifier les lieux de « nouveaux modèles de subjectivité, de nouvelles formes d’expérience, de nouvelles formes de vie collective, de nouvelles expériences de vie » (Ferrarese et Laugier 2015).
S’agissant de la première partie du problème que l’on se donne alors – celle figurée par l’identification de la forme de vie relevant du gouvernement moderne –, on propose de s’arrêter un instant sur le processus de relogement (appelé istifada) de populations issues du plus ancien des bidonvilles de la ville[3] vers un quartier nouvellement édifié (le Projet) dans la commune rurale de Lahraouiyine. Ceux qui seront ainsi désormais nommés les moustafidin (« les bénéficiaires ») furent ainsi environ 50 000 à être déplacés du bidonville au Projet.
L’opération de relogement au Projet, quiparticipe pleinement du programme « Villes sans bidonvilles », doit son point de départ discursif aux attentats du 16 mai à Casablanca. En effet, si aucun des assaillants de 2003 n’était originaire des Carrières centrales, l’idée selon laquelle le bidonville est une forme de vie où est possible le passage à l’acte terroriste est ainsi devenue doxique dans le débat public, justifiant par suite les politiques visant à son « éradication » (le terme est émique). Plus avant, le lien entre la visée à l’éradication du bidonville et le développement en tant que catégorie politique est ainsi réalisé dans le programme « Villes sans bidonvilles » - dont le chef de l’État décrit ainsi la réalisation « Ce que nous visons, en définitive, ce n’est pas uniquement d’avoir des villes sans bidonvilles, ni d’y substituer des blocs de béton sans âme, réfractaires à toute sociabilité. Nous entendons, plutôt, ériger nos cités en espaces propices à la vie en bonne intelligence, dans la convivialité et la dignité, et en faire des pôles d’investissement et de production[4] » (nous soulignons).
Chronique d’un déplacement : l’istifada
Un bref résumé de la complexe opération peut être dit comme suit : dans une lointaine périphérie de l’espace social, un investisseur peu doté en capitaux (le moul chekara) se charge de construire un immeuble pour deux familles bidonvilloises et moins favorisées encore. Lorsque les ressources des uns et des autres se tarissent, le moul chekara perd son investissement tandis que le moustafid est forcé d’habiter son chantier-logement. Ainsi, la hiérarchisation symbolique du nouvel espace est en partie liée au degré d’avancement de l’immeuble non fini : au plus bas de laquelle se trouvent ainsi les maisons dites « décapotables », c’est-à-dire celles où même la façade n’a pas été construite, signifiant alors que les pièces des appartements peuvent être vues depuis l’extérieur ; sans électricité ni eau courante, infestés de rats, cibles faciles de potentiels cambrioleurs et susceptibles de s’écrouler à tout moment, ces immeubles sont malgré tout habités, parfois par des « squatteurs », le plus souvent encore par les moustafidin auxquels ils étaient destinés.
Une fois l’opération d’istifada aboutie, et quoique l’entièreté du processus de construction soit déléguée par la puissance publique au moul chekara, il revient à la charge du moustafid de demander à l’administration communale la reconnaissance de la conformité de son logement aux normes en vigueur, via l’octroi ou non d’un permis d’habiter – qui seul permet à son tour le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité. Cependant, l’immense complexité des normes à respecter, la quantité de documents demandés à une population issue de l’informalité du bidonville et l’état de délabrement précoce du quartier, tout concoure à marquer du sceau de l’impossible l’obtention de l’indispensable attestation. Alors, paradoxe au fondement du passage du bidonville au Projet, l’opération officiellement conçue pour mettre fin à la prolifération urbaine de « l’habitat illégal » se révèle en pratique un exil vers une autre informalité.
Dans ce contexte, même la corruption, pourtant recours habituel face aux complexités bureaucratiques, se révèle impossible - car directement corrélée à la difficulté pratique de l’obtention du document. L’aporie semble alors entière : la double contrainte financière empêchant d’un côté de mener les travaux permettant la conformité aux normes et de l’autre de verser la « tarifa » de la corruption rend ainsi impossible toute levée de l’obstacle. Nadia, ancienne habitante des Carrières Centrales relogée au Projet indique ainsi : « Moi ça fait cinq ans que j’habite ici mais je n’ai toujours pas le permis d’habiter. À chaque fois j’y vais [à l’administration communale de Lahraouiyine], à chaque fois ils me disent qu’il manque quelque chose, un papier, et chaque fois que je l’amène c’est un autre qui manque. Là, en ce moment, ils me disent que c’est parce que le rez-de-chaussée n’est pas aménagé, tu sais comme le moul chekara s’est enfuit… Mais tu sais comment est le Makhzen, tout ce qu’ils veulent c’est de l’argent. Pour le permis d’habiter, c’est la tarifa [tarif], tu veux l’avoir, tu payes c’est tout… Le prix c’est 5 000 dirhams, directement dans la poche du responsable à la commune. Et il faut aussi donner un peu à tous les techniciens qui passent pour vérifier l’immeuble. 50, 100, 200 dirhams, tout dépend de l’importance de celui qui vient »
L’écart entre bidonville et Projet est constitué dans la nature des relations qui s’établissent moustafidin et autorités locales dans l’un et l’autre cas : si les Carrières Centrales constituaient une zone de non-droit, c’est-à-dire un espace où l’administration publique y précarisait les habitants par la négation de leur existence, la nouvelle configuration du pouvoir à Lahraouiyineest celle d’une inclusion-exclusion, si bien que c’est précisément par l’insertion forcée dans un réseau de contraintes normatives qu’advient une nouvelle informalité – et, par suite, un resserrement de la contrainte administrative. Alors, en contraste avec la situation précédente des Carrières centrales, où la négation institutionnelle était incarnée physiquement par des campagnes punitives réprimant collectivement la vie bidonvilloise, les pouvoirs publicsn’agissent au Projet que par une normativité individualisée : la règle est fixe, mais la vérification de sa mise en œuvre est conduite au cas par cas – installant ainsi les moustafidin dans une durable et multiforme précarité.
De ce changement de paradigme administratif découle alors la seconde rupture au Projet avec la situation politique du bidonville ; par le fait même de la gestion par l’absence désormais promue par les services publics, le clientélisme électoral ne porte plus que sur des biens privés et individuels, une fois encore en contraste avec la configuration des Carrières Centrales où « la médiation des patrons électoraux transforme le groupe habitant en groupe politique, dont les membres partagent le même idéal du relogement, mais aussi le souci de préserver des biens (indivisibles) en commun » (Zaki 2005). En effet, le gain de finesse représenté par le changement de paradigme de gouvernement territorial lors du passage du bidonville au Projet ordonne également les échanges entre notables et population en situation d’anomie dont il faut « gagner la sympathie » par une série de faveurs strictement individuelles.
Aussi, c’est bien selon ce dernier modèle que se réagence la trame du pouvoir sous-tendant la sortie du bidonville. Au sein des Carrières centrales, l’État jouait un rôle directement discrétionnaire, excluant et réprimant par principe toute revendication collective émergeant parmi les habitants, tandis que l’intervention de notables communautaires était strictement cantonnée à une fonction de médiation. Après la translation au Projet, les pouvoirs publics se contentent de tresser une toile normative où les moustafidin sont comme pris au piège.
Effets de propriété
Le déplacement a la force de la simplicité. L’istifada est officiellement accomplie quand le moustafid est installé dans un appartement au Projet – et, en creux, lorsque le bidonville est ainsi éradiqué. Pourtant, ce dernier point – l’installation pratique dans un appartement du Projet de l’ancien ménage bidonvillois–, n’est que le plus superficiel des effets de l’istifada. En effet, par la translation du baraquement du bidonville à l’appartement du Projet, l’istifada a ainsi modifié le rapport même à la propriété des populations ciblées. Dès lors, plus que le passage physique de « l’espace ouvert du bidonville » (Le Tellier 2008) à ce qui serait l’exiguïté de l’appartement, bouleversement qui, au sein d’une certaine tradition de géographie de l’habitat[5], modifie en substance la forme de vie qui s’y développe (Bourdieu 1992) ; c’est bien la transformation de la propriété collective, mouvante et éphémèrement durable, telle que pratiquée au bidonville (Chesnais et Le Bras 1976), en une autre, individuelle, limitée par la force de la loi et stable dans l’informalité qui s’atteste à travers l’istifada.
Ainsi translatée, la forme de vie bidonvilloise est à l’évidence radicalement modifiée ; une distribution nouvelle de ce qui relève du privé et du public se donne alors à voir. Aux Carrières Centrales, « la proximité physique [de la communauté des voisins] qu’elle ménageait et une précarité qui, socialement, pouvait s’extérioriser sans procès ni stigmatisation à l’intérieur du bidonville, jouent un rôle fondamental au niveau de la sociabilité et des formes qu’elle revêt » (Arrif 1992). Autrement dit, la complicité ainsi constituée au bidonville était d’abord d’ordre pratique. On affrontait la précarité propre à l’existence marginale par le truchement d’une réaffiliation opérée in situ : mariages, alliances et naissances s’agrégeaient autour d’un noyau de parenté matériellement élargi par la construction de baraquement en cercles concentriques. Dès lors, au sein du groupe ainsi structuré, les enfants des uns sont, au moins en partie, les enfants de tous et il est fréquent que les configurations familiales formant foyers ne soient pas construites sur le rapport parents-enfants mais sur ceux des oncles/tantes-neveu/nièce, grands-parents-petits-enfants[6] etc. À l’inverse, l’istifada a opéré par l’attribution d’un lotissement au Projet à la stricte famille nucléaire ; aussi, cette matrice normative a-t-elle considérablement favorisé ceux, rares parmi les bidonvillois, qui en adoptaient déjà les contours – et au détriment mécanique de tous les autres.
Surcroît d’ordre bureaucratique, délimitation plus stricte de la propriété et valorisation de la famille nucléaire ; s’il s’agit bien un régime nouveau de marginalité urbaine, plus étatisé que ne l’était le bidonville, le Projet ne porte jamais si bien son nom qu’en tant qu’il est que le lieu d’une ingénierie sociale agissant sur la nature même de la vie. On peut aller alors plus loin : la forme de vie qui résulte de la sortie des Carrières centrales n’est à l’évidence pas en rupture avec les transformations globales affectant le reste des points d’application de la gestion territoriale moderne. Si le surcroît d’inscription au sein de l’ordre étatique est ainsi plus visible dans le cours du processus de relogement qu’ailleurs, il apparait ainsi que la raison en est moins l’exceptionnalité de l’arrivée que celle du point de départ : autrement dit, c’est moins la forme de vie ayant court au Projet qui est en rupture que celle du bidonville qui a ainsi été quittée.
La translation du bidonville au Projet – et l’éradication du premier -est parachevée en 2015. Aussi, quoiqu’il s’agisse ici de l’État issu des indépendances, « tout se passe comme si le colonisateur retrouvait d’instinct la loi ethnologique qui veut que la réorganisation de l’habitat, projection symbolique des structures les plus fondamentales de la culture, entraîne une transformation généralisée du système culturel[7] ». S’il ne s’agit guère de l’instinct relevé par Bourdieu et Sayad, l’effacement des solidarités collectives par l’État postcolonial est bel et bien un clair indicateur de sa faillite.
ADORNO Theodor W. 1951 [2003]. Minima Moralia : réflexions sur la vie mutilée, Payot, Paris
AGAMBEN Giorgio. 2013. De la très haute pauvreté. Rivages, Paris
ARRIF Abdelmajid. 1992. Le passage précaire. Anthropologie appliquée d’une mutation résidentielle. Le cas de Hay Moulay Rachid à Casablanca, Thèse de doctorat soutenue à l’Université Aix-Marseille 1
BOURDIEU Pierre. 1993. Effets de lieu, in Pierre Bourdieu (dir.), 1993, La misère du monde, Le Seuil, Paris
CHESNAIS Jean-Claude et LE BRAS Hervé. 1976. Villes et bidonvilles du Tiers Monde. Structures démographiques et habitat, pp. 1207-1231
DALLAL, S. Ahmed. 2018. Islam without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought. Chapel Hill: The University of North Carolina Press
ESMILI Hamza. 2016. D’une marginalité à l’autre. Mémoire de master 2 de sociologie, École normale supérieure de Paris
ESMILI Hamza. 2018. « Faire communauté. Politique, charisme et religion au sein du Hirak du Rif », Revue Tumultes, n°50
FERRARESE, Estelle, et LAUGIER Sandra. 2015. « Politique des formes de vie », Raisons politiques, vol. 57, no. 1, pp. 5-12
FOUCAULT Michel. 2004. Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Hautes Études, Paris
FOUCAULT Michel. 2001. Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard,, pp. 1041-1062
Jaeggi, Rahel. 2005. Une critique des formes de vie est-elle possible ? Le négativisme éthique d'Adorno dans Minima Moralia. Traduit de l'allemand par Aurélien Berlan, Actuel Marx, vol. 38, no. 2, pp. 135-158
LAUGIER Sandra. 2008. Règles, formes de vie et relativisme chez Wittgenstein, Noesis, 14 , 41-80
LAZARUS Sylvain. 1996. Anthropologie du nom, Seuil, Paris
LE TELLIER Julien. 2008. À la marge des marges urbaines : les derniers bidonvilles de Tanger (Maroc). Logique gestionnaire et fonctionnement des bidonvilles à travers les actions de résorption, Autrepart 1/2008 (n° 45), p. 157-171
MAHE Yvonne. 1936. L’extension des villes indigènes au Maroc, Thèse de droit, Université de Bordeaux
MANNHEIM Karl. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, Maison Sciences de l’Homme, Paris
ROSTOW Walt Whitman. 1960. The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto, Cambridge: Cambridge University Press
SAÏD Edward. 1978 [2005]. L'Orientalisme : L'Orient créé par l'Occident, Seuil, Paris
TROIN Jean-François. 1985. La ville arabe et le géographe. Analyse des approches des géographes français et des géographes arabes françisants URBAMA, Tours
WITTGENSTEIN Ludwig. 2004 [1953]. Recherches Philosophiques, Paris: Gallimard
ZAKI Lamia. 2005. Pratiques politiques au bidonville, Casablanca (2000-2005), Thèse de doctorat soutenue à l’Institut d’études politiques de Paris
[1] On entend par là que le relogement des populations du Karyane central de Casablanca vers Lahraouiyine n’a en aucun cas abouti à la résorption de la marginalité dans laquelle elles évoluent.
[2] Souvent assimilée à la théologie franciscaine, la notion de formes de vie (forma vitae) a des occurrences plus anciennes.
Voir Agamben 2013
[3] Les premiers baraquements datent ainsi de la fondation de la ville de Casablanca, en 1912, et la première mention attestée du bidonville date de 1930.
Voir Mahé 1936 : « Mais je crois bien qu’il [bidonville] est né en Afrique du Nord et probablement au Maroc. Je ne serais même pas étonné que ce soit à Casablanca, où il supplanta le mot “gadoueville”, attesté vers 1930, mais qui n’eut pas de succès ».
[4] Mohammed VI, Discours en date du 12 décembre 2006
[5] Citons ainsi ces lignes de Jean-François Troin, dressant un état des lieux de la géographie française de la ville arabe : « dans le domaine du bâti, les études sur l’habitat, sa typologie, sa répartition, son évolution dominent assez largement. Il s’agit d’études assez « systématiques ». (…) Peut-être faut-il relier cette spécificité des recherches à l’insuffisance pratique de la langue arabe par les géographes français, présents au Machrek ? L’étude de l’habitat permettait de décortiquer la ville sans trop pénétrer dans sa société et ses moteurs. »
[6] La possibilité de foyers alternatifs à la famille nucléaire est renforcée au bidonville par la précarité existentielle qu’implique l’appartenance à la marge de l’espace social.
Partant de l’identification de la catégorie du développement à la « tempête que nous appelons le progrès », on se propose d’opérer un retour critique sur la thèse du retard. On le sait, dans le cas du monde arabo-islamique (Saïd 1978 [2005]), celle-ci relève aussi bien de la caractérisation historique (le déclin consécutif à l’âge d’or) que de la détermination économique par le décollage à venir - suivant la bien-connue théorie évolutionniste des étapes du développement (Rostow 1960). Aussi, si les études historiques contemporaines tendent à mettre en cause la thèse du déclin civilisationnel (Dallal 2018), on s’attache dans ce qui suit à la seconde partie de la définition du développement : celle qui, prenant appui sur l’analyse économique, indique un horizon d’attente global – aussi bien sur le plan subjectif que national.
Plus avant, s’agissant de ce dont le développementest le nom, on se propose de porter le regard sur le passage du « mauvais » au « bon » État. « Être développé » est alors moins un inéluctable processus historique (la « chaîne d’évènements » de Benjamin) qu’une forme de vie (Wittgenstein 2004 [1953]) caractérisée par le surcroît d’inscription dans l’ordre libéral et étatique. Dès lors, à l’appui de l’identification du développement à une forme de vie, il s’agira de prendre appui sur une enquête conduite dans le quartier de relogement de Lahraouiyine, en périphérie de Casablanca. Elle retrace le cas d’un développement qui, quoique « raté »[1], parvient néanmoins à rendre accessibles à la gestion territoriale d’État (Foucault 2004) les populations bidonvilloises (Esmili 2016).
Forme de vie et critique
Qu’est-ce qu’une forme de vie ? Sitôt formulée, la question se double d’une seconde, plus pressante : quelle est « notre » forme de vie ? Arrêtons-nous un instant au premier volet du problème, celui de la définition des formes de vie. Une des principales[2] occurrences de la notion nous vient de Wittgenstein, pour qui celle-ci est consubstantielle au langage – ce dernier est ainsi le « tourbillon de l’organisme que Wittgenstein appelle formes de vie » (Cavell 1969 p. 52). Autrement dit, la notion est ainsi moins culturelle ou sociale que biologique : la forme de vie (au singulier) est, selon Wittgenstein, le donné indépassable de l’expérience humaine (Laugier 2008).
Pour autant, c’est moins à l’auteur des Recherches philosophiques qu’à Theodor W. Adorno que l’on emprunte la notion. Dans Minima Moralia (dont le sous-titre est ainsi Réflexions sur la vie mutilée) ce dernier identifie le capitalisme à une forme de vie où « la vie ne vit pas ». Plus avant, Adorno propose une caractérisation du capitalisme fondée sur la phénoménologie du quotidien : c’est « l’amour fanatique des voitures » (MM, § 91), la « technicisation » (MM, § 19) ou, plus généralement, la formalisation et le détachement à l’égard de l’expérience vécue (MM, § 38) qui indiquent les contours de la critique ainsi formulée. On le voit alors, dans l’acception que lui donne Adorno, la notion de formes de vie est large : elle vise à mettre en lumière les « les puissances objectives qui déterminent l’existence individuelle jusque dans ses replis les plus secrets » (Adorno op.cit. p9), articulant ainsi la structuration de l’espace social à l’expérience intime du monde. Autrement dit, s’il n’est pas donné congé à l’analyse matérialiste, il s’agit bien du capitalisme en tant que mode d’aliénation du sujet, dans une visée éthique explicite (Jaeggi 2005), qui est ainsi rendu disponible à la critique. Rahel Jaeggi indique ainsi que « pour ceux qui, depuis Marx et avec lui, ont une vision critique de la société, le capitalisme n’apparaît pas seulement comme une société irrationnelle reposant sur l’exploitation, mais aussi comme une forme de vie qui, à bien des égards, est ratée. En critiquant l’aliénation, le jeune Marx s’attaque non seulement à la répartition de la richesse sociale qui va avec le mode de production capitaliste, mais également à la manière dont les individus qui mènent leur vie dans un cadre capitaliste se rapportent à eux-mêmes et au monde » (Jaeggi op.cit.).
La tâche est donc double : il s’agit tout d’abord de repérer ce qui, dans la séquence historique contemporaine, relève de la forme de vie par défaut, c’est-à-dire telle que celle-ci est configurée, tant sur le plan des subjectivités que sur celui du collectif, dans le cours des mécanismes du gouvernement moderne ; puis, identifier les lieux de « nouveaux modèles de subjectivité, de nouvelles formes d’expérience, de nouvelles formes de vie collective, de nouvelles expériences de vie » (Ferrarese et Laugier 2015).
S’agissant de la première partie du problème que l’on se donne alors – celle figurée par l’identification de la forme de vie relevant du gouvernement moderne –, on propose de s’arrêter un instant sur le processus de relogement (appelé istifada) de populations issues du plus ancien des bidonvilles de la ville[3] vers un quartier nouvellement édifié (le Projet) dans la commune rurale de Lahraouiyine. Ceux qui seront ainsi désormais nommés les moustafidin (« les bénéficiaires ») furent ainsi environ 50 000 à être déplacés du bidonville au Projet.
L’opération de relogement au Projet, quiparticipe pleinement du programme « Villes sans bidonvilles », doit son point de départ discursif aux attentats du 16 mai à Casablanca. En effet, si aucun des assaillants de 2003 n’était originaire des Carrières centrales, l’idée selon laquelle le bidonville est une forme de vie où est possible le passage à l’acte terroriste est ainsi devenue doxique dans le débat public, justifiant par suite les politiques visant à son « éradication » (le terme est émique). Plus avant, le lien entre la visée à l’éradication du bidonville et le développement en tant que catégorie politique est ainsi réalisé dans le programme « Villes sans bidonvilles » - dont le chef de l’État décrit ainsi la réalisation « Ce que nous visons, en définitive, ce n’est pas uniquement d’avoir des villes sans bidonvilles, ni d’y substituer des blocs de béton sans âme, réfractaires à toute sociabilité. Nous entendons, plutôt, ériger nos cités en espaces propices à la vie en bonne intelligence, dans la convivialité et la dignité, et en faire des pôles d’investissement et de production[4] » (nous soulignons).
Chronique d’un déplacement : l’istifada
Un bref résumé de la complexe opération peut être dit comme suit : dans une lointaine périphérie de l’espace social, un investisseur peu doté en capitaux (le moul chekara) se charge de construire un immeuble pour deux familles bidonvilloises et moins favorisées encore. Lorsque les ressources des uns et des autres se tarissent, le moul chekara perd son investissement tandis que le moustafid est forcé d’habiter son chantier-logement. Ainsi, la hiérarchisation symbolique du nouvel espace est en partie liée au degré d’avancement de l’immeuble non fini : au plus bas de laquelle se trouvent ainsi les maisons dites « décapotables », c’est-à-dire celles où même la façade n’a pas été construite, signifiant alors que les pièces des appartements peuvent être vues depuis l’extérieur ; sans électricité ni eau courante, infestés de rats, cibles faciles de potentiels cambrioleurs et susceptibles de s’écrouler à tout moment, ces immeubles sont malgré tout habités, parfois par des « squatteurs », le plus souvent encore par les moustafidin auxquels ils étaient destinés.
Une fois l’opération d’istifada aboutie, et quoique l’entièreté du processus de construction soit déléguée par la puissance publique au moul chekara, il revient à la charge du moustafid de demander à l’administration communale la reconnaissance de la conformité de son logement aux normes en vigueur, via l’octroi ou non d’un permis d’habiter – qui seul permet à son tour le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité. Cependant, l’immense complexité des normes à respecter, la quantité de documents demandés à une population issue de l’informalité du bidonville et l’état de délabrement précoce du quartier, tout concoure à marquer du sceau de l’impossible l’obtention de l’indispensable attestation. Alors, paradoxe au fondement du passage du bidonville au Projet, l’opération officiellement conçue pour mettre fin à la prolifération urbaine de « l’habitat illégal » se révèle en pratique un exil vers une autre informalité.
Dans ce contexte, même la corruption, pourtant recours habituel face aux complexités bureaucratiques, se révèle impossible - car directement corrélée à la difficulté pratique de l’obtention du document. L’aporie semble alors entière : la double contrainte financière empêchant d’un côté de mener les travaux permettant la conformité aux normes et de l’autre de verser la « tarifa » de la corruption rend ainsi impossible toute levée de l’obstacle. Nadia, ancienne habitante des Carrières Centrales relogée au Projet indique ainsi : « Moi ça fait cinq ans que j’habite ici mais je n’ai toujours pas le permis d’habiter. À chaque fois j’y vais [à l’administration communale de Lahraouiyine], à chaque fois ils me disent qu’il manque quelque chose, un papier, et chaque fois que je l’amène c’est un autre qui manque. Là, en ce moment, ils me disent que c’est parce que le rez-de-chaussée n’est pas aménagé, tu sais comme le moul chekara s’est enfuit… Mais tu sais comment est le Makhzen, tout ce qu’ils veulent c’est de l’argent. Pour le permis d’habiter, c’est la tarifa [tarif], tu veux l’avoir, tu payes c’est tout… Le prix c’est 5 000 dirhams, directement dans la poche du responsable à la commune. Et il faut aussi donner un peu à tous les techniciens qui passent pour vérifier l’immeuble. 50, 100, 200 dirhams, tout dépend de l’importance de celui qui vient »
L’écart entre bidonville et Projet est constitué dans la nature des relations qui s’établissent moustafidin et autorités locales dans l’un et l’autre cas : si les Carrières Centrales constituaient une zone de non-droit, c’est-à-dire un espace où l’administration publique y précarisait les habitants par la négation de leur existence, la nouvelle configuration du pouvoir à Lahraouiyineest celle d’une inclusion-exclusion, si bien que c’est précisément par l’insertion forcée dans un réseau de contraintes normatives qu’advient une nouvelle informalité – et, par suite, un resserrement de la contrainte administrative. Alors, en contraste avec la situation précédente des Carrières centrales, où la négation institutionnelle était incarnée physiquement par des campagnes punitives réprimant collectivement la vie bidonvilloise, les pouvoirs publicsn’agissent au Projet que par une normativité individualisée : la règle est fixe, mais la vérification de sa mise en œuvre est conduite au cas par cas – installant ainsi les moustafidin dans une durable et multiforme précarité.
De ce changement de paradigme administratif découle alors la seconde rupture au Projet avec la situation politique du bidonville ; par le fait même de la gestion par l’absence désormais promue par les services publics, le clientélisme électoral ne porte plus que sur des biens privés et individuels, une fois encore en contraste avec la configuration des Carrières Centrales où « la médiation des patrons électoraux transforme le groupe habitant en groupe politique, dont les membres partagent le même idéal du relogement, mais aussi le souci de préserver des biens (indivisibles) en commun » (Zaki 2005). En effet, le gain de finesse représenté par le changement de paradigme de gouvernement territorial lors du passage du bidonville au Projet ordonne également les échanges entre notables et population en situation d’anomie dont il faut « gagner la sympathie » par une série de faveurs strictement individuelles.
Aussi, c’est bien selon ce dernier modèle que se réagence la trame du pouvoir sous-tendant la sortie du bidonville. Au sein des Carrières centrales, l’État jouait un rôle directement discrétionnaire, excluant et réprimant par principe toute revendication collective émergeant parmi les habitants, tandis que l’intervention de notables communautaires était strictement cantonnée à une fonction de médiation. Après la translation au Projet, les pouvoirs publics se contentent de tresser une toile normative où les moustafidin sont comme pris au piège.
Effets de propriété
Le déplacement a la force de la simplicité. L’istifada est officiellement accomplie quand le moustafid est installé dans un appartement au Projet – et, en creux, lorsque le bidonville est ainsi éradiqué. Pourtant, ce dernier point – l’installation pratique dans un appartement du Projet de l’ancien ménage bidonvillois–, n’est que le plus superficiel des effets de l’istifada. En effet, par la translation du baraquement du bidonville à l’appartement du Projet, l’istifada a ainsi modifié le rapport même à la propriété des populations ciblées. Dès lors, plus que le passage physique de « l’espace ouvert du bidonville » (Le Tellier 2008) à ce qui serait l’exiguïté de l’appartement, bouleversement qui, au sein d’une certaine tradition de géographie de l’habitat[5], modifie en substance la forme de vie qui s’y développe (Bourdieu 1992) ; c’est bien la transformation de la propriété collective, mouvante et éphémèrement durable, telle que pratiquée au bidonville (Chesnais et Le Bras 1976), en une autre, individuelle, limitée par la force de la loi et stable dans l’informalité qui s’atteste à travers l’istifada.
Ainsi translatée, la forme de vie bidonvilloise est à l’évidence radicalement modifiée ; une distribution nouvelle de ce qui relève du privé et du public se donne alors à voir. Aux Carrières Centrales, « la proximité physique [de la communauté des voisins] qu’elle ménageait et une précarité qui, socialement, pouvait s’extérioriser sans procès ni stigmatisation à l’intérieur du bidonville, jouent un rôle fondamental au niveau de la sociabilité et des formes qu’elle revêt » (Arrif 1992). Autrement dit, la complicité ainsi constituée au bidonville était d’abord d’ordre pratique. On affrontait la précarité propre à l’existence marginale par le truchement d’une réaffiliation opérée in situ : mariages, alliances et naissances s’agrégeaient autour d’un noyau de parenté matériellement élargi par la construction de baraquement en cercles concentriques. Dès lors, au sein du groupe ainsi structuré, les enfants des uns sont, au moins en partie, les enfants de tous et il est fréquent que les configurations familiales formant foyers ne soient pas construites sur le rapport parents-enfants mais sur ceux des oncles/tantes-neveu/nièce, grands-parents-petits-enfants[6] etc. À l’inverse, l’istifada a opéré par l’attribution d’un lotissement au Projet à la stricte famille nucléaire ; aussi, cette matrice normative a-t-elle considérablement favorisé ceux, rares parmi les bidonvillois, qui en adoptaient déjà les contours – et au détriment mécanique de tous les autres.
Surcroît d’ordre bureaucratique, délimitation plus stricte de la propriété et valorisation de la famille nucléaire ; s’il s’agit bien un régime nouveau de marginalité urbaine, plus étatisé que ne l’était le bidonville, le Projet ne porte jamais si bien son nom qu’en tant qu’il est que le lieu d’une ingénierie sociale agissant sur la nature même de la vie. On peut aller alors plus loin : la forme de vie qui résulte de la sortie des Carrières centrales n’est à l’évidence pas en rupture avec les transformations globales affectant le reste des points d’application de la gestion territoriale moderne. Si le surcroît d’inscription au sein de l’ordre étatique est ainsi plus visible dans le cours du processus de relogement qu’ailleurs, il apparait ainsi que la raison en est moins l’exceptionnalité de l’arrivée que celle du point de départ : autrement dit, c’est moins la forme de vie ayant court au Projet qui est en rupture que celle du bidonville qui a ainsi été quittée.
La translation du bidonville au Projet – et l’éradication du premier -est parachevée en 2015. Aussi, quoiqu’il s’agisse ici de l’État issu des indépendances, « tout se passe comme si le colonisateur retrouvait d’instinct la loi ethnologique qui veut que la réorganisation de l’habitat, projection symbolique des structures les plus fondamentales de la culture, entraîne une transformation généralisée du système culturel[7] ». S’il ne s’agit guère de l’instinct relevé par Bourdieu et Sayad, l’effacement des solidarités collectives par l’État postcolonial est bel et bien un clair indicateur de sa faillite.
ADORNO Theodor W. 1951 [2003]. Minima Moralia : réflexions sur la vie mutilée, Payot, Paris
AGAMBEN Giorgio. 2013. De la très haute pauvreté. Rivages, Paris
ARRIF Abdelmajid. 1992. Le passage précaire. Anthropologie appliquée d’une mutation résidentielle. Le cas de Hay Moulay Rachid à Casablanca, Thèse de doctorat soutenue à l’Université Aix-Marseille 1
BOURDIEU Pierre. 1993. Effets de lieu, in Pierre Bourdieu (dir.), 1993, La misère du monde, Le Seuil, Paris
CHESNAIS Jean-Claude et LE BRAS Hervé. 1976. Villes et bidonvilles du Tiers Monde. Structures démographiques et habitat, pp. 1207-1231
DALLAL, S. Ahmed. 2018. Islam without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought. Chapel Hill: The University of North Carolina Press
ESMILI Hamza. 2016. D’une marginalité à l’autre. Mémoire de master 2 de sociologie, École normale supérieure de Paris
ESMILI Hamza. 2018. « Faire communauté. Politique, charisme et religion au sein du Hirak du Rif », Revue Tumultes, n°50
FERRARESE, Estelle, et LAUGIER Sandra. 2015. « Politique des formes de vie », Raisons politiques, vol. 57, no. 1, pp. 5-12
FOUCAULT Michel. 2004. Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Hautes Études, Paris
FOUCAULT Michel. 2001. Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard,, pp. 1041-1062
Jaeggi, Rahel. 2005. Une critique des formes de vie est-elle possible ? Le négativisme éthique d'Adorno dans Minima Moralia. Traduit de l'allemand par Aurélien Berlan, Actuel Marx, vol. 38, no. 2, pp. 135-158
LAUGIER Sandra. 2008. Règles, formes de vie et relativisme chez Wittgenstein, Noesis, 14 , 41-80
LAZARUS Sylvain. 1996. Anthropologie du nom, Seuil, Paris
LE TELLIER Julien. 2008. À la marge des marges urbaines : les derniers bidonvilles de Tanger (Maroc). Logique gestionnaire et fonctionnement des bidonvilles à travers les actions de résorption, Autrepart 1/2008 (n° 45), p. 157-171
MAHE Yvonne. 1936. L’extension des villes indigènes au Maroc, Thèse de droit, Université de Bordeaux
MANNHEIM Karl. 2006 [1929]. Idéologie et utopie, Maison Sciences de l’Homme, Paris
ROSTOW Walt Whitman. 1960. The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto, Cambridge: Cambridge University Press
SAÏD Edward. 1978 [2005]. L'Orientalisme : L'Orient créé par l'Occident, Seuil, Paris
TROIN Jean-François. 1985. La ville arabe et le géographe. Analyse des approches des géographes français et des géographes arabes françisants URBAMA, Tours
WITTGENSTEIN Ludwig. 2004 [1953]. Recherches Philosophiques, Paris: Gallimard
ZAKI Lamia. 2005. Pratiques politiques au bidonville, Casablanca (2000-2005), Thèse de doctorat soutenue à l’Institut d’études politiques de Paris
[1] On entend par là que le relogement des populations du Karyane central de Casablanca vers Lahraouiyine n’a en aucun cas abouti à la résorption de la marginalité dans laquelle elles évoluent.
[2] Souvent assimilée à la théologie franciscaine, la notion de formes de vie (forma vitae) a des occurrences plus anciennes.
Voir Agamben 2013
[3] Les premiers baraquements datent ainsi de la fondation de la ville de Casablanca, en 1912, et la première mention attestée du bidonville date de 1930.
Voir Mahé 1936 : « Mais je crois bien qu’il [bidonville] est né en Afrique du Nord et probablement au Maroc. Je ne serais même pas étonné que ce soit à Casablanca, où il supplanta le mot “gadoueville”, attesté vers 1930, mais qui n’eut pas de succès ».
[4] Mohammed VI, Discours en date du 12 décembre 2006
[5] Citons ainsi ces lignes de Jean-François Troin, dressant un état des lieux de la géographie française de la ville arabe : « dans le domaine du bâti, les études sur l’habitat, sa typologie, sa répartition, son évolution dominent assez largement. Il s’agit d’études assez « systématiques ». (…) Peut-être faut-il relier cette spécificité des recherches à l’insuffisance pratique de la langue arabe par les géographes français, présents au Machrek ? L’étude de l’habitat permettait de décortiquer la ville sans trop pénétrer dans sa société et ses moteurs. »
[6] La possibilité de foyers alternatifs à la famille nucléaire est renforcée au bidonville par la précarité existentielle qu’implique l’appartenance à la marge de l’espace social.
[7] BOURDIEU, P., SAYAD, A. 1964. Le Déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, Paris : Les Éditions de Minuit,

